Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Lorenzaccio, d’Alfred de Musset au programme de terminale L
Édition établie par Simon Jeune
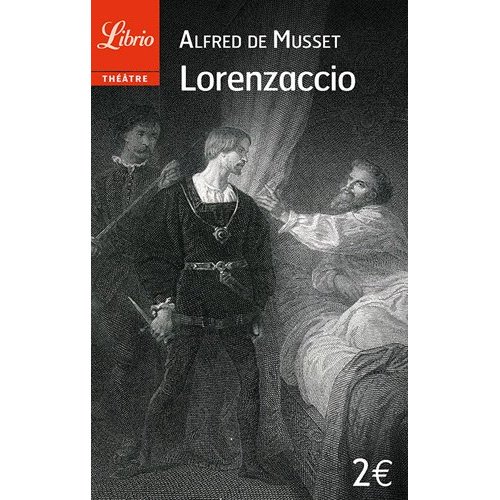 Lorenzaccio, d’Alfred de Musset au programme de terminale L
Lorenzaccio, d’Alfred de Musset au programme de terminale L
Bibliothèque de la Pléiade, 1990 (1834), 1368 p., 60 €
samedi 22 septembre 2012, par
Cette série d’articles sur Musset est dédiée à mon oncle Jean-Pierre Labosse (1949-2012).
La nouvelle mouture du programme de Terminale littéraire est inaugurée en 2012-2013. Deux heures d’enseignement au lieu de quatre ; deux œuvres au lieu de quatre (qui changeront par moitié tous les ans) ; avec cela une durée d’épreuve et un coefficient au bac inchangé (4). Cherchez l’erreur ! Nos honorables collègues profs de langue y gagnent deux heures d’enseignement de « littérature étrangère » en langue seconde, c’est-à-dire en petits effectifs, avec un coefficient 1 et une épreuve orale vite fait, bien fait ! Comme d’habitude, on surcharge la barque des profs de français, déjà la plus plombée de toutes les matières. On colle à des élèves qui ont souffert en première avec six heures d’enseignement pour un coefficient de 3 + 2, deux heures pour un coeff 4 ! Bref, assez râlé [1], je m’y colle cette année, avec enthousiasme, puisque nous avons déjà en stock un article sur Zazie dans le métro de Raymond Queneau, et nouveauté en janvier 2014, cet article sur Paul Éluard. Quant à Alfred de Musset, c’est un vieux pote, mais j’avais négligé de lire ses pièces systématiquement, et en ai vu fort peu sur scène. Ce sera si j’ai le courage l’occasion de tout relire, poésie, théâtre et proses. Commençons par Lorenzaccio, avant de nous attaquer aux quatre pièces de jeunesse antérieures, puis aux pièces postérieures. Et en prime, un article sur Alfred de Musset, ainsi que mon cours en deux parties sur Le Théâtre romantique. Que demande le peuple ! Ben, tiens, en 2013, ciliegia sulla pasticceria, voilà un ultime article intitulé « À Florence (et à Rome), sur les traces de Lorenzaccio ».
Qu’est-ce que Lorenzaccio sinon l’histoire — révérence gardée — d’une « tarlouze », avec ce diminutif méprisant « -accio », d’un « mignon », qui se venge avec son épée phallique sur celui qui l’a humilié en le traitant de « castrataccio » ? S’il était en 1833 trop tôt (ou trop tard, si on lit Édouard II, de Christopher Marlowe) pour être explicite sur une scène de théâtre au sujet de l’homosexualité, c’est l’un des intérêts d’un objet d’étude axé sur « lire-écrire-publier » de fouiller la vase de la censure et de l’autocensure qui entoure ce chef d’œuvre d’un jeune auteur de 23 ans altersexuel avant la lettre. Entre Zazie et Lorenzaccio, cette année les « hormosessuels » sont au programme ! On verra cependant grâce à nos autres articles combien cette œuvre de jeunesse est une exception dans l’œuvre mussétienne. La pièce de vieillesse Carmosine, commencée un an après Lorenzaccio, mais jouée quinze ans après, sonne clairement comme un repentir d’un auteur qui a très vite choisi le parti de l’Ordre.
Qu’est-ce que Lorenzaccio sinon l’histoire — révérence gardée — d’une « tarlouze », avec ce diminutif méprisant « -accio », d’un « mignon », qui se venge avec son épée phallique sur celui qui l’a humilié en le traitant de « castrataccio » ? S’il était en 1833 trop tôt (ou trop tard, si on lit Édouard II, de Christopher Marlowe) pour être explicite sur une scène de théâtre au sujet de l’homosexualité, c’est l’un des intérêts d’un objet d’étude axé sur « lire-écrire-publier » de fouiller la vase de la censure et de l’autocensure qui entoure ce chef d’œuvre d’un jeune auteur de 23 ans altersexuel avant la lettre. Entre Zazie et Lorenzaccio, cette année les « hormosessuels » sont au programme ! On verra cependant grâce à nos autres articles combien cette œuvre de jeunesse est une exception dans l’œuvre mussétienne. La pièce de vieillesse Carmosine, commencée un an après Lorenzaccio, mais jouée quinze ans après, sonne clairement comme un repentir d’un auteur qui a très vite choisi le parti de l’Ordre.
Plan
La version de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre
L’Apologie de Lorenzino de Médicis
Les sources de Lorenzaccio
Lorenzino, la pièce d’Alexandre Dumas (1842)
Lorenzaccio : un personnage homosexuel crypté
Acte Premier
Acte II
Acte II
Acte III
Acte IV
Acte V
La version de l’Heptaméron de Marguerite de Navarre
Nous devons la première mention en français de l’histoire de Lorenzino de Médicis à Marguerite de Navarre (1492-1549), dans la douzième nouvelle de son Heptaméron, écrite à la fin de sa vie, juste avant la mort de Lorenzo (assassiné en 1548). Cette version n’est pas du tout mentionnée dans le volume de la Pléiade, et il ne semble pas que Musset l’ait connue, en tout cas elle n’est pas à considérer comme une source ; peut-être a-t-elle inspiré en partie George Sand. C’est la chronique d’une affaire de mœurs, d’une vengeance personnelle, dont les motivations politiques ne sont pas trop développées par la sœur de François Ier, même si la nouvelle commence par annoncer : « Et ainsi, delivrant sa patrie d’un tel tyran, sauva sa vie et l’honneur de sa maison ». Pour la suite, c’est un peu Gala : « Depuis dix ans en ça, en la ville de Florence, y avoit un duc de la maison de Medicis, lequel avoit espousé madame Marguerite, fille bastarde de l’Empereur. Et, pour ce qu’elle estoit encores si jeune, qu’il ne luy estoit licite de coucher avecq elle, actendant son aage plus meur, la traicta fort doulcement ; car, pour l’espargner, fut amoureux de quelques autres dames de la ville que la nuict il alloit veoir, tandis que sa femme dormoit ». « Amoureux de quelques autres dames de la ville que la nuict il alloit veoir », cela ne manque pas de sel ! Nous dirions aujourd’hui — révérence gardée — qu’il strausskahnisait à couilles rabattues ! Bref, une phrase résume le dilemme de Lorenzo : « D’un costé, luy venoit au devant l’obligation qu’il devoit à son maistre, les biens et les honneurs qu’il avoit receuz de luy ; de l’autre costé, l’honneur de sa maison, l’honnesteté et chasteté de sa seur ». Cela nous rappelle que Musset a tiré son drame de ce qui, à la base, n’est qu’une affaire de macho mafieux qui veille jalousement à cadenasser la virginité de sa sœur, sur le mode toutes des putes sauf ma mère et ma sœur ! [2] La scène du meurtre est un modèle du genre, et a sans doute inspiré George Sand ; ce n’est plus Gala, mais Détective : « Et, quant le duc l’ouyt revenir, pensant qu’il luy amenast celle qu’il aymoit tant, ouvrir son rideau et ses oeilz, pour regarder et recepvoir le bien qu’il avoit tant actendu ; mais, en lieu de veoir celle dont il esperoit la conservation de sa vie, va veoir la precipitation de sa mort, qui estoit une espée toute nue que le gentil homme avoit tirée, de laquelle il frappa le duc qui estoit tout en chemise ; lequel, denué d’armes et non de cueur, se mest en son seant, dedans le lict, et print le gentil homme à travers le corps, en luy disant : " Est-ce cy la promesse que vous me tenez ? " Et, voiant qu’il n’avoit autres armes que les dentz et les ongles, mordit le gentil homme au poulce, et à force de bras se defendit, tant que tous deux tomberent en la ruelle du lict. Le gentil homme, qui n’estoit trop asseuré, appela son serviteur ; lequel, trouvant le duc et son maistre si liez ensemble qu’il ne sçavoit lequel choisir, les tira tous deux par les piedz, au milieu de la place, et avecq son poignard s’essaya à couper la gorge du duc, lequel se defendit jusques ad ce que la perte de son sang le rendist si foible qu’il n’en povoit plus. Alors le gentil homme et son serviteur le meirent dans son lict, ou à coups de poignart le paracheverent de tuer. Puis tirans le rideau, s’en allerent et enfermerent le corps mort en la chambre. » Juste après, Marguerite fait une courte allusion politique : « Et, quant il se veid victorieux de son grand ennemy, par la mort duquel il pensoit mettre en liberté la chose publicque, se pensa que son euvre seroit imparfaict, s’il n’en faisoit autant à cinq ou six de ceulx qui estoient les prochains du duc. » Le serviteur (Scoronconcolo) l’en dissuade. On apprend ensuite que, contrairement à la version Musset, « Et fut aussy prouvé que sa pauvre seur jamais n’en avoit oy parler ; laquelle, combien qu’elle fust estonnée du cas advenu, si est-ce qu’elle en ayma davantaige son frere, qui n’avoit pas espargné le hazard de sa vie, pour la delivrer d’un si cruel prince ennemy ». Bref, on ne lui a pas demandé son avis, à sœurette (ou tata) : manquerait plus que les filles choisissent les gars avec qui elles veulent voir la feuille à l’envers !
Côté français, on note aussi chez Montaigne, ces quelques lignes de son Journal de voyage en Italie : « Il y a entre autres un pupitre de marbre, avec grand nombre de figures d’une telle beauté que ce Laurent qui tua, dit-on, le duc Alexandre, enleva les têtes de quelques-unes, et en fit présent à la reine. » (Pléiade, 1962, p. 1298).
L’Apologie de Lorenzino de Médicis
Les éditions Allia ont fait traduire en français par Denis Authier en 1995 (réédition en 2010) une édition italienne de ce court texte, suivie d’une postface savante de Francesco Espamer (ou Erspamer, car son nom est écrit deux fois de façon différente sur le livre !). Ce texte semble avoir été écrit pendant le séjour en France ; Marguerite de Navarre en a donc peut-être eu connaissance ; mais la postface nous apprend que Lorenzo s’est mis à envoyer à ses amis des épîtres destinées à être rendues publiques, un mois après le meurtre. Dans un style caractéristique de la rhétorique antique, avec captatio benevolentiæ, etc., Lorenzino se justifie au point de vue moral, en expliquant en gros que d’une, « il est bien que les tyrans soient tués », peu importe les moyens ; de deux, ce n’est pas de sa faute si, l’intention étant bonne, le résultat a été nul. En tout cas, Lorenzo s’y montre d’une manière radicalement opposée au personnage de Musset, en républicain convaincu, et se plaint de la mollesse ou des erreurs des exilés, qui ont échoué à transformer l’essai. Une lettre de Philippe Strozzi est d’ailleurs citée dans la postface, qui utilise le qualificatif de « Brutus » repris par Musset en V, 2 : « Je crains que l’exploit de notre Brutus ne se révèle aussi vain que celui de l’autre, lorsque Auguste succéda à César » (p. 49). Mieux, c’est Lorenzino lui-même qui se prenait pour Brutus, et il fit graver peu après le crime, une monnaie à l’imitation de l’antique, le représentant en Brutus, à l’avers d’un bonnet phrygien (p. 62). Il dresse un portrait à charge d’Alexandre, l’accuse d’avoir fait tuer sa mère (p. 24), etc. Par contre, dans cette histoire narcissique, il oublie d’expliquer pourquoi il avait, quelques mois avant le meurtre, écrit pour les noces d’Alexandre avec Marguerite de Parme (fille naturelle de Charles Quint dont il devint donc gendre), son unique comédie L’Aridosia (traduction française parue aux Belles Lettres en 2005)… Voici quelques extraits de l’Apologie :
« Si j’avais à justifier mes actes devant ceux qui ne savent pas ce que c’est que liberté ou tyrannie, je m’emploierais, quant à moi, à démontrer et prouver par diverses raisons (car, il y en a beaucoup) que les hommes ne doivent rien désirer davantage que de vivre en citoyens, et par conséquent en liberté ; la vie de citoyen étant plus rare et moins durable dans toute autre forme de gouvernement que dans la république. Je démontrerais encore que, la tyrannie étant totalement contraire à la participation des citoyens, ils ne peuvent également que la haïr par-dessus tout ; et que cette opinion a tellement prévalu, en d’autres occasions, que les tyrannicides libérateurs de leur patrie ont été réputés dignes des seconds honneurs, après les fondateurs de celles-ci. » (Incipit, p. 9).
« [Alexandre] méditait et trouvait de nouvelles sortes de tourments et de morts, comme de murer vifs des hommes en des lieux si étroits qu’ils ne pouvaient ni
se tourner ni même bouger, mais semblaient ne faire qu’un avec les pierres et les briques ; et, ainsi logés, leur faisait donner une nourriture misérable et prolongeait le plus possible leur agonie, ce monstre que ne rassasiait pas la simple mort de ses citoyens. » (p. 14).
« Ces gens qui me blâment, auraient apparemment voulu que je courusse la ville en appelant le peuple à la liberté et en lui montrant le tyran mort ; selon eux, les paroles
auraient mis en branle ce peuple qu’ils savent n’avoir point été ébranlé par les faits » (p. 30).
La postface signale des œuvres plus ou moins anciennes inspirées de l’histoire de Lorenzino, depuis La Tragédie du vengeur de Cyril Tourneur (dont il exista une traduction française chez Aubier-Montaigne, et qui fut librement adapté au cinéma par Jacques Rivette sous le titre Noroît), jusqu’au roman Lorenzino de l’auteur américain Arvin Upton, qui ne semble pas avoir été traduit en français, et semble être l’œuvre unique de cet auteur, en passant par le poème de Vittorio Alfieri L’Etruria vendicata (1788), et la pièce d’Alexandre Dumas Lorenzino (1842), pièce qui n’eut guère de succès, suite à quoi Dumas reprit l’histoire de Lorenzo dans son journal de voyage publié en 1841, Une année à Florence (chapitre « Le palais Riccardi »), puis en 1844 dans Les Médicis, une chronique historique. Mais tout cela est déjà excellemment recensé, avec des liens, par le site « Lettres volées ». Cela dit, pour [Une année à Florence, le texte proposé en ligne étant erroné, je vous propose un fichier PDF rectifié.
Terminons sur cet utile opuscule en citant la conclusion de Francesco E(r)spamer : « Il composa l’Apologie pour rappeler aux contemporains et à la postérité que malgré tout, il avait accompli, lui, tout seul, un geste mémorable. Un geste parfait puisqu’autorisé et annoncé par des exempla classiques, puisqu’“accomplissement“ de ces antiques “figures“ ou, si l’on veut, réalisation, “représentation“ scénique, d’un canevas écrit depuis longtemps. Auteur d’une des meilleures comédies de la Renaissance, Lorenzino avait, comme beaucoup de ses contemporains, une perception “théâtrale“ de la réalité. »
Les sources de Lorenzaccio.
Selon Simon Jeune, Musset était plutôt paresseux, et contrairement à une légende longuement répandue par son frère et ayant-droit Paul, n’a pas consacré son séjour à Venise avec George Sand entre fin décembre 1833 et avril 1834 à recueillir des notes pour écrire son chef d’œuvre (« le seul drame français qui puisse se comparer aux grandes pièces de Shakespeare », p. 966). Au contraire, il l’avait entièrement élaboré entre août et décembre 1833, en même temps que Fantasio, et n’a fait que le retoucher à son retour à Paris, avant la publication le 23 août 1834, dans le tome I d’Un spectacle dans un fauteuil, en compagnie des Caprices de Marianne. Plutôt qu’à de fastidieuses recherches personnelles, Musset s’était contenté de se livrer à la lecture dans son fauteuil d’un court texte dramatique inédit de George Sand, qu’elle lui avait confié, écrit en 1830 et qui ne fut publié qu’en 1899, Une conspiration en 1537, « scène historique », s’inspirant de quelques pages d’une chronique historique de Benedetto Varchi, Storia fiorentina, que Musset lira aussi en italien [3]. Le texte de George Sand était, selon Simon Jeune, dans le goût de « la faveur littéraire dont bénéficient vers 1830 la brutalité, la cruauté, les pulsions sadiques ou monstrueuses ». L’inspiration de Musset croise ces sources à son propre point de vue sur la révolution ratée de 1830, qui vit, au terme des Trois Glorieuses (27 au 29 juillet) le peuple de Paris se faire confisquer sa victoire par le « roi bourgeois » Louis-Philippe. Musset, qui était alors libéral, « comme les membres de sa propre famille », sinon républicain, regrette sans doute de n’avoir pas pris part à la lutte, et donne son point de vue par le détour de la pièce, sur ces « républicains, incapables de remettre aux mains de la nation ce pouvoir qu’ils avaient pourtant conquis » (p. 967) [4]. Musset modifie le projet de Sand, et fait par exemple du duc, « une figure typique d’obsédé sexuel » (p. 968), tout en tempérant l’image du despote, colorée d’une tendance fantaisiste et débonnaire. Cela n’échappera pas, même après la mort de l’auteur, à l’administrateur de la Comédie Française Édouard Thierry, à qui Paul de Musset proposera de monter la pièce de son feu frère en 1863, de la refuser sous prétexte qu’« Il y a deux hommes dans la pièce, dont l’un est atteint de priapisme et dont l’autre s’est chargé d’affamer et de repaître cette abominable manie » (p. 976). Musset plaque sur Lorenzaccio ses propres tourments : « il éprouvait à la fois la nostalgie de la pureté et la fascination du mal, conçu essentiellement comme la transgression des tabous sexuels et la substitution de la recherche érotique au sentiment ou à l’épanchement du cœur » (p. 970). Le fait que Lorenzo (né en 1514) ait commis son crime à l’âge de 23 ans (1537), âge de Musset au moment de l’écriture, n’est peut-être pas pour rien dans l’identification au personnage.
Dans la version de Sand, le Duc méprise ouvertement Lorenzo, et s’en vante à Valori, l’envoyé du pape : « Cette feinte amitié que je lui montre ne trompe peut-être ici que vous et lui. » […] C’est moi, qu’ils appelaient un soldat grossier, c’est moi qui l’ai plongé dans le bourbier et qui ai mis mon pied sur sa tête. Mon or l’a corrompu, comme tant d’autres » (p. 835). La mère de Lorenzo lui reproche simplement : « Vous méprisez les femmes, Lorenzo, nous le savons », et Lorenzo reconnaît : « Je suis content de ne pas croire en Dieu. Je n’ai pas la peine de le haïr et c’est un de moins » (p. 838). Sand a parfois des envolées métaphoriques dignes de Musset (à moins qu’il ne lui ait sucé cette verve au sein ?) : « Je n’ai plus personne qui me soutienne. Les amis, c’est comme les pierres d’un mur. La première qui se détache entraîne toutes les autres. Que votre honneur reçoive une brèche, chacun y met la main pour l’élargir et d’une égratignure, ils nous font une plaie » (p. 840). La lucidité politique de Lorenzo est déjà clairement esquissée par Sand, que ce soit dans la scène II, quand Lorenzo explique à Bindo et Capponi, les chefs républicains venus le solliciter, que ce sont leurs intérêts personnels et non le bien de la république qui les guide (p. 841), ou dans le dénouement, quand il exprime son individualisme et son mépris du peuple : « Échappons à cette bête féroce qu’on appelle le peuple et qui a dévoré les Pazzi. » (p. 854). Il espionne et trahit explicitement les républicains, en complicité avec le Duc : « Faisons-lui grâce, s’il est libertin, car nous le sommes aussi » (p. 844). La scène de la cotte de maille se limitait à un conseil d’élégance : « En vérité, maître, ce haubert à mailles de Venise et ces gantelets de buffle vont vous donner l’air d’un guerrier tudesque plutôt que d’un amoureux florentin. » (p. 848).
Lorenzino, la pièce d’Alexandre Dumas (1842)
Il est injuste de négliger cette version : sa valeur pédagogique est aussi grande que sa médiocrité artistique (du moins comparée à son modèle, car ce n’est pas si nul !). La comparaison, ne fût-ce que des scènes d’exposition chez Musset et Dumas, fera comprendre à nos élèves, sans besoin de quelque dessin que ce soit, la différence entre un chef d’œuvre et un navet, navet qui était pourtant dans le goût de l’époque. Cela s’améliore après ; seule la première scène est vraiment ridicule, surtout comparée à la scène géniale de Musset. Le texte est savant, truffé d’allusions complexes à l’histoire de l’Antiquité aussi bien que de Florence, et Musset paraît limpide à côté. Et quand on sait que Dumas avait sous les yeux la pièce de Musset quand il rédigea son pensum !
Pour le lire, une seule solution : Google Books. Là, vous taperez « Lorenzino Dumas ». Le problème est qu’il existe deux versions, sans doute une plus ancienne, illustrée, avec un personnage appelé Giomo (illustration ci-dessus), et l’autre sans doute révisée, où Giomo est remplacé par Jacopo. Il est passionnant de comparer les deux versions. La première pesante scène présente les comparses, Jacomo et le Hongrois (que Musset confondait), et le spectateur poireaute en attendant que le Duc et le personnage éponyme veuillent bien se présenter à lui, là où Musset nous les mettait sous les yeux en une exposition magistrale. Dans la version 2, dès que Lorenzino est évoqué, Jacopo s’exclame « Je reconnais bien là notre mignon ! » tandis que dans la version 1, Giomo le décrit ainsi : « Connu pour un poltron, pour un lâche, pour une femmelette qui se trouve mal en voyant une goutte de sang. », et le Hongrois de répondre : « Mais si Lorenzino n’était rien de tout cela ; s’il avait voulu le paraître seulement ? ». Quand le Duc et Lorenzino paraissent l’un après l’autre, le Duc traite Lorenzino de poltron, et celui-ci réplique (à partir de cette scène, les deux versions se rejoignent presque) : « Oui, poltron ! poltron, tant que vous voudrez… Mais j’ai, du moins, sur mes pareils, l’avantage de ne point cacher ma poltronnerie, moi… ».
Dumas n’imite pas du tout Musset. Il invente une jeune Luisa, élevée par Philippe Strozzi, oncle de Lorenzo, et promise à lui en mariage. Or Lorenzo refuse de l’épouser, parce que Strozzi est connu comme conspirateur contre son maître. Il se plaint de l’attitude des Strozzi à son égard, qui ont préféré Alexandre le bâtard à lui-même pour régner : « Et vous m’avez abandonné, moi qui étais de conscience pure et de race immaculée ; et, comme j’avais un corps frêle et féminin, vous m’avez appelé un Lorenzino, un Lorenzaccio ! ». Strozzi lui propose de rejoindre le complot, et reprend l’allusion à l’homosexualité de la scène III, 3 de Musset (dans la 2e version seulement) : « Il y a encore des couronnes pour Harmodius, et des palmes pour Aristogiton ». Lorenzo refuse et se vante de son déshonneur : « tu ne sais donc pas que je suis une femmelette, un poltron, un lâche ? » L’acte II est meilleur. Dans la 1re scène (qui n’existe que dans la version 2), Lorenzo se fait traiter de « Mignon » par le Duc. Il se vante devant lui d’avoir un couteau fait part Benvenuto Cellini, et d’avoir un ennemi à tuer (belle trouvaille). Puis il négocie non pas sa tante, mais sa fiancée, la petite Luisa (intrigue que Dumas développe à fond, pour hétérosexualiser, sans doute, son Lorenzo). Scoronconcolo chez Dumas, tente d’abord d’assassiner Lorenzo sous le nom de Michele, stipendié par Philippe Strozzi, dans une belle scène de théâtre dans le théâtre digne d’Hamlet, où il lui demande de jouer avec lui sa propre pièce Brutus, joignant le geste à la parole quand Brutus tue César. Évidemment, quand Lorenzo renverse la situation et met le sicaire à sa merci, cela est peu cohérent avec le rôle qu’il se compose… quoique, justement, s’il ne fait que le composer…
Le reste de l’acte est semblable dans les deux versions. Dans l’acte III, Philippe traite Lorenzino d’« infâme », mot fort connoté à l’époque ; mais dans l’acte IV, le Duc aussi est traité de ce mot (voir cet article). Luisa dresse le panégyrique de Lorenzino : « parfois, il est gai comme un enfant ; parfois, il pleure comme une femme ». Le personnage de Fra Leonardo inventé par Dumas est héroïque : « Mon maître, c’est Dieu !… je n’ai pas d’autre Seigneur que celui qui est au ciel ; et tandis que j’entends ta voix qui me dit : « Va-t’en ! » j’entends la sienne qui me dit : « Demeure ! » ». Le Duc est à l’image du moine, fort courageux, et donne une chance de le tuer, et une épée, à Strozzi, qui n’en profite pas (belle scène). Dans la version 1, l’acte III se termine par la manigance de Lorenzino pour ménager une entrevue entre le Duc et Luisa. L’acte IV est quasi identique dans les deux versions : Luisa, puis Lorenzino rendent visite à Stozzi puis à Fra Leonardo. Ce n’est qu’assaut de sentiments héroïques et républicains, le contrepied absolu de Musset !
L’acte V se passe dans la chambre de Lorenzino. Dumas semble jouer sur le souvenir de Musset, car quand il fait dire à son héros s’adressant à Scoronconcolo : « Depuis un an, les voisins ont entendu chez moi tant de cris et de froissements d’épée, qu’ils n’y feront pas attention ; sois tranquille. », aucune scène précédente ne le justifie ! La version 1 est très différente de la 2. Dans la 1re, le mélo est à son comble, car Luisa, croyant que Lorenzo l’a livrée au Duc, se suicide en buvant le poison que son père lui a confié à l’acte IV, avant que Lorenzo, ou plutôt que Michele, embroche le Duc dans une scène fort terne, qui se termine sur ces mots frôlant le ridicule : « MICHELE, sortant du cabinet et essuyant son épée sous son bras. — C’est égal, il est plus facile de vivre quand on est vengé ! ». Le « c’est égal » commente sans doute la mort simultanée du Duc et de Luisa. Dans la version 2, Luisa est dans un oratoire, et se suicide pendant le début de l’action qu’elle entend, mais Lorenzino apprendra qu’elle a bu le flacon seulement après avoir expédié, ou plutôt fait expédier par Michele, le Duc. La fin est bien mélo : « LORENZINO, sanglotant. Mon Dieu ! mon Dieu !… (Luisa glisse sur ses genoux.) À l’aide ! au secours !… Elle se meurt !… (Luisa pousse un long soupir.) Mortel… (Silence désespéré, pendant lequel Michèle reparaît à la porte de la chambre.) Je n’avais que deux amours : Florence et elle… Je n’ai plus qu’une religion : la liberté !… ».
En conclusion, il est étonnant que Dumas, ayant connaissance du texte de Musset (mais cette œuvre était passée inaperçue à l’époque), ait produit ce drame honnête, mais comparativement bien médiocre, sous-tendu par une idéologie diamétralement opposée.
Lorenzaccio : un personnage homosexuel crypté
L’homosexualité (masculine seulement) avait été rarement traitée dans le théâtre européen avant Lorenzaccio, du moins dans les pièces connues, mais il y a sans doute des trouvailles à faire parmi les pièces censurées ou oubliées. Elle était couramment évoquée dans les comédies grecques antiques (jamais dans les tragédies), (voir les pièces d’Aristophane, ex : La Paix, Les femmes à l’Assemblée, Lysistrata, etc.) À la Renaissance, par exemple, Shakespeare, connu pour avoir écrit des Sonnets homosexuels, n’a jamais créé un personnage homosexuel dans une de ses pièces. On peut relever des allusions, par exemple dans Troïlus et Cresside, dans une scène d’injures où Patrocle est traité de catin d’Achille ; mais ce n’est qu’une injure noyée dans un flot d’injures toutes invraisemblables, et dans le reste de la pièce nos amants se comportent d’une façon très hétérosexuelle. Seul le contemporain de Shakespeare Christopher Marlowe a publié en 1592 une pièce consacrée aux amours homosexuelles et à la fin tragique d’Édouard II. En France, le sujet était tabou. Un grand personnage du théâtre française, Don Juan, a souvent été analysé comme homosexuel, mais bien après sa création, et Molière ne se serait pas permis de se moquer d’un grand seigneur homosexuel, à cause des mœurs connues de Monsieur, frère du roi Louis XI ; et on relève des allusions dans la pièce de Balzac, Vautrin, créée en 1840, qui reprend son personnage célèbre, mais avant qu’il ait rendu explicite son homosexualité dans la dernière partie de Splendeurs et Misères des courtisanes, publiée en 1847 seulement. La pièce est censurée après la première représentation parce que Frédérick Lemaître a la mauvaise idée de se déguiser en poire pour moquer Louis-Philippe, mais aussi parce qu’il se grime pour ressembler à Eugène-François Vidocq, de qui Balzac se serait inspiré pour son personnage. Le théâtre est encore plus censuré que le roman, donc les premières traces (très allusives) de personnages homosexuels dans les romans de Balzac ou de Victor Hugo sont encore plus impossibles au théâtre, raison pour laquelle Musset, même dans une version non destinée à la représentation publique, va jusqu’à retirer du manuscrit les deux minimes allusions qu’il avait faites.
Les allusions à l’homosexualité de Lorenzo sont nombreuses, et la plus explicite se trouve d’abord dans la chronique de Benedetto Varchi (publiée en appendices du volume de la Pléiade sous le titre Fragment du livre XV des « chroniques florentines ») : « Il [Lorenzo] se passait toutes ses envies, et tout spécialement en amour, sans aucune considération de sexe, d’âge ou de condition. » (p. 827).
George Sand avait repris à son compte cette information par l’allusion, le non-dit et la métaphore, sans oublier le traditionnel stigmate d’efféminement. Dans sa scène II, quand le Duc présente Lorenzo à l’envoyé du pape venu réclamer sa tête, il dit : « Bah ! Lorenzino, Lorenzaccio, comme l’appellent les Florentins ? Mais c’est mon parent et mon favori, l’ignorez-vous ? » […] Allons, vous raillez, quand vous parlez de poignard à Lorenzino. C’est un éventail qui convient à sa blanche main ! (p. 833/4). Le Duc manie le sous-entendu, s’agissant de la faiblesse de Lorenzaccio : « Messieurs, c’est une maladie étrange, et s’il n’avait été battu mainte fois par les valets de maint mari jaloux, l’on pourrait croire… » (Le reste de sa phrase se perd dans l’éloignement.) » Il s’agit en fait non pas tant d’homosexualité que de castration : « Lorenzo, seul (il est sur ses genoux et regarde autour de lui avec précaution) : Oui, Lorenzaccio, Castrataccio, c’est cela ! (Il se relève et secoue la poussière de son vêtement.) De la poussière ? c’est de la boue ? Jetez-en sur moi à pleines mains, c’est bien ! » (p. 837). On relève évidemment ici non seulement une occurrence de « haine de soi », mais aussi d’appropriation du stigmate avant la lettre (voir Erving Goffman). La scène du meurtre, si elle est bien gore dans l’air du temps, contient des allusions homosexuelles grosses comme le poing. En guise de « bâillon », « Il lui met les doigts dans la bouche » (p. 851). Cela ne se passe pas comme prévu, et on dirait la scène lacanienne du « vagin denté » : « Ce chien furieux tient mon pouce entre ses dents. Il me le broie. […] Il me coupera le doigt » […] Enfonce le couteau plus avant dans la gorge » ; et l’accusation de « castrataccio » est clairement vengée : « Ce doigt sera mutilé pour toujours. Tant mieux ! C’est une glorieuse blessure et j’aurai toujours ce souvenir sous les yeux. » (p. 851). L’idée de « noces » est reprise plusieurs fois : « je veux te faire faire un tableau d’importance pour le jour de mes noces. » (II, 2, p. 169). L’homosexualité est aussi un thème mineur, comme l’évocation sous-entendue des liens sado-masochistes entre deux ecclésiastiques dont l’un est le mignon de l’autre. En réalité, le texte se contente de l’allusion par le mot « lieu de débauche » (II, 3, p. 171, et la note).
Musset s’autocensure, avant même la représentation posthume, en retranchant de la publication deux scènes contenant des allusions pourtant peu explicites (ce sont les deux seules scènes retranchées, publiées parmi les documents en notes de l’édition de la Pléiade (p. 985 à 990), ce qui laisse supposer que ces allusions sont la cause de l’autocensure) [5]. Dans la première scène retranchée, la didascalie initiale montre « Le Duc et Lorenzo, sommeillant ». Ils sont surpris par l’arrivée de Benvenuto Cellini, le graveur, qui dans les ébauches de Musset symbolisait l’art pur opposé à la corruption politique, lequel dans la version définitive ne sera plus représenté que par le peintre Tebaldeo (mais Cellini est nommé en I, 5). Il ne se passe rien de plus ; il semble que cette seule mention ait été jugée susceptible de choquer ! Dans la 2e scène retranchée, Lorenzo tente de corrompre un jeune peintre, Freccia (finalement lui aussi retranché de la version définitive, ou plutôt fusionné avec Tebaldeo), en lui faisant parvenir de l’argent d’une femme riche et âgée censée lui payer son portrait d’avance. Une réplique laisse supposer un jeu de scène suggestif : « Oui, oui, comme, par exemple, de savoir enlever tout doucement un collier de prix sur une épaule qu’on caresse entre deux baisers bien appliqués » (p. 988). Simon Jeune explique en note : « Lorenzo mimant une séduction imaginaire ébauche, aux yeux du spectateur, une scène réelle de séduction homosexuelle. Est-ce un hasard si les deux scènes retranchées se caractérisent par leur homosexualité provocante ? ». Quoi qu’il en soit, Freccia se contente de répliquer à la fin de cette longue scène : « Ne me montrez pas un paradis pour me mener à mal » (p. 989). [6] Quand on compare à la débauche hétérosexuelle la plus explicite, on s’étonne d’une telle réserve. Mais il faut avoir présent, la même année exactement, les scrupules du jeune Victor Hugo, aîné de Musset, à évoquer l’homosexualité d’un personnage lui aussi tiré de la réalité, Claude Gueux. Le premier vrai personnage homosexuel du roman moderne français (évidemment il y a une « préhistoire », voir par exemple Cyrano de Bergerac), il faudra attendre l’extrême fin de l’œuvre de Balzac pour le voir paraître… Dans la pièce, le portrait de Lorenzo par le Duc est suggestif, et ouvre la porte aux interprétations homosexuelles, voire homophobes, de mise en scène : « Regardez-moi ce petit corps maigre, ce lendemain d’orgie ambulant. Regardez-moi ces yeux plombés, ces mains fluettes et maladives, à peine assez fermes pour soutenir un éventail ; ce visage morne, qui sourit quelquefois, mais qui n’a pas la force de rire. » (p. 152). Le test de l’épée, qui fait défaillir Lorenzo, est déterminant : « la seule vue d’une épée le fait trouver mal. Allons, chère Lorenzetta, fais-toi emporter chez ta mère. » (p. 154). Le mépris est exprimé par la féminisation du nom, rien de bien neuf ! On note qu’en II, 4, Lorenzo et le Duc s’appellent mutuellement « mignon » : « LE DUC — Ma foi, non, elle m’ennuie déjà. Dis-moi donc, mignon, quelle est donc cette belle femme […] LORENZO — Une autre fois, mignon. » (p. 178). Idem en II, 6, Lorenzo : « Vous avez là une jolie cotte de mailles, mignon ! » (p. 185). Voir aussi IV, 10, p. 234. On peut aussi évoquer l’attitude étonnante pour l’époque, de chevaucher en croupe du prince : « L’autre jour, à la chasse, j’étais en croupe derrière vous, et en vous tenant à bras-le-corps, je la sentais très bien. » (p. 185). Si vous pensez qu’il y a la quelque allusion graveleuse, vous fourrez-vous le doigt dans l’œil ? On relève encore en III, 3, cet aveu de Lorenzaccio : « pour devenir son ami, et acquérir sa confiance, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies », qui suggère une homosexualité (ou bisexualité) stratégique. Dans son ouvrage parascolaire intilulé Lorenzaccio paru aux éditions Ellipses en août 2012, Thanh-Vân Ton-That relève les différentes altérations du nom du personnage (p. 84), cela va jusqu’au « Renzinaccio » prononcé par Alamanno dans la scène IV, 7. Elle montre qu’il y a comme une base -renz-, avec préfixes ou suffixes selon qui parle. J’ajouterais que c’est une évocation lexicale de la castration du personnage.
On sait que la pièce a été créée par Sarah Bernardt travestie en 1896. À ce propos, Thanh-Vân Ton-That cite dans son ouvrage un jugement intéressant d’Anne Ubersfeld (Le Drame romantique, Belin, 1994) : « Une double tradition est ainsi fondée : reconstruire le drame, le concentrer autour du héros en sacrifiant les intrigues secondaires — et faire jouer le rôle équivoque par une femme, ce qui souligne fâcheusement sa subjectivité au détriment de sa pensée et de son action. Le rapport au monde de Lorenzo ainsi perturbé ou évacué, le drame apparaît comme une aventure psychologique individuelle ». Le rôle fut repris, selon Thanh-Vân Ton-That, par Marie-Thérèse Piérat entre 1922 et 1930 à la Comédie Française, puis par Renée Falconetti, connue pour avoir joué Jeanne D’Arc dans le film célèbre de Carl Theodor Dreyer, entre 1926 et 1935. Dans cet extrait non identifié d’un film parlant en noir et blanc, le rôle est joué par une femme. L’extrait est bien choisi car il s’agit de la scène de la répétition du meurtre, entre Lorenzaccio et Scoronconcolo. Il ne s’agit pas de Marguerite Jamois au théâtre Montparnasse en 1945. Cela serait étonnant, car il ne reste aucune archive filmée de Gérard Philipe en 1952, et malgré l’immense escalier évoqué par les critiques, on a du mal à imaginer cela comme du théâtre filmé en 1945. Agnès Vinas [7], du site « Lettres volées », m’a très aimablement fourni une réponse : il s’agit d’un documentaire sur le Conservatoire national d’art dramatique en 1957. Ils n’ont filmé que cet assaut, rien d’autre de Lorenzaccio. L’actrice s’appellerait Marie-Claude Lorraine, illustre inconnue non répertoriée… En tout cas ce document unique donne une idée de l’image de Lorenzaccio qu’on pouvait avoir avant Gérard Philipe. À partir de 1933, le rôle est joué par des hommes (selon le relevé forcément incomplet de cet ouvrage). On peut se demander à quel point cette habitude de travestir le rôle, peu conforme aux habitudes du théâtre français, correspond à une vision homosexuelle du personnage. Un autre grand personnage du théâtre française, Don Juan, a souvent été analysé comme homosexuel, mais je ne sache pas qu’il ait été interprété par des actrices.
Dans les mises en scène récentes, à part celle évoquée ci-dessus, Thanh-Vân Ton-That évoque dans son ouvrage au moins quatre exemples où l’homosexualité est sciemment soulignée par le metteur en scène. Georges Lavaudant, dans sa mise en scène de 1988, a « tendance à voir le meurtre du duc par Lorenzo sous l’angle du fait divers. Un fait divers pasolinien, sur fond de rituels et d’homosexualité. J’ai le sentiment qu’il y a chez le duc un désir de mort, un désir de se faire tuer par Lorenzo. Le sens politique du meurtre s’efface derrière sa charge sentimentale » (Voir cet article du Soir. C’est aussi le choix de Jean-Pierre Vincent au théâtre des Amandiers en 2000. Voici deux extraits d’un article de Virginie Lachaise sur ce spectacle dans Télérama : « Jean-Pierre Vincent a dirigé la séquence du meurtre comme la plus grotesque et la plus tragique des scènes d’amour. Entre deux hommes qui ont été au bout de leurs désirs, deux hommes lassés de vivre, qui s’enlacent brutalement une dernière fois ; Alexandre mord même si fort Lorenzaccio au doigt qu’il lui laisse pour jamais la trace d’une alliance sanglante… C’est fort, c’est violent, cette homosexualité affichée » ; « Et s’il faut parler encore d’interprétation, ajoutons que Jérôme Kircher est tout à fait convaincant en Lorenzaccio, « mignon » d’Alexandre efféminé et veule donnant à son seul acte de courage [8], l’assassinat du Duc, la forme de l’ignominie puisqu’il se travestit en femme » (extrait aussi de l’ouvrage cité ci-dessus). Il y en a même qui restent sur leur faim, comme le critique Michel Cournot, qui regrette « que Jean-Pierre Vincent n’ait pas repris deux scènes que Musset avait écrites, et qu’il n’a pas publiées. Pas osé. Lorenzo y dépassait les limites admises des convenances et ses amours très physiques avec le duc Alexandre y apparaissaient, gros comme une maison. Du temps de Musset, l’amour des hommes entre eux n’était pas, comme du temps de Racine par exemple, un signe extérieur de richesse, un privilège du gratin. Le geste de recul de Musset est regrettable, Lorenzo et le duc gagnaient, en mystère comme en liberté, à se laisser surprendre au lit. » (voir le texte de cette critique du Monde du 28/7/2000 sur le même lien que ci-dessus). Enfin, à propos d’une mise en scène d’Anne-Cécile Moser et Robert Bouvier, au Théatre des Quartiers d’Ivry en 2004, voici l’extrait d’une critique d’Aude Brédy dans L’Humanité du 8 novembre 2004 : « il [l’acteur Philippe Pollet qui joue le Duc] fait surenchère du motif d’une sensualité qui se veut subversive. Celle-ci, plus largement le fait de l’adaptation, est particulièrement démonstrative d’homme à homme ; ainsi, entre le duc et Lorenzaccio qui, parfois vêtus d’une sorte de culotte d’esclave, semblent prêts à entamer une séance de fouet juste pour le plaisir. Rien de choquant dans ce trémoussement des corps, mais si l’on y voit un effet de mode, on ne trouve pas qu’il nourrisse à bon escient la pièce ».
Sur le thème de l’homosexualité à la Renaissance, voir l’article sur Édouard II, de Christopher Marlowe (1592).
ACTE PREMIER
(vous trouverez un tableau synoptique du contenu des scènes sur le site Magister ; pour avoir le texte, allez sur Wikisource).
L’exposition nous plonge in medias res, la corruption d’une oie blanche, dans une scène qui par son décor (nuit, jardin, clair de Lune) évoque l’acte II scène 2 de Roméo et Juliette pour en retourner tous les motifs que nos élèves trouveront « romantiques », alors que le romantisme au sens littéraire du terme est tout le contraire ! (Musset reprend un cliché justement anti-romantique au sens vulgaire du théâtre romantique, qui est l’abus sexuel, que ce soit l’incipit d’Hernani, ou l’Acte II, scène 2 du Roi s’amuse. Voir sa chanson « Ballade à la Lune » évoquée à la fin de cet article. Lorenzo se livre à un anti-manifeste d’éducation : « Quoi de plus curieux pour le connaisseur que la débauche à la mamelle ? Voir dans un enfant de quinze ans la rouée à venir ; étudier, ensemencer, infiltrer paternellement le filon mystérieux du vice dans un conseil d’ami, dans une caresse au menton ; — tout dire et ne rien dire, selon le caractère des parents ; — habituer doucement l’imagination qui se développe à donner des corps à ses fantômes, à toucher ce qui l’effraie, à mépriser ce qui la protège ! […] Et quel trésor que celle-ci ! […] Une jeune chatte qui veut bien des confitures, mais qui ne veut pas se salir la patte ». Il y a dans Alexandre, à un détail près, du Gilgamesh : un tyran qui règne sur une cité et « ne laisse pas un fils à son père / […] ne laisse pas une vierge à sa mère ». La lutte faite de haine et d’attirance entre Alexandre et Lorenzo n’est pas sans rappeler les liens entre Enkidou et Gilgamesh. Il est étonnant que Musset ne tire aucun parti du surnom courant d’Alexandre le Maure, ainsi appelé parce qu’il était bâtard, et peut-être mulâtre (voir sur ce point le livre La légende du sexe surdimensionné des Noirs, de Serge Bilé). Le lecteur-spectateur de Lorenzaccio est immédiatement sensible au style brillant truffé d’aphorismes et de métaphores, que je me plairai à relever dans cet article. Le Duc se montre clément mais aussi dominateur et méprisant en épargnant le frère de l’oie (le dindon ?), Maffio : « Allons donc ! frapper ce pauvre homme ! Va te recoucher, mon ami, nous t’enverrons demain quelques ducats » (p. 140). La scène II, très shakespearienne, est une scène de rue qui permet au spectateur (ou plutôt lecteur ici, je ne vais pas le répéter à chaque fois !) de s’identifier au populaire, et de se replonger dans l’atmosphère d’une pré-révolution : « La cour ! le peuple la porte sur le dos, voyez-vous ! Florence était encore (il n’y a pas longtemps de cela) une bonne maison bien bâtie ; tous ces grands palais, qui sont les logements de nos grandes familles, en étaient les colonnes. Il n’y en avait pas une, de toutes ces colonnes, qui dépassât les autres d’un pouce ; elles soutenaient à elles toutes une vieille voûte bien cimentée, et nous nous promenions là-dessous sans crainte d’une pierre sur la tête. » (p. 143 ; une des rarissimes intrusions du peuple dans tout le théâtre de Musset). On relève dans la bouche du marchand une quasi-citation de Dom Juan : « Vous avez l’air de savoir tout cela par cœur », dit il à l’orfèvre après sa tirade brillante, de même Sganarelle à Don Juan : « Vertu de ma vie, comme vous débitez ; il semble que vous ayez appris cela par cœur, et vous parlez tout comme un livre » (I, 2). La scène III nous introduit dans l’intimité d’une famille de l’aristocratie, marquise, marquis et le cardinal Cibo, frère du marquis. Musset place un de ses aphorismes dans la bouche de la marquise : « Ceux qui mettent les mots sur leur enclume, et qui les tordent avec un marteau et une lime, ne réfléchissent pas toujours que ces mots représentent des pensées, et ces pensées, des actions. » (p. 149). La satire des jésuites en la personne du cardinal est entamée avec l’allusion à la « direction d’intention », dénoncée par Blaise Pascal dans la VIIe lettre des Provinciales : « On peut respecter les choses saintes, et, dans un jour de folie, prendre le costume de certains couvents, sans aucune intention hostile à la sainte Eglise catholique », ce à quoi la marquise répond : « L’exemple est à craindre, et non l’intention » (p. 149). La scène IV reprend assez fidèlement la première scène de Sand. Sire Maurice, chancelier des Huit, demande la disgrâce de Lorenzo : « Lorenzo est un athée ; il se moque de tout. […] Le peuple appelle Lorenzo, Lorenzaccio : on sait qu’il dirige vos plaisirs, et cela suffit. » (p. 151). Sans que cela soit précisé, on sait donc que le surnom est insultant. Le Duc, contrairement à la version Sand, soutient et défend son favori : « Tout ce que je sais de ces damnés bannis, de tous ces républicains entêtés qui complotent autour de moi, c’est par Lorenzo que je le sais. Il est glissant comme une anguille ; il se fourre partout, et me dit tout » (p. 152). La scène 5 poursuit l’évocation du peuple, parmi lequel se sont glissés, on l’apprendra plus tard, des personnalités républicaines (le prieur). Une remarque anodine d’une « Deuxième dame » sur un officier : « Tu sauras qu’il n’y a rien de mieux que cet homme-là » inspire une note étonnante : « sous-entendu égrillard, si l’on se rappelle que l’opinion populaire attribue aux simples d’esprit certains « avantages » anatomiques et physiologiques en matière de sexualité » (p. 1002). C’est aussi l’occasion d’une tentative de drague de Julien Salviati sur la personne de Louise Strozzi. Dans la scène VI, il provoque délibérément le prieur, un Strozzi : « J’ai rencontré cette Louise la nuit dernière au bal des Nasi ; elle a, ma foi, une jolie jambe, et nous devons coucher ensemble au premier jour » (p. 158). Dans la scène VI, la sœur et la tante de Lorenzo se plaignent de lui : « Ah ! Catherine, il n’est même plus beau ; comme une fumée malfaisante, la souillure de son cœur lui est montée au visage. Le sourire, ce doux épanouissement qui rend la jeunesse semblable aux fleurs, s’est enfui de ses joues couleur de soufre, pour y laisser grommeler une ironie ignoble, et le mépris de tout. » (p. 160).
On comparera avec profit l’immoralité professée dans cette scène au portrait de Don Pèdre, dans Carmosine. Ce roi, véritable despote éclairé, à l’opposé d’Alexandre, est fidèle à sa femme, et au lieu de se rendre chez les jeunes filles pour les violer, ne se rend chez Carmosine, amoureuse de lui, que pour la raisonner, et la marier avec son soupirant légitime.
ACTE II
Cela commence par une scène de conspiration réunissant les Strozzi, dont l’essentiel de l’énergie se consume à disputer l’honneur de Louise, plutôt que de s’occuper de politique. Cette attitude sera critiquée par Philippe Strozzi dans la scène 5 : « Où en sommes-nous, si l’insolence du premier venu tire du fourreau des épées comme les nôtres ? » (p. 180). Dans la scène II, Lorenzo tente de troubler l’esprit du jeune peintre, qui résiste mieux que dans la scène retranchée ; cela donne une stichomythie fameuse « LORENZO — Pourquoi donc ne peux-tu peindre une courtisane, si tu peux peindre un mauvais lieu ? TEBALDEO — On ne m’a point encore appris à parler ainsi de ma mère. LORENZO — Qu’appelles-tu ta mère ? TEBALDEO — Florence, seigneur. LORENZO — Alors tu n’es qu’un bâtard, car ta mère n’est qu’une catin. » (p. 168). Puis c’est la confession de la marquise Cibo au cardinal son beau-frère qui tente d’extorquer des informations. Elle l’envoie paître, mais avoue que dans la relation avec le Duc Alexandre, « Ah ! pourquoi y a-t-il dans tout cela un aimant, un charme inexplicable qui m’attire ? » (p. 174 ; écho à la fameuse tirade de l’inconstance de Dom Juan de Molière, I, 2 : « Les inclinations naissantes après tout, ont des charmes inexplicables ». À nouveau le jésuite se trahit : « Que voulez-vous dire ? LE CARDINAL :Qu’un confesseur doit tout savoir, parce qu’il peut tout diriger », formule reprise par la marquise, comme le terme « intention » à la scène I, 3. La scène IV est très proche du modèle conçu par George Sand. Musset y a ajouté une scène d’autoscopie fort proche de la célèbre « Nuit de décembre » : « Mais le spectre s’est assis auprès de la lampe sans me répondre ; il a ouvert son livre, et j’ai reconnu mon Lorenzino d’autrefois. » (p. 175). Dans la 2e partie de la même scène, l’entrevue avec les conjurés, on trouve une allusion à la fameuse réplique de Covielle dans Le Bourgeois gentilhomme [9] : « Je voulais dire seulement que vous aviez contracté au collège l’habitude innocente de vendre de la soie. » (p. 176). Lorenzo tourne la tronçonneuse de son ironie dans la plaie de l’orgueil des marchands : « Vous ne connaissez pas la véritable éloquence. On tourne une grande période autour d’un beau petit mot, pas trop court ni trop long, et rond comme une toupie ; on rejette son bras gauche en arrière de manière à faire faire à son manteau des plis pleins d’une dignité tempérée par la grâce ; on lâche sa période qui se déroule comme une corde ronflante, et la petite toupie s’échappe avec un murmure délicieux. On pourrait presque la ramasser dans le creux de la main, comme les enfants des rues. » (p. 177). L’échange entre le duc et Lorenzo : « LORENZO : Cela serait très difficile. C’est une vertu. LE DUC : Allons donc ! Est-ce qu’il y en a pour nous autres ? » rappelle la complicité de Don Juan et Sganarelle : « DON JUAN : Sganarelle, le Ciel ! SGANARELLE : Vraiment oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres » I, 3). Philippe Strozzi, à la scène 5, évoque la vendetta, en des termes qui rappellent le « Chant des partisans » [10] : « plus d’une fois le sang que tu bois peut-être à cette heure avec indifférence séchera au soleil de tes places. » (p. 181). La scène 6 est l’occasion d’un nouvel hommage à Molière : « Cracher dans un puits pour faire des ronds est mon plus grand bonheur » (p. 186) [11].
ACTE III
La scène première est calquée sur celle de Sand, en plus bavard. La scène II réunit les Strozzi, et le patriarche sermonne ses enfants inconséquents : « Des questions qui ont remué le monde ! des idées qui ont blanchi des milliers de têtes, et qui les ont fait rouler comme des grains de sable sur les pieds du bourreau ! » (p. 191). L’image des grains de sable sera reprise par Pierre en IV, 2. Il pose une bonne question : « Et quand vous aurez renversé ce qui est, que voulez-vous mettre à la place ? » Son fils Pierre répond : « Nous sommes toujours sûrs de ne pas trouver pire », puis ajoute de façon prémonitoire « Les têtes d’une hydre sont faciles à compter. » Les têtes d’une hydre ont la faculté de repousser, et c’est ce qui adviendra au dénouement. Enfin, Philippe veut se mêler du projet, même irréfléchi : « Depuis quand le vieil aigle reste-t-il dans le nid, quand ses aiglons vont à la curée ? ». Cela n’est pas sans rappeler la citation de Fantasio, rédigé en parallèle : « L’éternité est une grande aire, d’où tous les siècles, comme de jeunes aiglons, se sont envolés tour à tour pour traverser le ciel et disparaître ; le nôtre est arrivé à son tour au bord du nid ; mais on lui a coupé les ailes, et il attend la mort en regardant l’espace dans lequel il ne peut s’élancer. ». La scène III, interminable, commence par l’arrestation des fils Strozzi pour leur assassinat raté de Julien Salviati (ça veut fomenter une révolution et ça n’est pas capable de s’assurer qu’un pourceau est bien embroché !). Cette arrestation ne parvient pas à entraîner une émeute, ce qui trace la route de l’argumentation bavarde de Lorenzo. Il apprend à Philippe que « Salviati voulait séduire [sa] fille, mais non pas pour lui seul. Alexandre a un pied dans le lit de cet homme ; il y exerce le droit du seigneur sur la prostitution » (p. 197). Il lui fait ce reproche : « N’avez-vous dans la tête que cela : délivrer vos fils ? […] quelque autre pensée plus vaste, plus terrible, ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse ? » (p. 198). Il confie son idée fixe de jeunesse : tuer un tyran, comme un Brutus [12] : « Je voulais agir seul, sans le secours d’aucun homme, je travaillais pour l’humanité ; mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. […] je ne voulais pas soulever les masses, ni conquérir la gloire bavarde d’un paralytique comme Cicéron ; je voulais arriver à l’homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, et après cela porter mon épée sanglante sur la tribune, et laisser la fumée du sang d’Alexandre monter au nez des harangueurs, pour réchauffer leur cervelle ampoulée » (p. 199 ; retrouvez cet extrait dans un corpus BTS du thème « Seuls avec tous »). Lorenzo développe en trois images le thème des profondeurs souillées qui recèlent la vérité, c’est l’image de la « cloche de verre » sous la mer, déjà utilisée par Fantasio en I, 2 de la pièce éponyme (p. 110), puis celle de la cité : « La vie est comme une cité ; on peut y rester cinquante ou soixante ans sans voir autre chose que des promenades et des palais ; mais il ne faut pas entrer dans les tripots, ni s’arrêter, en rentrant chez soi, aux fenêtres des mauvais quartiers » (p. 201), enfin « tous les masques tombaient devant mon regard ; l’humanité souleva sa robe et me montra, comme à un adepte digne d’elle, sa monstrueuse nudité » (p. 202). Et on s’étonne qu’il y ait des coupes à la représentation ! Philippe fait une allusion cryptée à l’homosexualité, en donnant à Lorenzo comme modèle « les statues de bronze d’Harmodius et d’Aristogiton ». Puis c’est la the tirade : « Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre ? Veux-tu donc […] que je sois un spectre, et qu’en frappant sur ce squelette (il frappe sa poitrine), il n’en sorte aucun son ? […] Songes-tu que ce meurtre, c’est tout ce qui me reste de ma vertu ? Songes-tu que je glisse depuis deux ans sur un mur taillé à pic, et que ce meurtre est le seul brin d’herbe où j’aie pu cramponner mes ongles ? Crois-tu donc que je n’aie plus d’orgueil, parce que je n’ai plus de honte ? […] j’en ai assez d’entendre brailler en plein vent le bavardage humain ; il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. […] Que les hommes me comprennent ou non, qu’ils agissent ou n’agissent pas, j’aurai dit aussi ce que j’ai à dire ; je leur ferai tailler leurs plumes si je ne leur fais pas nettoyer leurs piques, et l’humanité gardera sur sa joue le soufflet de mon épée marqué en traits de sang. […] dans deux jours les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté » (p. 205). Putain, ça fait du bien ! La scène VI est la confrontation de la marquise avec le Duc, qui se prête à tous les raffinements de mise en scène. Celle-ci parle politique, après un sermon liminaire féministe : « à quoi bon écouter une femme ? une femme qui parle d’autre chose que de chiffons et de libertinage, cela ne se voit pas » (p. 208). Cette sortie n’est-elle qu’une coquetterie ? « je t’en supplie, que je ne sois pas perdue sans ressource ; que mon nom, que mon pauvre amour pour toi ne soit pas inscrit sur une liste infâme » (p. 210). On songe bien sûr au catalogue de de Don Giovanni (Acte I, scène 5 de l’opéra). La marquise ne peut que constater son échec : « Écoute ! écoute ! je vois que tu t’ennuies auprès de moi. Tu comptes les moments, tu détournes la tête ; ne t’en va pas encore : c’est peut-être la dernière fois que je te vois. Écoute ! je te dis que Florence t’appelle sa peste nouvelle, et qu’il n’y a pas une chaumière où ton portrait ne soit collé sur les murailles avec un coup de couteau dans le cœur » (p. 211). Le vers blanc Tu comptes les moments, tu détournes la tête est un clin d’œil à Andromaque IV, 5, de Racine, quand Hermione s’en prend à Pyrrhus : « Perfide, je le voi : / Tu comptes les moments que tu perds avec moi ! ». Mais c’est aussi une scène proche de Dom Juan IV, 6, quand Elvire vient parler de Dieu à son séducteur, qui n’en peut mais, et s’intéresse seulement à « son habit négligé, son air languissant, et ses larmes », de même que le Duc n’écoute pas la Marquise, mais remarque seulement « Tu as une jolie jambe » (p. 210). Musset joue d’ailleurs avec le lecteur de son « spectacle dans un fauteuil », puisque ce n’est qu’à la fin de la scène qu’avec cette réplique « Aide-moi donc à remettre mon habit ; je suis tout débraillé » qu’on comprend sur quel fond se passe la leçon de politique de la marquise ! La scène VII poursuit le thème de la vendetta ; Philippe Strozzi déclare à ses convives : « C’est une juste vengeance qui me pousse à la révolte, et je me fais rebelle parce que Dieu m’a fait père. […] Notre vengeance est une hostie que nous pouvons briser sans crainte et nous partager devant Dieu » (p. 213). Intertextualité, encore, avec Fantasio, I, 2 : « L’amour est une hostie qu’il faut briser en deux au pied d’un autel et avaler ensemble dans un baiser » (p. 112). Au cours de ce repas, Louise meurt empoisonnée. Philippe est bouleversé et renonce immédiatement à l’action pour aller enterrer sa fille dans un couvent, avec cette phrase qui nous rappelle la nuance entre ensevelir et enterrer : « Oui, oui. ensevelissez seulement ma pauvre fille, mais ne l’enterrez pas ; c’est à moi de l’enterrer » (p. 215).
ACTE IV
Cet acte conduit par de grands cercles centripètes au meurtre bref qui le conclut. On commence par une entrevue Lorenzo / Alexandre, contenant un clin d’œil au Roi s’amuse de Victor Hugo (II, 2) : « Catherine est un morceau de roi » (p. 217). Puis les Strozzi fils sortent de prison et apprennent la mort de Louise. Pierre s’apprête à jurer : « ô Dieu ! faites que ce que je soupçonne soit la vérité, afin que je les broie sous mes pieds comme des grains de sable » (p. 219) en reprenant l’image de son père (III, 2, ci-dessus). La scène 3 est un nouveau bavardage, pardon, monologue, de Lorenzo, très sartrien : « Le spectre de mon père me conduisait-il, comme Oreste, vers un nouvel Egiste ? » (p. 219 sic). La confrontation de la marquise avec son beauf le cardinal ne manque pas de sel : « César a vendu son ombre au diable, cette ombre impériale se promène, affublée d’une robe rouge, sous le nom de Cibo » (p. 220) ; elle tente de percer les desseins de l’homme de Dieu : « qui sait jusqu’où les larmes des peuples, devenues un océan, pourraient lancer votre barque ? » (p. 223), et pour déjouer sa fourbe, avoue tout à son mari avant qu’il ait pu ouvrir la bouche. Comme on dit, ça la lui coupe au point qu’il jure : « Ah ! corps du Christ ! » (p. 224). [13] Un nouveau bavardage (pardon !) de Lorenzo en IV, 5, conclut sur une auto-absolution : « j’ai commis bien des crimes, et si ma vie est jamais dans la balance d’un juge quelconque, il y aura d’un côté une montagne de sanglots ; mais il y aura peut-être de l’autre une goutte de lait pur tombée du sein de Catherine » (p. 226), qui rappelle le poème d’Hugo « Sultan Mourad » dans La Légende des siècles (I, VI, 3) : « Du côté du pourceau la balance pencha ». Suivent des scènes de conjurés (Pierre impuissant à les coaliser en l’absence de son père), les forfanteries de Lorenzo qui échoue à prévenir les patriciens qu’il va tuer et qu’ils s’apprêtent à agir, un bavard… monologue de Lorenzo, et c’est le coït foudroyant du meurtre, que Musset a nettoyé des coulées de sang de la version Sand, lui qui a été interminablement bavard avant l’acte ! (et c’est la marquise qui passe pour bavarde !). Il n’y a que deux répliques : « C’est toi, Renzo ? — Seigneur, n’en doutez pas » (p. 235). Simon Jeune signale que peut-être Musset a voulu traduire maladroitement le mot de Varchi : non dubitate, qui signifierait plutôt n’ayez pas peur (p. 1038). Peut-on voir dans le « Seigneur » un double sens, puisque Lorenzo vient de dire que par ce meurtre il comptait se racheter au jugement dernier ? En tout cas la sublime réplique « Regarde, il m’a mordu au doigt. Je garderai jusqu’à la mort cette bague sanglante, inestimable diamant » condense comme un diamant la boucherie gore de George Sand, tout en soulignant l’éros-et-thanatesque lien érotique entre Lorenzo et son duc ! Une œuvre à étudier en parallèle : David et Goliath (1555), de Daniele da Volterra (1509-1566).
ACTE V
Cet acte est une sorte de petite mort : après le point culminant, le drame politique serait incomplet sans montrer que Lorenzo avait raison de haïr les hommes. Dans les heures qui suivent le décès, à peine sortis de l’incertitude, les Huit procèdent à l’élection du successeur, qui sera Cosme Ier, dont voici le superbe buste, œuvre de Benvenuto Cellini admirable au California Palace of the Legion of Honor de San Francisco.

Seul Ruccellaï s’oppose : « Il ne faut plus à la république ni princes, ni ducs, ni seigneurs ; voici mon vote » (p. 240). Dans la scène II, Lorenzo retrouve Philippe Strozzi à Venise, et lui remet la fameuse clé de sa chambre, sur laquelle Sand avait clos son drame (Lorenzaccio serait-elle une œuvre à clef ?) : « Cette clef ouvre ma chambre, et dans ma chambre est Alexandre de Médicis, mort de la main que voilà » (p. 241). Philippe lui reproche : « Pourquoi n’es-tu pas sorti, la tête du duc à la main ? le peuple t’aurait suivi comme son sauveur et son chef » (p. 242). Lorenzo méprise les bassesses auxquelles se livrerait le peuple : « Il y en a aussi de féroces, comme les habitants de Pistoie, qui ont trouvé dans cette affaire une petite occasion d’égorger tous leurs chanceliers en plein midi » Musset a fait une nouvelle erreur de traduction selon Simon Jeune : il a pris pour un nom commun le mot Cancelliere qui figurait dans le texte de Varchi, et désignait une famille, un clan : il s’agissait en réalité d’un règlement de compte clanique ! La scène V permet de fermer la pièce sur elle-même, avec le dialogue entre l’orfèvre et le marchand : « Il y en a qui voudraient, comme vous dites ; mais il n’y en a pas qui aient agi » (p. 247). Puis à travers la scène des précepteurs et des petits Strozzi et Salviati, prêts à perpétuer la vendetta, Musset lance une petite pique à Hugo en parodiant selon Simon Jeune, la préface des Orientales, mais aussi le poème « DICTÉ APRÈS JUILLET 1830 » : « Nous verrons avec majesté, / Comme une mer sur ses rivages, / Monter d’étages en étages / L’irrésistible liberté ! » (Hugo) est parodié dans le vers proposé par le premier précepteur qui se vante, à l’instar d’Hugo, d’avoir « commencé par chanter la monarchie en quelque sorte », et de « semble[r] cette fois chanter la république ». Ce vers est : « Chantons la liberté, qui refleurit plus âpre… ». (p. 248). Avant de mourir, Lorenzo a cet aphorisme : « J’étais une machine à meurtre, mais à un meurtre seulement » (p. 250). Il ironise sur un sicaire impuissant à le tuer, malgré la rançon magnifique promise : « Le pauvre homme portait une espèce de couteau long comme une broche ; il le regardait d’un air si penaud qu’il me faisait pitié ; c’était peut-être un père de famille qui mourait de faim » Selon Simon Jeune, cela rappelle l’ultime réplique des Brigands de Friedrich Schiller. La mort de Lorenzo, comme celle d’Alexandre, a la brièveté d’un orgasme. Cela rappelle comment dans Le Rouge et le Noir, Stendhal avait passé sans peser sur l’exécution de Julien comme sur l’assassinat raté de Mme de Rénal.
– Voir maintenant les pièces postérieures à Lorenzaccio.
– Si ce petit article ne vous a pas trop déplu, merci de faire un lien depuis votre site, comme Lettres volées, Littéralille et bmlettres.
– Une version peu connue du mythe, celle de Paul Morand, dans la nouvelle « Lorenzaccio ou le retour du Proscrit », recensée par l’ami Jean-Yves.
– Parution en 2014 de La Vie sexuelle de Lorenzaccio, court essai de Catherine Dufour (Mille et une nuits, Fayard, 54 p., 2,5 €). Il s’agit d’un résumé de la pièce vu sous l’angle sexuel. Lorenzo est vu comme « un énorme sex-toy dépressif » qui « se promène dans Florence » ! Merci à l’auteure d’avoir cité notre article. Voir la présentation du livre sur son site, ainsi qu’une biographie de Musset.
– Il a fallu attendre que je visite Prague en 2016 pour me rendre compte qu’Alfons Mucha, l’auteur de l’affiche et des costumes de Sarah Bernhardt, n’était pas simplement un affichiste, mais un artiste plus qu’illustre dans son pays ; j’y ai retrouvé aussi quelques traces d’Otomar Krejca, le metteur en scène de la version de 1969.
Voir en ligne : La page du site « Lettres volées » sur Lorenzaccio
© altersexualite.com 2012. Reproduction interdite.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Voir pour des opinions du même tonneau, mes honorables collègues du site « Lettres volées ».
[2] En fait, sa tante, mais Marguerite se trompe, ainsi que Musset au moins une fois, dans la scène II, 4 (p. 175).
[3] L’édition de la Pléiade ne précise pas l’histoire de la publication du texte de Varchi, semble-t-il assez compliquée : ces chroniques lui auraient été commandées par Côme Ier, mais n’auraient été publiées qu’au XVIIIe siècle, deux ans avant l’Apologie de Lorenzino.
[4] Attention, la position politique de Musset évoluera subséquemment vers le parti de l’Ordre, jusqu’à l’Empire y compris. D’autre part, c’est une saine habitude de ne pas transférer sur l’auteur les opinions des personnages ou nos propres opinions !
[5] Il y a une autre scène supprimée signalée en note p. 1044, mais elle n’a pas le même statut, car elle a été publiée, et seulement retranchée par l’auteur lui-même à partir des éditions de 1853. C’est la courte scène où les étudiants attaquent les soldats. Selon le choix éditorial, elle peut se retrouver dans le texte.
[6] La mise en scène de Franco Zeffirelli pour la Comédie française, qui date de 1977, et est la seule disponible en DVD pour l’enseignement, restitue par le jeu cette dimension autocensurée : Francis Huster (Lorenzaccio) embrasse sur la bouche Tebaldeo en lui proposant de venir « à [s]on palais ». De même dans de nombreuses scènes avec le duc ou avec le jeune peintre, il est très tactile !
[7] Profitons-en pour acheter et lire le beau livre érudit qu’elle vient de consacrer, avec Robert Vinas, à l’histoire de La Compagnie catalane en Orient (T.D.O. Éditions, 2012, 240 p., 42 €).
[8] Qualifier d’« acte de courage » cet assassinat d’un homme qu’on a désarmé, voilà qui pourrait faire l’objet d’une question !
[9] « Lui marchand ? C’est pure médisance, il ne l’a jamais été. Tout ce qu’il faisait, c’est qu’il était fort obligeant, fort officieux ; et comme il se connaissait fort bien en étoffes, il en allait choisir de tous les côtés, les faisait apporter chez lui, et en donnait à ses amis pour de l’argent. (IV, 3)
[10] « Demain du sang noir / sèchera au grand soleil / sur les routes. »
[11] « Notre grand flandrin de vicomte […] ne saurait me revenir : et depuis que je l’ai vu, trois quarts d’heure durant, cracher dans un puits pour faire des ronds, je n’ai pu jamais prendre bonne opinion de lui. » (V, 4).
[12] Il confond deux Brutus de l’histoire romaine, « celui qui chassa les Tarquin et celui qui tua Jules César » (p. 1020)
[13] Ce type d’ecclésiastique ainsi que la crapulerie régnant dans la cité font songer à la bande dessinée Le Pape terrible, d’Alejandro Jodorowsky & Théo, dont l’action est censée se passer une vingtaine d’années auparavant, sous le pape Jules II.
 altersexualite.com
altersexualite.com