Accueil > Cours & documents pédagogiques > Insultes & discriminations : ce que nous apprennent livres, théâtre et (...)
D’Aristophane à Sattouf et Youssoupha…
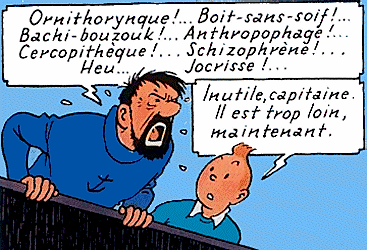 Insultes & discriminations : ce que nous apprennent livres, théâtre et rap
Insultes & discriminations : ce que nous apprennent livres, théâtre et rap
Homophobie, racisme, mœurs, hygiène : à quoi touchent les insultes ?
samedi 15 juin 2013
À l’origine, cet article constituait un bref prolongement d’un article consacré à la restitution d’une intervention de l’association Contact auprès de classes de 2de, basée sur une réflexion sur le rapport entre insultes et discriminations. Au fil des années, l’article s’est étoffé au gré de mes lectures et trouvailles. Voici donc quelques ressources de tout poil pour travailler sur le thème des insultes. Et vous verrez que c’est sérieux, puisque même des universités s’emparent de ce thème. L’idée de départ est d’éviter de prendre les insultes toujours au premier degré. Réprimer, faire des lois de répression des propos racistes, antisémites, homophobes, cela fait 30 ans qu’on fait cela, et que cela échoue. Si l’on abordait ces choses par le versant culturel, ce serait, à mon humble avis, plus productif. Quant aux enfants de *** qui ne sont pas contents, qu’ils aillent illico se faire *** sur le site de l’insultron !
Plan de l’article
Gargantua : fouaciers vs bergers
Shakespeare
Molière, Marivaux, Casanova, Musset, Hugo, Verdi
Une Charogne et un hareng saur
Claudel, Birago Diop, Pierre Jourde…
Émile Zola
Aristophane, Alain, Sartre…
John Fante
Robert Antelme
Au cinéma
Riad Sattouf, les collégiens & présidents de républiques, Bigard
La « parenté à plaisanterie » selon Amadou Hampâté Bâ
Les « dozens », insultes ritualisées dans le rap
Rap et « battles » hip-hop
Il faudrait commencer peut-être par la plus ancienne épopée du monde, L’épopée de Gilgamesh, dans laquelle les insultes et le combat farouche d’Enkidou avec le héros débouchent sur le plus grand amour possible. N’est-ce par un signe, sinon une preuve, que l’insulte homophobe est parfois paradoxalement un symptôme subtil d’homosexualité, qu’il vaudrait mieux s’efforcer de canaliser plutôt que de l’enflammer ? Au Moyen-Âge, les Sagas légendaires islandaises sont friandes d’insultes rituelles dans lesquelles, comme nous l’apprend Régis Boyer, « la pire des infamies est, pour un être humain, de se comporter comme s’il appartenait au sexe opposé, notamment en matière sexuelle. Sinfjötli accuse son interlocuteur d’ergi, l’homosexualité passive : c’était, selon les codes de lois, un óbótamál, un cas d’insulte si grave que la loi ne prévoyait pas de possibilité de compensation pour une telle offense. D’autre part, Snorri Sturluson dit dans son Ynglinga Saga (premier texte de sa Heimskringla) que l’exécution de l’opération magique dite sejðr s’accompagnait d’un tel épuisement qu’elle mettait l’homme qui la pratiquait en état d’ergi, ce pourquoi, toujours selon lui, la pratique était la spécialité des femmes ».
Gargantua : fouaciers vs bergers
Voici une belle bordée d’injures très humanistes. En cours de français, on pourrait aussi coupler une intervention d’association comme Contact sur les insultes avec une lecture de l’extrait célèbre du chapitre 25 de Gargantua, de Rabelais, contenant la fameuse litanie des fouaciers de Lerné contre les bergers de Gargantua, que je préfère donner ici en version originale, pour découpler la valeur poétique du signifiant de la bassesse référentielle du signifié :
« A leur requeste ne feurent aulcunement enclinez les fouaciers, mais (que pis est) les oultragerent grandement, les appelans trop diteulx, breschedens, plaisans rousseaulx, galliers, chienlictz, averlans, limes sourdes, faictneans, friandeaulx, bustarins, talvassiers, riennevaulx, rustres, challans, hapelopins, trainneguainnes, gentilz flocquetz, copieux, landores, malotruz, dendins, baugears, tezez, gaubregeux, gogueluz, claquedans, boyers d’etrons, bergiers de merde, et aultres telz epithetes diffamatoires, adjoustans que poinct à eulx n’apartenoit manger de ces belles fouaces, mais qu’ilz se debvoient contenter de gros pain ballé et de tourte ». (Lire la suite).
Dans la lignée de Rabelais, Cervantès nous sert une bonne tartine de « fidepute ». Voir aussi la terrible scène de l’affrontement entre les mineurs et la troupe, sixième partie, chapitre V de Germinal : « Et, sans attendre, elle tomba sur l’armée, la bouche noire, vomissant l’injure. — Tas de canailles ! tas de crapules ! ça lèche les bottes de ses supérieurs, ça n’a de courage que contre le pauvre monde ! Alors, les autres se joignirent à elle, ce furent des bordées d’insultes. Quelques-uns criaient encore : « Vivent les soldats ! au puits l’officier ! » Mais bientôt il n’y eut plus qu’une clameur : « À bas les pantalons rouges ! » Ces hommes qui avaient écouté, impassibles, d’un visage immobile et muet, les appels à la fraternité, les tentatives amicales d’embauchage, gardaient la même raideur passive, sous cette grêle de gros mots. Derrière eux, le capitaine avait tiré son épée ; et, comme la foule les serrait de plus en plus, menaçant de les écraser contre le mur, il leur commanda de croiser la bayonnette. Ils obéirent, une double rangée de pointes d’acier s’abattit devant les poitrines des grévistes. — Ah ! les jean-foutre ! hurla la Brûlé, en reculant. Déjà, tous revenaient, dans un mépris exalté de la mort. Des femmes se précipitaient, la Maheude et la Levaque clamaient : — Tuez-nous, tuez-nous donc ! Nous voulons nos droits. » (édition Pocket, p. 446).
Dans le monde paysan, Henri Vincenot dans La Vie quotidienne des paysans bourguignons au temps de Lamartine (1976), explique la tradition des « mais », forme d’insulte ritualisée : « C’est ce groupe de jeunes hommes de treize à vingt ans qui va couper les « mais », ces baliveaux de charme que l’on fixe solidement à la porte des filles le jour du 1er mai. C’est lui qui décide si l’on doit accompagner d’un bouquet de fleur le « mai » de la fille aimable et simple, ou d’une touffe de « peigne-treue » celui de la grincheuse, ou d’un « râchon d’épeune » (touffe d’épine) pour la méchante, d’une branchette de sureau pour les inconstantes, d’un rameau de verne pour celle qui a trahi. Pour les filles de mauvaise vie âgées de moins de vingt-cinq ans, ils décidaient d’attacher à la porte, sans baliveau, un paquet d’ordures, fixé par une guenille, mais cette décision devait être prise à l’unanimité du groupe des jeunes hommes, car la chose était grave ». Vincenot justifie cette tradition en mentionnant des exemples où cette tradition avait permis de changer le caractères des victimes.
Shakespeare
Quant au maître Shakespeare, dans Troïlus et Cresside, pièce elle-même peu mémorable, il a laissé de mémorables scènes d’insultes plus ou moins amicales, entre Achille, Patrocle et Thersite, le serviteur d’Ajax (personnage mineur qui existe chez Homère). Exemple parmi d’autres (Acte V, scène 1 ; éditions Bouquins, Robert Laffont, 2002, traduction de Pierre Spriet & Gilles Monsarrat), véritable « dozen » avant la lettre (cf. ci-dessous) :
« ACHILLE : Alors, bourbillon plein de malignité, Ulcère croûteux de la nature, quelles nouvelles ?
THERSITE : Eh bien ! image de ce que tu parais être et idole des adorateurs de sots, voici une lettre pour toi.
ACHILLE : D’où vient-elle, rogaton ?
THERSITE : Mais, plat d’andouilles, elle vient de Troie. […]
PATROCLE : Bien dit, pervertisseur. Et à quoi servent ces calembredaines ?
THERSITE : Tais-toi, je te prie, gamin. Ce que tu dis ne m’apprend rien. On pense que tu es le valet-servante [« male varlet »] d’Achille.
PATROCLE : « Valet-servante », gredin ? Qu’est-ce que c’est ?
THERSITE : Eh ! Sa catin masculine [« masculine whore »]. Et donc, que les maladies pourries du sud, les coliques, les hernies, les flux d’humeurs, les calculs dans les reins, les apoplexies, les froides paralysies et le reste frappent, et frappent encore ces perversions manifestes !
PATROCLE : Ah ! çà ! réceptacle damné de malignité, pourquoi maudire ainsi ?
THERSITE : Est-ce que je te maudis ?
PATROCLE : Eh bien non ! tonneau délabré, foutu roquet bâtard, non.
THERSITE : Non ? Pourquoi alors es-tu si furieux ? Tu n’es qu’un écheveau de bourre de soie sans valeur ou utilité, un morceau de taffetas vert qu’on colle sur un œil malade, le gland de la bourse d’un prodigue, voilà ce que tu es, toi ! Ah ! comme ce pauvre monde est infesté de tels moucherons ! Ces nabots de la nature.
PATROCLE : Va-t’en, bilieux !
THERSITE : Œuf de pinson ! ».
L’accusation d’homosexualité est remise en cause par une saillie de Thersite sur Patrocle, ce qui montre que l’insulte est indépendante de son contenu référentiel : « Patrocle me donnera n’importe quoi si je lui parle de cette catin. Le perroquet ne fera pas plus pour avoir une amande que lui pour avoir une ribaude complaisante. Luxure, luxure, toujours guerres et luxure ! » Mieux, quand Hector tombe sur lui pendant le combat, Thersite n’hésite pas à s’insulter lui-même pour sauver sa peau :
« HECTOR : Qui es-tu, Grec ? Peux-tu te mesurer à Hector ? Es-tu de bon sang et honorable ?
THERSITE : Non, non, je suis un vaurien, un galeux, un coquin injurieux, un ignoble gredin.
HECTOR : Je te crois volontiers : vis donc ! »
La Comédie-Française a eu l’idée bizarre d’exhumer cette pièce de l’oubli en 2013. Je croyais que la représentation sauverait ce bavardage iconoclaste (j’avais vu il y a deux ans aux Bouffes du Nord une mise en scène délirante d’une bluette de jeunesse du maître, La Comédie des erreurs, par Dan Jemmett), mais que nenni, la mise en scène de Jean-Yves Ruf tient du défilé de mode, devant un décor indigent qui encombre la scène du début à la fin des 3 h de pensum, d’une tribune où les acteurs reposent leurs ulcères (les héros-éros sont tous plus ou moins syphilitiques) en déclamant face aux spectateurs, et d’une palissade de panneaux de bois sculptés qui nous empêche de contempler l’absence de décor qui se cache derrière. Je pensais à l’épigraphe de Zazie dans le métro, sur ce fameux mur élevé par les Achéens, dont Aristote aurait dit que « celui qui l’a créé l’a détruit ». Le problème, c’est que celui qui a commandé ces décors les a sans doute trouvés trop chers pour les ôter de notre vue ! Ce qui m’a le plus agacé est le choix du comédien, pour camper Patrocle, de surjouer l’efféminement, contresens total autant pour le Patrocle des Grecs que pour celui de Shakespeare. Rappelons que dans Le Banquet de Platon, Patrocle est présenté comme l’amant, et non l’aimé, d’Achille… Heureusement, reste le plaisir de revoir d’excellents acteurs. Michel Vuillermoz, qui fut parfait en Cyrano, est Hector, quel joli parallèle… Loïc Corbery déjanté campe parfaitement l’Ajax détergenté de Shakespeare ; Michel Favory argente ses favoris et yoyote de sa touffe chenue pour crachoter un Nestor grabataire, etc.
Victor Hugo himself, sans doute interpellé par les travaux de son fils François-Victor Hugo, traducteur de Shakespeare, a laissé quelques lignes de brouillon sur une ébauche de comédie à propos du même Thersite, d’Achille et Patrocle. Voir sur Culture & Débats les archives de la revue Arcadie à ce sujet.
Molière, Marivaux, Casanova, Musset, Hugo, Verdi
Dans Amphitryon de Molière, Acte Ier, scène 2 : quand Mercure déguisé en lui-même, bat Sosie pour l’obliger à reconnaître qu’il n’est pas lui, au moment où Mercure fait trêve de coups et l’injurie, Sosie est soulagé : « Quoi ? Pendard, imposteur, coquin… / Pour des injures, Dis-m’en tant que tu voudras : / Ce sont légères blessures, / Et je ne m’en fâche pas ».
Dans L’Île des esclaves (1725), Marivaux inverse les rôles entre maître et valet, occasion pour Cléanthis de rappeler à sa maîtresse Euphrosine comment elle l’injurie à longueur de journée :
« CLÉANTHIS. – J’ai aussi des surnoms ; vous plaît-il de les savoir ?
TRIVELIN. – Oui-da. Et quels sont-ils ?
CLÉANTHIS. – J’en ai une liste : Sotte, Ridicule, Bête, Butorde, Imbécile, et caetera.
EUPHROSINE, en soupirant. – Impertinente que vous êtes !
CLÉANTHIS. – Tenez, tenez, en voilà encore un que j’oubliais.
TRIVELIN. – Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l’on en peut dire impunément. »
Casanova réfléchit sur les insultes européennes. À Livourne il fait connaissance d’un mauvais poète, Giacomo Passano, qui souhaite publier des vers insultant un abbé Chiari : « Chacun de ses sonnets n’était qu’une plate filastroque qui finissait par dire que l’abbé Chiari était un coglione. Il ne le prouvait pas ; mais il disait qu’il l’était, et cela pouvait suffire pour faire de la peine à ce prêtre bressan qui d’ailleurs n’était pas coglione ; mais homme d’esprit, et poète, qui, s’il avait connu le théâtre, aurait surpassé Goldoni, car il possédait mieux la langue. Ce mot coglione, qui proprement signifie testicule, se prend en Italie dans l’acception de sot, comme coïon en français veut dire viédase, et en allemand faquin. On ne peut pas dire à un Allemand un mot plus injurieux de coïon, comme faquin à un Français ».
Dans Les Caprices de Marianne, belle scène d’échange d’insultes gracieuses entre Octave et Claudio :
« OCTAVE. — Par quelle oreille, sénateur incorruptible ?
CLAUDIO. — Par celle de ma femme, qui m’a tout raconté, godelureau chéri.
OCTAVE. — Tout absolument, époux idolâtré ? Rien n’est resté dans cette charmante oreille ?
CLAUDIO. — Il y est resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire » (p. 88).
Dans Les Travailleurs de la mer, Victor Hugo met dans la bouche de son héros dans lequel il s’identifie, une des plus belles insultes de la littérature : comme la tempête menace de détruire son œuvre, et qu’il parvient, à force d’industrie, à la dompter, il la traite de « cruche » : « Cette chose faite, il prit d’ une flaque de pluie un peu d’eau dans le creux de sa main, but, et dit à la nuée : cruche ! »
Plus prosaïquement, le biographe Jean-Marc Hovasse rapporte un graffiti de Totor en tournée avec sa Juliette, sur le mur d’une auberge à Laon. Ne pardonnerait-on pas un élève qui croquerait ainsi un de ses profs sur une table de lycée ?
« Vendeur de fricot frelaté,
Hôtelier chez qui se fricasse
L’ordure avec la saleté,
Gargotier chez qui l’on ramasse
Soupe maigre et vaisselle grasse
Et tous les poux de la cité,
Ton auberge comme ta face
Est hure pour la bonne grâce
Et groin pour la propreté. »

Dans La Traviata, Acte II, scène 2, de Giuseppe Verdi, Alfredo « jette avec mépris et colère une bourse aux pieds de Violetta », dont il ignore que si elle l’a quitté pour un autre homme c’est parce que son propre père l’en a suppliée pour que son état de courtisane n’entache pas la réputation familiale. Fait exceptionnel, tous les invités et son père lui reprochent aussitôt cet outrage et cette insulte : « Il ne mérite que le mépris celui qui, même dans la colère, offense une femme. » ; « L’injure atroce faite à cette femme, nous a tous offensés, mais un tel outrage sera vengé ».
Je place ici un intermède musical et cinématographique, dû à Richard Gotainer, « Saperlipopette », qui n’est pas sans rappeler la « Ronde des jurons » de Georges Brassens.
Charogne ! Toi-même eh hareng saur !

Le peintre belge James Ensor (1860-1949) se faisait moquer par les critiques qui avaient transformé son patronyme en calembour (« art-Ensor »). Il retourna l’injure dans un tableau fameux intitulé « Squelettes se disputant un hareng saur » (1891) visible aux Musées des beaux-arts royaux de Bruxelles (photographié ci-dessus par votre serviteur en juillet 2017). Les squelettes représentent bien sûr les inspirés critiques ! Une mise en abyme de ce tableau par son auteur dans un « cabinet d’amateur » est à voir au Musée d’art de Tel Aviv.
L’une des injures traditionnelles les plus usitées est devenu le titre d’un des plus fameux poèmes des Fleurs du mal de Charles Baudelaire : « Une charogne ». Le mot est à prendre à double sens, car la charogne c’est à la fois le cadavre que le poète donne en spectacle à sa belle, mais c’est aussi sans doute le nom d’oiseau adressé par antiphrase à l’aimée : « Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, / À cette horrible infection, / Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, / Vous, mon ange et ma passion ! » Peu connu, le tableau éponyme du peintre symboliste Gustav-Adolf Mossa (1883-1971) visible également aux Musées des beaux-arts royaux de Bruxelles (photographié par votre serviteur en juillet 2017). On ne voit pas bien, mais un quatrain du poème de Baudelaire est reproduit au bas à gauche du tableau.

Claudel, Birago Diop, Pierre Jourde…
On se souvient que le grand Paul Claudel se rendit coupable d’insultes homophobes contre les surréalistes. Au lieu d’engraisser des avocats, ceux-ci lui répondirent vertement. Voir l’article de Jean-Yves. Pour la petite histoire, cette lettre réjouissante est reproduite dans l’excellent manuel Bordas Français, Textes et perspectives 1re, édition 2010, p. 314, comme exemple de pamphlet ! Je trouve un exemple très différent du même type de résilience face à l’insulte, dans un conte de Birago Diop, « Les Mamelles », reproduit dans Les Contes d’Amadou Koumba mais aussi dans l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française de Léopold Sédar Senghor (1948). Il s’agit d’un mari qui a deux épouses bossues, dont l’une tourne aigrie, tandis que l’autre prend son mal avec philosophie : « Quand on se moquait de la petite Koumba-Khoughé du temps où elle jouait, buste nu, en lui demandant de prêter un instant le bébé qu’elle avait sur le dos, elle répondait, en riant plus fort que les autres : « Ça m’étonnerait qu’il vienne avec toi. Il ne veut même pas descendre pour téter. » »
Dans son conte philosophique Carnets d’un voyageur zoulou dans les banlieues en feu (Gallimard, 2008, 120 p., 7 €), Pierre Jourde imagine que les banlieues de la Nubie souffrent de l’ultraviolence d’immigrés belges et catholiques. Façon ironique d’inverser la situation européenne. Il imagine les insultes typiquement belges que s’échangent les « jeunes » des banlieues nubiennes : « Les jeunes gens parlaient très fort, en se bousculant et en s’invectivant en des termes d’une crudité qui horrifiait le pauvre commerçant zoulou, avec des roulements de r, des syllabes traînantes, et de temps en temps un petit crachat par terre : « Alors l’autre bléter, j’y ai fait exploser les beuzes. - Arrêteke, rottekop, tu causes, mais t’es qu’un lawaïtemoeker, un babelleïr, alleï. – Lupt no de kluëte, platte beuze, ta mère la plode, elle t’a refilé des platloïes en t’accouchant, alleï. – Et toi, krapul van ’t strotche, zagher de ta race ! – Fafoul ! » Pour autant que le brave commerçant zoulou pouvait comprendre le patois de ces jeunes, les insultes, qui semblaient un élément indispensable de leur mode d’échange verbal, portaient principalement, d’une part sur leurs mamans respectives, d’autre part sur leurs « races ». On lui avait expliqué que les Belges se subdivisaient en Flamands et Wallons. Visiblement, les deux peuplades se trouvaient représentées dans le petit groupe. Les jeunes ne cessaient de se traiter de « plode de Wallon de ta race » ou de « Flamand de mes beuzes ». Toutefois, leur vindicte semblait surtout se porter sur deux autres peuples. »
Émile Zola
Dans le livre troisième de La Faute de l’abbé Mouret d’Émile Zola, belle scène d’insultes et même de rixe entre l’octogénaire Jeanbernat et le curé borné Frère Archangias, le premier étant prêt à essoriller le second, qui est prêt à le tuer au nom de Dieu ! « Oui, tu l’as fourrée dans son lit, répétait le Frère affolé ! Et tu avais mis un Christ sous le matelas pour que l’ordure tombât sur lui… Ha ! ha ! tu es étonné que je sache tout. Tu attends quelque monstre de cet accouplement-là. Tu fais chaque matin les treize signes de l’enfer sur le ventre de ta gueuse, pour qu’elle accouche de l’Antéchrist. Tu veux l’Antéchrist, bandit !… Tiens, que ce caillou t’éborgne ! »
La rixe des lingères Gervaise & Virginie au chapitre I de L’Assommoir n’a plus besoin d’être évoquée : « Salope ! » ; « rosse » ; « saleté » ; « Oui, oui, je vas te dessaler, grande morue ! » ; « La bataille recommença, muette, sans un cri, sans une injure. » Mais aussi au chapitre III, les surnoms de Gervaise et de Mme Lorilleux, qui blessent comme des injures : « Tu vas coucher dans la chambre à la Banban ! Gervaise devint toute pâle. Ce surnom, qu’elle recevait à la face pour la première fois, la frappait comme un soufflet. Puis, elle entendait bien l’exclamation de sa belle-sœur : la chambre à la Banban, c’était la chambre où elle avait vécu un mois avec Lantier, où les loques de sa vie passée traînaient encore. Coupeau ne comprit pas, fut seulement blessé du surnom. — Tu as tort de baptiser les autres, répondit-il avec humeur. Tu ne sais pas, toi, qu’on t’appelle Queue-de-Vache, dans le quartier, à cause de tes cheveux. Là, ça ne te fait pas plaisir, n’est-ce pas ?… […] Madame Lorilleux n’ajouta rien, se renfermant dans sa dignité, horriblement vexée de s’appeler Queue-de-Vache. » Au chapitre VII, Coupeau et Lantier passent insensiblement de l’injure à l’amitié, rendant possible le ménage à trois : « Ça s’arrangeait donc ? Coupeau et Lantier continuaient de causer au bord du trottoir. Ils s’adressaient encore des injures, mais amicalement. Ils s’appelaient « sacré animal », d’un ton où perçait une pointe de tendresse. Comme on les regardait, ils finirent par se promener doucement côte à côte, le long des maisons, tournant sur eux-mêmes tous les dix pas. Une conversation très-vive s’était engagée. Brusquement, Coupeau parut se fâcher de nouveau, tandis que l’autre refusait, se faisait prier. Et ce fut le zingueur qui poussa Lantier et le força à traverser la rue, pour entrer dans la boutique. »

Au chapitre X de L’Œuvre, Zola préfigure de nombreux discours modernes sur le caractère identitaire de l’injure ou l’« appropriation du stigmate », depuis Sartre pour qui l’antisémitisme constitue le juif, jusqu’à Didier Éribon qui applique cette idée aux homosexuels. L’histoire du Manifeste des 343 en 1971, devenu dans la mémoire collective, « Manifeste des 343 salopes » alors qu’au début c’était plutôt une insulte, constitue un exemple supplémentaire.
Claude Lantier, éternel refusé des Salons, a enfin un tableau représentant son enfant mort accepté grâce à une « charité » de son ami Fagerolles. Comme il ne parvient pas à trouver son tableau, « une idée venait de pousser Claude. Il s’ébahissait de n’avoir pu découvrir son tableau. Rien n’était plus simple. N’y avait-il donc pas une salle où l’on riait, un coin de blague et de tumulte, un attroupement de public farceur injuriant une œuvre ? Cette œuvre serait la sienne, à coup sûr. Il avait encore dans les oreilles les rires du Salon des Refusés, autrefois. Et, de chaque porte, il écoutait maintenant, pour entendre si ce n’était pas là qu’on le huait. » Mais lorsqu’il finit par trouver son tableau, en position si haute que personne ne le remarque, « Claude souffrait plus encore de l’abandon de son œuvre. Un étonnement, une déception, le faisait chercher des yeux la foule, la poussée à laquelle il s’attendait. Pourquoi ne le huait-on pas ? Ah ! les insultes de jadis, les moqueries, les indignations, ce qui l’avait déchiré et fait vivre ! Non, plus rien, pas même un crachat au passage : c’était la mort. »
Moins connue que la rixe de Gervaise & Virginie, L’Argent (1891) contient une page d’anthologie où deux amants qui se partagent une baronne se mesurent et ne mégotent pas sur l’injure, puisqu’il n’y a pas de mari présent, et que Saccard, l’amant surpris, n’a que faire de sa réputation :
« Enfin, il sentit la main de Clarisse tâtonnant le long de son bras. Il comprit, lui donna, sans une parole, une enveloppe ; où il avait glissé les deux cents francs promis. Et elle marcha la première, écarta la portière du cabinet, le poussa dans la chambre, en disant :
— Tenez ! les v’là !
Devant le grand feu, aux braises ardentes, Saccard était sur le dos, couché au bord de la chaise longue, n’ayant gardé que sa chemise, qui, roulée, remontée jusqu’aux aisselles, découvrait, de ses pieds à ses épaules, sa peau brune, envahie avec l’âge d’un poil de bête ; tandis que la baronne, entièrement nue, toute rose des flammes qui la cuisaient, était agenouillée ; et les deux grosses lampes les éclairaient d’une clarté si vive, que les moindres détails s’accusaient, avec un relief d’ombre excessif.
Béant, suffoqué par ce flagrant délit anormal, Delcambre s’était arrêté, pendant que les deux autres, comme foudroyés, stupides de voir entrer cet homme par le cabinet, ne bougeaient pas, les yeux élargis et fous.
— Ah ! cochons ! bégaya enfin le procureur général, cochons ! cochons !
Il ne trouvait que ce mot, il le répéta sans fin, l’accentua du même geste saccadé, pour lui donner plus de force. Cette fois, d’un bond, la femme s’était levée, éperdue de sa nudité, tournant sur elle-même, cherchant ses vêtements, qu’elle avait laissés dans le cabinet de toilette, où elle ne pouvait aller les reprendre ; et, ayant mis la main sur un jupon blanc resté là, elle s’en couvrit les épaules, garda les deux bouts de la ceinture entre les dents, afin de le serrer autour de son cou, contre sa poitrine. L’homme, qui avait quitté aussi la chaise longue, rabattit sa chemise, l’air très ennuyé.
« Cochons ! répéta encore Delcambre, cochons ! dans cette chambre que je paie ! »
Et, montrant le poing à Saccard, s’affolant de plus en plus, à l’idée que ces ordures se faisaient sur un meuble acheté avec son argent, il délira.
— Vous êtes ici chez moi, cochon que vous êtes ! Et cette femme est à moi, vous êtes un cochon et un voleur !
Saccard, qui ne se fâchait pas, aurait voulu le calmer, fort embarrassé d’être ainsi en chemise, et tout à fait contrarié de l’aventure. Mais le mot de voleur le blessa.
— Dame ! monsieur, répondit-il, quand on veut avoir une femme à soi tout seul, on commence par lui donner ce dont elle a besoin.
Cette allusion à son avarice acheva d’enrager Delcambre. Il était méconnaissable, effroyable, comme si le bouc humain, tout le priape caché lui sortait de la peau. Ce visage, si digne et si froid, avait brusquement rougi, et il se gonflait, se tuméfiait, s’avançait en un mufle furieux. L’emportement lâchait la brute charnelle, dans l’affreuse douleur de cette fange remuée.
— Besoin, besoin, balbutia-t-il, besoin du ruisseau… Ah ! Garce !
Et il eut vers la baronne un geste si violent, qu’elle prit peur. Elle était restée debout, immobile, ne parvenant à se voiler la gorge, avec le jupon, qu’en laissant à découvert le ventre et les cuisses. Alors, ayant compris que cette nudité coupable, ainsi étalée, l’exaspérait davantage, elle recula jusqu’à la chaise, s’y assit en serrant les jambes, en remontant les genoux, de façon à cacher tout ce qu’elle pouvait. Puis, elle demeura là, sans un geste, sans un mot, la tête un peu basse, les yeux obliques et sournois sur la bataille, en femelle que les hommes se disputent, et qui attend, pour être au vainqueur.
Saccard, courageusement, s’était jeté devant elle.
— Vous n’allez pas la battre, peut-être !
Les deux hommes se trouvèrent face à face.
— Enfin, monsieur, reprit-il, il faut en finir. Nous ne pouvons pas nous disputer comme des cochers… C’est très vrai, je suis l’amant de madame. Et je vous répète que, si vous avez payé les meubles ici, moi j’ai payé…
— Quoi ?
— Beaucoup de choses : par exemple, l’autre jour, les dix mille francs de son ancien compte chez Mazaud, que vous aviez absolument refusé de régler… J’ai autant de droits que vous. Un cochon, c’est possible ! mais un voleur, ah ! non ! Vous allez retirer le mot.
Hors de lui, Delcambre cria :
— Vous êtes un voleur, et je vais vous casser la tête, si vous ne déguerpissez pas à l’instant.
Mais Saccard, à son tour, s’irritait. Tout en remettant son pantalon, il protesta.
— Ah ! ça, dites donc, vous m’embêtez, à la fin ! Je m’en irai si je veux… Ce n’est pas encore vous que me ferez peur, mon bonhomme !
Et, quand il eut enfilé ses bottines, il tapa résolument des pieds sur le tapis, en disant :
— Là, maintenant, je suis d’aplomb, je reste.
Étouffant de rage, Delcambre s’était rapproché, le mufle en avant.
— Sale cochon, veux-tu filer !
— Pas avant toi, vieille crapule !
— Et si je te flanque ma main sur la figure !
— Moi, je te plante mon pied quelque part !
Nez à nez, les crocs dehors, ils aboyaient. Oublieux d’eux-mêmes, dans cette débâcle de leur éducation, dans ce flot de vase immonde du rut qu’ils se disputaient, le magistrat et le financier en vinrent à une querelle de charretiers ivres, à des mots abominables, qu’ils se lançaient, avec un besoin croissant de l’ordure, comme des crachats. Leurs voix s’étranglaient dans leur gorge, ils écumaient de la boue.
Sur sa chaise, la baronne attendait toujours que l’un des deux eût jeté l’autre dehors. Et, calmée déjà, arrangeant l’avenir, elle n’était plus gênée que par la présence de la femme de chambre, qu’elle devinait derrière la portière du cabinet de toilette, restée là pour se faire un peu de bon sang. Cette fille, en effet, ayant allongé la tête, avec un ricanement d’aise, à entendre des messieurs se dirent des choses si dégoûtantes, les deux femmes s’aperçurent, la maîtresse accroupie et nue, la servante droite et correcte, avec son petit col plat ; et elles échangèrent un flamboyant regard, la haine séculaire des rivales, dans cette égalité des duchesses et des vachères, quand elles n’ont plus de chemise.
Mais Saccard, lui aussi, avait vu Clarisse. Il achevait de s’habiller violemment, enfilait son gilet et revenait lâcher une injure dans la figure de Delcambre, passait la manche gauche de sa redingote et en criait une autre, passait la manche droite et en trouvait d’autres, d’autres toujours, à pleins baquets, à la volée. Puis, tout d’un coup, pour en finir :
— Clarisse, venez donc !… Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres, pour que toute la maison et toute la rue entendent !… Monsieur le Procureur général veut qu’on sache qu’il est ici, et je vais le faire connaître, moi !
Pâlissant, Delcambre recula, en le voyant se diriger vers une des fenêtres, comme s’il voulait en tourner la crémone. Ce terrible homme était très capable d’exécuter sa menace, lui qui se moquait du scandale.
— Ah ! canaille, canaille ! murmura le magistrat. Ça fait bien la paire, vous et cette catin. Et je vous la laisse…
— C’est ça, décampez ! On n’a pas besoin de vous… Au moins, ses factures seront payées, elle ne pleurera plus misère… Tenez ! voulez-vous six sous, pour prendre l’omnibus ?
Sous l’insulte, Delcambre s’arrêta un instant, au seuil du cabinet de toilette. Il avait de nouveau sa haute taille maigre, sa face blême, coupée de plis rigides. Il étendit le bras, il fit un serment.
— Je jure que vous me paierez tout ça… Oh ! je vous retrouverai, prenez garde ! »
Dans La Débâcle (Première partie, chapitre II), l’une des scènes initiales entre les futurs parangons de l’amitié, Jean et Maurice, les montre s’insultant, mais ce qui est émouvant et fort bien vu, c’est que ces insultes cachent un intérêt pour l’autre et une quête d’amitié : « Et Maurice avait déjà posé son fusil sur un tas de pierres, lorsque Jean, qui tentait vainement de s’opposer à cet abandon abominable des armes, l’aperçut. Il se précipita. — Reprenez votre fusil tout de suite, tout de suite, entendez-vous ! Un flot de terrible colère était monté soudain à la face de Jean. Lui, si calme d’habitude, toujours porté à la conciliation, avait des yeux de flamme, une voix tonnante d’autorité. Ses hommes, qui ne l’avaient jamais vu comme ça, s’arrêtèrent, surpris. — Reprenez votre fusil tout de suite, ou vous aurez affaire à moi ! Maurice, frémissant, ne laissa tomber qu’un mot, qu’il voulait rendre outrageux. — Paysan ! — Oui, c’est bien ça, je suis un paysan, tandis que vous êtes un monsieur, vous !… Et c’est pour ça que vous êtes un cochon, oui ! Un sale cochon. Je ne vous l’envoie pas dire. Des huées s’élevaient, mais le caporal poursuivait avec une force extraordinaire : — Quand on a de l’instruction, on le fait voir… Si nous sommes des paysans et des brutes, vous nous devriez l’exemple à tous, puisque vous en savez plus long que nous… Reprenez votre fusil, nom de dieu ! Ou je vous fais fusiller en arrivant à l’étape. Dompté, Maurice avait ramassé le fusil. Des larmes de rage lui voilaient les yeux. Cependant, quelques pages plus loin, Maurice est à nouveau pris à partie par Jean, et en est ému… comme le lecteur : « Jean, calmé, dit poliment à Maurice, comme s’il ne se fût pas adressé à un de ses hommes : — Monsieur, vous ne pouvez pas être avec les lâches… Allez, nous ne sommes pas encore battus, c’est nous qui finirons bien par les rosser un jour, les Prussiens ! À cette minute, Maurice sentit un chaud rayon de soleil lui couler jusqu’au cœur. Il restait troublé, humilié. Quoi ? cet homme n’était donc pas qu’un rustre ? Et il se rappelait l’affreuse haine dont il avait brûlé, en ramassant son fusil, jeté dans une minute d’inconscience. »
Mais chez un auteur qui publia fort jeune un livre de critiques sous le titre Mes haines, l’insulte est souvent directe ou bien pratique l’ironie, d’autant qu’en journaliste, il sait fort bien combien le scandale apporte en publicité. Ainsi par exemple dès la publication de Thérèse Raquin, Zola répond avec malice à un article de « Ferragus » (Louis Ulbach) intitulé « La littérature putride », en faisant mine de ne pas reconnaître son contradicteur (alors qu’en tant que journaliste et auteur déjà en correspondance avec les plus grands critiques, il devait bien savoir de quoi il retournait). : « Je vous avoue, monsieur, que je vous aurais répondu tout de suite si je n’avais éprouvé un scrupule bête. J’aime à savoir à qui je m’adresse, votre masque me gêne. J’ai peur de vous dire des choses désagréables sans le vouloir. Oh ! je me suis creusé la tête. J’ai épelé votre article, fouillant chaque mot, cherchant une personnalité connue au fond de vos phrases. Je déclare humblement que mes recherches ont été vaines. Votre style a un débraillé violent qui m’a dérouté. Quant à vos opinions, elles sont dans une moyenne honnête ne portant pas de signature individuelle.
On m’a bien cité quelques noms : mais, vraiment, monsieur, si vous êtes un de ceux que l’on m’a nommés, il est à croire que le masque vous a donné le langage bruyant et lâché de nos bals publics. Quand on a le visage couvert, on peut se permettre l’engueulement classique, surtout en un temps de carnaval. Je me plais à penser que, dans un salon, vous dévorez les gens avec plus de douceur.
Donc, monsieur, je n’ai pu vous reconnaître. J’essaie de répondre posément et sagement à un inconnu déguisé en Matamore qui, en se rendant un samedi à l’Opéra, a rencontré un groupe de littérateurs, et qui a voulu les effrayer en faisant la grosse voix. »
Ce qui est amusant c’est que dans ce premier roman (Chapitre XXXI) qu’on accuse de tous les maux, Zola, qui nous en a fait voir des vertes et des pas mûres, éprouve une étrange pudeur devant un simple mot d’insulte : « Monsieur ne fait rien, monsieur s’est arrangé de façon à vivre à mes dépens, les bras croisés… Non, tu n’auras rien, pas un sou… Veux-tu que je te le dise, eh bien ! tu es un… Et elle dit le mot. Laurent se mit à rire en haussant les épaules. Il se contenta de répondre : — Tu apprends de jolis mots dans le monde où tu vis maintenant. Ce fut la seule allusion qu’il se permit de faire aux amours de Thérèse. Celle-ci redressa vivement la tête et dit d’un ton aigre : — En tout cas, je ne vis pas avec des assassins. »
Aristophane, Alain, Sartre…
Pour une réflexion sur la pratique rituelle des insultes chez les Grecs antiques, lire l’article de Rossella Saetta Cottone sur les comédies d’Aristophane : « Injures onomasti et public : éléments pour une analyse interactionnelle », Methodos, 7 (2007). Un autre extrait fort intéressant pour nos élèves se trouve dans un livre de Vahan Totovents, « Une enfance arménienne » : l’insulte suprême y est adressée aux « amateurs de pigeons » ! Quant au philosophe Alain, il nous propose une belle page sur le sujet : « Si un phonographe vous couvrait soudainement d’injures, cela vous ferait rire. Si un homme de mauvaise humeur, mais à peu près sans voix, faisait marcher un phonographe à injures pour contenter sa colère, personne ne croirait que telle injure, blessante par hasard, lui était destinée. Mais quand c’est la face humaine qui lance l’injure, chacun veut croire que tout ce qu’elle dit était prémédité, ou tout au moins est pensé dans l’instant même. Ce qui trompe, c’est l’éloquence des passions et l’espèce de sens qu’offrent presque toujours des paroles produites sans pensée par une bouche humaine. […] Il est à supposer que les jurons, qui sont des exclamations entièrement dépourvues de sens, ont été inventés comme instinctivement pour donner issue à la colère, sans rien dire de blessant ni d’irréparable. Et nos cochers, dans les encombrements, seraient donc philosophes sans le savoir. Mais il est bien plaisant de voir que parmi ces cartouches à blanc, quelquefois il y en a une qui blesse par hasard. On peut m’injurier en russe, je n’y entends rien. Mais si par hasard je savais le russe ? Réellement toute injure est charabia. » (Alain, Propos sur le bonheur, LXXII, « Injures »). Propos à rapprocher de la fameuse citation de Sartre dans Qu’est-ce que la littérature ?, Folio, p. 30-32 : « Il sait que les mots, comme dit Brice Parain, sont des « pistolets chargés ». S’il parle, il tire. Il peut se taire, mais puisqu’il a choisi de tirer, il faut que ce soit comme un homme, en visant des cibles et non comme un enfant, au hasard, en fermant les yeux et pour le seul plaisir d’entendre les détonations. »
John Fante
Dans Demande à la poussière, le personnage principal, Arturo Bandini, double de l’auteur, mal à l’aise avec ses origines ritales, insulte la petite serveuse mexicaine dont il est amoureux, laquelle nie sa mexicanité ; mais il est conscient que ses insultes racistes proviennent de son propre malaise par rapport à ses origines : « Je les vois tituber à la sortie de leurs palais du cinéma, même qu’ensuite ils clignent leurs yeux vides pour affronter de nouveau la réalité ; ils rentrent chez eux encore tout hébétés et ils lisent le Times pour voir ce qui se passe dans le monde. J’ai vomi à lire leurs journaux, j’ai lu leur littérature, observé leurs coutumes, mangé leur nourriture, désiré leurs femmes, visité leurs musées. Mais je suis pauvre et mon nom se termine par une voyelle, alors ils me haïssent, moi et mon père et le père de mon père, et ils n’aimeraient rien tant que de me faire la peau et m’humilier encore, mais à présent ils sont vieux, en train de crever au soleil au milieu de la rue, en pleine chaleur, en pleine poussière, tandis que moi je suis jeune, plein d’espoir et d’amour pour mon pays et mon époque ; alors quand je te traite de métèque ce n’est pas mon cœur qui parle mais cette vieille blessure qui l’élance encore, et j’ai honte de cette chose horrible que je t’ai faite, tu peux pas savoir » (édition 10:18, p. 77). Les deux personnages s’insultent copieusement tout en s’aimant : « Je lui ai tapoté la main en souriant. Elle était chaude, fine, brune, avec de longs doigts. « Ma petite princesse mexicaine… Si charmante, si innocente… » Elle a aussitôt retiré sa main. Elle était livide. « Je suis pas mexicaine ! Je suis américaine. » « Non, pour moi tu seras toujours une gentille petite fille de péon. Une fille-fleur du vieux Mexique. » « Sale rital, fils de pute ! » elle m’a fait. » (p. 101).
Robert Antelme
Dans un camp de concentration où il est interné pour résistance, entre août 1944 et fin avril 1945, Robert Antelme a survécu de justesse. Il raconte dans ces conditions extrêmes de détention et de déchéance sans utiliser aucun euphémisme. On pisse, on chie et on meurt dans la crudité du langage. Voici une réflexion sur l’insulte, basée ici sur un mot pourtant anodin : « Je suis sorti du bureau et j’ai remis mon calot. Dans l’escalier, j’ai croisé un civil de trop près. Il portait une blouse grise, des bottes, un petit chapeau vert.
– Weg ! (fous le camp !), m’a-t-il dit d’une voix rauque.
Ça a glissé. Ça n’avait peut-être pas grande importance ici. Mais c’était le mouvement même du mépris – la plaie du monde –, tel qu’il règne encore partout plus ou moins camouflé dans les rapports humains. Tel qu’il règne encore dans le monde dont on nous a retirés. Mais ici c’était plus net. Nous donnions à l’humanité méprisante le moyen de se dévoiler complètement.
Le civil m’avait dit très vite : Weg ! Il ne s’était pas attardé, il avait dit cela en passant et le mot l’avait calmé. Mais il aurait pu faire éclore sa vérité : « Je ne veux pas que tu sois. »
Mais j’étais encore. Et ça glissait.
Au prolétaire le plus méprisé la raison est offerte. Il est moins seul que celui qui le méprise, dont la place deviendra de plus en plus exiguë et qui sera inéluctablement de plus en plus solitaire, de plus en plus impuissant. Leur injure ne peut pas nous atteindre, pas plus qu’ils ne peuvent saisir le cauchemar que nous sommes dans leur tête : sans cesse nié, on est encore là. » (p. 59)
Cette réflexion n’empêche pas Antelme d’utiliser à son tour l’insulte « tante » pour un détenu qui a une autre façon que la sienne de survivre : « Ça veut dire que le menuisier qui fait les petits travaux du lagerältester et qui lui fabrique des jouets pour la Noël, que la petite tante de stubendienst français droit commun, qui couche avec ce lagerältester, et d’autres petits copains, ont déjà eu leur rab, eux. » (p. 71). Les insultes sont finalement banales : « Ceux qui ne peuvent pas passer la gamelle par- dessus une épaule essaient d’atteindre le baquet par-dessous. Ils se font écraser la tête.
— Je ne servirai pas ! gueule le cuistot.
— Bande d’enculés, ils en ont plein le ventre ! crient les types qui s’écrasent contre le baquet et se piétinent.
Le kapo ordonne au cuistot de rentrer le baquet.
— Vous êtes comme des animaux ! gueule le cuistot.
C’est fini. Il n’y aura plus de rab ! — Scheisse ! ponctue le kapo en regardant la masse des types. » (p. 72)
Plus loin, autre réflexion sur ce type d’insultes : « — On sait que c’est un salaud, observa le camarade.
— T’en fais pas, si on se rencontre après, il y aura droit, fit Félix entre ses dents.
L’autre haussa les épaules. Il y avait longtemps déjà qu’on entendait ces menaces. Elles voulaient faire croire que la haine pouvait être chez certains autre chose qu’une fulguration des estomacs vides, qu’elle avait une chance d’être durable. Mais la menace était elle-même usée par la misère. C’était un état du corps qui proposait à ceux-là les mots les plus ignobles. Enculé était l’un des plus fréquents. Il voulait être définitif. C’était ainsi que Félix venait de traiter le petit stubendienst. Il le lui avait déjà dit en face d’ailleurs. Mais il pouvait le lui redire et, deux jours plus tard, rigoler avec lui.
Fange, mollesse du langage. Des bouches d’où ne sortait plus rien d’ordonné ni d’assez fort pour rester. C’était un tissu mou qui s’effilochait. Les phrases se suivaient, se contredisaient, exprimaient une certaine éructation de la misère ; une bile de mots. Tout y passait à la fois : le salaud, la femme abandonnée, la soupe, le pinard, les larmes de la vieille, l’enculé, etc. la même bouche disait tout à la suite. Ça sortait tout seul, le type se vidait. Ça ne cessait que la nuit. L’Enfer, ça doit être ça, le lieu où tout ce qui se dit, tout ce qui s’exprime est vomi à égalité comme dans un dégueulis d’ivrogne. » (p. 148). « Les copains étaient rongés par l’envie d’injurier et de calomnier. Si quelqu’un intervenait pour dire que c’était faux, que Gilbert ne s’en mettait pas plein la lampe et qu’à l’usine il avait défendu des types qui avaient des ennuis, il n’avait pas d’écho, cela tombait dans le silence. La calomnie était plus forte que la vérité, parce qu’ils préféraient qu’il en fût ainsi. Ils avaient l’estomac vide, et, à défaut d’autre chose, la haine occupait ce vide. Il n’y avait que la haine et l’injure qui pouvaient distraire de la faim. On mettait à en découvrir le sujet autant d’acharnement qu’à chercher un morceau de patate dans les épluchures. Nous étions possédés. » (p. 150).
– Voir d’autres extraits du même livre ici, là et encore là.
Dans le contexte des guerres, les Allemands sont appelés couramment « Boches », ce qui nous vaut ce commentaire de Gabriel Chevallier, dans La Peur : « Il est rigolo, ce Boche ! Car on ne saurait appeler un Allemand que Boche. Ce terme n’est pas méprisant dans l’esprit des hommes, il est simplement commode, bref et amusant. » (p. 247)
Insultes au cinéma
Quand les élèves surpris à se traiter de « sale noir » vous rétorquent que c’est « entre amis », ils pourraient se référer à une séquence mémorable de La Grande illusion de Jean Renoir. Au dénouement, Maréchal (Jean Gabin), traite amicalement Rosenthal (Marcel Dalio) de « sale juif ». Rosenthal est issu d’une famille juive fortunée, et il partage fraternellement les colis de nourriture qu’il reçoit quotidiennement dans le camp de prisonniers de la Première Guerre. Lorsqu’ils s’évadent, au cours de leur longue marche pour rejoindre la Suisse, Rosenthal se blesse et traîne la patte ; son ami craque et lui dit qu’il a toujours détesté les juifs avant de l’abandonner, puis de revenir, honteux de son attitude. Une fois sauvés, il lui lance cette insulte amicale.
Samuel Fuller affectionnait l’insulte « son of a bitch ». Dans le documentaire Un Américain en Normandie. Le jour J de Samuel Fuller (1994), trois ans avant sa mort, Fuller évoque un Français resté seul dans Colleville lors du Débarquement, qui tua trois Allemands à coups de pelle. Il l’avait rencontré à nouveau lors d’une visite commémorative, mais voilà que le type était mort en 1984, et devant sa tombe, Fuller de s’exclamer : « He’s dead, son of a bitch ! » Quel compliment !
Riad Sattouf, les collégiens & présidents de républiques, Bigard
Retour au collège de Riad Sattouf, qui propose une réflexion et un témoignage sur l’insulte pratiquée couramment dans les collèges. Nos élèves sont souvent fans du groupe de rap Sexion d’assaut. Mais de même, la lecture des propos confus de ce groupe en butte aux réactions que suscitent ses propos homophobes pourrait peut-être amener les élèves à prendre conscience de la gravité de ces insultes. À moins qu’ils ne confortent certains d’entre eux dans un machisme grégaire, sur le thème de la concurrence des discriminations (les homos étant considérés comme favorisés par l’intelligentsia). Le problème est que les actions militantes visant à empêcher ces « artistes » de s’exprimer ne peut que les conforter dans un confortable cocon victimisant. Il semble cependant qu’on prenne la voie d’un dialogue constructif.
Il faudrait d’ailleurs, quand on traite du rap, faire l’effort de comprendre le côté provocateur de l’insulte dans cette pratique, le phénomène des « dozens » (cf. ci-dessous), qu’on peut aussi rapprocher, lorsqu’on est cultivé, de la pratique surréaliste de l’écriture automatique. Quel sens cela aurait-il de censurer une écriture automatique ? Les rappeurs ne veulent pas plus couper les pénis d’homosexuels, qu’ils ne veulent que leurs amis sodomisent leur maman adorée lorsqu’ils ponctuent leur phrase de « nique ta mère ». Ce sont des façons de s’exprimer modernes. Le monde évolue. Dans l’ancien temps, les présidents de républiques disaient « Veuillez vous écarter, mon brave » ; maintenant, ils disent « casse-toi, pauv con ». Il faut s’adapter, c’est tout. Ou demander à un psychanalyste à quoi correspondent ces saillies révélatrices de l’inconscient de leurs proférateurs… Je ne croyais pas si bien dire : voici l’analyse par le psychanalyste Patrick Declerck de propos tenus par un président de république vu à la TV. Lors de la crise du national-covidisme en 2021, Jean-Marie Bigard utilise l’insulte couillue pour interpeller le type qui occupe le CDD de président de république en le traitant de, je cite, « président de… mes couilles » (c’est pas moi qui le dit, c’est l’autre) qui n’a pas de couilles, car s’il en avait, il (je cite) virerait son « putain de ministre de la santé de merde ». Repris sur des sites en Belgique, mais pas beaucoup en France dans la patrie, comme disent nos plumitifs, des « droits de l’homme » et de la liberté d’expression. Il s’agit d’une stratégie de la rupture pour réveiller les mougeons & autres moutruches complètement hypnotisés par le pouvoir. Et voici une compilation des insultes des plus vaillants coronazis provax de France & de Navarre contre les mauvais citoyens qui refusent l’injection.
La « parenté à plaisanterie » selon Amadou Hampâté Bâ
Or donc, on ne comprend rien au rap [1] sans un peu de connaissance en culture populaire, voire savante. Partons d’Afrique de l’Ouest. La « Parenté à plaisanterie », ou sinankunya au Mali, est une pratique sociale typiquement ouest-africaine [2], qui autorise, parfois même oblige, des membres d’une même famille ou de certaines ethnies, à se moquer ou s’insulter, sans conséquence ; ces affrontements verbaux constituent des moyens de décrispation sociale. Voilà ce qu’en dit Amadou Hampâté Bâ (1900-1991), dans le 1er tome de son autobiographie, Amkoullel, l’enfant peul : « Un lien de camaraderie puissant, de fraternité même, doublé d’un devoir d’assistance mutuelle, se crée entre les circoncis d’une même promotion, et cela pour toute la vie. Ils ont les uns sur les autres des droits analogues à ceux que donne la relation dite de “parenté à plaisanterie” ou sanankounya (dendirakou en peul). […] ils peuvent, sans considération d’âge ni de classe sociale, se plaisanter et se “mettre en boîte”, même assez vertement, en public, sans que cela puisse tirer à conséquence ; ils peuvent aussi se baigner nus ensemble en un même lieu, utiliser les montures des uns et des autres sans avertissement préalable, s’asseoir sur leurs couchettes respectives (attitude très inconvenante pour toute autre personne), enfin se montrer galants en paroles avec les épouses de leurs condisciples (comme dans la relation de sanankounya entre beaux-frères et belles-sœurs), sans que leur attitude puisse être suspectée par le mari à moins d’une preuve patente de déshonneur conjugal, ce qui vaudrait d’ailleurs au coupable d’être mis au ban de tous ses camarades, voire de ses concitoyens, dans le cas où le mari ne lui aurait pas déjà passé sa lance à travers le corps ! » (p. 245, éd. J’ai lu).
« Leurs deux ethnies [Dogons et Bozos] étaient liées, en effet, par les liens sacrés d’alliance de la sanankounya (dont j’ai parlé précédemment), que des ethnologues appellent “parenté à plaisanterie” parce qu’elle permet de se plaisanter et de se mettre en boîte, voire de s’injurier, sans que cela puisse jamais tirer à conséquence. En fait, il s’agit de tout autre chose que d’une plaisanterie ; cette relation représente un lien très sérieux et profond qui, jadis, entraînait un devoir absolu d’assistance et d’entraide, puisant son origine dans une alliance extrêmement ancienne, nouée entre les membres ou les ancêtres de deux villages, deux ethnies, deux clans (par exemple entre les Sérères et les Peuls, les Dogons et les Bozos, les Toucouleurs et les Diawambés, les Peuls et les forgerons, les clans peuls Bâ et Diallo, etc.). Évoluant avec le temps, il n’est souvent resté de cette alliance que la tradition de mise en boîte réciproque, sauf entre les Dogons et les Bozos dont la sanankounya est sans conteste l’une des plus solides de l’Afrique de la savane, avec, peut-être, celle qui unit les Peuls et les forgerons » (p. 378). Voir une autre définition de la parenté à plaisanterie dans Les Tambours de la mémoire, de Boubacar Boris Diop (1995). Lire aussi un article de Sophie Douce pour Le Monde : « « Toi le Yadga mangeur de riz, tu es mon esclave » : pour rire et faire la paix, les Burkinabés s’insultent », publié le 17 janvier 2020, et qui fait le point sur la parenté à plaisanterie à l’ère du djihadisme.
Puisque nous en sommes à Hampâté Bâ, signalons un autre extrait intéressant sur le thème de l’insulte, du second tome de son autobiographie, Oui mon commandant !. Nommé fonctionnaire à Ouagadougou, le jeune homme fiancé, fervent musulman, est victime d’une calomnie sur sa virilité défaillante. Une femme surnommée Gros melon, « épouse coloniale » de son chef, lui tend un piège digne de la femme de Putiphar : elle l’attire dans sa chambre puis menace de l’accuser d’avoir voulu la violer s’il ne couche avec elle. Il trouve un prétexte pour lui promettre de revenir plutôt quelques jours plus tard, car il est amoureux d’elle et ne veut pas faire l’amour à la sauvette. Le jour venu, il se venge d’elle en l’insultant, puis réfléchit sur cette vengeance :
« J’enfourchai mon vélo et pris la route qui passait devant la maison de l’adjudant. La petite servante, postée près du mur pour me guetter, m’aperçut de loin. Je la vis franchir les marches de la véranda et entrer dans le salon. Immédiatement, parée comme une nouvelle mariée, la silhouette plantureuse de sa maîtresse se dessina dans l’ouverture en arcade cintrée de la véranda. Je continuai de pédaler, baissant la tête comme pour me protéger du vent, et passai devant la porte d’entrée sans m’y arrêter. Elle me fit signe que je me trompais. Je lui répondis non de la tête et de la main. Pensant que j’allais entrer un peu plus loin, après le tournant de la rue, en sautant par-dessus la murette qui entourait la concession, elle traversa la cour presque en courant et vint à ma rencontre. Je m’arrêtai, tout en restant sur mon vélo. « Pourquoi veux-tu sauter par-dessus le mur au lieu de passer par la porte ? me demanda-t-elle. Par souci de discrétion ?
— Je ne vais pas sauter le mur.
— Ah bon ? Et comment feras-tu alors pour entrer chez moi ?
— Je n’en ferai rien, ni aujourd’hui ni demain, car je ne reviendrai plus jamais chez toi. Et ne viens pas me dire encore que tu m’aimes ! continuai-je en m’échauffant. Tu n’es rien d’autre qu’une gourmande sexuelle doublée d’une belle prétentieuse. Si tu as voulu me forcer à coucher avec toi, c’était uniquement pour pouvoir te vanter partout d’avoir réussi là où les autres filles de Ouagadougou avaient échoué… Ton piège était savant, je le reconnais, mais il était laid, déloyal et perfide. Je ne suis pas au-dessus des rapports sexuels, la nature ne m’a pas fait différent des autres, mais il me répugne de m’y livrer avec une « Madame tout le monde ». Tu m’as menacé d’ameuter le quartier et de crier que j’étais allé forcer ta porte pour te violer ?… Eh bien, vas-y ! Crie, hurle, ne te gêne pas ! »
Je posai mon pied sur la pédale : « Et si jamais je te retrouve encore sur mon chemin, j’écrirai à ton mari pour lui dire qui tu es et comment tu le bafoues. Il est vraiment dommage qu’une belle créature comme toi soit aussi dévergondée ! Adieu !… »
Et je repris la route, laissant la pauvre Gros melon pétrifiée sur place. Enfin mon âme était assouvie, toute à la joie d’avoir blessé celle qui avait voulu ma honte et la destruction de ma carrière, sinon de ma vie tout entière !
Une fois revenu chez moi, la voix de mon esprit, que j’avais réussi à étouffer tout au long de cette scène, reprit le dessus, comme à son habitude : « Eh bien, me dit-elle, en quoi le méchant langage que tu as tenu à cette pauvre femme t’a-t-il avantagé ? Tu oublies que celui qui aboie contre un chien parce que ce dernier a aboyé contre lui vaut moins que le chien lui-même, parce que le chien, lui, ne fait que suivre sa nature. Et puis, est-ce toi qui t’es tiré tout seul des griffes de cette femme, ou Dieu qui est venu à ton aide ? L’homme qui veut aller vers Dieu doit aimer toutes ses créatures, à commencer par l’être humain. Tu ne dois donc en flétrir aucune. Ton âme s’est pâmée de plaisir parce que tu t’es vengé, mais moi je m’attriste parce que tu as manqué de charité. Dieu s’est montré miséricordieux pour toi, alors que toi tu ne l’as pas été pour cette femme. Souviens-toi de l’adage : « On ne doit pas se servir d’une souillure pour en laver une autre ».
Autant j’avais éprouvé de plaisir à voir la perfide Gros melon écrasée sous le poids de mes paroles, autant je me sentis étreint par les réprimandes de mon esprit. Certes, je n’avais pas à retourner chez la jeune femme, mais pourquoi l’insulter ? Le Seigneur n’a-t-il pas dit dans le Coran : « Ma Miséricorde embrasse tout » ? De toute évidence, aucun être ne saurait être exclu de ce tout universel… Aujourd’hui encore, je continue de regretter cet acte irréfléchi de mon jeune âge. » (édition J’ai Lu, p. 143)
Si nous allons en Afrique du Sud, je ne crois pas qu’il existe ce genre d’institution. Cependant Nadine Gordimer nous explique dans son ultime roman Vivre à présent, que l’insulte « inkwenkwe » (« Garçon noncirconcis ») « est peut-être la pire chose qu’on puisse dire à un homme noir » (p. 389).
Les « dozens », insultes ritualisées dans le rap
On retrouve sous une autre forme cette « parenté à plaisanterie » aux origines du rap, selon l’essai précurseur des sociologues Georges Lapassade et Philippe Rousselot, Le rap ou la fureur de dire (1990). « Dozens est finalement le terme générique retenu par Labov [3] pour désigner ces vannes structurées. Fondamentalement, elles constituent un acte langagier d’adolescents, parfois d’enfants, qui suppose de la virtuosité de la part du locuteur, et de l’admiration de la part de l’auditeur. Non seulement il faut en connaître les formules d’envoi, mais il faut savoir improviser en rimant. C’est un fait qu’il y a un thésaurus des dozens, plus ou moins connu aujourd’hui dans le ghetto. Ainsi, la formule « ta mère boit de la pisse » appelle la réponse « ton père bouffe de la merde », laquelle constitue alors le point de départ d’une joute entre deux ou trois locuteurs. Si la mère de celui à qui l’on s’adresse est la cible principale des dozens, celles-ci peuvent très bien viser quelqu’un d’autre »
Tout d’abord, la vanne doit être courte, sèche, violente et cruelle. Elle s’intègre dans une joute entre pairs, entre complices : son exportation hors du cercle aurait pour résultat de déclencher une bagarre, ce qui est précisément ce que veut éviter cette joute verbale sans merci. L’américain familier, copping a plea, « plaider coupable », a très probablement pour origine « le fait de s’avouer vaincu » dans une joute de dozens. Le critère de réussite, de victoire, c’est le rire du public » (op. cit., p. 54).
Sans ces connaissances, on risque fort de se méprendre sur le sens des insultes pratiquées par les jeunes, les banlieusards et dans le rap, qui sont avant tout le signe d’une joie de vivre dont il faut se féliciter qu’elle subsiste. Source de nombreuses polémiques stériles, parmi lesquelles je citerai celle provoquée par un ex-ministre de l’Intérieur contre le groupe Sniper, analysée par Anthony Pecqueux dans « Les mots de la mésentente entre Sarkozy et Sniper », Libération, Jeudi 13 /11/2003. Extrait :
« En revanche, on peut se risquer à écouter les chansons citées. Pour « La France », une argumentation classique bienveillante porterait sur un second degré : affirmer que ce qui y est « niqué », « La France », vaut pour une synecdoque du système en place. Il n’est pas sûr qu’elle convainque entièrement les citoyens indignés, qui lui opposeraient à juste titre les auditeurs qui l’entendent au premier degré. Cet argument ne fait que déplacer le problème.
Autre possibilité : l’écoute attentive des nombreuses paroles qui pourraient donner prise à une imputation de haine de la police ou de la République. Un syndicat de policiers (SGP-FO) reprenait récemment dans une lettre au ministre des paroles du groupe : « Pour mission : exterminer les ministres et les fachos / Car de nos jours, ’sert à rien d’gueuler, d’parler à des murs / À croire que l’seul moyen de s’faire entendre est d’brûler des voitures. » Il oubliait la qualification de ces propos, qui suit : « Après tout / Ça avance pas et j’sais qu’ça les arrange si on s’bouffe entre nous. » Les rappeurs complètent plus loin par « Nous faire taire franch’ment ça s’rait impossible » : ils ont finalement choisi la parole, contre les voitures brûlées. Sniper décrit ensuite ces « frères [qui] sont armés jusqu’aux dents », et de nouveau la conclusion est explicite : « À quoi ça mène ? ! [...] Ça les arrange c’coup-là y aura pas b’soin d’bavure policière », qui résonne comme un appel à d’autres solutions que celle des armes, tout en continuant à sous-entendre l’existence de bavures. […] Il faut reconnaître qu’il n’y a pas d’appel à des actes illégaux, comme « brûler des voitures », mais au contraire des conclusions morales (mieux vaut dénoncer par la parole que se tromper de cible, etc.) » Il ne s’agit pas ici d’insultes, mais un reproche récurrent contre les rappeurs est les insultes contre la France ou contre les « keufs », le drapeau, etc. Les prendre au premier degré, et en tirer une loi ridicule pénalisant l’outrage au drapeau est d’une bêtise consternante, laquelle bêtise a contaminé les trois-quarts de l’intelligentsia et des politiciens français, ceux qui, tels des dictateurs de républiques bananières, ne légifèrent que sur les faits divers.
Rap et « battles » hip-hop
Une illustration des propos de Lapassade et Rousselot, ainsi que de des réflexions d’Anthony Pecqueux est fournie par l’excellent clip de Youssoupha (né en 1979) : « Menace de mort » : « J’ai plaidé la légitime défense dans ma déposition / Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position ». Il s’agit d’une brillante réplique dans une polémique stérile l’opposant à un célèbre islamophobe du PAF. Il ajoute avec finesse : « On a les critiques imparables d’une France qui oublie que les paroles de son hymne son plus violentes que celles du gangsta rap ». Voir aussi une tribune du même artiste dans Le Monde : « Ces artistes fantômes que sont les rappeurs français ». Youssoupha participe avec Kery James (né en 1977) et Médine au réjouissant « battle » « Contre nous » : « Me comparer à Youssoupha, t’es fou j’vois pas le rapport / Le négro est trop bas d’où j’suis je vois pas le rappeur / Pour qu’le négro arrive il a fallu que j’m’absente / Comme Jay-Z sans Biggie Bonobo a saisi la branche ». Du même Kery James, on écoutera avec profit « Banlieusards », qui reprend dans un style rap moralisateur (pour abonder dans le sens d’Anthony Pecqueux), le thème inauguré en 1982 par Karim Kacel dans « Banlieue » [4]. Pour faire « punchline », de Kacel à Kery, on passe du vol de Mobylette à la mobilisation ! Voir aussi chez Kery James un excellent exemple (moralisateur aussi) de mise en abyme, et d’autres citations de textes moralisateurs : « Je revendique et je dis qu’il y a trop de mômes qui / Insultent la police pour que dalle / Se comportent dans la rue en vandales / Donc ne t’étonne pas que Le Pen souhaiterait qu’on les remballe / Je revendique et j’indique que certains jeunes contribuent / À la montée du racisme dans nos rues » (« Je revendique »). « Je veux que les jeunes Africains relèvent la tête / Que les jeunes du ghetto cessent de dire que l’État les oppresse / Et que c’est pour cela qu’ils pratiquent l’illicite business » (« Des terres d’Afrique »).
Enfin, dans ce registre, je vous recommande l’excellent livre de Magyd Cherfi, Livret de famille. On remarque d’ailleurs chez ces rappeurs, une nette tendance à se rapprocher de la chanson traditionnelle, avec notamment, fait remarquable, des textes parfaitement audibles et compréhensibles du début à la fin, et dont les paroles sont disponibles sur Internet, notamment sur le site « rapgenius.com ».
Qu’est-ce qu’un « battle » ? Le hip-hop est un mouvement culturel urbain étasunien réunissant plusieurs disciplines artistiques, notamment le deejaying, le graffiti, la breakdance, le rap. Dans ces quatre disciplines étaient organisés des « battles » (= batailles, confrontations). Le hip-hop était un mouvement fun, bon enfant, ce que n’est plus le rap. Il existe cependant toujours en France des compétitions de « battle », par exemple « rap contender » ou « end of the week ». L’anglicisme « punchline » est utilisé en français pour désigner une « vanne » percutante (c’est-à-dire en français, un aphorisme, une pointe, une pique, un trait, un sarcasme, une raillerie, ou le fait de « casser » quelqu’un) [5]. Visionnez absolument cette impro de freestyle au « rap contender », entre Gaïden et le champion invaincu, Jazzy Bazz, (mazette quel bogosse ! Quel pied de se faire punchliner par ce Cyrano de la Vanne rap !) puis lisez cet article. J’ignore si l’on peut classer la chanson parodique de Fatal-Bazooka « J’aime trop ton boule » dans la catégorie « battle », mais il parvient à se moquer d’une certaine attitude macho tout en se moquant aussi gentiment d’une certaine attitude gay, tout cela très bon enfant.
– J’ai eu l’opportunité de recevoir Kery James dans une de mes classes de 1re techno lundi 10 juin 2013, pour une rencontre filmée pour le journal de M6 (ce qui m’a permis d’affiner cet article). On peut visionner ce que cela donne ici (attention, on est obligé de se gaufrer de la pub). Une minute trente pour plus d’une heure de tournage de la journaliste reporter d’image. Elle est même revenue spécialement m’interviewer pendant un quart d’heure, dont il n’a été retenu… que dalle ! Et le nom de l’élève qui cause dans le poste n’est pas le bon ! Enfin, ce sera un bon souvenir quand même. D’ailleurs, je songe à me reconvertir dans le rap pédagogique… On peut lire l’article de Jacques Denis « Rap domestiqué, rap révolté » paru dans Le Monde diplomatique en septembre 2008. Pour en finir avec Kery James, des collègues se sont gendarmés dans mon lycée contre sa venue, au nom de… la lutte contre l’homophobie. Ils ont tapoté sur Internet et ont trouvé les paroles originales d’un morceau intitulé « Hardcore », qui date de 1998, l’auteur ayant 21 ans et officiant au sein du groupe Ideal J, avant sa carrière solo. On trouvait un vers d’une insupportable homophobie : « Hardcore, deux pédés qui s’embrassent en plein Paris ». Or il se trouve que ce véritable appel au meurtre avait été remplacé dans la version actuelle jouée en scène, publiée dans le recueil 92.2012 : 20 ans d’écriture, par « Hardcore, des gens qui font l’amour en plein Paris ». Bien sûr je m’étais renseigné sur le scandale avant d’accepter de décider de recevoir l’artiste, et ce prurit excessif de quelques collègues dans le genre militants de la 25e heure avait de quoi amuser autant qu’agacer. Je milite depuis 15 ans sur la question, et ma conception n’a jamais été la censure, mais le dialogue et la culture. Qu’un rappeur se soit rendu compte qu’il a dérapé, s’en excuse et modifie son texte, cela mérite au moins le pardon, sinon le respect ! Et quel meilleur exemple pour des élèves dont certains ont des préjugés homophobes bien plus virulents que d’être gênés par deux hommes qui s’embrassent ? Relativement à l’emploi du mot « pédé », les collègues n’ont pas remarqué que le rappeur, lui-même noir, emploie souvent le mot « négro ». Il n’en reste pas moins que ledit Kery James se montre par ses textes très pudique et pas particulièrement altersexuel, mais quand nous étudions un auteur en classe, exige-t-on de lui un certificat de politiquement correct ? À ce compte, il faudrait rayer un grand nombre de classiques pour misogynie, homophobie ou racisme ! Détail amusant, le texte initial se terminait sur « Pas de concession dans mes lyrics », phrase supprimée de la version publiée ! Georges Brassens n’a-t-il pas chanté naguère « Sonneraient-elles plus fort, ces divines trompettes / Si, comme tout un chacun, j’étais un peu tapette / Si je me déhanchais comme une demoiselle / Et prenais tout à coup des allures de gazelle ? » (« Les trompettes de la renommée »). Comme dirait l’autre, aux vertus qu’on exige dans un rappeur, connaissez-vous beaucoup d’académiciens qui fussent dignes d’être slameurs ?!
Le « battle », les « dozens » ne renouent-ils pas avec l’origine même du théâtre grec et du tribunal, qui consistaient, soit par la catharsis, soit par la mise en scène de la justice, à mettre à distance la violence, à remplacer la vendetta, la violence privée, par une représentation de cette violence ou une compensation symbolique. Les textes de rap – et Kery James en est un bon exemple – sont obnubilés par la violence, et cela peut choquer l’honnête citoyen du XXIe siècle qui y a renoncé depuis longtemps. Mais prenons par exemple le final d’un chef d’œuvre du cinéma tel que L’Homme tranquille de John Ford (1952). L’action est censée se passer au XXe siècle en Irlande, mais la façon de traiter les femmes n’a guère à envier à l’époque d’Aristophane. Et le combat de boxe final, « homérique » (mot employé dans le dialogue) et ritualisé, n’est-il pas un autre genre de « battle », qui est pour les Américains populaires d’origine irlandaise, mutatis mutandis, la même chose que les « dozens » pour les Américains populaires d’origine africaine ? Reste à savoir la quelle des deux est la plus civilisée. Kery James, le rappeur moralisateur hanté par la mort d’un ami assassiné, qui ne cesse de rappeler dans ses textes qu’il a été violent mais qu’il faut renoncer à la violence, me semble on ne peut plus proche de Sean Thornton (John Wayne), hanté par la mort d’un de ses adversaires sous ses poings, qui préfère passer pour lâche plutôt que de se battre encore pour régler un conflit.
– Dans le domaine de la BD, le grand maître dans l’ordre de l’Insulte avec un grand I est bien sûr le capitaine Haddock. Voir sur Wikipédia Vocabulaire du capitaine Haddock.
– Signalons pour terminer un site de référence sur l’insulte en politique, dû à l’Université de Bourgogne. Un fidèle lecteur me signale pour les Bretons qui auraient pu s’égarer sur cet article, Florilège des insultes et satires des Bretons de Philippe Camby, un livre que je n’ai pas encore lu. Voici également une excellente page sur les insultes germanophobes. Pour revenir à la spécificité de notre site, un livre pour les enfants reprend les principales insultes homophobes : Papa, c’est quoi un homme haut sèkçuel ?, d’Anna Boulanger, selon le principe d’appropriation du stigmate. Et maintenant, chers lecteurs, ayez l’obligeance d’aller vous faire voir chez les Grecs !
Voir en ligne : Allez vous faire cuire un œuf sur insultron
© altersexualite.com, 2007-2022.
[1] Je me suis intéressé au rap de bonne heure, étant passionné de chanson. Je me suis documenté sur le rap pour écrire L’Année de l’orientation, roman épistolaire, en 2003, et surtout pour la suite du précédent, Karim & Julien, en 2007, dans lequel les personnages épistoliers se livrent à une critique par correspondance d’un album de Sniper, qui occupe bien dix pages sur l’ensemble du roman. Une citation du premier de ces livres se retrouve d’ailleurs – gag – en note dans l’article rap de Wikipédia. Il s’agit d’une condamnation en bloc du rap, que j’avais placée sous la plume d’un de mes personnages, et qui se retrouve créditée de mon nom ! Affres du roman épistolaire !
[2] C’est ce que je croyais et que vous trouverez dans l’article de Wikipédia, jusqu’à ce que je découvre en lisant « Funérailles d’un cochon », de David Jaomanoro, que la pratique est également malgache sous le nom de « zivas ».
[3] Le sociolinguiste William Labov, dans Language in the inner city, essai paru en 1978, pas encore traduit.
[4] Il se trouve qu’au moment même où j’écris cette phrase, le 7 juin 2013, j’apprends la mort de Pierre Mauroy, qui fut premier ministre à l’époque de cette chanson. Abolition de la peine de mort. Dépénalisation des relations homosexuelles avec les mineurs de plus de 15 ans. Cinquième semaine de congés payés. On peut s’électrocuter en pleurant sur un clavier ?
 altersexualite.com
altersexualite.com