Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Théâtre complet d’Alfred de Musset : avant Lorenzaccio
Édition établie par Simon Jeune
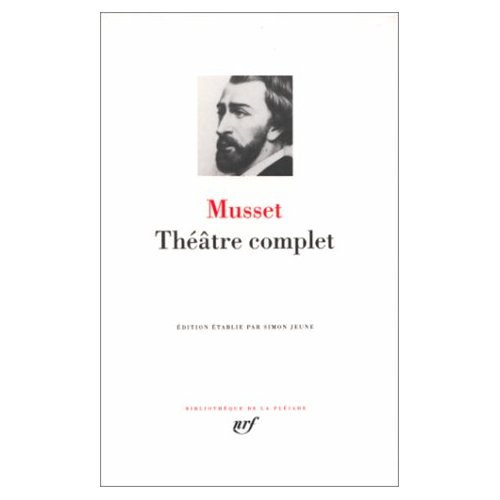 Théâtre complet d’Alfred de Musset : avant Lorenzaccio
Théâtre complet d’Alfred de Musset : avant Lorenzaccio
Bibliothèque de la Pléiade, 1990 (1830-1833), 1368 p., 60 €
samedi 8 septembre 2012, par
Cette série d’articles sur Musset est dédiée à mon oncle Jean-Pierre Labosse (1949-2012).
Après l’article sur Lorenzaccio, voici donc une lecture du volume de la Bibliothèque de la Pléiade consacré au théâtre par Simon Jeune en 1990. Pour la petite histoire, le volume de poésie et le volume de prose datent de… 1933 et 1938 ! Autant dire que le dernier ne dit mot de l’opuscule érotique Gamiani ou Deux nuits d’excès ! Les pièces sont présentées dans ce volume par ordre chronologique de publication. Ce qui frappe d’emblée, outre la provocation iconoclaste de la forme et du fond, c’est la préoccupation de l’équilibre entre amour et amitié, et un prérequis évidemment utopique de l’égalité entre homme et femme dans l’amour. Cet article présente mes notes de lecture sur l’introduction et sur les quatre pièces de jeunesse antérieures à Lorenzaccio. Suivront un article sur les pièces postérieures, et un article sur Alfred de Musset, et en prime, mon cours en deux parties sur Le Théâtre romantique. Que demande le peuple ! En 2013, ciliegia sulla pasticceria, voilà un ultime article intitulé « À Florence (et à Rome), sur les traces de Lorenzaccio ».
Plan
Introduction de Simon Jeune
La Nuit vénitienne
André del Sarto
Les Caprices de Marianne
Fantasio
Introduction de Simon Jeune
L’objet d’étude « lire-écrire-publier » est particulièrement pertinent pour Musset. En effet, voilà un auteur qui, jeune, « veut atteindre à la notoriété de l’homme de théâtre, nettement plus lucrative que celle de poète » (p. XI). Dès l’échec précoce de sa première pièce représentée, La Nuit vénitienne, en décembre 1830, il cesse d’écrire en vue de la représentation, tout en restant fasciné par le théâtre, dont il dit : « dans cette multitude de spectateurs, dans ces acteurs qui vont et viennent, dans tout cet appareil, dans toutes ces pensées, il semble qu’il n’y ait qu’une pensée unique et un seul homme qui parle à un autre homme ». Belle définition de la « double énonciation » ! (cité p. XIII). Musset aura un autre motif d’intérêt, son goût pour les très jeunes actrices, maintes fois évoqué dans ce volume. Ainsi dans la notice des Caprices, l’actrice principale âgée de 17 ans lors des représentations de 1851 (Musset a 41 ans) s’exprime-t-elle ainsi dans ses mémoires : « De mon temps, il n’y avait pas de praticable pour monter au balcon et c’était Musset en personne qui tenait le pied de l’échelle, tandis que j’y montais. Il n’y aurait pas manqué un soir. » (p. 910). Les modèles et influences de Musset sont connus : Shakespeare, Schiller, Byron, Jean-Paul… (p. XVI). Une tendance fondamentale de Musset à la confrontation avec lui-même trouve un terrain naturel dans le théâtre, encore plus que dans la poésie : « C’est parce qu’il avait à dire des choses contradictoires, ou plutôt parce qu’il voulait mener une investigation complète sur ces contradictions intimes, que Musset, tout naturellement, créa des personnages qui tantôt s’interrogeaient eux- mêmes, et plus souvent dialoguaient en incarnant des tendances opposées de sa propre nature. Musset se sert du théâtre pour essayer de dominer et d’unifier par l’analyse ses tumultes et ses tensions. » (p. XVII). Cela prend chez nombre de personnages la forme théâtrale d’une tension « dialectique entre pureté et débauche » (p. XIX). S’il évoque l’amour, c’est dans l’affrontement et « une perpétuelle guerre des sexes » ; et Simon Jeune fait remarquer que les deux pièces les plus originale et forte de Musset, Fantasio et Lorenzaccio, sont « sans amour » (p. XXI). Le préfacier voit une évolution de l’image de la femme : « Le théâtre de la maturité constitue ainsi une remarquable « défense et illustration » de la femme, quand le théâtre de jeunesse aboutissait souvent à une mise en accusation » (p. XXVII). L’incapacité de Musset à se marier et à connaître de longues relations avec une femme influent sur les caractères de ses personnages (cf. p. XXXV). Quelques vers extraits de la dédicace du poème « La Coupe et les lèvres » expriment l’idéal théâtral de Musset : « L’autre, comme Racine et le divin Shakspeare / Monte sur le théâtre, une lampe à la main, / Et de sa plume d’or ouvre le cœur humain. / C’est pour vous qu’il y fouille, afin de vous redire / Ce qu’il aura senti, ce qu’il aura trouvé, / Surtout, en le trouvant, ce qu’il aura rêvé. / L’action n’est pour lui qu’un moule à sa pensée. » (cité p. XXII). Le caractère ombrageux de Musset, qui refusait des aides parfois prestigieuses, explique une partie de ses échecs (p. XXX). Par contre quand le succès vient en 1848-1851, Musset reprend et édulcore ses pièces pour la représentation, souvent sur demande de la censure officielle. Les versions données dans le volume de la Pléiade, contrairement aux habitudes, sont donc plutôt les plus anciennes, les moins censurées. La chronologie qui suit l’introduction fait ressortir les goûts précoces du poète : « Il ressent le besoin d’aimer, ou, plus prosaïquement, celui de s’étourdir par « le punch et la bière », et d’aller « chez les filles » » (en 1827 !). De nombreuses liaisons féminines, échouant toutes sur la plage du mariage, sont égrenées, de celle avec George Sand, en 1833, jusqu’à Louise Colet, en 1852.
La Nuit vénitienne
En 1830, l’échec de cette première pièce de Musset est le pendant de la bataille d’Hernani. Musset échoue malgré, ou à cause de l’aspect provocateur de la pièce, qui se joue des lieux communs romantiques (cf. notice p. 865). Razetta se voit enlever son amante Laurette par le prince d’Eysenach. Dans une tirade qui peut se lire comme un manifeste ironique du théâtre romantique, il cherche à se venger de façon nouvelle : « Mais il me faut trouver quelque chose de nouveau ici, car d’abord j’ai affaire à une couronne. Oui, tout moyen usé d’ailleurs me répugne. » Il tergiverse, puis envisage « Le fer est le moyen le plus sûr. Mais une main si faible ?… Qu’importe ? Le courage est tout. La fable qui courra la ville demain matin sera étrange et nouvelle » (p. 14). Préfiguration de Lorenzaccio, qui s’entraîne à tuer son duc, en III, 1. Le prince agit en terrain conquis. Il demande à Laurette, qu’il rencontre pour la première fois, mais que lui a gagnée son émissaire le secrétaire intime : « Est-ce que toutes les femmes sont aussi jolies que vous dans cette ville ? » (p. 21). Puis il lui fait miroiter cyniquement une véritable maison de poupée avant la lettre, mais une maison sans jalousies : « vous allez respirer l’air délicieux de la plus aristocratique bonbonnière ; c’est de ma petite cour que je parle, ou plutôt de la vôtre, car je suis le premier de vos sujets. Une grave duègne vous suivra, c’est l’usage ; mais je la payerai pour qu’elle ne dise rien à votre mari. Aimez-vous les chevaux, la chasse, les fêtes, les spectacles, les dragées, les amants, les petits vers, les diamants, les soupers, le galop, les masques, les petits chiens, les folies ? — Tout pleuvra autour de vous. Enseveli au fond de la plus reculée des ailes de votre château, le prince ne saura et ne verra que ce que vous voudrez. » (p. 25). Finalement la belle se laisse tenter, et l’amant délaissé abandonne son projet de vengeance pour un bon repas promis par ses amis : « — Veux-tu tuer ton rival ou le noyer ? Laisse ces idées communes au vulgaire des amants ; souviens-toi de toi-même , et ne donne pas le mauvais exemple. Demain matin les femmes seront inabordables, si on apprend celte nuit que Razetta s’est noyé. Encore une fois, viens souper avec nous. » (p. 29).
André del Sarto
Belle pièce en 3 actes, inspirée de la vie du peintre Andrea del Sarto (1486-1531). Alfred de Musset exprime à travers les tortures morales qu’il fait subir à ce trouple tragique ses propres sentiments contradictoires sur l’art et sur l’amour. Le peintre voit sa femme Lucrèce et son meilleur ami Cordiani le tromper tous deux. Fou de douleur, il préfère se tuer plutôt que de se venger, car « il n’y a point d’offensé, il n’y a qu’un malheureux » (p. 58). Il faut voir là l’écho du renoncement de Musset à George Sand. La pièce fut jouée fin 1848, avec une moralisation du dénouement, imposée par la censure (Cordiani meurt ; Lucrèce se repent). L’amour de Cordiani pour Lucrèce est une impulsion immotivée, impérieuse, mortelle : « Crois-tu que je l’aie séduite ? qu’elle ait réfléchi et que j’aie réfléchi ? […] Je ne veux rien analyser, rien savoir : il n’y a d’heureux que les enfants qui cueillent un fruit et le portent à leurs lèvres sans penser à autre chose, sinon qu’ils l’aiment et qu’il est à portée de leurs mains. » (I,1, p. 35). En situant l’action à la Renaissance, Musset établit un parallèle habile entre la décadence de l’art et celle de l’amour. Lionel, disciple et ami d’André, en fait le constat : « Sous Michel-Ange, les écoles étaient de vrais champs de bataille ; aujourd’hui elles se remplissent à peine, lentement, de jeunes gens silencieux. On travaille pour vivre, et les arts deviennent des métiers. » (I, 1, p. 36). Aux ambassadeurs de François Ier venus réclamer les tableaux que le roi avait payés d’avance à André, celui-ci s’accuse : « j’ai toujours fait mes tableaux trop vite, pour avoir de l’argent comptant » (III, 2, p. 64). L’amitié d’André pour Cordiani qui le trahit atteint des sommets pathétiques, quand André propose à son ami son aide lorsqu’il le surprend arrivant chez sa femme après avoir tué son gardien Grémio : « Mon ami, mon cher ami, doutes-tu de moi ? » (I, 3, p. 44). Cette amitié était égale à l’amour : « Où sont mes vingt années de bonheur, ma femme, mon ami, le soleil de mes jours, le repos de mes nuits ? » (II, 3, p. 58). Voici le tableau La Charité que le héros est censé montrer aux ambassadeurs. La notice nous apprend que dans la version scénique, le public se moquait d’une reproduction malhabile du tableau que les ambassadeurs et à travers eux le roi étaient censés admirer.

Les Caprices de Marianne
Variation sur le même thème : André & Cordiani se retrouvent sous l’avatar de Cœlio & Octave, et l’on trouve des aveux de Musset que « Les deux jeunes gens sont nés de la projection de tendances profondes et opposées de la personnalité du poète : un Cœlio timoré, idéaliste et mélancolique, épris d’un amour d’autant plus impérieux qu’il le sent – qu’il le souhaite ? Au fond de lui-même voué à l’échec […] ; un Octave trop hardi et trop gai, libertin et blasé » (notice, p. 906). Pour Simon Jeune, Marianne « est la première d’une lignée d’héroïnes soucieuses de leur liberté et de leur dignité », et « ces jeunes femmes font de Musset un vigoureux auteur féministe » (notice, p. 907). La représentation en 1851 fut informée par la censure, dont le rapport écrivait : « La crudité de certains détails, la manière dont sont présentées par Octave des théories au moins inconvenantes sur le mariage et l’amour, nous paraissent rendre cet ouvrage inadmissible. » (notice, p. 908).
La pièce commence ex abrupto par une déclaration d’amour par l’intermédiaire de Ciuta, « vieille femme », qui avertit Marianne qu’« un jeune homme de cette ville est éperdument amoureux [d’elle] ». Marianne l’envoie paître : « En voilà assez. Dites à celui qui vous envoie qu’il perd son temps et sa peine et que s’il a l’audace de me faire entendre une seconde fois un pareil langage j’en instruirai mon mari. » (p. 72). Quelle audace ? Survient Octave, le cousin ivrogne de Marianne et ami de Cœlio. Son ébriété le rend éloquent, et nous offre une belle stichomythie : « il y a une grande différence entre mon auguste famille et une botte d’asperges. Nous ne formons pas un faisceau bien serré, et nous ne tenons guère les uns aux autres que par écrit. » (p. 75). Stichomythie, ou plutôt sorte de chant amébée, forme antique appréciée de Musset, spécialement dans cette pièce, qu’on peut considérer comme un ancêtre du rap et du slam. Octave accepte d’aider le décidément peu audacieux Cœlio, non sans avoir commencé par lui conseiller : « Si tu en aimais une autre ? » (p. 76), et de lui proposer une prostituée. Octave aborde Marianne, en termes peu séduisants. Il lui demande son âge, et quand elle a dix-neuf ans : « Vous avez donc encore cinq ou six ans pour être aimée, huit ou dix ans pour aimer vous-même, et le reste pour prier Dieu. » (p. 79). Pendant ce temps, Cœlio rentre dans son très vieil appartement rue Sarasate, où il retrouve sa vieille maman chérie : « Quand vous aviez dix ou douze ans, toutes vos peines, tous vos petits chagrins se rattachaient à moi, d’un regard sévère ou indulgent de ces yeux que voilà dépendait la tristesse ou la joie des vôtres, et votre petite tête blonde tenait par un fil bien délié au cœur de votre mère. » (p. 80). Octave continue à entretenir librement Marianne autant qu’il le veut, et celle-ci lui tête de belle façon, avec des propos féministes : « Qu’est-ce après tout qu’une femme ? L’occupation d’un moment, une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée, qu’on porte à ses lèvres et qu’on jette par-dessus son épaule. Une femme ! C’est une partie de plaisir ! Ne pourrait-on pas dire, quand on en rencontre une : voilà une belle nuit qui passe ? » (p. 86). J’ai cité dans cet article une belle scène d’insultes gracieuses entre Octave et Claudio. La scène première de l’acte II contient encore un bel échange entre Marianne et Octave. Celle-ci lui fait la leçon en établissant une contradiction entre son goût du vin fin et son goût des prostituées : « Je croyais qu’il en était du vin comme des femmes. ». En gros, les prostituées, c’est comme le gros rouge, c’est bon pour le peuple. Et Octave de répliquer, très pragmatique : « Combien de temps pensez-vous qu’il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs ? » […] « Elle sait qu’elle est bonne à boire et qu’elle est faite pour être bue. » (p. 90). Les notes précisent que Musset transposait dans cette scène son examen de conscience personnel (cf. note 2, p. 930). On songe à la confrontation entre Camille et Perdican à l’acte II, scène V d’On ne badine pas avec l’amour : à chaque fois le match est serré, et l’on sent dans la bouche de la femme les reproches que Musset se fait à lui-même. C’est parce que son mari lui fait une scène pour avoir causé avec Octave que Marianne décide « Je veux prendre un amant » (p. 95). Octave magnanime envoie donc enfin son pusillanime ami au front avec un conseil qui en fait effectivement un auteur féministe : « et si elle résiste, prouve-lui qu’il est un peu tard » (p. 97) [1]. Il se fait ces réflexions cyniques : « Souffler une maîtresse à son ami, c’est une rouerie trop commune pour moi. Marianne ou toute autre, qu’est-ce que cela me fait ? La véritable affaire est de souper ; il est clair que Cœlio est à jeun. » (p. 97). Le pauvre puceau meurt à la première escarmouche, ce qui nous vaut une parodie d’éloge funèbre d’Octave et Marianne sur sa tombe : « Je ne sais point aimer, Coelio seul le savait. La cendre que renferme cette tombe est tout ce que j’ai aimé sur la terre, tout ce que j’aimerai. […] Je ne suis qu’un débauché sans cœur ; je n’estime point les femmes ; l’amour que j’inspire est comme celui que je ressens, l’ivresse passagère d’un songe. » (p. 100).
Dans Histoire du théâtre dessinée (Nizet, 1996), André Degaine détaille sur un tiers de page les nombreuses modifications acceptées par Musset pour la représentation de cette pièce, avec ce commentaire : « Il veut être joué : il a des dettes » (p. 268). Je trouve ce commentaire déplacé : tous les dramaturges de l’époque sans une seule exception, Hugo le premier, ont dû ramper sous les fourches caudines de la censure, et avaler toutes les couleuvres possibles et imaginables, tout en publiant leur texte intégral pour la postérité. Musset a été le seul à refuser d’être joué pendant 17 ans. Puis il a accepté. Ce n’est pas une question d’autocensure : c’est qu’il avait changé, qu’il n’avait plus de talent, et que son absence de talent correspondait au goût dominant de l’époque. Quant à ses pièces anciennes, elles ont fini par plaire, et il a profité de l’aubaine, comme tous ses contemporains, en acceptant des coupes, qui parfois correspondaient aussi à l’évolution de ses propres idées, comme la fameuse suppression de la scène des étudiants dans Lorenzaccio…
Fantasio
L’une des pièces les plus jouées, bien qu’il ne s’agisse comme son titre l’indique que d’une aimable fantaisie. C’est le brio de l’auteur qui fait briller ce diamant. Si la politique fait son entrée dans l’œuvre théâtrale de Musset, elle est subordonnée à une intrigue amoureuse digne d’un conte, comme avoué en II, 5 : « C’est un vrai conte de fées » (p. 129). On retrouve en Fantasio le clone de l’Octave de l’opus précédent, en ivrogne inspiré. L’exposition est expéditive : le prince de Mantoue arrive, à qui est promise la princesse. Le secrétaire du roi ne se livre à aucun éloge, ce dont le roi, roué, infirme que le prince est indigne : « je ne sacrifierai le bonheur de ma fille à aucun intérêt. », conclut-il (p. 104). Le groupe d’amis bruyants dont Fantasio fait partie se voit chassé par respect pour la princesse. Ils protestent discrètement ; les mots « intolérable » et « despotisme » sont timidement formés sur leurs lèvres (p. 105). Mais l’arrivée de Fantasio ramène la conversation sur le terrain existentiel : « Quelles solitudes que tous ces corps humains ! » (p. 108) ; « je m’y suis promené en cent fois plus de sens, dans cette cervelle délabrée, moi son seul habitant ! je m’y suis grisé dans tous les cabarets ; je m’y suis roulé comme un roi absolu dans un carrosse doré ; j’y ai trotté en bon bourgeois sur une mule pacifique, et je n’ose seulement pas maintenant y entrer comme un voleur, une lanterne sourde à la main. » (p. 109) ; à peine Fantasio reconnaît-il que son ennui provient du fait qu’il « n’exerc[e] aucune profession ». Ruiné, Fantasio envisage de coucher « chez la première venue » (p. 109). Au milieu de cette scène déprimante, « il se met à danser » (p. 110), comme Lorenzaccio en IV, 9. La conversation reprend, et avide de placer ses bons mots, c’est de la bouche de Spark, que Musset fait sortir cette allégorie typique des « enfants du siècle » : « L’éternité est une grande aire, d’où tous les siècles, comme de jeunes aiglons, se sont envolés tour à tour pour traverser le ciel et disparaître ; le nôtre est arrivé à son tour au bord du nid ; mais on lui a coupé les ailes, et il attend la mort en regardant l’espace dans lequel il ne peut s’élancer. » (p. 111). Lorenzaccio philosophe sur l’amour en termes pré-houellebecquiens : « L’amour n’existe plus, mon cher ami. La religion, sa nourrice, a les mamelles pendantes comme une vieille bourse au fond de laquelle il y a un gros sou. » (p. 112). C’est parce qu’il raille l’enterrement du bouffon Saint-Jean qu’on lui lance une plaisanterie qu’il prend au mot : il se propose comme bouffon, bien qu’il soit « filleul de la feue reine » (p. 113 ; un détail qui ne sera pas repris).
La princesse se résigne, par amour pour son père, à épouser un homme dont l’alliance amènera la paix au royaume : « Après tout, je serai une reine, c’est peut-être amusant ; je prendrai peut-être goût à mes parures, que sais-je ? à mes carrosses, à ma nouvelle cour ; heureusement qu’il y a pour une princesse autre chose dans le mariage qu’un mari. Je trouverai peut-être le bonheur au fond de ma corbeille de noces. » (p. 117). Cette réflexion ne vaut-elle que pour les princesses ? N’est-ce pas une réponse aux propos désabusés de Fantasio ? Le premier entretien de la princesse et du bouffon rappelle celui d’Octave et Marianne, avec ce trait de chant amébée : « ELSBETH : Pauvre homme ! quel métier tu entreprends ! faire de l’esprit à tant par heure ! N’as-tu ni bras ni jambes, et ne ferais-tu pas mieux de labourer la terre que ta propre cervelle ? FANTASIO : Pauvre petite ! quel métier vous entreprenez ! épouser un sot que vous n’avez jamais vu ! — N’avez-vous ni cœur ni tête, et ne feriez-vous pas mieux de vendre vos robes que votre corps ? » (p. 119). Le prince est caricaturé, mais c’est aussi une parodie des comédies de travestissement : s’il a l’idée, comme dans Le jeu de l’amour et du hasard d’échanger son rôle avec celui de son aide de camp pour espionner la princesse, le roi estime immédiatement que cet aide de camp (le prince déguisé) « est un imbécile » (p. 122). Pourtant, le prince renonce par deux fois à reprendre son habit, histoire de boire la coupe jusqu’à la lie ! C’est un truc de potache qui fait échouer le mariage : Fantasio hameçonne la perruque princière, et se retrouve en prison, d’où la princesse le sauvera. Quant à la guerre qui va reprendre, on s’en bat l’œil du moment que la princesse est libre ! Il était temps que Musset passe à quelque chose de plus substantiel !
Voir en ligne : Œuvres complètes d’Alfred de Musset sur le projet Gutemberg
© altersexualite.com 2012
Reproduction interdite
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com