Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Théâtre complet, d’Alfred de Musset : après Lorenzaccio
Édition établie par Simon Jeune
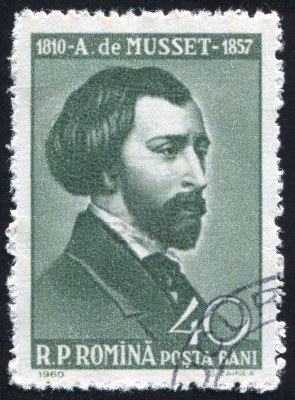 Théâtre complet, d’Alfred de Musset : après Lorenzaccio
Théâtre complet, d’Alfred de Musset : après Lorenzaccio
Bibliothèque de la Pléiade, 1990 (1834-1857), 1368 p., 60 €
samedi 13 octobre 2012, par
Cette série d’articles sur Musset est dédiée à mon oncle Jean-Pierre Labosse (1949-2012).
Après Lorenzaccio, voici donc la lecture de la suite du volume de la Bibliothèque de la Pléiade consacré au théâtre d’Alfred de Musset par Simon Jeune. Les pièces y sont présentées par ordre chronologique de publication. Cet article présente mes notes de lecture sur les pièces postérieures à Lorenzaccio, après un article sur les pièces antérieures, et avant un article sur Alfred de Musset. L’amour, l’amour, et encore l’amour ; vous en reprendrez bien une louche ? Comment, après un tel chef d’œuvre, Musset a-t-il pu se répéter, bêcher et rebêcher la même plate-bande ? Heureusement, on passe de trois à un acte. Voici les dix pièces « autorisées » par Musset, c’est-à-dire reprises par lui-même en volume, suivies de quelques pièces ou fragments plus ou moins reniées, soit posthumes, soit publiées dans une anthologie ou en journal et non reprises. En prime, vous trouverez sur ce site mon cours en deux parties sur Le Théâtre romantique. En 2013, ciliegia sulla pasticceria, voilà un ultime article intitulé « À Florence (et à Rome), sur les traces de Lorenzaccio ».
Plan
On ne badine pas avec l’amour
La Quenouille de Barberine
Le Chandelier
Il ne faut jurer de rien
Un Caprice
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Louison
On ne saurait penser à tout
Carmosine
Bettine
Pièces non reprises par Musset
Ébauches et projets
On ne badine pas avec l’amour
Cette pièce a été publiée en 1834 avant Lorenzaccio, et créée peu après la mort de l’auteur, avec quelques coupes, malgré des précautions et réticences polies de la commission de censure, qu’on trouvera dans la notice, p. 1054. Musset s’est inspiré de son amour pour et des lettres de George Sand. Simon Jeune estime que Musset a voulu dénoncer la façon dont les religieuses se réfugient dans l’amour de Dieu par dépit pour l’amour humain, alors qu’il avait au contraire valorisé l’amour de Dieu des moines dans « Rolla ». La pièce avait été commencée en alexandrins (le début de la première scène seulement), et ce document figure en annexe. Belle idée de « réécriture » pour les 1re L. Le scénario est bête comme chou : deux jeunes cousins de sexe opposés ont été bien éduqués de part et d’autre, et se retrouvent dans la maison du baron leur père et oncle, veuf, qui a prévu de les marier. Malheureusement, prévenue par des religieuses, Camille a décidé de renoncer aux hommes pour se consacrer à l’amour de Jésus. Perdican utilise la jeune paysanne Rosette, sœur de lait de Camille, pour tenter de la récupérer, en titillant sa jalousie.
Le baron, comme tous les autres personnages, semble un faire valoir, il n’influe que fort peu sur son fils et sa nièce. Ses propos sont fort ridicules, par exemple quand il théorise sa conception des femmes : « je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Soyez persuadé qu’elles aiment à avoir de la poudre dans les yeux, et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent, afin d’en gober davantage » (p. 258). Dès l’arrivée de Camille, le pauvre baron déchante, car celle-ci refuse d’embrasser son cousin, et admire le portrait d’une grand-tante dévote (p. 259). Lors de leur première entrevue, Perdican lui propose de devenir amis à défaut d’époux, et lui demande de lui toucher la main pour sceller le pacte, mais elle répond : « Je n’aime pas les attouchements » (p. 267). Le mot avait à l’époque un sens moins fort. Aussitôt Perdican, en jeune homme inconséquent, entreprend de draguer Rosette, et cherche ses lèvres. Une note précise : « En 1861, le baiser sur la bouche était impossible à la Comédie-Française » Le texte avait été modifié, mais suite à une tournée à Londres, l’administrateur avait constaté que le public puritain n’était pas choqué par « les vives tendresses de Roméo et Juliette », et avait imposé le baiser sur les lèvres (p. 1063). À la fin de cette scène, c’est le garçon qui pleure, ce qui ne laisse pas d’étonner. On sent que Musset est dans la même perspective d’autocritique que dans Fantasio. La scène 5 de l’acte II est un modèle de discussion franche entre homme et femme sur le mariage : « Camille : — Que me conseilleriez-vous de faire le jour où je verrais que vous ne m’aimez plus ? Perdican : — De prendre un amant. Camille : — Que ferai-je ensuite le jour où mon amant ne m’aimera plus ? Perdican : — Tu en prendras un autre. » Cela me fait penser à la discussion entre Aline et Germain Larrey dans Aline-Ali, d’André Léo, à ceci près qu’ici c’est le garçon qui mène la discussion, et n’en reste qu’à de jolis paradoxes, alors que le roman d’André Léo approfondit la question politique de la situation des femmes dans le mariage.
C’est dans cette scène que Musset met dans la bouche de Perdican le même aveu que celui d’André del Sarto : « je ne crois pas à la vie immortelle ». Camille est inflexible : « Je veux aimer, mais je ne veux pas souffrir ; je veux aimer d’un amour éternel, et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Elle montre son crucifix. » (p.277). Camille limite sa réflexion au sentiment amoureux lui-même, et rive provisoirement son clou à Perdican : « Il me semble que vous devez cordialement mépriser les femmes qui vous prennent tel que vous êtes, et qui chassent leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d’une autre sur les lèvres. Je vous demandais tout à l’heure si vous aviez aimé ; vous m’avez répondu comme un voyageur à qui l’on demanderait s’il a été en Italie ou en Allemagne, et qui dirait : « Oui, j’y ai été » ; puis qui penserait à aller en Suisse, ou dans le premier pays venu. » (p. 278) [1]. Camille ne se montre guère altersexuelle], et Perdican lui répond par un autre bon mot : « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels ; toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées ; le monde n’est qu’un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange ; mais il y a au monde une chose sainte et sublime, c’est l’union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. » (p. 280). Cela ne coûte guère à dire, et l’on se demande si Musset a lu Balzac pour avoir une vision si « romantique » du mariage ! On retrouve en tout cas le même genre de défi qu’il semble se lancer, que dans la discussion de l’acte II, scène 1 des Caprices de Marianne entre Marianne et Octave : mettre dans la bouche de la femme des arguments imparables, puis relever le défi et les parer ! Les notes nous apprennent que la conclusion de Perdican (« on se retourne pour regarder en arrière ; et on se dit : “ J’ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j’ai aimé. C’est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. “ ») provient d’une lettre… de George Sand !
La manigance ourdie par Perdican au moment où il ouvre la lettre de Camille disant qu’elle l’a « réduit au désespoir par son refus », doit être un modèle de la comédie fatale qu’invente Cécile dans Bonjour tristesse, de Françoise Sagan : « J’ai demandé un nouveau rendez-vous à Camille, et je suis sûr qu’elle y viendra ; mais par le ciel, elle n’y trouvera pas ce qu’elle y comptera trouver. Je veux faire la cour à Rosette devant Camille elle-même. » Perdican se montre particulièrement « romantique » au sens vulgaire du terme et odieux dans la scène 3, quand il se sert de Rosette devant Camille qu’il sait cachée, dans cette sorte de rondeau en prose : « Sais-tu ce que c’est que l’amour, Rosette ? Ecoute ! le vent se tait ; la pluie du matin roule en perles sur les feuilles séchées que le soleil ranime. Par la lumière du ciel, par le soleil que voilà, je t’aime ! Tu veux bien de moi, n’est-ce pas ? On n’a pas flétri ta jeunesse ? On n’a pas infiltré dans ton sang vermeil les restes d’un sang affadi ? Tu ne veux pas te faire religieuse ; te voilà jeune et belle dans les bras d’un jeune homme. Ô Rosette, Rosette ! sais-tu ce que c’est que l’amour ? » (p. 287). À étudier en parallèle avec la fameuse scène des paysannes de Dom Juan ; au moins le séducteur de Molière est-il conscient de tromper ! Dans la scène 6, Camille aura beau jeu de le morigéner : « Tu as voulu me lancer à tout prix quelque trait qui pût m’atteindre, et tu comptais pour rien que ta flèche empoisonnée traversât cette enfant, pourvu qu’elle me frappât derrière elle. » (p. 292), et la pièce bute abruptement sur une pirouette cruelle à la Bérénice, puisque, alors que la voie semble libre, le rideau s’abaisse sur un « Adieu, Perdican ! » il faut dire bien mérité.
La Quenouille de Barberine
Cette pièce publiée en 1835 est entièrement adaptée d’une nouvelle d’un conteur italien de la Renaissance, Matteo Bandello. Elle a été écrite en deux actes, puis gonflée d’un troisième acte pour être mise en scène. Ce 3e acte figure dans le dossier. Un conte, Ulric, doit laisser son épouse aimante au château, pour rejoindre la cour. Là, il fait la connaissance d’un jeune arriviste, Rosemberg, qui, mal conseillé par un chevalier, entreprend de le défier sur la fidélité de son épouse, qu’il parie de séduire, avec la reine pour témoin, qui déclare : « N’y a-t-il pas une présomptueuse et hautaine folie à prétendre juger toutes les femmes ? » (p. 313). Selon Simon Jeune, c’est une des seules pièces de Musset, sinon la seule, où l’amour conjugal est présenté comme équilibré (p. 1072). C’est aussi une véritable purge, qui ne se joue plus, et pour cause, comme si Musset avait épuisé toute sa sève. Ulric est inquiet : « Que ma femme soit chaste, cela est bien certain ; je n’en doute pas, mais… Quel mal pourrait-il y avoir, si je croyais trouver un moyen… non pas de m’en assurer, puisque cela est prouvé pour moi, mais enfin… » (p. 316). Le bélître ne fait pas long feu (ce en quoi on peut dire que Musset avait la plume en berne), et se retrouve emprisonné, forcé par la belle à filer la quenouille pour gagner son pain, malgré ses protestations : « je ne suis point une fileuse » (p. 324). On relèvera seulement une défense de la fidélité, qui transpire l’exercice de rhétorique chez Musset : « ROSEMBERG : — Puisque Dieu a fait la beauté, comment peut-il défendre qu’on l’aime ? C’est son image la plus parfaite […]. BARBERINE : — Mais si la beauté est l’image de Dieu, la sainte foi jurée à ses autels ne lui est-elle pas plus chère que la beauté même ? S’est-il contenté de créer ? N’a-t-il donc pas sur son œuvre céleste étendu la main comme un père, pour défendre et pour protéger ? » (p. 318). Les variantes données en annexe proposent une fin encore plus lénifiante que le texte premier.
Le Chandelier
Voilà encore une aimable niaiserie datée de 1835, à ranger parmi les Comédies et proverbes. Le titre suggère l’expression « tenir la chandelle ». La pièce a pu être jouée du vivant de l’auteur, grâce à une brève suppression de la censure sous la Deuxième République, entre février 1848 et juillet 1850. Puis elle a été jouée avec une fin remaniée, plus « morale ». Fortunio était joué par une femme, comme c’était le cas pour Chérubin dans l’œuvre de Beaumarchais. Le ton est dès le début plus moliéresque, y compris dans le langage du barbon. Il s’agit de détourner la jalousie dudit barbon sur un « chandelier », le jeune clerc Fortunio. Jacqueline, femme du notaire Maître André, aime le hussard Clavaroche, qui lui suggère, quand ils manquent d’être découverts, d’utiliser un « chandelier », c’est-à-dire un pigeon qui joue le rôle d’amoureux transi (définition par Clavaroche, p. 336) pour détourner les soupçons du mari sur le véritable amant : « Les soupçons, ma chère, les soupçons d’un mari jaloux ne sauraient planer dans l’espace ; ce ne sont pas des hirondelles. Il faut qu’ils se posent tôt ou tard, et le plus sûr est de leur faire un nid » (p. 338). Jacqueline ourdit donc la machination en choisissant celui des trois clercs de son époux dont sa servante lui dit qu’il salue les grisettes et n’a d’yeux que pour elle. L’acte II s’ouvre sur une complainte de Clavaroche en Don Juan fatigué de la drague : « En vérité, on représente l’amour avec des ailes et un carquois ; on ferait mieux de nous le peindre comme un chasseur de canards sauvages, avec une veste imperméable et une perruque de laine frisée pour lui garantir l’occiput. Quelles sottes bêtes que les hommes, de se refuser leurs franches lippées pour courir après quoi, de grâce ? Après l’ombre de leur orgueil ! » (p. 347).
Le personnage de Fortunio est insupportablement niais, il emplit les oreilles de Jacqueline de son amour souffreteux à la façon du jeune Jean-Jacques Rousseau jouissant de s’étaler aux pieds de Mme Basile (livre II des Confessions : « d’un simple mouvement de doigt elle me montra la natte à ses pieds »). Quand Clavaroche se montre trop sûr de lui parce qu’il croit les soupçons du mari envolés (« Il faut souffler sur le chandelier », p. 359), c’est l’arroseur arrosé, et moyennant la bonne vieille ficelle de la discussion surprise par Fortunio caché dans l’alcôve, l’affaire connaîtra un dénouement plus heureux que la même machination dans On ne badine pas avec l’amour, puisque Fortunio va intervertir son rôle de chandelier contre celui de l’amant en titre. Auparavant, il nous aura fallu subir un interminable monologue de Fortunio, culminant avec cette saillie qui assurément ferait bien rire si l’on avait la mauvaise idée de monter la pièce aujourd’hui : « Non ! tant d’horreur n’est pas possible ! Non, une femme ne saurait être une statue malfaisante, à la fois vivante et glacée ! » (p. 366). Musset ne nous livre qu’un mauvais vaudeville, pauvre en bons mots (« [Fortunio] est par là quelque part dans vos jupes ; vous l’avez oublié dans une armoire, et votre servante l’aura par mégarde accroché au porte-manteau. », p. 362). Tout au plus peut-on voir dans la situation de Jacqueline, épiée par son mari et les clercs de son mari, soumise au bon vouloir de son amant, une mise en accusation de la situation des femmes dans le mariage, mais quel affadissement par rapport aux Caprices de Marianne ! Le fait que Fortunio emporte la chandelle, tandis que Rosette mourait dans Badine, victime du même type de ricochet, est significatif. Mais quand on supporte le monologue de Fortunio, on se prend à bâiller en regrettant son presque homonyme Fantasio, et ce qu’avec le même nombre de mots Lorenzaccio pouvait remuer… D’après Simon Jeune, l’intrigue est tirée d’une mésaventure de jeunesse de l’auteur, qui joua ce type de rôle à 17 ans. On nous apprend même le nom de la donzelle… Mon avis est que toute cette donjuanerie de bas étage sent à plein nez son homosexualité refoulée…
Il ne faut jurer de rien
Ce « proverbe » date de 1836, également nourri d’expériences personnelles selon Simon Jeune (souvenirs d’une période où Musset souhaita se ranger des voitures ; le dialogue avec le baron serait issu d’un dialogue qu’il eut avec lui-même, ce que nous avons déjà maintes fois rencontré…). Le ton est beaucoup plus alerte que la précédente, excepté la chute décevante ; on n’a pas peur de faire dans le vaudeville, comme l’indique cette réplique du baron à la fin de la scène 1 : « Me prends-tu pour un oncle du Gymnase ? » (p. 386). L’intrigue est téléphonée : un oncle riche menace son neveu de le déshériter s’il ne se marie, et lui propose un parti [2]. L’oncle se fait une conception du mariage des plus attrayantes : « Tu serais, parbleu, bien à plaindre quand on te mettrait ce soir dans les bras une jolie fille bien élevée, avec cinquante mille écus sur ta table pour t’égayer demain matin au réveil. Voyez un peu le grand malheur, et comme il a de quoi faire l’ombrageux ! Tu as des dettes, je te les paierais ; une fois marié, tu te rangeras » (p. 381). Les réticences du neveu sont cavalièrement exprimées ; elles portent sur la fidélité des femmes, en arguant de sa propre expérience de cocueur ! « J’avais seize ans, et je sortais du collège, quand une belle dame de notre connaissance me distingua pour la première fois. […] J’étais un soir chez ma maîtresse, au coin du feu, son mari en tiers. Le mari se lève et dit qu’il va sortir. À ce mot, un regard rapide, échangé entre ma belle et moi, me fait bondir le cœur de joie. […] Je me retourne, et vois le pauvre homme mettant ses gants. […] Tandis qu’il y enfonçait ses mains, debout au milieu de la chambre, un imperceptible sourire passa sur le coin des lèvres de la femme, et dessina comme une ombre légère les deux fossettes de ses joues. […] Mais, par une bizarrerie étrange, le souvenir de ce moment de délices se lia invinciblement dans ma tête à celui de deux grosses mains rouges se débattant dans des gants verdâtres ; et je ne sais ce que ces mains, dans leur opération confiante, avaient de triste et de piteux, mais je n’y ai jamais pensé depuis sans que le féminin sourire ne vînt me chatouiller le coin des lèvres, et j’ai juré que jamais femme au monde ne me ganterait de ces gants-là » (p. 383). Il se plaint comme un gandin de l’éducation que se font sur les tas les femmes mariées, et pointe sans en avoir l’air l’habitus féminin de l’époque : « Quelle éducation a-t-elle reçue ? […] A-t-elle une femme de chambre adroite, un escalier dérobé ? […] La mène-t-on, après un bon dîner, les soirs d’été, quand le vent est au sud, voir lutter aux Champs-Élysées dix ou douze gaillards nus, aux épaules carrées ? […] A-t-elle à sa porte un verrou doré, qu’on pousse du petit doigt en tournant la tête, et sur lequel retombe mollement une tapisserie sourde et muette ? […] A-t-elle des migraines ? » (p. 384). Pour complaire au baron, le neveu fait le pari de séduire la donzelle en huit jours sous une identité d’emprunt. S’il y parvient, c’est une salope, il n’épouse pas ; s’il n’y parvient pas, c’est une sainte, il l’épouse parce qu’il ne l’a pas séduite ! Évidemment, les choses ne se passent pas ainsi : comme dans Fantasio, le déguisement tourne à la farce : ici, l’oncle vend la mèche à la baronne, laquelle est persuadée que sa fifille bien élevée lui remettra la lettre délirante du neveu déguisé. Elle ne la donne pas, mais la baronne l’exige, et se vexe qu’elle y soit traitée de « girouette ». Chassé, Valentin se veut venger, et tâche de plus belle à séduire la belle : « Je jure qu’elle sera ma maîtresse, mais qu’elle ne sera jamais ma femme » (p. 405). On note une nouvelle série de répliques sur le modèle du chant amébée en III, 1. Le 3e acte ne tient pas ses promesses, puisqu’en fait de donjuaniser la belle, on apprend qu’il y a eu tromperie : les deux tourtereaux s’étaient déjà rencontrés et plu à un bal, et si Cécile se rend au rendez-vous nocturne, elle a une bonne excuse : « Pourquoi ne serais-je pas venue, puisque je sais que vous m’épouserez ? » Il se prépare une belle vie d’aristocrates rangés : « quand vous vivrez dans les métairies et que vous aurez des pauvres à vous » (p. 416). Musset fait donc du Musset, et fait pisser à grand jet le mérinos romantique : « Regarde comme cette nuit est pure ! Comme ce vent soulève sur tes épaules cette gaze avare qui les entoure ! Prête l’oreille : c’est la voix de la nuit, c’est le chant de l’oiseau qui invite au bonheur. Derrière cette roche élevée, nul regard ne peut nous découvrir. Tout dort, excepté ce qui s’aime. Laisse ma main écarter ce voile, et mes deux bras le remplacer. » (p. 412). Je serais cette jeune fille, je me méfierais du renard ! C’est du même violon que jouait Perdican pour Rosette…
Un Caprice
C’est une pièce en un acte, écrite en 1837 et jouée dix ans plus tard, la 2e pièce de Musset représentée de son vivant, avec une bizarrerie : elle avait été traduite en russe, puis représentée, en russe et même en français, à Saint-Pétersbourg, avant d’être jouée par la même actrice en France. Selon Simon Jeune, « C’est de loin la pièce de Musset le plus souvent représentée à la Comédie-Française » (p. 1171). Mme de Chavigny — « Une femme de vingt ans, belle comme un ange et fidèle comme un lévrier ! » (p. 437) — aime son mari, mais souffre de le voir faire la cour à une Mme de Blanville. Elle lui fait de ses mains une bourse rouge. Mais au moment où elle va la lui donner, il en sort une bleue, que l’amie du couple, Mme de Léry, reconnaît comme étant de la main de Mme de Blanville. Crise de larmes et de jalousie ; Mme de Léry entreprend de venger son amie et de réconcilier les époux. Elle obtient du mari ce que n’avait obtenu sa femme, qu’il brûle la bourse bleue, lui faisant croire que la rouge serait d’elle. Cet aimable divertissement conjugal et mondain est prétexte à considérations de bon ton sur les hommes et les femmes. M. de Chavigny se vante d’être autant l’amant que le mari de sa femme, puis d’avoir les idées larges : « Vous savez, ma chère, que je vous laisse libre et que vous sortez quand il vous plaît. Vous trouverez juste que ce soit réciproque. » (p. 423). Le fil rouge de la bourse, qui sert à mettre de l’or que l’on joue ou dont on fait l’aumône à ses pauvres, est typique de ce milieu social, comme est révélateur le fait que Musset n’ait pas songé à nommer les domestiques dans la liste des personnages, quoiqu’ils eussent des répliques. Musset plaisante en passant son amie : Mme de Léry lit « la Revue des Deux Mondes ; un article très joli de madame Sand sur les orangs-outangs. » ! (p. 438). Elle allume M. de Chavigny, lui fait dire des fadaises : « MADAME DE LÉRY : — Je vous le ferai croire bien aisément. J’ai une vanité qui ne veut pas de maître. CHAVIGNY : — Ne peut-elle souffrir un serviteur ? MADAME DE LÉRY : — Bah ! Serviteurs ou maîtres, vous n’êtes que des tyrans. CHAVIGNY, se levant. — C’est assez vrai, et je vous avoue que là-dessus j’ai toujours détesté la conduite des hommes. Je ne sais d’où leur vient cette manie de s’imposer, qui ne sert qu’à se faire haïr. » (p. 445) ; il propose un « caprice », liaison sans engagement : « ce qui s’offre à vous n’est pas le plaisir sans amour, c’est l’amour sans peine et sans amertume ; c’est le caprice, puisque nous en parlons, non l’aveugle caprice des sens, mais celui du cœur, qu’un moment fait naître et dont le souvenir est éternel » (p. 446). Avant de le remettre dans les rails conjugaux, elle se permet un court sermon : « Quand nous nous serons prouvé l’un à l’autre que je suis une coquette et vous un libertin, uniquement parce qu’il est minuit et que nous sommes en tête-à-tête, voilà un beau fait d’armes que nous aurons à écrire dans nos mémoires ! » (p. 448). Cette pièce est utilisée par Zola dans Une Page d’amour (IVe partie, chapitre III) : Mme Deberle, qui s’apprête à tromper son mari, monte cette pièce avec des amies et son amant, et le mari conseille ces dames sur la façon de jouer cette « comédie imbécile » !
Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée
Ce proverbe date de 1845 ; Malgré le succès de sa pièce précédente, Musset a arrêté d’écrire du théâtre pendant 8 ans. Selon Simon Jeune, on retrouve « le problème qui est au cœur même de la vie de Musset, la guerre des sexes » (p. 1178). Elle constitue après Un Caprice le 2e plus grand succès de Musset au théâtre. Ce lever de rideau n’est même pas divisé en scènes. Un peigne-cul de conte vient s’ennuyer auprès d’une marquise, ayant oublié le jour de réception réservé aux ennuyeux de son espèce. Du moins c’est ce qu’on croit, car en enfilant des perles de riens sur un fil de futilité, on en vient à parler d’amour de façon convenue, et la marquise envoie balader le comte de belle manière jusqu’à ce qu’il ne lui parle plus d’amour mais de mariage. D’une façon différente d’Il ne faut jurer de rien, le comte a pu, à son corps défendant, constater que ladite marquise était armée pour rejeter tous les godelureaux qui lui viendraient conter bagatelle. D’où sans doute son entêtement à la séduire malgré les rebuffades. Le titre m’avait toujours interpellé, mais je n’avais pas eu l’occasion de lire ou de voir cette aimable niaiserie. Non qu’il n’y ait de jolies escarmouches dignes du boulevard : « LA MARQUISE : — Mais, mon Dieu ! c’est bien pis qu’une phrase, c’est une déclaration que vous me fabriquez là. Avertissez au moins : est-ce une déclaration ou un compliment de bonne année ? LE COMTE : — Et si c’était une déclaration ? LA MARQUISE : — Oh ! ce que je n’en veux pas ce matin. Je vous ai dit que j’allais au bal, je suis exposée à en entendre ce soir ; ma santé ne me permet pas ces choses-là deux fois par jour. » (p. 454). À la page suivante, la marquise se surpasse : « La belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête, comme une poupée dans un étalage,et de lui dire bien agréablement : Madame, je vous trouve charmante ! Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un cornet de bonbons, voilà pourtant ce qu’on appelle faire la cour. Fi donc ! comment un homme d’esprit peut-il prendre goût à ces niaiseries-là ? » « Niaiseries », c’est décidément le mot.
Louison
Jouée et publiée en 1849, voici Louison, ennuyeux proverbe en vers qui reprend le thème d’Un Caprice : un jeune et beau duc pourvu d’une jeune et belle duchesse s’ennuie, fréquente le bal et tente de strausskahniser la soubrette Louison, fille de la campagne dont la mère du duc est la marraine. Louison n’est pas dupe, et quand il lui offre un diamant, s’exclame « Monsieur veut m’acheter » (p. 470). Heureusement, sur ces entrefaites un certain Berthaud, rustaud de son village, vient la demander en mariage. Elle le traite de sot ou d’imbécile (p. 505), mais l’accepte, pourvu qu’il lui permette de sauver son honneur. Cette piécette est tout juste l’occasion de quelques propos de salon sur l’égalité, qui semblent accorder la même valeur à une servante qu’à un duc (« Un brin d’herbe au soleil, comme on dit, a sa place », p. 499), mais si l’on y regarde de plus près, les vaches mussétiennes sont mieux gardées que celles de Marivaux ou Beaumarchais, et chacun est renvoyé à sa place. Berthaud invoque Voltaire, qui d’après lui aurait déclaré « Que les mortels entr’eux sont égaux sur la terre » (p. 479) [3]. La citation inexacte par un rustre, de même que le « comme on dit » de l’affirmation de Louise, mettent un bémol aux envolées égalitaires ! Musset semble faire l’apologie d’un amour conjugal heureux basé pourvu qu’on soit riche, jeune et beau, sur la fidélité réciproque et une jalousie bien tempérée. Berthaud ne l’est pas, beau, mais est-ce utile à des domestiques ? Le consentement de Louise est exprimé de façon insultante : elle le chasse et lui demande de la demander au duc, dans le but de se débarrasser de son encombrante cour. Le duc reproche franchement à sa jeune épouse casanière de ne pas accepter qu’il la « montre » au bal et à la cour (« n’ai-je donc pu me croire, / En vous montrant aussi, le droit d’en tirer gloire ? », p. 483). Musset ventriloque par duchesse interposée : « On croit qu’aimer, enfin, c’est le bonheur suprême… / Non. Aimer, c’est douter d’un autre et de soi-même, / C’est se voir tour à tour dédaigner ou trahir, / Pleurer, veiller, attendre… avant tout, c’est souffrir ! » Et la didascalie de redonder : Elle pleure (p. 509). On a connu Musset plus fin ! Comme dans Un Caprice, le mari repentant monologue au pied de sa femme qu’il croit endormie : « C’est ma sœur, mon enfant, ma femme et ma maîtresse » (p. 513), et tout est bien qui finit bien, car en fait elle ne dort que d’une oreille, le croiriez-vous ? Musset ne s’abaisse pas, malgré des références à Molière, à faire parler différemment son Berthaud ; au contraire, il le fait parfois parodier le langage tragique (p. 504). Mais alors, qu’est-ce qui justifie le mépris de Louise, lourdement affirmé au dénouement : à sa marraine, elle répond pour se justifier de n’avoir trouvé que ça comme époux : « Vous m’avez dit tantôt / De trouver un prétexte » (p. 516). Si Musset avait écrit à notre époque, on imaginerait bien des rires enregistrés !
On ne saurait penser à tout
Cette pièce médiocre a été créée d’abord pour des chaisières, et Musset, comme le rappelle Simon Jeune citant sa correspondance, s’en gaussait : « Les petits becs roses sortaient des chapeaux, et les menottes blanches des mitaines ». Avec le vrai public, ce fut une autre paire de mitaines, et Musset se plaignit d’avoir à affronter « sa majesté le suffrage universel » (p. 1202). Le texte fut publié en 1849 dans un journal intitulé L’Ordre, « un quotidien de propagande antisocialiste » fondé par un ami de Musset, dont la devise était « Religion, Famille, Propriété » ; c’est tout dire. Il s’agit de l’adaptation d’un texte de Carmontelle (1717-1806), le fondateur du genre des Proverbes. C’est encore une histoire de comtesse, de baron et de marquis, qui cherchent à s’épouser, mais sont embêtés car il y a une mission diplomatique à mener à bien, féliciter une duchesse qui vient d’accoucher. Le ressort comique est censé être que le marquis est tête en l’air et commet une bourde à la minute. Passons.
Carmosine
Cette pièce en trois actes, inspirée d’une nouvelle du Décaméron de Boccace, est intéressante pour l’étude de Lorenzaccio. En effet, la critique génétique a prouvé que malgré sa publication tardive en 1850, cette pièce qui ne fut pas jouée du vivant de son auteur, avait été conçue majoritairement vers 1834. Or le message politique de la pièce est radicalement différent selon Simon Jeune : « Ainsi apparaît un Musset fort différent, à quelques semaines d’intervalle, du Musset presque subversif dans sa sympathie pour l’idée républicaine, que venait de révéler Lorenzaccio ». Selon Jean Pommier, Musset inclinait déjà, un an après son chef d’œuvre, à rejoindre ses positions de classe, comme on a pu le vérifier par la plupart des pièces précédentes. Il s’agirait donc d’un « repentir » de Musset après Lorenzaccio. En 1850, le vieux schnoque qu’était devenu Musset, réactionnaire et catholicolâtre, dépensa pourtant les royalties rondelettes de la pièce à « une soirée organisée […] où les seuls convives étaient des filles » (p. 1216). C’est dire le grand écart entre le penchant politique et la libido du bonhomme. La pièce pourtant, sans doute du fait de fragments datant de 1834, année où l’auteur avait encore du talent, est moins médiocre que les précédentes. Même si le sujet est encore limité à des amours de princes et de duchesses, quelques répliques trahissent encore l’ancien talent. L’intrigue empruntée à Boccace est l’histoire d’une fille de bourgeois qui tombe amoureuse du roi, et oublie qu’elle est promise au fils de l’ami de son père, qui revient après six années d’absence consacrées à ses études. La pièce est truffée de galanteries réactionnaires sur la femme dont l’essence serait d’être un bibelot, bien emberlificotées par le talent de Musset. Exemple : « Si donc cette chose plus légère qu’une mouche, plus insaisissable que le vent, plus impalpable et plus délicate que la poussière de l’aile d’un papillon, cette chose qui s’appelle une jolie femme, réjouit tout et console de tout, n’est-il pas juste qu’elle soit heureuse, puisque c’est d’elle que le bonheur nous vient ? » (p. 562). Le discours du roi à son peuple, en II, V, constitue effectivement un repentir de Lorenzaccio : « La liberté, n’est-ce pas, et la patrie ? Et tel est l’empire de ces deux grands mots, qu’ils ont sanctifié la vengeance. » (p. 575). Dans la scène des « jeux-partis » (II, VI), on retrouve brièvement le talent de Musset pour le chant amébée, sans doute est-ce une partie de la pièce qui date de 1834. Tout dans l’attitude du roi Don Pèdre sent son repentir, car il est l’exact contraire de l’Alexandre de Lorenzaccio. En effet, comme il vient à apprendre qu’une bourgeoise est tombée amoureuse de lui, au lieu de chercher à l’abuser, il envoie sa femme la rendre à la raison avant de s’imposer lui-même au domicile de la fille, et lui trouve un mari convenable, alors qu’Alexandre ne s’imposait au domicile des jeunes filles que pour les violer. La reine, au lieu d’être jalouse, est magnanime, et loin des piques anticléricales du jeune Musset, pousse Carmosine à s’agenouiller devant l’idée de Dieu et du mariage (p. 602).
Bettine
Pour bien comprendre la médiocrité des pièces de la maturité de Musset, il faut avoir présent à l’esprit que ces années ont vu la création et le succès de pièces de jeunesse qui n’avaient pas été créées à l’époque de leur écriture. Il était donc logique que l’auteur à succès se voie commander d’autres pièces. Bettine est intéressante parce que Musset, qui l’a écrite par passion pour une actrice, s’y dépeint en vieil amateur d’actrices, capables, à l’instar de son personnage le marquis Stéfani, de se « blottir dans ce cher petit coin où j’étais à demeure pour me délecter à vous entendre ». Il est lucide sur son état : « C’est que je commence à aimer mes souvenirs plus qu’il ne faudrait » (p. 615). Pour le reste, l’ami de George Sand se complaît à nouveau à des propos méprisants pour le sexe faible : « Rien ne coûte si cher que les femmes qui ne coûtent rien » (p. 609) ; cependant ces propos sont ceux du Baron, qui veut faire quitter le théâtre à Bettine quand il l’épousera, et se réserver son talent. Son orgueil est blessé, quand il est ruiné au jeu, par sa proposition de payer sa dette : « De quel front, avec quel visage irais-je subir ce rôle d’un mari qui vit d’une fortune qui n’est pas la sienne, et promener par toute l’Italie une femme que je ne ferais que suivre, avec mon nom sur son passeport et mes armes sur sa voiture ? » (p. 631). Il a le mauvais rôle et la générosité du Marquis s’accommode au contraire du retour au théâtre de celle qu’il se déclare prêt à épouser alors qu’elle vient de se ruiner pour le Baron. Musset s’amuse à faire de la jalousie du baron le déclencheur du retour de flamme du Marquis, comme si les diamants qu’il vient d’offrir à Bettine, et qui ont suscité ladite jalousie, étaient parfaitement innocents ! Bettine s’achève en anti-Bérénice, puisque la défection du Baron ouvre la voie à son rival dans le cœur de Bettine.
Pièces non reprises par Musset
La Quittance du diable est une fantaisie romantico-gothique de jeunesse (1830) jamais publiée, adaptation libre d’un roman de Walter Scott, avec effets spéciaux, flammes, enfer et damnation. Elle contient l’une des seules apparitions de personnages populaires dans le théâtre de Musset : un jeune paysan venu réclamer sa quittance de fermier à un Lord.
La matinée de Don Juan est un « fragment » très court, publié en revue en 1833 et oublié. Don Juan s’y fait lire quelques noms de la « liste » de ses conquêtes, qu’il commente de façon bouffonne. Exemple : « La baronne de Valmont : Quelle paire de moustaches elle avait ! » (p. 676). Il fait draguer pour lui par Leporello une fille dans la rue, et à la fin se décide à se lever pour voir ce dont il retourne, et demande son « corset ». Un Don Juan efféminé autant que désenchanté, qui n’a rien à voir avec la vision tragique de Don Juan dans « Namouna ».
Faire sans dire est un « proverbe » publié en 1836 au sein d’un recueil de 12 pièces d’auteurs différents. Une affaire d’honneur change le destin d’un pauvre musicien qui se plaint de son sort : une femme et son amant poursuivis par un frère jaloux se réfugient chez lui, mais l’amant est lâche, et le musicien sa sacrifie pour la donzelle. C’est l’occasion, comme le remarque Simon Jeune, d’une des rares « revendication économico-sociale » (p. 1274) du théâtre de Musset.
L’Habit vert est un « proverbe » léger issu d’une collaboration entre Musset et Émile Augier, joué en février 1849. Les deux auteurs avaient connus de gros succès dans les semaines précédentes, et la critique leur reprocha de s’être divertis à bon compte. La pièce met en scène un couple d’amis colocataires par obligation, qui doivent mettre au clou leur dernier habit commun qu’ils se prêtaient, pour manger quelque chose. Le prêteur est un juif, clairement désigné comme tel et bien sordide. Dommage que cette petite pièce antisémite soit encore l’une de celles où Musset soit attentif au peuple, seulement pour s’en moquer semble-t-il. La jeune première de la pièce, pauvre ouvrière, s’exclame avec bon sens : « Ne vous semble-t-il pas que ces belles dames, ces jolis petits messieurs, qui ont sans cesse ce mot charmant d’amour sur les lèvres, passent leur vie dans un désœuvrement tout à fait royal, et que ce sont les plus habiles gens du monde à ne rien faire ? C’est pour eux que l’amour a été inventé, car sans lui que deviendraient-ils ? Ils ont besoin de rêver pour ne pas dormir ; et plus ces rêves sont variés, nouveaux, plus ils les chérissent ! Sans quoi, ils périraient d’ennui un beau jour, entre deux coups de lansquenet. Moi, je vais en journée, je taille des robes, je raccommode de la dentelle… vous comprenez que, si j’ai autre chose en tête, je vais broder de travers ou me piquer les doigts » (p. 699). Ne dirait-on pas une autocritique ?
Le Songe d’Auguste est une pièce de commande publiée de façon posthume. Ironie du sort, elle fut commandée par « Hippolyte Fortoul, ancien ami de Musset [qui] avait été un des rares critiques à louer le drame de Lorenzaccio, et à le louer notamment en raison des sympathies républicaines qu’il laissait transparaître ». Devenu ministre de Napoléon III, il rend à Musset « sa charge de bibliothécaire de ministère, qui lui avait été retirée en mai 1848 par Ledru-Rollin », et lui commande une pièce à la gloire de l’Empire. La musique d’accompagnement fut composée par Charles Gounod, mais la pièce ne fut jamais jouée en dehors d’une lecture musicale, à cause de la proclamation pacifique qu’elle contient, au moment où éclate la guerre d’Orient (p. 1281). C’est une pièce dans le genre tragique en alexandrins, assez incohérente et surtout sans action. Des chœurs saluent Auguste ; il discute avec Livie et Octavie sur ce qu’il doit faire ou ne pas faire, puis avec Mécène à propos de poésie, puis s’endort et voit les Muses en rêve.
L’Âne et le ruisseau est également une pièce de commande du même ami, pour le divertissement de la cour. C’est la dernière œuvre de Musset, et elle fut publiée posthume, mais il eut quand même le temps d’en faire une lecture devant la cour, où il se formalisa d’être interrompu par un Rothschild et un perroquet ! En parlant de perroquet, encore une fois, Musset s’inspire d’un proverbe de Carmontelle et d’une pièce (Le Legs) de Marivaux. On se demande bien pourquoi, dans « La Coupe et les Lèvres », le jeune Musset avait tenu à écrire : « Je hais comme la mort l’état de plagiaire ; / Mon verre n’est pas grand, mais je bois dans mon verre ». Il y a en effet peu d’auteurs qui ont trouvé autant de mal que lui à trouver des sujets originaux ! En fait de sujet original, c’est la nième variation mussétienne sur le thème « Je t’aime, moi non plus », et toujours, pour donner raison à la jeune ouvrière de la pièce précédente, on reste entre « ces belles dames, ces jolis petits messieurs, qui ont sans cesse ce mot charmant d’amour sur les lèvres ». Variation réussie d’ailleurs : Musset termine sa carrière sur une jolie comédie du XVIIIe siècle. Un marquis et un baron doivent épouser une comtesse et sa nièce. Le baron n’ose pas franchir le pas, et la nièce est tant soit peu froide. Le marquis invente de feindre un amour caché avec la comtesse pour forcer les deux récalcitrants à préciser leurs sentiments, d’où le titre, explicité en cette phrase : « Pousse cette porte, te dis-je ! Tiens, Henri, sais-tu, en ce moment, de quoi tu as l’air ? Tu ressembles, révérence parler, à un âne qui n’ose pas franchir un ruisseau » (p. 751) [4].
Ébauches et projets
Le volume de la Pléiade se termine par une série d’ébauches et projets, souvent limités à deux ou trois pages. C’est le ton qui permet de situer ces pages souvent non-datées, dans la chronologie du style mussétien. Le plan d’un drame en cinq actes intitulé Le Comte d’Essex sent son romantisme gore. Par exemple à l’acte V, une scène prévoit : « Mort affreuse de d’Essex. Raleigh y assiste ». Un fragment intitulé Les Deux magnétismes rappelle le ton provocateur des débuts, qui aurait fait rougir le poète de cour de Napoléon III : « Cela me fait une belle jambe ! Un roi qui verse les siennes dans ses bottes avec une cuillère à pot ! Il est pourri, votre Louis XVIII, au moral comme au physique.— Leur Napoléon ne vaut guère mieux » (p. 786). Le projet sur La Servante du roi (1839) est intéressant, car il témoigne d’une volonté malheureusement avortée de réformer la tragédie après les excès romantiques. Simon Jeune résume un article de Musset de 1838 dans La Revue des Deux Mondes : « [la tragédie] se substituera au « débordement », au « déluge » du drame romantique. Elle ne suivra pas la tragédie de Racine, trop discoureuse, « mais celle de Sophocle, dans toute sa simplicité […], dans sa féroce grandeur, dans son atrocité sublime » » (p. 1317). Cette ébauche, ainsi que la suivante, était du cousu main pour l’actrice Rachel (Rachel Félix), née juive et pauvre, ce qui explique qu’il ait abandonné des projets pourtant bien avancés. Musset multiplie les allusions à ce destin particulier d’une actrice qu’il aime. Cela relativise peut-être l’antisémitisme présent dans L’Habit vert ? Faustine (1851) est l’ébauche la plus aboutie, sous la forme d’un acte premier presque entier, avec un personnage féminin qui se pose là en deux scènes. Voici un extrait où elle s’adresse à son frère, qui envisage de tuer l’homme à qui elle s’est fiancée en secret pour échapper à un mariage arrangé (et prestigieux) : « Être fidèle à la foi jurée, appelles-tu cela forfaire à l’honneur ? Le vôtre, à vous, se montre partout, à la maison, au palais, au sénat, dans les rues, en mer, au combat ! Vous le portez au bout de votre épée ! Le nôtre, à nous, est au fond de notre âme. Tout ce que nous pouvons, c’est aimer ; tout ce que nous devons, c’est d’être fidèles » (p. 813). La dernière ébauche de cette édition est Madame de Châteauroux, comédie politique datant des années 1850, dont le début laissait bien augurer. Il est dommage qu’avec tant de projets alléchants, les pièces abouties soient souvent si décevantes…
Voir en ligne : Œuvres complètes d’Alfred de Musset sur le projet Gutemberg
© altersexualite.com 2012
Reproduction interdite
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires d’altersexualite.com.
[1] En passant, cette réplique fournit de quoi répliquer aux puristes qui prétendent qu’il ne faut pas dire « avoir été » mais « être allé ». La distinction est claire dans cette phrase entre « avoir été » à l’aspect duratif, désignant un séjour passé, et « aller », qui désigne seulement un projet de déplacement.
[2] J’ai naguère vu un excellent boulevard intitulé Le Gai mariage qui brodait sur le même thème avec une petite variante…
[3] Simon Jeune remet les pendules à l’heure dans ses notes, et cite Voltaire critiquant Rousseau « qui crie que tous les hommes sont égaux » : « Ces maximes sont le fruit d’un orgueil ridicule qui détruirait toute société » (p. 1197).
[4] « révérence parler » : cette variante de « (toute) révérence gardée » est appréciée par Molière, cf par exemple : « LA MERLUCHE.— Et moi, Monsieur, que j’ai mon haut-de-chausses tout troué par derrière, et qu’on me voit, révérence parler… » (L’Avare, III,1).
 altersexualite.com
altersexualite.com