Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Le Théâtre romantique (partie 1/2)
Un cours pour les Terminale L
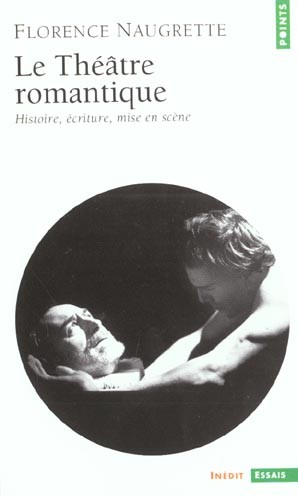 Le Théâtre romantique (partie 1/2)
Le Théâtre romantique (partie 1/2)
Florence Naugrette et André Degaine mis à contribution
samedi 15 décembre 2012
Voir directement nos cours sur Hernani de Victor Hugo.
Après quatre articles consacrés à Alfred de Musset, à Lorenzaccio, puis à son Théâtre complet : avant Lorenzaccio et après Lorenzaccio, voici un cours (en deux parties) sur le Théâtre romantique., cours toujours utile jusqu’en 2020 pour Hernani. En 2013, ciliegia sulla pasticceria, voilà un ultime article intitulé « À Florence (et à Rome), sur les traces de Lorenzaccio ».
Je me suis borné à glaner dans le livre excellent de Florence Naugrette (Points Seuil essais, 2001), et celui plus ancien mais non moins excellent d’André Degaine, Histoire du théâtre dessinée (Nizet, 1996), l’essentiel de ce qui permet de comprendre les tenants et aboutissants de cette période du théâtre. J’ai reproduit de nombreuses citations, parfois raccourci, parfois allongé les extraits choisis. Tout cela entremêlé de considérations plus personnelles. Les citations entre guillemets non référencées sont extraites du livre de Florence Naugrette.
Introduction
Le théâtre romantique jouit d’une réputation paradoxale quant au petit nombre de pièces que le temps a consacrées comme chefs d’œuvre : Hernani, Lucrèce Borgia et Ruy Blas de Victor Hugo (1802-1885), Chatterton d’Alfred de Vigny (1797-1863), Lorenzaccio d’Alfred de Musset (1810-1857). Le théâtre d’Alexandre Dumas (1802-1870), l’autre grand dramaturge de l’époque, n’est plus guère accessible, et le succès de ses œuvres romanesques a éclipsé le succès considérable qu’il eut à l’époque comme auteur de théâtre. Cyrano de Bergerac, d’Edmond Rostand, créé en 1897, un an après Lorenzaccio, bien après la période romantique, est un succès paradoxal, comme si la forme idéale du théâtre romantique avait été trouvée après coup. En dépit de ce faible héritage, les conceptions romantiques du théâtre ont profondément modifié le genre, mais elles n’ont fait que poursuivre une réflexion menée depuis le XVIIe siècle en France et en Allemagne notamment, et accuser le coup de la révélation des pièces de William Shakespeare, découvertes dans leurs versions originales au début du XIXe siècle seulement en France. Le théâtre romantique est donc à considérer comme un point nodal sur un continuum qui va des origines du théâtre français au théâtre actuel.
Plan
1. Critique des règles du théâtre classique, en France et en Allemagne, du XVIIe au XVIIIe
2. La démocratisation du théâtre
3. Vers une nouvelle esthétique théâtrale
4. La censure
5. La bataille d’Hernani
6. Les différents théâtres
7. Les acteurs célèbres
8. Mise en scène, décors, éclairage
9. L’évolution du théâtre au XIXe
10. La condition des femmes
11. La redécouverte de Shakespeare
12. L’esthétique de Victor Hugo
13. Le drame romantique et la question sociale
14. Peuples et rois vus par les romantiques
1. Critique des règles du théâtre classique, en France et en Allemagne, du XVIIe au XVIIIe.
Au XVIIe siècle déjà, on se rebelle contre les « contraintes des règles figées par les doctes au nom d’Aristote » (384-322 avant J.-C.) (p. 22). Il n’est qu’à voir le mélange des genres dans les grandes comédies de Molière, et cette déclaration par exemple, de Dorante dans La Critique de l’École des femmes (1663) :
DORANTE. — « Vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants, et nous étourdissez tous les jours. Il semble, à vous ouïr parler, que ces règles de l’art soient les plus grands mystères du monde ; et cependant ce ne sont que quelques observations aisées, que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l’on prend à ces sortes de poèmes ; et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours, sans le secours d’Horace et d’Aristote. Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n’est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n’a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s’abuse sur ces sortes de choses, et que chacun ne soit pas juge du plaisir qu’il y prend ? »
Au siècle des Lumières, plusieurs théoriciens publient des essais dans le but de prôner un genre intermédiaire entre comédie et tragédie, qui sera le drame bourgeois. Denis Diderot (1713-1784) publie Le Fils naturel (écrit en 1757, représenté en 1771), puis les Entretiens sur « Le Fils naturel ». Gotthold Ephraim Lessing (1719-1781) traduit en allemand Le Fils naturel, et publie La Dramaturgie de Hambourg (1767), essai dans lequel il prolonge les idées de Diderot. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) publie un Essai sur le genre dramatique sérieux (1767), au moment de sa première pièce Eugénie, bien avant sa trilogie (1775 à 1792). Extrait :
« J’entends citer partout de grands mots et mettre en avant, contre le genre sérieux, Aristote, les anciens, les poétiques, l’usage du théâtre, les règles et surtout les règles, cet éternel lieu commun des critiques, cet épouvantail des esprits ordinaires. En quel genre a-t-on vu les règles produire des chefs-d’œuvre ? N’est-ce pas au contraire les grands exemples qui de tout temps ont servi de base et de fondement à ces règles, dont on fait une entrave au génie en intervertissant l’ordre des choses ? Les hommes eussent-ils jamais avancé dans les arts et les sciences s’ils avaient servilement respecté les bornes trompeuses que leurs prédécesseurs y avaient prescrites ? […] Le génie curieux, impatient, toujours à l’étroit dans le cercle des connaissances acquises, soupçonne quelque chose de plus que ce qu’on sait ; agité par le sentiment qui le presse, il se tourmente, entreprend, s’agrandit, et, rompant enfin la barrière du préjugé, il s’élance au-delà des bornes connues. Il s’égare quelquefois, mais c’est lui seul qui porte au loin dans la nuit du possible le fanal vers lequel on s’empresse de le suivre. Il a fait un pas de géant, et l’art s’est étendu…
Est-il permis d’essayer d’intéresser un peuple au théâtre, et de faire couler ses larmes sur un évènement tel qu’en le supposant véritable et passé sous ses yeux entre des citoyens, il ne manquerait jamais de produire cet effet sur lui ? Car tel est l’objet du genre honnête et sérieux. »
Moins connu comme dramaturge, Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) publie deux essais en 1773 et 1778, et prescrit de parler « des affaires qui agitent la nation » plutôt que de l’histoire ancienne, de même qu’il cherche à représenter dans ses propres pièces le peuple entier et non la seule bourgeoisie, en préférant la collectivité à un héros individuel. Sa pièce à succès La Brouette du vinaigrier (1774) reprend et adapte à des personnages populaires le coup de théâtre des Femmes savantes : le vinaigrier offre ses économies pour sauver de la ruine un négociant dont son fils est amoureux de la fille, promise à un coureur de dot qui cède la place dès qu’il apprend que le futur beau-père est ruiné. Extrait de Du Théâtre, ou Nouvel essai sur l’art dramatique (1773) :
« L’art dramatique (quoi qu’on en dise) est peut-être encore dans son enfance, parce que, malgré les efforts de quelques hommes de génie, l’édifice, d’abord timidement conçu, n’a pas été bâti sur le plan le plus général et le plus solide : on a resserré la sphère de la scène, on n’y a fait monter que certains personnages, et ceux-là précisément qu’il semble qu’on aurait dû dédaigner. On n’a point aperçu toute l’étendue, toute la fécondité de cet art important : on a eu pour sa première forme une admiration superstitieuse. L’écrivain, moins audacieux qu’esclave, n’a guère vu que son cabinet au lieu de la société. Même de nos jours, l’assemblée que composent ordinairement les auditeurs de nos pièces ne peut être considérée que comme une compagnie particulière, à laquelle les poètes ont eu le dessein de plaire exclusivement. Nos spectacles n’ont été que des chambrées, parce que les raisonnements de quelques littérateurs trop accrédités ont borné l’art et détruit son essor relativement à leur faire et aux règles sacrées de ce prétendu goût dont ils parlent sans cesse, et qui n’est qu’un mot inventé par eux pour voiler d’une manière captieuse la petitesse et la froideur de leurs idées. […] Notre théâtre (il faut le dire), gothiquement conçu dans un siècle à demi barbare, enfant du hasard et rejeton parasite, a conservé l’empreinte de sa burlesque origine. Notre théâtre n’a jamais appartenu à notre sol : c’est un bel arbre de la Grèce, transplanté et dégénéré dans nos climats. Il a été greffé par des mains grossières et maladroites ; aussi n’a-t-il porté que des fruits équivoques et sans substance. De serviles imitateurs, copiant jusqu’aux chœurs grecs, ont dressé nos premiers tréteaux, tréteaux mouvants et qui firent regretter alors les mystères [1], bien plus intéressants pour la nation. »
Mme de Staël (1766-1817) aura une grande influence en mettant à la portée des auteurs français les idées et les pièces allemandes, notamment les idées d’Auguste Schlegel (1767-1845), qui critique le caractère absolu de la règle des trois unités. Il regrette aussi la suppression du chœur antique, qui permet justement de rapporter ce qui se passe en dehors de l’espace-temps de la scène : seule l’unité d’action se justifie, mais les autres en découlent, et l’unité de lieu va de pair avec le goût pour un décor surchargé, qui n’existe pas dans le plateau nu du théâtre élisabéthain (théâtre de l’époque de la reine Élisabeth Ire, 1558 – 1603).
2. La démocratisation du théâtre
Le public du théâtre se démocratise. Molière l’évoquait déjà dans La Critique de l’École des femmes :
DORANTE. — « Tu es donc, marquis, de ces messieurs du bel air, qui ne veulent pas que le parterre ait du sens commun, et qui seraient fâchés d’avoir ri avec lui, fût-ce de la meilleure chose du monde ? Je vis l’autre jour sur le théâtre un de nos amis, qui se rendit ridicule par là. Il écouta toute la pièce avec un sérieux le plus sombre du monde ; et tout ce qui égayait les autres ridait son front. À tous les éclats de risée, il haussait les épaules, et regardait le parterre en pitié ; et quelquefois aussi, le regardant avec dépit, il lui disait tout haut : Ris donc, parterre, ris donc. Ce fut une seconde comédie, que le chagrin de notre ami. Il la donna en galant homme à toute l’assemblée, et chacun demeura d’accord qu’on ne pouvait pas mieux jouer qu’il fit. Apprends, marquis, je te prie, et les autres aussi, que le bon sens n’a point de place déterminée à la comédie ; que la différence du demi-louis d’or, et de la pièce de quinze sols, ne fait rien du tout au bon goût ; que, debout ou assis, l’on peut donner un mauvais jugement ; et qu’enfin, à le prendre en général, je me fierais assez à l’approbation du parterre, par la raison qu’entre ceux qui le composent, il y en a plusieurs qui sont capables de juger d’une pièce selon les règles, et que les autres en jugent par la bonne façon d’en juger, qui est de se laisser prendre aux choses, et de n’avoir ni prévention aveugle, ni complaisance affectée, ni délicatesse ridicule. »
Le théâtre à l’italienne permet un compartimentage social. Les aristocrates étaient protégés du public populaire dans les loges (les « ouvreurs » sont les ouvreurs de loges), avec des escaliers séparés ; la bourgeoisie montante constitue le gros du public à l’orchestre et à la corbeille, mais les artisans, commerçants et les employés, les domestiques, le petit peuple, fréquente aussi les théâtres, le 2e et 3e balcon, et notamment les « paradis » des théâtres à l’italienne pour les plus pauvres, et au XIXe, les nombreux théâtres des boulevards. L’orchestre et le parterre sont uniquement masculins ; les dames refusent d’ôter leurs chapeaux, et « occupent avant-scènes ou corbeille […] c’est seulement en 1895 que la Comédie-Française tolère les femmes sans chapeau à l’orchestre, sauf les jours d’abonnement » (A. Degaine, op. cit. p. 277). Ces extraits de Splendeurs et Misères des courtisanes (1838), d’ Honoré de Balzac, montrent bien quel jeu social se joue dans les théâtres, indépendamment des spectacles qui s’y donnent :
« De sa loge à l’Opéra, ses yeux froids [du baron de Nucingen] plongeaient tranquillement sur le Corps de Ballet. Pas une œillade ne partait pour ce capitaliste de ce redoutable essaim de vieilles jeunes filles et de jeunes vieilles femmes, l’élite des plaisirs parisiens. »
« Le baron envoya son domestique chercher une des deux loges d’Avant-scène aux premières. Autre originalité parisienne ! Quand le Succès, aux pieds d’argile, emplit une salle, il y a toujours une loge d’Avant-scène à louer dix minutes avant le lever du rideau ; les directeurs la gardent pour eux quand il ne s’est pas présenté, pour la prendre, une passion à la Nucingen. Cette loge est, comme la primeur de Chevet, l’impôt prélevé sur les fantaisies de l’Olympe parisien. »
« Au spectacle, il fut obligé de boire un nombre infini de verres d’eau sucrée, en laissant Esther seule pendant les entractes. Par une rencontre si prévisible qu’on ne saurait la nommer un hasard, Tullia, Mariette et madame du Val-Noble se trouvaient au spectacle ce jour-là. Richard d’Arlington fut un de ces succès fous, et mérités d’ailleurs, comme il ne s’en voit qu’à Paris. En voyant ce drame, tous les hommes concevaient qu’on pût jeter sa femme légitime par la fenêtre, et toutes les femmes aimaient à se voir injustement opprimées. Les femmes se disaient : « C’est trop fort, nous ne sommes que poussées… mais ça nous arrive souvent !… » Or une créature de la beauté d’Esther, mise comme Esther, ne pouvait pas flamber impunément à l’Avant-scène de la Porte-Saint-Martin. Aussi, dès le second acte, y eut-il dans la loge des deux danseuses une sorte de révolution causée par la constatation de l’identité de la belle inconnue avec la Torpille. »
« Une quinzaine environ avant le jour choisi pour donner sa fête, et qui devait être le lendemain du premier bal de l’Opéra, la courtisane, que ses bons mots commençaient à rendre redoutable, se trouvait aux Italiens, dans le fond de la loge que le baron, forcé de lui donner une loge, lui avait obtenue au rez-de-chaussée, afin d’y cacher sa maîtresse et ne pas se montrer en public avec elle, à quelques pas de madame de Nucingen. Esther avait choisi sa loge de manière à pouvoir contempler celle de madame de Sérisy, que Lucien accompagnait presque toujours. La pauvre courtisane mettait son bonheur à regarder Lucien les mardis, les jeudis et les samedis, auprès de madame de Sérisy. Esther vit alors, vers les neuf heures et demie, Lucien entrant dans la loge de la comtesse le front soucieux, pâle, et la figure presque décomposée. »
Chapitre « La scène est dans les loges » : « Quand Lucien rentra dans la loge de madame de Sérisy, au lieu de tourner la tête vers lui, de lui sourire et de ranger sa robe pour lui faire place à côté d’elle, elle affecta de ne pas faire la moindre attention à celui qui entrait, elle continua de lorgner dans la salle ; mais Lucien s’aperçut au tremblement des jumelles que la comtesse était en proie à l’une de ces agitations formidables par lesquelles s’expient les bonheurs illicites. Il n’en descendit pas moins sur le devant de la loge, à côté d’elle, et se campa dans l’angle opposé, laissant entre la comtesse et lui un petit espace vide ; il s’appuya sur le bord de la loge, y mit son coude droit, et le menton sur sa main gantée ; puis, il posa de trois quarts, attendant un mot. Au milieu de l’acte, la comtesse ne lui avait encore rien dit, et ne l’avait pas encore regardé.
– Je ne sais pas, lui dit-elle, pourquoi vous êtes ici ; votre place est dans la loge de mademoiselle Esther…
– J’y vais, dit Lucien qui sortit sans regarder la comtesse. »
Le boulevard du Temple est surnommé « boulevard du Crime » à cause des mélodrames qu’on y joue à partir de 1797 (le crime est un ressort dramatique fréquent, souligné par un trémolo à l’orchestre, ou un roulement de cymbales : « mélodrame » signifie littéralement « drame chanté »). Un journal de 1823 comptabilise : « En 20 ans, Tautin a été poignardé 16 302 fois, Marty a subi 11 000 emprisonnements avec variantes, Fresnoy a été immolé de différentes façons 27 000 fois. Mademoiselle Dupuis a été 75 000 fois « innocente », séduite, enlevée ou noyée ». Voir le célèbre film de Marcel Carné, Les Enfants du Paradis (1945) [2]. Les théâtres de l’époque ont tous disparu quand Haussmann a créé la place de la République à l’endroit où ils se trouvaient. Le seul qui subsiste encore est le théâtre Déjazet, car c’est le seul qui se trouvait au côté sud du boulevard. Les théâtres proposent plusieurs pièces dans le même spectacle, par exemple deux drames (un de Hugo et un de Dumas) ou cinq vaudevilles en un acte. L’ambiance dans la salle est survoltée ; on s’installe longtemps avant le spectacle, on interpelle les acteurs. Les comédiens doivent s’avancer et dominer le public d’un regard circulaire, ce qui rend impossible une mise en scène au sens moderne. « Dans la mesure où il touche un public vaste et assidu [et la partie illettrée du peuple], le théâtre est naturellement le genre le plus convoité par les auteurs, mais aussi le mieux surveillé des autorités » (p. 77) (la chanson est aussi très surveillée).
Voir les gravures d’Honoré Daumier (1808-1879) (Croquis pris au théâtre, 1864).

3. Vers une nouvelle esthétique théâtrale
L’esthétique du théâtre est également bousculée. On raille la déclamation tragique :
« Un auteur est-il embarrassé d’un personnage qu’il a traîné de scènes en scènes pendant cinq actes, il vous le dépêche d’un coup de poignard : tout le monde se met à pleurer ; et moi je ris comme une folle. Et puis, a-t-on jamais parlé comme nous déclamons ? Les princes et les rois marchent-ils autrement qu’un homme qui marche bien ? Ont-ils jamais gesticulé comme des possédés ou des furieux ? Les princesses poussent-elles, en parlant, des sifflements aigus ? On suppose que nous avons porté la tragédie à un haut degré de perfection ; et moi je tiens presque pour démontré que, de tous les genres d’ouvrages de littérature auxquels les Africains se sont appliqués dans ces derniers siècles, c’est le plus imparfait. » (paroles de Mirzoza dans Les Bijoux indiscrets de Denis Diderot, 1748)
Extrait de L’Impromptu de Versailles (Scène première), de Molière (1663) :
MOLIÈRE : — « J’avais songé une comédie où il y aurait eu un poète, que j’aurais représenté moi-même, qui serait venu pour offrir une pièce à une troupe de comédiens nouvellement arrivés de la campagne. « Avez-vous, aurait-il dit, des acteurs et des actrices qui soient capables de bien faire valoir un ouvrage, car ma pièce est une pièce… — Eh ! Monsieur, auraient répondu les comédiens, nous avons des hommes et des femmes qui ont été trouvés raisonnables partout où nous avons passé. — Et qui fait les rois parmi vous ? — Voilà un acteur qui s’en démêle parfois. — Qui ? ce jeune homme bien fait ? Vous moquez-vous ? Il faut un roi qui soit gros et gras comme quatre, un roi, morbleu ! qui soit entripaillé comme il faut, un roi d’une vaste circonférence, et qui puisse remplir un trône de la belle manière. La belle chose qu’un roi d’une taille galante ! Voilà déjà un grand défaut ; mais que je l’entende un peu réciter une douzaine de vers. » Là-dessus le comédien aurait récité, par exemple, quelques vers du roi de Nicomède :
Te le dirai-je, Araspe ? Il m’a trop bien servi ;
Augmentant mon pouvoir…
le plus naturellement qu’il aurait été possible. Et le poète : « Comment ? Vous appelez cela réciter ? C’est se railler : il faut dire les choses avec emphase. Écoutez-moi.
(Imitant Montfleury, excellent acteur de l’Hôtel de Bourgogne.)
Te le dirai-je, Araspe ?… etc.
Voyez-vous cette posture ? Remarquez bien cela. Là, appuyez comme il faut le dernier vers. Voilà ce qui attire l’approbation, et fait faire le brouhaha. — Mais, Monsieur, aurait répondu le comédien, il me semble qu’un roi qui s’entretient tout seul avec son capitaine des gardes parle un peu plus humainement, et ne prend guère ce ton de démoniaque. — Vous ne savez ce que c’est. Allez-vous-en réciter comme vous faites, vous verrez si vous ferez faire aucun ah ! »
(Le même Montfleury (1600-1667) sera encore conspué dans l’acte I de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand en 1897)
Attention, cette déclamation tragique a été récemment étudiée et réhabilitée sous le nom de déclamation baroque par les recherches du dramaturge et cinéaste Eugène Green.
Diderot prône « un changement radical du rapport scène-salle » (p. 43). C’est l’idée du « quatrième mur », qui empêche les apartés, ou l’habitude des acteurs de venir réciter juste devant la rampe et quêter les approbations du public.
« Soit donc que vous composiez, soit que vous jouiez, ne pensez non plus au spectateur que s’il n’existait pas. Imaginez sur le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre : jouez comme si la toile ne se levait pas.
« Mais l’Avare qui a perdu sa cassette, dit cependant au spectateur : Messieurs, mon voleur n’est-il point parmi vous ? » Eh ! Laissez là cet auteur. L’écart d’un homme de génie ne prouve rien contre le sens commun. Dites-moi seulement s’il est possible que vous vous adressiez un instant au spectateur sans arrêter l’action ; et si le moindre défaut des détails où vous l’aurez considéré, n’est pas de disperser autant de petits repos sur toute la durée de votre drame, et de le ralentir ? » (De la poésie dramatique, 1758).
Stendhal reprend cette idée dans Racine et Shakespeare (1825 ; édition revue et augmentée subséquemment) :
« La première condition du drame, c’est que l’action se passe dans une salle dont un des murs a été enlevé par la baguette magique de Melpomène, et remplacé par le parterre. Les personnages ne savent pas qu’il y a un public. Quel est le confident qui, dans un moment de péril, s’aviserait de ne pas répondre nettement à son roi qui lui dit quelle heure est-il ? [réplique sifflée lors de la première d’Hernani] Dès l’instant qu’il y a concession apparente au public, il n’y a plus de personnages dramatiques. Je ne vois que des rapsodes récitant un poème épique plus ou moins beau. »
4. La censure et la condition des auteurs et comédiens
Beaumarchais crée en 1777 la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Auparavant, les auteurs se voyaient acheter leurs pièces comme des marchandises, et souvent étaient spoliés de leurs droits (les directeurs organisaient une « chute » de la pièce, ou truquaient leurs comptes). Avec la loi de 1791 (ci-dessous), les auteurs peuvent faire représenter leurs œuvres partout en France, et faire collecter leurs droits. C’est grâce à l’effet conjugué de cette société et de l’ouverture de nombreuses salles avec la fin des restrictions du nombre de théâtres, que se créera des années plus tard une génération d’auteurs gagnant suffisamment leur vie pour se consacrer entièrement au théâtre et améliorer la qualité des œuvres. Sur ce modèle, le 28 janvier 1828, la Société des gens de lettres (SGDL) est fondée, sur une idée d’Honoré de Balzac, par lui-même et George Sand, Victor Hugo, et Alexandre Dumas père. Dans ces années-là commencent à paraître les « romans-feuilletons », qui assurent des revenus substantiels aux auteurs.
La loi Le Chapelier abolit en 1791 le système des privilèges et de la censure préalable. Ce système réservait des types de spectacles à certaines salles, et facilitait le cloisonnement des genres. Napoléon Ier reviendra sur cette loi en 1807, mais la censure avait déjà été rétablie en août 1793. La situation s’améliorera sous la Restauration (1814-1830), puis la censure sera abolie par la monarchie de Juillet, et le théâtre vivra cinq années de pleine liberté entre 1830 et 1835. La censure sous la Restauration est effectuée par des auteurs ou des juristes tatillons. À cette époque, la loi sur le sacrilège punit de mort la profanation des hosties. Les allusions aux ministres ou aux corps constitués sont traquées, ainsi que les sous-entendus grivois (cela n’empêche pas que des vaudevilles sont joués au début de la Restauration, au Théâtre des Variétés, en vertu de la loi de spécialisation). Les critiques sur le goût dissimulent des réticences sur le fond. Les pièces sont soumises à la censure deux semaines avant la première, et elle rend son rapport, avec les passages à modifier ou à supprimer et suggestion d’autorisation ou interdiction. C’est ainsi que le plus célèbre censeur Charles Brifaut, obtient l’interdiction de Marion de Lorme de Victor Hugo, puis, n’osant pas faire interdire à nouveau Hernani, manigancera en sous-main pour tenter de faire échouer la pièce. Voici son avis de censure :
« Ce n’est pas seulement un aïeul du roi qui est tourné en ridicule, c’est le roi lui-même. Dans Louis XIII chasseur et gouverné par un prêtre, tout le monde verra une allusion à Charles X ! Nous sommes dans un moment sérieux. Le trône est attaqué de tous les côtés ; la violence des partis redouble tous les jours, ce n’est pas l’heure d’exposer aux rires et aux insultes du public la personne royale. On sait trop depuis Le Mariage de Figaro, ce que peut une pièce de théâtre. » (cité p. 80).
La censure sera rétablie en 1835 suite à l’attentat de Giuseppe Fieschi contre Louis-Philippe (« lois de septembre »), mais sur d’autres bases, et les censeurs seront dorénavant des fonctionnaires acquis aux idées libérales. Ils traquent surtout les atteintes au roi et aux institutions et les appels à l’insurrection, mais à cette époque où le peuple est largement analphabète, la censure est beaucoup moins vigilante sur les pièces comme Lorenzaccio qui ne sont pas représentées, mais juste publiées. Les théâtres subventionnés pratiquent l’autocensure. Les pièces jouées présentent souvent un texte édulcoré par rapport au texte publié. Par exemple, Lucrèce Borgia, de Victor Hugo, est publié avec deux variantes, présentées ainsi : « Le texte de la pièce, telle qu’elle est imprimée ici, est conforme à la représentation, à deux variantes près que l’auteur croit devoir donner ici pour ceux de MM. Les directeurs de théâtre de province qui voudraient monter Lucrèce Borgia ». L’une des modifications est la chanson de la scène de l’orgie finale, blasphématoire dans la version publiée, simplement bachique dans la variante pour la scène.
Il arrive encore que les comédiens soient excommuniés, comme le fut Molière. En 1802, puis en 1815 éclatent des scandales lorsque le curé de l’église Saint-Roch refuse l’entrée de l’église au convoi funéraire de Marie-Adrienne Chameroy, jeune danseuse morte en couche (1779-1802), puis de Mademoiselle Raucourt (1756-1815). Pour cette dernière, la vraie raison est peut-être qu’elle avait été lesbienne et fière de l’être.
5. La bataille d’Hernani.
Le premier grand succès « romantique » est Henri III et sa cour, d’Alexandre Dumas (Comédie française, 1829), qui inspire les jeunes auteurs. Une scène est admirée pour son réalisme, celle où le Duc de Guise broie les poignets de sa femme (jouée par Mademoiselle Mars) pour la forcer à donner rendez-vous à son amant Saint-Mégrin, pour lui tendre un piège. Hernani est écrite en un mois par Hugo, furieux de l’interdiction de Marion de Lorme. Il situe l’action en Espagne, ce qui rend la censure difficile, d’autant plus que même à cette époque, Hugo n’est pas un simple auteur, sa position sociale lui donne droit à des égards. Bien qu’elle ait été créée en février 1830, les romantiques en feront rétrospectivement un événement annonciateur de la révolution de Juillet. C’est d’abord une victoire contre la censure. La pièce dura 50 représentations, et la bataille ne fut pas menée qu’à la première, mais tous les soirs, et soutenue vaillamment par les comédiens, qu’Hugo avait pourtant eu du mal à convaincre. Les provocations concentrées dans la première scène suscitent les sifflets (l’escalier / Dérobé, où le vers est disloqué par les coups frappés à la porte ; le roi caché dans une armoire, le roi demandant « Quelle heure est-il ? » et se voyant répondre « Minuit » (II, 1), etc.). Le combat symbolisé par cette pièce est culturel et idéologique avant d’être politique. La pièce célèbre la liberté, la jeunesse, contre la « force mortifère du passé » incarnée par le vieillard amoureux Don Ruy Gomez. La mort inutile de Doña Sol et d’Hernani, obéissant à un ordre ancien (l’honneur castillan) dont Hernani a intériorisé la loi, est stérile, contrairement à la mort de Roméo et Juliette qui permet la réconciliation des deux familles. Elle dénonce une société gérontocratique « qui étouffe ses forces vives » (p. 144).
Tableau d’Albert Besnard, La première d’Hernani en 1830 (1903) (Maison de Victor-Hugo), Paris.

Après les années 1840, les temps changent. Reprise en 1845, Hernani est devenu un classique :
« Quand on songe aux tumultes, aux cris, aux rages de toutes sortes soulevés par cette pièce, il y a dix ans, on est tout étonné que la postérité soit venue si vite pour elle ; on y assiste comme à un des chefs-d’œuvre de nos grands maîtres, et chaque spectateur achève lui-même le vers commencé par l’acteur. Cet Hernani, si sauvage, si féroce, si baroque, si extravagant, qui a fait soupçonner M. Hugo de cannibalisme par les bonnes têtes de l’époque, est aujourd’hui une œuvre calme, sereine, se mouvant et planant comme l’aigle des montagnes dans cette région d’azur éternel et de neige immaculée que le fumier et les brouillards ne peuvent atteindre. On en met des morceaux dans les cours de littérature, et les jeunes gens en apprennent des tirades pour se former le goût. C’est maintenant une pièce classique. » (Théophile Gautier, La Presse, 10 mars 1845.)
6. Les différents théâtres
La Comédie-Française s’ouvre dans une certaine mesure aux romantiques, tout en privilégiant les pièces en vers. Elle recrute certains acteurs du boulevard, mais Hugo ou Dumas ne parviendront jamais à obtenir d’y faire jouer le grand Frédérick Lemaître (1800-1876). Les auteurs écrivent souvent en prévoyant les rôles pour leurs acteurs fétiches. Vigny, Dumas, Hugo, sont compagnons amants ou époux d’actrices, et Musset tombera souvent amoureux d’actrices. François Harel, directeur du Théâtre de l’Odéon, annexe de la Comédie-Française, puis du Théâtre de la Porte-Saint-Martin, aura un rôle important dans le succès des romantiques. Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand sera créé dans cette même salle reconstruite après un incendie, en 1897. Il convient de s’arrêter sur cette pièce, chef d’œuvre anachronique du romantisme créée un an après la création posthume de Lorenzaccio. Même si c’est un héros à moitié raté, Cyrano est une sorte de condensé de l’héroïsme viril de l’action, l’exact contraire de Lorenzaccio. On peut visionner par exemple cet extrait de la mise en scène de Denis Podalydès, avec Michel Vuillermoz (Comédie-Française, 2006), mais il faudrait revoir tout l’acte I, pour comprendre à quel point notre Lorenzo est un cheveu sur la soupe de la virilité fin de siècle. C’est François Harel qui accueille le jeune Musset en 1830 pour le four de La Nuit vénitienne, et Dumas pour Christine, une pièce de 5 heures. À cette occasion, une anecdote raconte que Hugo et Vigny aidèrent Dumas à améliorer la versification de sa pièce en une nuit, après une première houleuse. Une brouille générale interviendra vers 1836, et Dumas et Hugo se tournent à nouveau vers la Comédie-Française ou d’autres théâtres. C’est en 1838 que Hugo réalise son rêve d’avoir son théâtre, le Théâtre de la Renaissance, partagé avec Dumas. Aucun des deux ne le dirige, pour des raisons de rivalité. Ruy Blas ouvre le théâtre, avec un succès public et un éreintement critique. Ce théâtre survit difficilement jusqu’en 1841. En 1847, Dumas ouvre son Théâtre Historique. La Reine Margot y est créée à l’ouverture, c’est une pièce de 9 heures ! (de 18h à 3h du matin).

Célèbre gravure : « Les romantiques chassés du temple », par de Barray, La Caricature provisoire, 1838. Voir le fichier à la p. 2 du dossier « Victor Hugo par la caricature ». Source : Wikicommons.
7. Les acteurs célèbres
Les acteurs célèbres comptent énormément. Mademoiselle Mars (1779-1847) joue de grands rôles des premières pièces romantiques à plus de 50 ans, par exemple Doña Sol dans Hernani. Frédérick Lemaître connaît le succès en s’appropriant progressivement la pièce L’Auberge des Adrets de Benjamin Antier et deux autres auteurs (1823). Il détourne le sens de la pièce « en la tirant vers la parodie, exhibant les ficelles du genre de manière très insolente » (p. 100). Dix ans après, il écrit une suite intitulée Robert Macaire. Il incarne un bandit qui se retourne contre la société qui l’a produit et qui le rejette. L’intrigue retourne précisément ces contradictions vers le public lui-même, dont les valeurs sont remises en cause. Voir un extrait des Enfants du Paradis, avec Pierre Brasseur dans le rôle de l’acteur (passage recommandé : deuxième époque, entre la 10e et la 20e minute à peu près : la répétition de l’Auberge des Adrets). On remarque au passage dans cet extrait que le public du parterre est uniquement masculin, alors que dans les scènes tournées au théâtre Le Funambule, le public est des deux sexes, conformément aux dessins de l’époque exposés à la Cinémathèque en 2012. Exposition légèrement décevante, soit dit en passant, qui semble uniquement constituée des archives de la cinémathèque et de la maison Pathé, sans éclairage historique (par exemple, pourquoi Prévert croque-t-il Frédéric Lemaître en acteur Shakespearien, sans évoquer le moins du monde les grands auteurs romantiques de l’époque, Dumas et Hugo, qui ne furent pas pour rien dans le succès de Lemaître ?) Pas un mot dans l’expo non plus, de ce prétendu classement du film au patrimoine mondial de l’Unesco. Je vous recommande cette page sur le mime Deburau, à la fin de laquelle vous trouverez la gravure qui pour moi fut le clou de l’expo, Le déménagement des théâtres du Boulevard du Crime, de Bertall, pour Le Monde Illustré, en 1862 (cf. ci-dessous, numérisation par votre serviteur). Cela étant dit, on a quand même des choses superbes, comme le double manuscrit de Prévert et de Carné côte à côte, ou deux portraits d’Arletty par de grands peintres. Un détail intéressant : Robert Le Vigan, l’acteur qui devait jouer le marchand d’habits, était un collabo notoire. Il fuit le tournage en plein milieu (en janvier 1944) parce que ça tournait mal pour les Allemands. Or dans son rôle tenu finalement par Pierre Renoir, c’est à lui que Lacenaire lançait qu’il avait cru l’entendre dire « Marchand d’amis » au lieu de « Marchand d’habits ». Il fallait le faire ! Plusieurs autres extraits sur You tube : le boulevard du Temple ; Frédérick Lemaître par Pierre Brasseur, etc. Pour revenir au théâtre populaire, n’oublions pas qu’il exista toujours, à côté du théâtre savant, écarté des histoires officielles. Victor Hugo lui rendit hommage avec la fameuse « Green-Box » dans L’Homme qui rit (1869).
Marie Dorval (1798-1849) actrice fétiche puis maîtresse de Vigny, constitue un couple de théâtre avec Frédérick Lemaître. Ils ont une conception « très moderne de la mise en scène, conçue comme un réseau de significations cohérentes » (p. 105). Par exemple, à la fin de Chatterton (1835) de Vigny, elle invente de glisser et tomber de l’escalier qui symbolise la rupture entre le monde éthéré de l’artiste et la société mercantile ; une scène muette qui bouleversera toute la génération romantique. Rachel Félix (Mademoiselle Rachel) (1821-1858) est repérée dès l’âge de 17 ans par Musset critique de théâtre. Elle ne jouera jamais de pièces romantiques, au grand dam des auteurs, mais intègrera les progrès du jeu romantique pour des pièces classiques. Voici Rachel dans le rôle de Chimène.

Edmund Kean (1787-1833), acteur shakespearien britannique, est mythifié de son vivant. Son succès mondial et sa vie privée défraient la chronique. Trois ans après sa mort, Dumas lui consacre une pièce, qui sera jouée par Frédérick Lemaître. C’est une mise en abîme du théâtre romantique (comme Chatterton) sous la figure d’un homme du peuple qui connaît la gloire mais que les aristocrates (le Prince de Galles, son rival en amour) remettent à leur place. Jean-Paul Sartre réécrira la pièce en 1953, pour offrir à son ami Pierre Brasseur le rôle de Kean.
Victor Hugo s’arrange souvent pour utiliser des acteurs à contre-emploi. Il organise des lectures de ses pièces en réunissant les comédiens, et ne révèle qu’à la fin la distribution qu’il a prévue. Il mélange acteurs de boulevard et classiques, en croisant leurs spécialités. Par exemple, pour Angelo, tyran de Padoue en 1835, il s’arrange pour que Mlle Mars prenne le rôle de la courtisane, alors que Marie Dorval aura celui de l’épouse malheureuse. De même pour Ruy Blas, donne-t-il au « mauvais garçon » Frédérick Lemaître le rôle du jeune premier Ruy Blas, et non celui, attendu, de Don César, de façon à obtenir le mélange des genres et l’effet de grotesque qu’il affectionne.
8. Mise en scène, décors, éclairage
La « mise en scène » au sens actuel n’existe pas à l’époque romantique. Le critique Jules Janin semble être le premier à avoir utilisé l’expression « mise en scène », à propos d’Hernani, mais ce sont à l’époque, soit l’auteur (Hugo), soit le directeur de la salle, soit le régisseur ou l’acteur principal, qui élaborent ce qu’on appelle aujourd’hui « mise en scène », mais sans la signer. Frédérick Lemaître assistera souvent Hugo pour faire passer ses instructions. On considère généralement que le compositeur Richard Wagner (1813-1883) est le premier metteur en scène mondial, et André Antoine (1857-1943) le premier en France. Mais la scénographie et l’art de l’acteur connaissent des évolutions à l’époque romantique. Louis Daguerre (1787-1851), l’un des inventeurs de la photographie, révolutionne le décor de théâtre par des procédés nouveaux, le « panorama » par exemple. À partir de 1821, un grand décorateur de l’époque, Pierre-Luc-Charles Ciceri (1782-1868), remplace l’éclairage, jusqu’alors obtenu par des lampes à huile appelées « quinquets » (procédé inventé par Antoine Quinquet), par l’éclairage au gaz. Les quinquets avaient remplacé les chandelles à moucher depuis 1784 (première utilisation à la Comédie-Française pour Le Mariage de Figaro). La Comédie-Française ne connaîtra jamais l’éclairage au gaz, et passera directement des quinquets à l’électricité !
Les décors sont souvent lourds et imposants, œuvres d’art à part entière attendues par le public, qui les applaudit parfois longuement. Victor Hugo bataillera parfois contre les décorateurs pour alléger le décor et l’adapter à l’effet qu’il recherche (alors qu’aujourd’hui ses décors paraissent lourds si l’on oublie le contexte de l’époque), par exemple pour Lucrèce Borgia (1833), une anecdote raconte qu’il repeignit lui-même directement pendant l’entracte de la première une porte trop voyante parce que le décorateur avait négligé qu’il s’agissait d’une porte dérobée. Une autre anecdote veut que Hugo, ayant été contacté par « un directeur de province l’interrogeant sur la meilleure façon de mettre en scène Ruy Blas [répond] qu’on peut aussi bien le jouer dans une grange, avec quatre chaises et une table » (p. 120). Dans une démarche proche de celle de Musset, Hugo écrira lors de son exil des pièces non destinées à être jouées, qui furent publiées de façon posthume dans un volume intitulé Théâtre en liberté. Dans ces conditions, la représentation de Lorenzaccio semble impossible. Les metteurs en scène modernes s’en accommodent pourtant, en utilisant le même espace pour représenter l’intérieur et l’extérieur : « Cette réversibilité de l’extérieur et de l’intérieur dit fort bien l’ubiquité du pouvoir, l’abolition de la frontière entre sphère publique et sphère privée en temps de dictature » (p. 259 ; voir par exemple la mise en scène de Franco Zeffirelli en 1976).
Au mieux, les auteurs prévoient de changer de lieu à chaque acte. Victor Hugo est un des premiers à vouloir tout maîtriser :
« Je n’ai jamais songé à diriger un théâtre, mais à en avoir un. Je ne veux pas être directeur d’une troupe, mais propriétaire d’une exploitation, maître d’un atelier où l’art se cisèlerait en grand, ayant tout sous moi et loin de moi, directeur et acteurs. Je veux pouvoir pétrir et repétrir l’argile à mon gré, fondre et refondre la cire, et pour cela il faut que la cire et l’argile soient à moi. » (Correspondance, Lettre à Victor Pavie, 25 février 1831.)
Le « praticable » est une innovation symbolique du théâtre de l’époque, ignoré des classiques et beaucoup pratiqué par Dumas. Il permet de « truquer » l’espace, en franchissant un balcon, une fenêtre, etc. Il symbolise également l’intégration sociale du bâtard, la violence criminelle à laquelle le déterminisme social pousse le héros.
Victor Hugo dessine souvent en marge de ses pièces les décors attendus. Il conçoit ses décors comme des cubes fermés, reprenant l’intuition de Diderot et de Stendhal sur le 4e mur. Ce cube symbolise aussi « l’enfermement des personnages dans l’univers étouffant du pouvoir » (p. 120). On peut y voir le signe que la pièce constitue une expérience de laboratoire, à l’instar du mouvement naturaliste à venir.
– Lire la 2e partie de ce cours.
Voir en ligne : Voir et entendre une conférence de Florence Naugrette
© altersexualite.com 2012
Reproduction interdite
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires d’altersexualite.com.
[1] Le mystère est un genre théâtral populaire de la fin du Moyen Âge, mettant en œuvre des sujets religieux. La Passion du Christ était un de ses sujets traditionnels.
[2] Une exposition sur ce film a eu lieu en 2012 à la Cinémathèque, à l’occasion de la ressortie du film : 3h10 de bonheur !
 altersexualite.com
altersexualite.com