Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Zazie dans le métro, de Raymond Queneau & de Louis Malle
Littérature et langages de l’image, en Terminale Littéraire
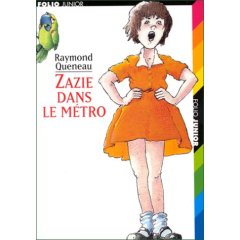 Zazie dans le métro, de Raymond Queneau & de Louis Malle
Zazie dans le métro, de Raymond Queneau & de Louis Malle
Gallimard, Folioplus classiques du XXe siècle, 1959, 193 p., 3,9 €.
jeudi 25 février 2010
Zazie dans le métro évoque souvent à notre mémoire alanguie, une gentille histoire de petite fille pas gentille, une Alice zazoue, roman pas méchant pour les enfants. Cette impression fausse a été longtemps cautionnée par l’édition dans la collection Folio junior, dont la 4e de couverture recommande Zazie « à partir de 9 ans » ! Une relecture réserve ce brûlot pour les lycées, vu sa difficulté de lecture. C’est ce que permet l’édition récente « Folioplus classiques » augmentée d’un excellent dossier réalisé par Laurent Fourcaut. Le livre est d’ailleurs au programme de littérature des terminales littéraires en 2012-2013, avec Lorenzaccio, ce qui remet les pendules à l’heure ! Le fait que le livre ait été présenté comme pour les enfants alors même qu’il n’était pas soumis à la loi du 16 juillet 1949 a sans doute permis à Gallimard de détourner cette loi pendant de longues années, et de présenter aux ados un livre qui évoquait l’homosexualité à une époque où cela était rendu inconcevable par ladite loi. Ce fait est à prendre en compte dans les conditions de la publication, y compris pour le film, soumis à d’autres lois, comme celle très triviale consistant à remplir les salles avec un film destiné au public familial. Cet article, consacré jadis au livre dans le cadre de la recherche d’ouvrages de littérature jeunesse abordant l’altersexualité, a pris une tout autre ampleur en 2013, fruit de nos recherches pour le programme de Terminale, et se consacre davantage au film, avec notamment un reportage exclusif sur les lieux de tournage parisiens, qui mènera votre serviteur aux portes du délirium zazique aggravé d’hallucinations mouaquées [1]. Ce reportage est le fruit d’une collaboration étroite de plus d’un mois avec Agnès Vinas et sa complice Marie-Françoise Leudet, du site Lettres volées. Malgré toutes les piques amicales à elles adressées au fil de ce modeste article, je tiens à remercier Agnès de m’avoir embarqué dans ce défi insensé qui m’a procuré stress et plaisir et permis de redécouvrir Paris comme un « vulgue homme Pécusse ». On consultera avec le plus grand profit leur énorme dossier, coche dont ce modeste article n’est que la mouche bourdonnante ! On pardonnera une allure à sauts et à gambades, due à une écriture par brèches et ajouts successifs ; le sommaire ci-dessous permettra de circuler dans l’article à volonté.
Plan de l’article :
ὁ πλάσας ἠφάνισεν
Résumé
Provocations
Hormosessualité
Néo-français et chinook
Le film
Le déclic anodin d’une enquête sans fin
Déambulation zazique sur les traces de Louis Malle
Le quartier Bonne-Nouvelle
Iliade, ou Odyssée ?
Tout savoir sur le chemin de fer
Decumanus et Cardo
La Seine dans tous ses états
L’affaire Camoëns
Le pont de Bir-Hakeim
Le scoop du siècle
Bouquet final à la tour Eiffel
Zazouave au pont de l’Alma
Puces / Pigalle et autres lieux
Camérateur
La Sainte-Chapelle enfin dévoilée
« Ainsi, impossible d’imaginer notation plus ténue, plus insignifiante que celle du « temps qu’il fait » (qu’il faisait) ; et pourtant, l’autre jour, lisant, essayant de lire Amiel, irritation de ce que l’éditeur, vertueux (encore un qui forclôt le plaisir), ait cru bien faire en supprimant de ce Journal les détails quotidiens, le temps qu’il faisait sur les bords du lac de Genève, pour ne garder que d’insipides considérations morales : c’est pourtant ce temps qui n’aurait pas vieilli, non la philosophie d’Amiel. »
Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Points Seuil, p. 85.
ὁ πλάσας ἠφάνισεν
ὁ πλάσας ἠφάνισεν (o plasas èphanissen). Cette épigraphe énigmatique en grec ancien multiplie les difficultés. Non content de citer du grec ancien en alphabet non transcrit et sans note explicative – ce qui donne un bon coup de volant du côté pédant en tête de ce roman prétendument populaire – Queneau déroute l’exégèse. Il crédite « Aristote », or d’après les renseignements que j’ai pu glaner ici ou là, cette citation à tiroir superpose trois auteurs. Le texte cité provient en effet de Strabon, géographe grec (-64/+25), qui dans sa Géographie, chapitre XIII.1.36, cite Aristote, ce dernier faisant référence à Homère ! Il semble que le texte d’Aristote ait été lui-même perdu entre-temps ; quant au texte d’Homère, le mot « Naustathme » a échappé à mes recherches, mais j’ai obtenu une réponse érudite d’Agnès Vinas, la rédactrice de Lettres volées : « Ce fameux naustathme a été traduit d’une manière particulièrement pédante par Amédée Tardieu, alors qu’on pouvait se contenter de port, mouillage, ou mieux, ici, campement naval. Le terme se trouve dans le Bailly : c’est un nom composé de ναῦς = le navire et de σταθμός = le lieu où l’on s’arrête, terme qui peut désigner une écurie, une bergerie, un mouillage, un campement, etc. L’édition Loeb de 1928 traduit par Naval Station. Il s’agit donc du camp des Achéens, installé à l’endroit où ils ont tiré leurs navires au sec sur la plage, non loin de la ville de Troie. Pendant la dernière année du siège, ils décident de construire un fossé et un rempart pour protéger ce campement au chant VII de l’Iliade ; mais le rempart ne parvient pas à contenir les assauts des Troyens au chant XII, et pire encore, Hector parvient au chant XV jusqu’aux navires grecs qu’il commence à incendier. C’est alors que Patrocle arrache à Achille l’autorisation de s’élancer au combat à sa place : il repousse les Troyens loin du camp, mais il y laissera la vie. Ce campement achéen constitue donc un enjeu de première importance dans l’Iliade ; mais son rempart subit un sort paradoxal : sitôt érigé, sitôt débordé… D’où le sens de l’expression d’Aristote citée par Strabon, et qui me semble signifier la toute-puissance du poète, libre d’inventer et de détruire à sa guise, sans rien devoir à la réalité historique ni même à la simple vraisemblance. » Pour ajouter à cette explication d’Agnès Vinas [2], voici le début du chant XII de l’Iliade traduit par Leconte de Lisle : « Ainsi le robuste fils de Ménoitios prenait soin d’Eurypylos dans ses tentes. Et les Argiens et les Troiens combattaient avec fureur, et le fossé et la vaste muraille ne devaient pas longtemps protéger les Danaens. Quand ils l’avaient élevée pour sauvegarder les nefs rapides et le nombreux butin, ils n’avaient point offert de riches hécatombes aux Dieux, et cette muraille, ayant été construite malgré les Dieux, ne devait pas être de longue durée ». En tout cas, cet entrelacement préliminaire est un signe érudit et moqueur, un encouragement à gratter le texte, à la manière de Rabelais et de son os médullaire [3] tout en se gardant d’avoir des illusions, puisque cette moelle substantifique n’est qu’un os qu’on nous met sous le nez et qu’on nous enlève avant qu’on ait pu y mordre (on peut voir un écho à ce motif dans le film, avec la scène où Zazie trouve une perle dans sa substantifique moule et la jette aussitôt, et c’est le camérateur (voir ci-dessous pour ce mot) qui a l’air de nous dire : « perle, mon cul ! »). Le sens des deux mots, extraits de leur contexte, serait « Il l’a créé ; il le détruit ». Le premier mot est de la famille de πλάσσω : faire, fabriquer, et le second, de la famille de ἀφανίζω : faire disparaître. Voici l’extrait chez Strabon : « Homère confesse que le mur du Naustathme ne fut élevé que très tard, si même il a jamais existé ailleurs que dans l’imagination du poète, qui alors a bien pu se croire en droit, pour nous servir de l’expression d’Aristote, de jeter par terre à un moment donné ce que lui seul avait construit ». Pour les élèves de terminale, cela constituera une belle question d’entrée dans l’œuvre double (film et roman). Nous verrons plus loin dans la partie consacrée au film, que Louis Malle a peut-être trouvé un moyen d’évoquer cette épigraphe en filmant un bâtiment imposant construit en un temps record dans le cadre de la prévention de la guerre, et détruit tout aussi vite…
Résumé
Le fameux « Doukipudonktan » [4], exemple de « coagulation phonétique » quenienne (ou « agglomération », ou « agglutination ») ouvre le récit comme un clairon déclarant la guerre au langage châtié (mais après l’épigraphe en grec ancien dont on ne sait quel rôle elle joue face à ce « Naustathme », Jericho du langage qu’il s’agit d’ébranler !). Jusqu’au « J’ai vieilli » qui le clôt, 36 heures à peu près se sont écoulées ; mais à l’instar du car de touristes ballotté par Gabriel, le lecteur a découvert Paris comme il ne l’avait sans doute jamais vu, un Paris populaire et interlope. Zazie tient à la fois de la tragédie avec son respect des unités, et du roman d’initiation, dans lequel, et c’est ce qui nous retient, la mère indigne délègue à l’oncle extravagant (et sans doute « hormosessuel ») le soin de l’éducation de sa fille. Est-il utile de résumer l’histoire ? L’oncle Gabriel, un colosse, accueille Zazie à la gare d’Austerlitz. Jeanne Lalochère, sœur de Gabriel, lui confie sa nièce le temps d’un week-end passé avec un amant. Manque de bol, Zazie qui ne rêve que de voir le métro, tombe sur une grève : « – Ah les salauds, s’écrie Zazie, ah les vaches. Me faire ça à moi. […] c’est à moi que ça arrive, moi qu’étais si heureuse, si contente et tout de m’aller voiturer dans l’métro. Sacrebleu, merde alors ». C’est la scoumoune absolue. On apprendra par Zazie que Jeanne serait veuve d’un monsieur alcoolique, qu’elle aurait tué elle-même à l’aide d’une hache confiée par son amant d’alors, au moment où le père s’apprêtait à abuser de la petite ! (« Et les papouilles zozées de recommencer », p. 54). Gabriel se fait passer pour veilleur de nuit, mais on apprendra qu’il est en réalité (si l’on peut dire) « danseuse de charme » (p. 62) dans une « boîte de tantes » (p. 63), « boîte de pédales » (p. 81) ou « boîte de tapettes » (p. 144), à Pigalle, sous l’avatar de Gabriella. Il est dûment marié avec Marceline, mais Zazie se demandera tout au long du récit s’il n’est pas « hormosessuel ». Queneau s’amuse avec le lecteur, car les dénégations de Gabriel et de ses camarades sont malicieusement contrariées entre autres par l’apparition finale de Marceline sous l’appellation de Marcel, ce qui renvoie à Gabriel / Gabriella, sans oublier le « Tu as oublié ton rouge à lèvres » que Marceline lance à Gabriel (p. 29), ou autres allusions souvent distillées en fin de chapitres. Rétrospectivement, la scène de séduction lesbienne entre Marceline et Mado (chapitre 13), puis avec Pédro-surplus, prennent donc un sens pour le moins altersexuel ! Mais Gabriel semble contagieux, car après sa prestation au Mont-de-piété, « Les éléments féminins veulent embrasser Gabriel, les masculins n’osent pas » (p. 171). Queneau serait-il un précurseur du Trouble dans le genre ? Louis Malle, en rebaptisant Marceline Albertine, fait une allusion à Marcel Proust et à son personnage Albertine, inspiré de son chauffeur / secrétaire Alfred Agostinelli. Il utilise des procédés visuels en plus de dialogues repris au livre, pour introduire le doute sur la sexualité de Gabriel. Par exemple, cet étonnant manteau qu’Albertine aide Gabriel à fermer par l’arrière, apanage en principe des vêtements féminins ! Le scénario indique, ce qui n’est pas évident à l’image, que lorsqu’elle quitte la loge vêtue en motarde, Marceline est habillée avec un « chandail qui lui donne une allure très virile » et qu’elle a l’air « en pantalon, en pull et les cheveux plaqués vers l’arrière, très lesbienne » (p. 55). Sur le quai vue de dos, Albertine est masculine, mais si le scénario publié indique « Le train file. Albertine reste en amorce dos premier plan. Elle se retourne : c’est bien « elle » qui se frotte ses joues non razées » (sic, p. 62), le montage final n’a pas retenu ce détail, et seul le « Arvoir, meussieu… » de Zazie insiste sur le changement de sexe d’Albert(ine). Dans la soûlerie finale, Turandot se met à valser avec un loufiat, retour du refoulé chez ce vieux célibataire aigri, qui dans le roman n’était point trop gay-friendly : « Bin, dit Turandot, t’es pas dégoûté. Tu vas haller dans une boîte de pédales pour célébrer tes fiançailles ? » (p. 142) ; « — Grosse fiotte, dit Turandot » (p. 152) ! Dans le roman déjà, Turandot, ivre, se mettait à « friser la jambe » : « Et il se mit à sautiller entre les tables, en essayant vaguement d’imiter Gabriella dans son numéro de La Mort du cygne » (p. 182). Zazie s’échappe, se défend toute seule contre les « meussieu » qui voudraient la raccompagner au logis, en les faisant passer pour des satyres, jusqu’à ce qu’elle trouve – provisoirement – plus fort qu’elle, en la personne de Pédro-surplus, alias Trouscaillon, alias l’inspecteur Bertin Poirée, alias Aroun Arachide, figure déléguée de l’auteur manipulant ses personnages (à moins que le perroquet Laverdure ne soit plutôt la figure de l’auteur). La bataille finale rapproche la structure du roman de celle de Le Chiendent, premier roman de Queneau publié en 1933, dont un des personnages principaux était déjà un garçon fugueur et déluré, Théo, qui s’amusait également à manipuler les adultes.
Intérêt du texte
Pour le fond, on rapprochera Zazie de La vie devant soi, de Romain Gary, avec lequel l’œuvre de Queneau partage une image non-conventionnelle de l’enfance, une vision du Paris interlope, et l’évocation d’une insolite parentalité déléguée. La filiation de Zazie sera pour nous éducateurs le prétexte d’un dossier pédagogique mêlant les joyeusetés hellènes (petits meurtres familiaux, inceste et tutti quanti) et les coupures de presse scabreuses sur l’affaire d’Outreau. Pour l’analyse du roman et sa place dans l’histoire littéraire, il n’y a rien à ajouter à la brillante étude de Laurent Fourcaut suivie d’extraits de romans contemporains (et à tous les dossiers notamment du CNDP (Elsa Ferracci) et de Zéro de conduite (Marie Basuyaux et Suzanne de Lacotte), disponibles sur Lettres Volées). Il nous reste à appuyer sur les aspects provocateurs. Cela commence au premier chapitre, où Gabriel s’alterque (pardon pour ce quenéaulogisme) avec un type : « probablement celui qu’avait le droit de la grimper légalement » (p. 8). Au chapitre 2, il s’avère que Zazie est « une petite salope » qui « aura eu le temps de mettre la main dans la braguette de tous les vieux gâteux » (p. 20). D’ailleurs si celle-ci veut « être institutrice », c’est « pour faire chier les mômes » ! (p. 22) ; et au café, après un panaché, elle commande « un vrai demi de vraie bière » (p. 51), alors que les protagonistes adultes ne sirotent que de la grenadine.
Queneau s’amuse avec le thème du transvestisme. On relève le néologisme « éonisme » (p. 67), forgé sur le chevalier d’Éon. Extrait intéressant au chapitre 7, avec un dialogue sur le thème « Le tonton est une tata », où l’on apprend que le fait qu’il soit marié ne prouve rien, avec exemple d’Henri Trois (p. 80). Pour Zazie, l’« hormosessualité » signifie « Qu’il se mette du parfum » (p. 87). Jusqu’à la fin elle s’interrogera, sans qu’aucun adulte daigne lui répondre, utilisant un vocabulaire qui prouve qu’elle en sait plus qu’elle veut bien l’admettre, et une tournure digne d’Audiard : « Qu’est-ce que c’est au juste qu’une tante ? […] Une pédale ? une lope ? un pédé ? un hormosessuel ? Y a des nuances ? » (p. 131). Voici une citation qui pourrait figurer en exergue de notre site, pour symboliser les ravages du déficit éducatif en la matière. Décidément bien informée, Zazie va jusqu’à menacer son oncle d’outing avant la lettre : « Si on descend pas, dit Zazie avec férocité, je leur dis que t’es un hormosessuel » (p.100). Autre dialogue intéressant, toujours sur le thème du mariage, mais avec Zazie, p. 88. La zoophilie est discrètement évoquée avec le perroquet Laverdure, qui amène dans la bouche de « un Écossaise », c’est-à-dire « une grosse fiotte », l’expression « Moi la terre verte… », dont une note de l’éditeur précise : « la terre jaune, en argot, c’est l’anus… » (p. 152) ; moins discrètement avec l’évocation de feu le père de Zazie qui avait le feu à l’endroit où Zazie a beaucoup de choses : « Alors, quand il était dans ces états-là, fallait se garer de lui, parce que le chat lui-même y aurait passé. Comme dans la chanson » (p. 53). Et loin d’être innocente, Zazie est présentée par Turandot comme très au courant de la sexualité : « je veux pas dans ma maison d’une petite salope qui dise des cochoncetés comme ça. Je vois ça d’ici, elle va pervertir tout le quartier. […] En deux trois jours, elle aura eu le temps de mettre la main dans la braguette de tous les vieux gâteux qui m’honorent de leur clientèle » (p. 20). Cela justifie presque l’accusation brutale de Pédro : « Cette petite faisait le tapin au marché aux puces. J’espère au moins que vous la vendez pas aux Arabes » (p. 61). Et après tout, si le film nous induit en erreur, le livre met les points sur les i : « Ya des filles qui se marient à quinze ans, à quatorze même. Y a des hommes qu’aiment ça » (p. 88). Cela, faut-il le rappeler, a été possible jusqu’à 2005 à 15 ans, par dérogation à 14 ans. D’ailleurs Pédro envisage Zazie comme possible : « Moi, qu’il dit comme ça, je suis un volage. La mouflette cambrousarde, elle m’intéressait pas malgré ses histoires meurtrières. Je vous parle là de la matinée. Mais, dans la journée, voilà-t-il pas que je tombe une rombière de la haute, à première vision. La baronne Mouaque. Une veuve. Elle m’a dans l’épiderme. En cinq minutes, sa vie était chamboulée » (p. 162). Le ton est parfois amer, comme dans cette évocation de la sexualité conjugale : « En tout cas, moi qui vous cause, je lui ai dit à mon mari, tu veux que ? (détails). Pollop, que je lui ai répondu. Va te faire voir par les crouilles si ça te chante et m’emmerde plus avec tes vicelardises. Voilà ce que je lui ai répondu à mon mari qui voulait que je… (détails) » (p. 34). L’association des mots « crouilles » et « Arabes » à l’évocation d’une sexualité blâmée évoque une atmosphère très années 50, qu’on retrouve dans le roman Élise ou la vraie vie, de Claire Etcherelli. Si Mado est moins coincée, elle ne présente guère non plus l’image rêvée de l’amour telle que le législateur la souhaitait dans les livres pour enfants en 1959 : non seulement elle trouve Charles, qui ne l’est guère, « trop romantique », mais en plus elle avoue naïvement : « Alors on tire un coup, sur les marches du palais » (p. 77). Voilà un bref rappel du contenu subversif, pour les collègues qui, confiants dans les indications de l’éditeur, donnaient ce roman à lire innocemment à des collégiens, en se basant sur des souvenirs de lecture lointains. Entre le livre et le film, on relève une variante significative. Lors de la première comédie de Zazie à l’attention des badauds, accusant Turandot, dans le livre, elle dit d’abord « il m’a dit des choses sales » avant d’être interrogée sur lesdites « choses sales », mais dans le film, la nécessité de faire court a enlevé la phrase de Zazie, de sorte que les passants demandent spontanément « Mais qu’est-ce qu’il t’a dit », type de questionnement inopérant dans le domaine des enquêtes sur des actes d’atteinte sexuelle pédophile, puisque la question induit l’enfant dans un présupposé qui le pousse à fabuler pour ne pas décevoir la personne qui l’interroge. Cas d’école pour le livre de Marie-Monique Robin, L’École du soupçon, les dérives de la lutte contre la pédophilie. Même si le côté décousu du récit et une certaine gratuité apparente dans la conduite de l’action peuvent dérouter, Zazie conserve sans doute toutes ses vertus d’éveil et de questionnement fécond pour les lycéens. Et puis allez, un nouveau roman pas chiant, c’est quand même pas à dédaigner ! Nouveau roman, mon cul !
Hormosessualité et mélange des genres
Si on se replonge dans le contexte des années 50, le scandale de Lolita de Vladimir Nabokov, que Queneau connaissait, a marqué les esprits. Les Aventures d’Alice au pays des merveilles (1865), le livre de Lewis Carroll (1832 - 1898), est toujours célèbre, et on sait la composante pédophile de la genèse de l’œuvre. Ce chef d’œuvre de la littérature serait aujourd’hui inconcevable, et Lewis Carroll croupirait en prison. Voir cette analyse psychanalytique d’Alice. Même si ce n’est pas politiquement correct, Queneau fait coup double et même triple en évoquant dans son roman à la fois l’homosexualité, la question transgenre et la pédophilie (qu’il ne confond pas, la pédophilie étant exclusivement hétérosexuelle, et Gabriel étant justement choisi par la mère parce que, étant homosexuel, il ne présente aucun risque pour sa fille !), tout en bénéficiant quand même de l’aura « livre pour enfants ». C’est un aspect extrêmement important. J’insiste sur ce point, car l’homosexualité était à cette époque un sujet absolument tabou pour les enfants. Pendant la production du film, le 18 juillet 1960, était voté le fameux Amendement Mirguet assimilant l’homosexualité à un « fléau social » ! Dans le roman, la question transgenre est abordée par la bande, avec la double métamorphose symétrique Gabriel-Gabriella, Marceline-Marcel. On relève aussi cette remarque anodine en apparence de Gabriel : « Je me demande pourquoi on représente la ville de Paris comme une femme. Avec un truc comme ça. Avant que ça soit construit, peut-être. Mais maintenant. C’est comme les femmes qui deviennent des hommes à force de faire du sport. On lit ça dans les journaux. » (p. 91). C’est à cette réplique que Charles craque : « — Lui aussi, qu’il dit en gémissant, lui aussi… toujours la même chose… toujours la sessualité… toujours question de ça… toujours… tout le temps… dégoûtation… putréfaction… Ils pensent qu’à ça… ». À un mot près (tous), le film reprend la réplique, sauf que c’est Zazie et non Gabriel qui fait craquer Charles. Excellente idée d’inversion des rôles, puisque Zazie joue elle-même au satyre qui pourchasse les adultes ! Louis Malle transpose magistralement cette idée par un travelling descendant sur les escaliers de la tour Eiffel, prouesse technique, qui évoque la descente vertigineuse vers le subconscient.
À lapin, lapin et demi !
Cette diabolisation de Zazie est filée par le détail des deux lapins blancs posés sur le piano pendant la scène où Zazie enchante diaboliquement les adultes au Paradis. Ces deux lapins vivants surenchérissent sur le pauvre lapin marionnette de Pédro-surplus lors de la « scène de rencontre » à travers les grilles du métro (cf. ci-dessous), comme si Malle voulait montrer que Zazie est bien plus forte qu’un vulgaire satyre. On relève aussi le plan où Pédro-surplus met un chapeau féminin pour séduire Albertine (« chapeau cloche à voilette » précise le scénario, p. 52). On a beaucoup dit que Malle avait censuré des dialogues trop crus, par exemple le récit de Zazie sur son père ; mais d’un autre côté il en a rajouté, comme ce gag où Gabriel met la main aux fesses d’un homme (plan 478) [5], alors justement qu’il essaie de se disculper de l’accusation d’hormosessualité ! Louis Malle, même s’il estompe les allusions à la pédophilie, accentue l’hommage à Lewis Carroll, dans la « scène de rencontre » entre Zazie et Pedro-surplus : celui-ci agite un lapin blanc fait avec un mouchoir, et Zazie a vite fait de débusquer le « vieux salaud » (mais elle-même va bientôt justifier le jugement de Turandot, et se comporter en « petite salope » avec le malheureux Charles, ou bien avec tout le personnel du Paradis). C’est dans cette scène du lapin-grille qu’on a le gag de la femme assassinée en arrière-plan. Si l’on considère qu’on est dans une parodie de « scène de rencontre » entre cette mouflette et ce satyre, la femme tuée par un homme prend un sens féministe particulier… Pour le reste, on trouvera de nombreux points communs entre Alice et Zazie, à commencer par leurs noms, le rapport entre terrier et métro, etc. D’autant plus que le premier titre du manuscrit original était Alice’s Adventures Under Ground ! En classe, on peut étudier l’incipit d’Alice. Pour poursuivre sur le féminisme, on peut se pencher sur la réplique de Mado à propos de ses fiançailles avec Charles. Elle évoque les « éconocroques ». Cela nous rappelle qu’avant la loi du 13 juillet 1965, la femme était inférieure à l’homme dans le mariage, et avait donc intérêt à trouver un homme avec porte-feuille incorporé !
Vocabulaire de l’homosexualité
Petite précision sur le vocabulaire de l’homosexualité. Dans le parascolaire Ellipses, Marie-Noëlle Campana commet plusieurs erreurs dans un article au demeurant excellent. En note p. 183, elle écrit « Au Moyen Âge, le terme d’« homosexualité » n’existant pas, cette attirance est qualifiée d’« inversion ». » Or cette acception des mots « inversion » / « inverti » date de la littérature médicale de la fin du XIXe ! Trois pages plus loin, elle se perd, à propos de l’expression « la terre verte », dans des considérations minérales, alors que le jeu de mots est expliqué dans l’édition Foliothèque (cf. ci-dessus). Pour « mignon », elle indique en note « Jeune favori d’Henri III, puis par extension, jeune homosexuel » (p. 186). Là, c’est exact, mais « jeune » n’est pas un trait de sens obligatoire, et dans Lorenzaccio, nous avons relevé que « mignon » est utilisé autant par Alexandre que par Lorenzo pour se désigner l’un l’autre, et qu’ils ont le même âge. Un livre de référence est le Vocabulaire de l’homosexualité masculine de Claude Courouve. Pour en revenir à l’homosexualité, plusieurs passages sont intéressants et problématiques. Dans le dialogue quasi identique entre Gridoux et Pédro-surplus, dans le livre et le film, on relève un paradoxe entre l’homophobie apparente dans l’utilisation méprisante des mots « pédale » ou « tante » : « Gabriel danse dans une boîte de pédales déguisé en Sévillane, dakor. Mais, qu’est-ce que ça prouve, hein ? » (p. 81 ; réplique absente du film), et la volonté farouche de défendre Gabriel : « D’ailleurs tout le monde l’aime dans le quartier » (livre, p. 80 ; scénario, p. 34). Idem avec Charles répondant à Zazie : « — Est-ce que j’ai l’air d’une pédale ? » (livre, p. 87 ; scénario, p. 36). C’est en replaçant le livre dans le contexte de l’époque qu’on peut comprendre que ces insultes disséminées dans l’œuvre font passer le plat, et que le principal est qu’un personnage possiblement homosexuel soit présenté sous un jour favorable dans un livre plus ou moins destiné aux enfants, et surtout que la question y soit clairement abordée comme un sujet dont il soit légitime de parler aux enfants. Un court échange du chapitre XI est d’ailleurs symbolique de ce point de vue tolérant : « — Pourquoi ? demanda Zazie. C’est un homo ? — Tu veux dire un normal, rectifia Fédor Balanovitch » (p. 124). Voir le même type de réflexion avec le personnage de Daniel dans Les Chemins de la Liberté, de Jean-Paul Sartre [6].
Le « néo-français » et le « chinook »
Queneau crée le concept de « néo-français », développé dans son essai Bâtons, chiffres et lettres (1950 ; en fait recueil d’articles de différentes époques). Voici un extrait utile d’un chapitre intitulé « Écrit en 1937 » (pp. 14-18).
« Mais l’ouvrage pour moi […] magistral, fut Le Langage de Vendryes. Particulièrement suggestives me paraissaient, et me paraissent encore, des considérations comme : « S’il n’y avait pas en français une tradition orthographique et que la langue fût recueillie et notée aujourd’hui comme on fait d’une langue de sauvages, la particule ti n’y serait pas séparée du verbe qui la précède. On écrirait en un seul mot žemti, žemtipa (« j’aime-ti, j’aime-ti pas »)… » (p. 203) ; ou : « Il ne faut donc pas s’étonner de rencontrer d’autres langues où, à l’inverse de l’indo-européen, la flexion se ferait au contraire par le devant. Le français même nous en donne une certaine idée par son pluriel qui dans les mots commençant par une voyelle s’exprime au moyen d’une sifflante préfixée : arbre, z-arbres ; homme, z-hommes ; œuf, z-œufs ; oie, z-oies. La langue populaire présente un curieux exemple de l’extension du procédé dans le verbe zyeuter tiré du pluriel du mot œil » (p. 97) ; ou : « Appartiennent à la langue écrite des phrases comme : « Il faut venir vite », « Quant à moi, je n’ai pas le temps de penser à cette affaire », « Cette mère déteste cet enfant » ; mais dans la langue parlée, neuf fois sur dix, elles auraient une forme toute différente : « Venez vite ! », « Du temps, voyons ! est-ce que j’en ai, moi, pour penser à cette affaire-là ! », « Son enfant, mais elle le déteste, cette mère » (p. 172) ; ou : « [En chinook] pour dire : l’homme a tué la femme avec un couteau, la phrase sera du type : lui elle cela avec||tuer homme femme couteau… Tout ce qui précède le tiret que nous avons introduit dans la phrase ne comprend que les indications grammaticales, [« en quelque sorte un résumé algébrique de la pensée »], les morphèmes ; les sémantèmes [« les données concrètes »] sont donnés après. Ne nous étonnons pas trop d’une structure aussi singulière. Le français parlé connaît des tours qui sont très voisins de celui-là. On entend dire dans le peuple : Elle n’y a encore pas || voyagé, ta cousine, en Afrique ou Il l’ati jamais || attrapé, le gendarme, son voleur ? » (pp. 102-103). « […] Il me devint évident que le français moderne devait enfin se dégager des conventions de l’écriture qui l’enserrent encore (conventions tant de style que d’orthographe et de vocabulaire) et qu’il s’envolerait, papillon, laissant derrière lui le cocon de soie filé par les grammairiens du XVIe et les poètes du XVIIe siècle. Il me parut aussi que la première façon d’affirmer cette nouvelle langue serait non pas de romancer quelque événement populaire (car on pourrait se méprendre sur les intentions), mais bien, à l’exemple des hommes du XVIe qui utilisèrent les langues modernes au lieu du latin pour traiter de théologie ou de philosophie, de rédiger en français parlé quelque dissertation philosophique ; et, comme j’avais emporté avec moi [en voyage en Grèce] le Discours de la Méthode, de le traduire dans ce français parlé. »
V’la-ti pas une idée qu’elle est bonne d’écriture d’invention pour nos élèves telle chinook translation proposer ? Mais de texte quel ? Derrière tête de moi petite idée avoir…
En 1969, Queneau revient sur cette idée dans un article « Errata » (NRF) : « La thèse du néo-français ne me paraît plus aussi fondée ».
– Voir l’article de Emma B, sur Des potes et des livres, et notre article sur Zapinette chez les Belges d’Albert Russo, livre qui rend hommage à Zazie.
Le film de Louis Malle
Le roman a été adapté en 1960 par Louis Malle (1932-1995), dans un chef-d’œuvre brillamment analysé par Ronny Chester (et tant d’autres, voir sur Lettres Volées). On peut actuellement visionner la bande annonce sur Dailymotion. Citons Louis Malle : « Je trouvais que le pari qui consistait à adapter Zazie à l’écran me donnerait l’occasion d’explorer le langage cinématographique. C’était une œuvre brillante, un inventaire de toutes les techniques littéraires, avec aussi, bien sûr, de nombreux pastiches. C’était comme de jouer avec la littérature et je m’étais dit que ce serait intéressant d’essayer d’en faire autant avec le langage cinématographique. […] Une des premières œuvres de Queneau était intitulée Exercices de style… voilà ce que c’était pour moi, un exercice de style pour approfondir ma connaissance de ce mode d’expression. » (Conversations avec… Louis Malle, Philip French, Denoël, 1993). Les « premiers laudateurs du film », apprend-on, furent Ionesco, Truffaut et Chaplin. Cela ne nous étonne pas !

Ma première vision naïve de ce film, dans un ciné-club vers 2007, se borna à pointer l’omniprésence des publicités à l’écran, notamment sous forme de tubes néons et de pancartes, surtout pour des alcools, chose étonnante dans un film réputé pour enfants. Pub pour Nicolas dans le hall de la gare de l’Est. Qui pourrait nous dire si le panneau était réellement là ? [7] En revanche, mon enquête révélera que la verrière en-dessous du panneau n’a pas bougé ! Parmi les néons, la marque de bière Kronenbourg, se retrouve fréquemment, et là, c’est fait en studio, on reconnaît le travail de William Klein ; c’est forcément un cas de placement de produit. Voir sur ce point sur Lettres volées le film de W. Klein. Il y a même une pancarte exhibée par une camionnette, dans le plan 525 (poursuite guidenappeurs ; photogramme ci-dessus). Même pour le car de touristes, no logo chez Queneau, Louis Malle nous a fourgué la marque Cityrama, qui existe toujours, et dont le siège se trouve place des Pyramides (lisible à loisir sur la casquette de Fédor). Existe-t-il une enquête sérieuse sur l’histoire de cette pratique au cinéma ? Dans le roman, Queneau utilisait fort peu de marques. Les adultes boivent « une grenadine bien tassée » (p. 69). Quant à l’alcool, une discussion oiseuse soupèse les propriétés du « fernet-branca », un alcool du XIXe siècle quasiment devenu produit générique, écrit avec des minuscules. Marceline boit du « kirsch » (p. 25), Turandot s’envoie trois « beaujolais » (p. 35), Pédro un « muscadet » (p. 50), et la veuve Mouaque a les mêmes goûts mais « siffle tout » (p. 180). On finira même par confondre les « bouteilles de muscadine et de grenadet » (p. 189). Le mot « bière » est utilisé à plusieurs reprises, mais que « no logo » ! Même Zazie exige « un vrai demi de vraie bière » (p. 51), après son fameux « cacocalo » qui pourrait à la rigueur être une concession à une marque célèbre (il y en a quelques autres, comme « pataugas », p. 46). Mais le « loufiat » de la brasserie ne fera pas de pub à « vos saloperies de cocacola ou de chianti » (p. 134). Dans le film, un homme sandwich zigzague souvent dans les embouteillages, mais impossible de lire son affiche. Le scénario précise que ce serait une inscription énigmatique : « Shell-Ica, des reprises foudroyantes ». Eh oui, si Queneau fricota avec le Parti Communiste, Louis Malle eut dès le berceau maille à partir avec le Capital !
En introduction, visionner ce document INA de moins de 5’ où Louis Malle présente son film avant sa sortie. Sachez que Zazie a été adapté en pièce musicale par Michel Beretti (livret) et Matteo Franceschini (musique) au théâtre du Châtelet en 2012. Enfin, voici les quelques mots de Queneau à propos du film :
« Le roman et le cinéma, ça fait deux comme chacun sait, et on le sait même si bien que pour beaucoup de représentants de la première activité nommée, le passage de l’un à l’autre est non seulement impossible mais de plus en plus sacrilège. Aussi a-t-on vu un film inspiré par une œuvre jusqu’alors peu lue d’ailleurs devoir joindre à son titre un millésime que ses adversaires jugeaient infamant ; malgré cela, le public se mit sinon à lire, du moins à acheter le produit du XVIIIe siècle finissant auquel le cinéma donnait un éclat inattendu [8]. L’adaptateur d’un roman (pour le « porter », comme on dit, à l’écran) tantôt écrasé par la popularité d’une œuvre (Les Trois Mousquetaires, Les Misérables) ne peut guère se permettre que de l’imagerie, tantôt, profitant d’une liberté totale, voit dans le roman qu’il a choisi (ou qu’on lui a imposé) un prétexte, un simple tremplin. Entre les deux, il est difficile de faire quelque chose de personnel ; c’est pourtant ce que me semble avoir réussi Louis Malle avec son dernier film, intitulé Zazie dans le métro. J’aime trop le cinéma – et je crois le connaître assez – pour ne pas concéder au cinéaste les modifications, les ajouts, les suppressions que nécessairement il doit se permettre. En même temps que je reconnais Zazie dans métro en tant que livre, je vois dans le film une œuvre originale dont l’auteur se nomme Louis Malle, une œuvre à l’insolite et à la poésie de laquelle je suis moi-même pris ».
Le déclic anodin d’une enquête sans fin
Pour l’anecdote, j’ai retrouvé par hasard le lieu de tournage d’une séquence de la poursuite, lorsque Zazie fait tourner en bourrique Pédro-surplus sur un escalier en fer à cheval (à la 30e minute du film). Il sort une canne à pêche et la ferre, mais elle se métamorphose en vieille dame vêtue comme Zazie, qui lui colle une beigne ! Il s’agit d’un escalier d’une belle résidence du 18e arrondissement, la villa des Platanes (et non pas un hôtel particulier comme il est écrit dans le scénario [9], qui ne tient pas compte des contingences du tournage) qu’on peut apercevoir depuis la grille d’entrée située 60, boulevard de Clichy. Il se trouve que cette résidence vient d’être ravalée ; les seuls détails qui aient changé sont la torchère que portent les statues (allusion au « lampadophore » de Queneau, qui d’ailleurs aurait pu utiliser le synonyme plus obscur « dadophore ») ; pour la petite histoire, elles sont désormais allumées bâille-naïte), et la pancarte à gauche de la porte a disparu. Voici deux photos (ci-dessus) pour comparer avec l’état des lieux à l’époque du tournage. Pour l’anecdote toujours, deux réalisateurs connus au moins habitent actuellement cette résidence, et je suppose que c’était déjà le cas avec d’autres cinéastes à l’époque. Ce lieu n’a évidemment aucun rapport avec les lieux de la poursuite qui précèdent et qui suivent dans le film, et c’est nous que le réalisateur fait tourner en bourriques… Dernière information anecdotique : on retrouve ce même escalier dans une courte scène du film Mata Hari, agent H 21, de Jean-Louis Richard (1964), avec — excusez du peu — Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant et Claude Rich. Mata Hari vient de rencontrer l’officier François Lassalle, à qui elle doit dérober des documents, et dont elle va s’éprendre. Ils descendent ledit escalier censé constituer l’accès à un hôtel particulier, et cela est l’objet d’un mini-gag puisque ils se tenaient la main et s’apprêtaient à descendre chacun d’un côté, et s’aperçoivent que c’est impossible, écho minime à la scène burlesque de Zazie. La chef-monteuse Kenout Peltier est sans doute le lien entre les deux films, qui a fait choisir cet escalier… Les curieux verront cette scène à la 15e minute du film. On note en passant des jeux de mots visuels, en plus du « lampadophore », puisque à la séquence suivante, l’échec de Pédro-surplus de « ferrer » Zazie depuis l’escalier en fer à cheval se transformera en réussite de Zazie de l’alpaguer avec un aimant en fer à cheval ! Voir l’excellente analyse de cette poursuite par Marie-Françoise Leudet et Agnès Vinas. En découvrant cette coïncidence chez un ami qui réside à cette adresse, j’étais loin de me douter que venait de m’être inoculé le virus de la terrible maladie de Zarzinson !
Déambulation zazique sur les traces de Louis Malle à Paris
Suite à cette trouvaille fortuite, Agnès Vinas – avec une candeur diaboliquement féminine – m’a suggéré de participer à un zazfari-photo pour Lettres Volées, à la recherche des lieux de tournage. Chic alors ! Enfin un truc enthousiasmant procuré par ce boulot parfois si déthousiasmant de prof de céfran ! Je m’y suis donc embarqué le 9 février 2013, par un beau soleil d’hiver, froid sec, appareil photo en bandoulière, tel un Roulezazille en reportage, ignorant que j’allais plonger pour deux mois dans un enfer pavé d’intentions zaziques, n’ayant plus ni frères ni famille ni amis, telle une vulgaire Jeanne Lalochère aveuglée par son désir pervers. On pourrait dire aussi tel le petit Poucet chaussé des bottes de sept lieues, puisque Malle nous fait faire des bonds de géant à travers Paris. Il y a fait une allusion au plan 377, où dans sa discussion avec Gridoux, Pédro chausse de telles bottes… Je mettrai juste quelques photos sur cet article, l’essentiel est visible sur Lettres Volées. Commençons par la gare de l’Est (sur Lettres volées, c’est ici). Zazie arrive gare d’Austerlitz, gare choisie par Queneau pour le A et le Z aux extrémités du mot, avec une certaine logique aussi, puisque la ville imaginaire de Saint-Montron évoque une ville desservie par cette gare, Saint-Amand-Montrond. Quant au scénario, il prévoyait un tournage gare de Lyon, et une réplique supprimée de Gabriel évoquait même la « Gare du Maine » (p. 13) ! L’intérieur de la gare de l’Est côté quais a relativement peu changé, inscription à l’Inventaire oblige. Seul l’intérieur de la gare a été bouleversé, pour introduire un véritable centre commercial avec toutes les enseignes franchisées que l’on trouve désormais absolument partout. On voit où se situe l’intérêt de la SNCF… Le quai 23 où arrivait le train de Zazie [10] a été raccourci, et les heurtoirs ronds ont été remplacés par des heurtoirs en barres (mais sur d’autres voies, il reste des heurtoirs ronds identiques à ceux du film) [11]. Coïncidence, les fameux trains en inox appelés « petits gris » ont été définitivement mis au rancart en janvier 2013 (pas exactement ceux du film, mais la génération suivante). Celui qu’on voit dans le film est sans doute un Z 5100 (nos premières impressions, erronées, seront confirmées ou infirmées par un spécialiste ; cf. ci-dessous), série construite à partir de 1953, disparue en 1998). Louis Malle s’amuse à nous brouiller la chronologie dès le début par un écran de fumée, avec ce générique filmé sur une voie électrifiée, suivi d’une arrivée dans un train à vapeur ! Mais c’est de Gabriel qu’on se demande s’il est à voile ou à vapeur, lui dont l’étreinte qu’il réserve à sa sœur se referme sur du vent ! Joli plan où beaucoup est dit de la destinée de l’homosexuel, exclu de la famille, condamné à n’étreindre que le vent… Comme quoi la question de l’identité, qui concerne autant les personnages que la « Sainte-Chapelle » est étendue par Malle au train. La verrière de la gare de l’Est, elle, inscrite à l’Inventaire, n’a pas bougé, ni le grand escalier qui mène aux bureaux, qu’on distingue bien dans la scène. Cet agrandissement de la gare date des années 1930 ; on est dans le style art déco. Enfin ce plan constitue un hommage à l’un des premiers films du cinéma, le célèbre L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, des frères Lumière. Un détail cloche quand on se rappelle l’époque du train vapeur, c’est que Jeanne et Zazie arrivent pimpantes et pomponnées dans les bras de Gabriel, lequel se plaint de l’odeur des gens qui attendent sur le quai. En principe, quand on descendait d’un train à vapeur, pour peu qu’on ait eu la curiosité de zazyeuter le paysage en se penchant quelque peu, notamment les enfants venant pour la première fois à la capitale, on était couvert de suie !


L’endroit le plus émouvant à mon sens – sens fort subjectif, car je subis déjà les premières atteintes du virus zazique – est la porte de la gare, qu’on découvre en suivant l’oncle et la nièce, comme un provincial qui débarque. Voici la première photo que je vous propose. Un détail ô combien trivial qui m’a touché, est la permanence des énormes arceaux en fonte protégeant les socles des colonnes. Combien de générations de clébards et de clodos se sont soulagés sur cette fonte ? Et l’orama, de ce côté-là, n’a pas changé, fait remarquable à Paris, à part la grille de fermeture de la gare inexistante à l’époque, et les innombrables panneaux de pub Decaux, contrepartie du contrat signé par la municipalité socialiste pour Vélib (si Vélib ne coûte presque rien à l’utilisateur, il le paie par le harcèlement publicitaire subi au quotidien, ainsi que par la hausse concomitante du prix des produits). La bouche de métro en grève où s’enfourne Zazie me semble (mais je n’en suis pas sûr du tout) être celle qui est toujours là, devant le parvis au milieu ; elle est très laide actuellement. Quant à celle à laquelle démarre le taxi, devant la brasserie « L’Écu de France », elle a disparu aujourd’hui, pour laisser place au parc de stationnement souterrain, et une nouvelle bouche a été implantée de l’autre côté de la rue du 8 mai 1945, à l’angle du boulevard de Strasbourg. On voit très bien la bouche disparue sur une des photos de ce site. Lors des Journées du Patrimoine 2013, j’ai eu l’opportunité de visiter la gare de l’Est et des bâtiments du quartier dont certains sont dans le film. Depuis la terrasse de la gare, j’ai pu admirer la perspective extraordinaire des boulevards de Strasbourg et Sébastopol, qui débouche sur… le Tribunal de commerce ! Le même phénomène se produit aussi avec la « pagode Guimard » et la grille de l’ancienne gare de la Bastille, qui occupaient alors l’emplacement actuel de l’opéra Bastille. Le plan séquence très travaillé de la « scène de rencontre » entre Zazie et Pédro-surplus se situe sur ce lieu voué à la démolition (voir sur Lettres volées). On peut le reconstituer grâce à l’extraordinaire collection de cartes postales de ce site. Cela dit, le montage est extrêmement habile, car le scénario indique, après le premier travelling sur les grilles du métro, « Cut. On la reprend en plan travelling identique longeant des grilles semblables mais donnant sur une rue ou un jardin public ». J’ai fait un tour à la Bastille lors d’une de mes randonnées subséquentes, et j’ai vérifié que les grilles et le muret du film sont les mêmes que celles qui entourent actuellement la station Bastille semi-enterrée sur la ligne 5 ; mais cela a dû être déplacé, parce qu’en regardant les photos que nous avons retrouvées, je ne comprends pas où pouvait se situer un parc public tel que celui d’où survient Pédro. Il faudrait retrouver des plans détaillés d’époque. Enfin, le métro est évoqué de façon métonymique par le carrelage typique des toilettes de l’appartement de Gabriel, visibles dans le plan 130, et le bruitage évoquant le métro. On songe à Chêne et chien de Queneau, qui fait le lien entre mère (métro) et excrément : « le soleil maternel est un excrément noir » (Œuvres complètes, Pléiade, tome 1, p. 12).
Pour la première rue dans laquelle s’engage le taxi au départ de la gare de l’Est, avec les enseignes « Lissac » et « Méo », j’ai eu longuement un doute, j’ai lancé un appel désespéré sur le présent article, et grâce à un ami, Julien, nous avons identifié… la rue Saint-Lazare, devant la gare du même nom, ou plutôt en direction de la Trinité, comme si le taxi quittait cette gare pour aller vers Bonne-Nouvelle, très précisément au coin de la rue de Budapest (pour que les immeubles qui barrent l’avenue soient à bonne échelle, même s’il m’a été impossible de reconstituer l’image, car Malle a filmé au télé-objectif, de façon à donner l’impression d’un décor artificiel et surtout pas réaliste). Si j’avais eu l’idée de consulter le site de Méo, j’aurais eu la réponse plus rapidement ! Cela confirme l’aspect oulipien du film, puisque contrairement à Queneau qui n’évoque que la gare d’Austerlitz, Malle évoque dans son scénario la gare de Lyon, tourne à celle de l’Est, fait passer le taxi sans aucune raison devant Saint-Lazare, tourne à l’ancienne gare de Bastille, et évoque la gare du Maine (et même plus, puisque le générique est tourné sur la ligne de Montparnasse, cf. infra)… C’est donc une tentative d’épuiser les gares parisiennes. Quant au roman, il évoque la « gare d’Orsay » au début du chapitre 9, mais a priori nous ne l’avions pas dénichée cachée dans un plan du film, jusqu’à ce que, en creusant un peu… (cf. infra).

Me pardonnerez-vous une crise de « racontouse », à mon tour ? Cette gare de l’Est, je l’ai hantée pendant des décennies, d’abord enfant banlieusard du réseau Est, puis étudiant, et j’habite désormais pas loin. Et faut-il évoquer ma feue grand-mère, qui fut garde-barrière en Haute-Saône sur le réseau de l’Est, et qui montait à Paris pendant la guerre en train, victuailles sous ses jupes ? Je la préfère nettement à l’inhumaine gare du Nord, avec sa façade prétentieuse de 1864 estampillée Rothschild. Avant d’arriver à l’église Saint-Vincent-de-Paul, le taxi fait un détour zazique devant la station du métro aérien Stalingrad, nettement identifiable. Parcours logique pour le roman, car le logement de Gabriel est censé se trouver dans le XVIIIe (intuitivement, car ce n’est pas explicite). Mais pour le film, c’est illogique, puisqu’on roule plein Nord pour virer plein sud ! Peu de changement sur cette station, semblable à bien d’autres à Paris, sinon que les escaliers métalliques ont été sécurisés, ils ne sont plus à claire-voie.
Bonne-Nouvelle : le forum antique, anti-pittoresque
Continuons notre promenade zazique, avec le lieu central du film, le café Turandot, également appartement de Gabriel et Marceline. Si l’intérieur est tourné en studio, avec vue sur les étonnantes enseignes lumineuses totalement artificielles (œuvre de William Klein – sans doute pas le papa de Noémie ! – restant à savoir si le fait d’introduire de vraies pubs contribua au financement du film) l’extérieur est parfaitement identifiable, il est situé au 9, rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle (cela est dit simplement, mais j’ai mis plusieurs jours à le retrouver au début de mon enquête !) Voici ci-dessous un photogramme du plan 147 du film, que j’ai tenté de reproduire. Attention : en plus de William Klein crédité comme conseiller artistique, il y avait aussi le décorateur Bernard Evein, et pour le film de Jacques Demy Les Parapluies de Cherbourg (1964), il réalisera le même type de palissades anti-réalistes.


Les lieux ont changé bien sûr. La plaque que j’avais prise au début pour une plaque commémorative, a disparu. En observant mieux le plan 368 (Mado devant la boutique de Gridoux), on distingue parfaitement qu’il s’agit d’une plaque de magasin, listant les produits : « taies d’oreillers, torchons, essuie-mains, mouchoirs, services de table ; magasin au 1er étage » ; on déchiffre presque le nom du magasin, quelque chose comme « Botel & Fils ». L’échoppe de Gridoux semble réelle, et non tournée en studio. Pour l’appartement de Gabriel, j’ai un doute, car il y a un plan où Gabriel et Zazie sont filmés au-dessus de la « salle de réunion » où est censé se trouver l’appartement ; et une photo de tournage montre l’équipe au même endroit… En lieu et place de cette « salle de réunion », se tient désormais un « Carrefour City ». O tempora, o mores ! Mais au-dessus de ce magasin se trouve vraisemblablement un vaste appartement (entrée 23 bld de Bonne-Nouvelle), d’où ont été filmées quelques scènes, même si les hautes verrières de l’appartement du film sont peu compatibles avec la hauteur sous plafond, ainsi que le plan en contreplongée totale, où Zazie tournicote autour du « trouple » constitué par son oncle, sa tante, et Pédro-surplus. Le jour où j’ai pris la photo, il y avait des scooters attachés, sans vergogne, à la balustrade sacrée où Annie Fratellini vampa Antoine Roblot ! Un clochard zonait devant feu le café Turandot, etc. Mais on distingue bien l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle au fond. Je n’ai pas pu reproduire le point de vue du photogramme pour une raison fort simple : la scène a été filmée depuis une grue, et un piéton normalement constitué ne peut se hausser au point de vue adéquat pour embrasser l’escalier et le sol de la partie surélevée depuis la partie basse ! Problème récurrent tout au long de mes repérages zaziesques…
Le fait d’aller sur les lieux m’a ému, bien sûr, mais aussi peut-être fait saisir le début du commencement d’un possible sens caché du film, qui se ressent dans sa chair avant de s’intellectualiser. Somesthésie, quand tu nous tiens ! c’est dans notre substantifique moelle épinière qu’est la clé des sens filmiques ! En effet, si l’action du roman est censée se situer quelque part dans le XVIIIe arrondissement, non loin des Puces, on peut se demander pourquoi Malle a posé ses malles dans ce quartier Bonne-Nouvelle, pour ne filmer que des coins de rues populaires, en reléguant scrupuleusement hors-plan les monuments reconnaissables du quartier. Il lui fallait bien sûr un trottoir avec escalier pour respecter le texte : « Charles descendit les cinq marches menant du trottoir au café-restaurant » (p. 19), mais ça se trouve dans plusieurs quartiers de Paris. Même quand dans son errance vespérale, la veuve Mouaque remonte, poursuivie par le pickpocket, le long de la balustrade du boulevard Bonne-Nouvelle à la minute 1h06 (je n’en suis pas complètement sûr, car dans le film il y a un escalier au milieu de cette balustrade, qui n’existe pas ou plus dans celle actuelle du boulevard), il prend soin de ne montrer clairement qu’une portion minime de la porte Saint-Denis, mais dans le plan suivant, séparé par un cut, il montre longuement en arrière-plan derrière le gros plan du visage de la veuve, la même porte très floue, (mais on reconnaît formellement la porte Saint-Denis, dont la corniche est bien plus haute que celle de la porte Saint-Martin). De même lors de la poursuite des « guidenappeurs », un plan furtif (542) montre une portion inreconnaissable de l’Arc de triomphe. Quand on a réussi à obtenir une autorisation de tournage pour la place de l’Étoile, je suppose que renoncer à la montrer explicitement doit être un choix volontaire ! Si l’on est très attentif, on distingue quand même l’Arc de triomphe en son entier, c’est dans l’un des plans depuis la tour Eiffel, quand Gabriel fait de l’équilibrisme et triomphe de la pesanteur. Idem pour la place de la Concorde châtrée de son obélisque, la Bastille coupée de sa colonne de Jouillet, la place Vendôme émasculée… et tous les ponts de Paris montrés par leurs dessous, par fractions, jamais en entier.
Plus simplement, cela correspond à l’absence de descriptions dans le roman. Le pittoresque, encore plus s’il est touristique, doit scrupuleusement se cantonner au hors-champ. Seules la tour Eiffel et l’église Saint-Vincent-de-Paul – Sainte-Chapelle du pauvre – sont filmées sous toutes les coutures, mais cette dernière n’est jamais présentée comme telle. Dans le plan de la course-poursuite où Zazie se cache parmi plusieurs mannequins zaziques, on aurait pu faire référence au Musée Grévin, lieu culte du quartier donnant sur le Passage Jouffroy, or Malle n’a pas sélectionné ce passage célèbre, mais deux autres dans le quartier, le passage du Grand-Cerf et la galerie Vivienne. Il m’a fallu deux voyages pour retrouver cette entrée en arcade, avec un numéro 52 visible sur un plan furtif, et une inscription « la concierge est dans l’entresol ». Elle est tout simplement située au 52 galerie Vivienne, dans l’axe principal de la galerie, mais radicalement rénovée ! Le numéro 52 est passé du côté droit de l’arcade. Voilà un montage de deux photogrammes du film (plans 269a et c), suivis de la photo de l’ensemble actuellement.


Iliade, ou Odyssée ?
Ce décentrement m’a fait songer (permettez ces élucubrations que je rectifierai au fur et à mesure de mes excursions zaziques) que Malle a peut-être voulu développer l’idée de Queneau selon laquelle « toute grande œuvre est soit une Iliade, soit une Odyssée, les odyssées étant beaucoup plus nombreuses que les iliades […] » (Bâtons, chiffres et lettres, Folio, p. 110 ; à la même page, Queneau précise que les odyssées sont « des récits de temps pleins », tandis que « les iliades sont au contraire des recherches du temps perdu »). Si l’on considère les lieux artificiellement ajoutés par Malle aux lieux délimités par Queneau, on constate qu’il a multiplié les portes de Paris, peut-être en extrapolant cette phrase du tout début du chapitre 4 : « elle arrive à l’une des portes de la ville ». De l’entrée et sortie du train (par la ligne de Montparnasse, comme nous l’apprendra la suite de notre enquête), à la passerelle de Saint-Cloud, en passant par la séquence de l’autoroute où Zazie conduit, totalement incongrue par rapport au roman, et les séquences de rues banlieusardes désertes où s’échappent les troupeaux automobiles, enfin la séquence où la voiture démantibulée de la veuve s’échoue dans un sous-bois qui fait penser au bois de Boulogne, sans oublier les tournages dans une zone déserte d’Orly au sud de Paris évoquées par Philippe Colin dans le bonus du DVD, cela ressemble à une tentative concertée de cerner Paris. Selon certaines versions, Troie aurait en effet eu six portes (et Thèbes, sept). On trouve cette idée dans le prologue de la pièce de Shakespeare Troïlus et Cresside, qui reprend John Lydgate, auteur anglais du XVIe : « Dardanienne, Timbria, Hélias et Chétas, Troyenne, Antenoride » (version de l’édition Bouquins, Robert Laffont). Qui nous aidera par exemple à identifier ce plan 532 de rue de banlieue ? Au terme de l’enquête, tous les lieux restant à identifier offerts à votre perspicacité ont été rassemblés sur cette page.

Autre défi de taille, identifier la voie d’entrée ferroviaire dans Paris. Quel réseau ? J’ai lancé un SOS à plusieurs associations de passionnés de chemins de fer pour identifier la gare minuscule qu’on entrevoit au générique (photogramme ci-dessous). En quelques minutes j’ai reçu une réponse épatamment circonstanciée de Pascal Berger, webmestre « ferrovipathe » (avec complication zazique ? [12]) de l’AJECTA, qui a trouvé fastoche cette énigme sur laquelle nous calions depuis 3 semaines, et nous a rectifié quelques erreurs : « L’identification est assez facile (!). La séquence introductive est prise à l’approche de la gare Montparnasse, un peu après la gare de Vanves-Malakoff, une fois qu’on a croisé les voies qui menaient aux garages de Chatillon-Montrouge (maintenant la ligne du TGV atlantique). Du point de vue du matériel, le générique constitue une vraie séquence historique avec les rames de banlieue en inox (Z5100) [chouette, j’avais bon !] bien connues (dites « Budd », du nom du concepteur américain de la méthode de soudage des tôles inox. À noter que ce ne sont pas des « petits gris » [pan ! sur le bec] qui sont eux des Z6100 et construites à partir de 1965. Les Z5100 remontaient au début des années 50. On voit aussi les locomotives électriques vertes 2D2 5400 dont les dernières ont disparu au milieu des années 70. Elles étaient au nombre de 23, numérotées 5401 à 5423 (en chemin de fer, on identifie chaque engin par un numéro unique). C’est la proto-histoire (plus que la préhistoire) de la traction électrique, une sorte d’hybride entre les locomotives à vapeur et les locomotives électriques. Elles sont encore [dans le film] dans leur état d’origine, avec deux phares centraux disposés de manière verticale. Elles avaient pour cela le surnom de « Cyclopes » [vous avez dit Odyssée ?]. Au début des années 60, lors de grandes révisions, elles ont perdu ceci pour gagner deux phares à l’horizontale, comme sur tous les engins modernes.
La gare que l’on voit au passage est la station Ouest-Ceinture qui, comme son nom l’indique, faisait la correspondance entre la banlieue de Montparnasse et la petite ceinture [rue Vercingétorix, M° Porte de Vanves]. Cette dernière ayant fermé aux voyageurs en 1934, la gare de Ouest-Ceinture ne voyait pas un gros trafic. Bien que pratique pour desservir le 14ème arrondissement, elle a été fermée en 1986 quand il a fallu démolir les quais pour faire passer les voies du TGV atlantique. La fermeture avait alors été présentée comme temporaire…
En 1960, l’arrivée du train aurait eu lieu dans l’ancienne gare Montparnasse (démolie en 1964 ?), mais la gare de l’Est qu’on voit dans les séquences suivantes était d’une ambiance assez proche. Elle n’est d’ailleurs pas encore électrifiée, celle-ci ayant été effective en 1962.
En ce qui concerne la séquence finale […] on circule bien sur la voie parallèle à celle du début. Sauf erreur, ces voies sont celles qui mènent aux garages de Châtillon-Montrouge, ce qui serait logique pour un tournage de film pour ne pas occuper inutilement les voies principales.

Pour la gare de l’Est, la locomotive que l’on voit est une 231K, originaire de la Compagnie du PLM (de mémoire, construite en 1911), dont certaines ont roulé à l’Est après la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, le dépôt de Paris-La Villette (donc celui de la gare de l’Est) était plein de vapeurs qui faisaient encore des services nobles, notamment sur Paris-Nancy, Paris-Strasbourg et Paris-Mulhouse via Chaumont. La première électrification a eu lieu en 1962 jusqu’à Château-Thierry et concernait surtout le réseau de banlieue. […] La disparition de la vapeur est presque toujours supposée très lointaine. Le dernier train à vapeur « commercial » a pourtant roulé en septembre 1975, ce qui n’est pas si vieux. En banlieue parisienne, les dernières circulations ont eu lieu en 1969 et 1970.
En décembre 1969, c’était entre la gare de la Bastille (actuel emplacement de l’opéra) et Boissy St Léger, jusqu’à la création du RER A. Les RER qui nous semblent les plus anciens ont donc roulé conjointement avec les locomotives à vapeur. Pour les wagons du train par lequel arrive Zazie, ce ne sont pas des Z5100, mais ce sont des voitures de prestige (première classe) de grandes lignes qu’on appelait les DEV INOX [je me disais aussi !]. Vu la date du film, il s’agit des toutes premières séries construites, entre 1956 et 1958, les suivantes n’ayant été livrées que vers 1962. Derrière, on voit les rames dites « Banlieue Est », datant de la compagnie des Chemins de Fer de l’Est au début des années 30.
[En ce qui concerne le choix de la voie 23], je ne suis pas sûr qu’il y ait une interprétation à chercher. Ce sont les voies les plus extrêmes de la gare de l’Est où il est facile de réaliser des prises de vues. »
Et pour terminer, M. Berger nous précise : « Pour l’anecdote, ma fille, en terminale, travaille sur Zazie dans le métro et ma belle-mère habite galerie Vivienne. J’ai notamment bien reconnu l’escalier du 52 (je l’ai connu avant rénovation) et la grille quand on sort vers la place des Victoires… » Et il y en a qui croient au hasard !
Mille mercis à M. Berger. Voici la gare dans le générique :
Cette information m’a obligé à mieux voir cette séquence : en effet, le rideau de vapeur, qui constitue un « volet naturel » en termes filmiques, que nous croyions un gag, n’est pas un gag. On distingue bien pendant une seconde, la locomotive à vapeur (cf. photogramme ci-dessus), avec même un machiniste qui sort la tête, très « La Bête humaine », et l’absence de ligne électrique, alors que sur la voie du générique, il y a bel et bien des caténaires ! Dès le début, Malle impose sa volonté de montrer la modernisation de Paris. Cette énigme résolue confirme notre intuition. À l’instar du métro où Zazie ne parvient pas à pénétrer, le cinéaste aurait-il redoublé ce motif en multipliant les tentatives de cerner, voire de ceinturer Paris, métaphore de l’impossibilité de reproduire le réel par l’art ? Aiguillonné par ces informations, je suis allé photographier cette gare de Ouest-Ceinture, qui tel un village de Gaulois résiste rue Vercingétorix, taguée de partout, à la croisée des lignes de Montparnasse et de ce qu’il reste de la Ligne de Petite Ceinture. En passant sous elle, on peut même traverser les voies et se retrouver de l’autre côté, rue Jacques Baudry, mais il faut avoir le cœur bien accroché pour n’y pas faire aussi sous soi, car ce passage souterrain est l’un des endroits les plus glauques de Paris. Désert, coudé de plusieurs zigzags zaziques, sombre, étroit, maculé de tout ce que vous pouvez imaginer, c’est l’endroit idéal pour tous les Monsieur William en quête de sensations fortes ! La gare en question est murée, et se dégrade à petit feu, alors qu’on pourrait faire de ce bâtiment un phare de ce quartier – restaurant, maison de quartier, école, que sais-je… Puis je me suis dirigé vers la gare Montparnasse pour emprunter cette ligne par laquelle Malle nous fait pénétrer dans son film et dans Paris. L’omnibus m’a mené jusqu’à Versailles-Chantiers. J’ai pu photographier depuis les vitres sales du train la façade ouest de la petite gare désaffectée, et pour le reste je n’ai rien reconnu. Les immenses immeubles tout blancs du film existent peut-être encore, mais comment les reconnaître noyés dans le magma urbain qui a poussé tout zazie-mut dans les cinquante dernières années ? Et ce que je prenais pour le périphérique sous lequel passerait le train, n’est en fait que l’ancien pont qui précédait la gare, noyé dans les pharaonesques travaux de rénovation les plus radicaux de toutes les gares parisiennes. Il ne reste rien de l’ancienne gare Montparnasse, de l’extrémité des quais à la façade. C’est une énigme, quand on compare à la gare de l’Est, dont les verrières ont été préservées parce que, j’imagine, classées. Qu’en était-il de l’ancienne gare Montparnasse ? Mystère et boule de gomme ! Sur le chemin de fer, voir notre article « Du cheval au cheval de fer et au cheval-vapeur ».
Decumanus et Cardo
Par ce choix du quartier de Bonne-Nouvelle, le cœur de Paris se trouve décentré dans un endroit improbable, mais plus proche du centre que le XVIIIe arrondissement. Et puis la rue d’Hauteville, nommée par Philippe Colin comme le centre névralgique du tournage, me semble prendre un sens crypté. La « haute-ville » ne s’oppose-t-elle pas à la ville souterraine du métro ? La rue d’Hauteville est une rue passionnante de Paris sur le plan géométrique. Elle suit l’axe sud-nord, depuis le boulevard de Bonne-Nouvelle (on la voit depuis l’escalier qui descend du café Turandot) à la Place Franz-Liszt, qui s’appelait place La Fayette à l’époque du tournage. Et elle bute sur l’église Saint-Vincent-de-Paul, sorte de Saint-Graal des touristes, à l’instar de la tour Eiffel, qui nous vaut des plans magnifiques vus de haut sur la ville. Voici une photo de cette rue, barrée par l’église, perspective offerte depuis le croisement avec la rue de Chabrol. Lors des journées du Patrimoine sus-mentionnées, j’ai pu accéder à la terrasse de l’église, d’où la vue sur Paris est étonnante et inhabituelle. On est dans l’axe de la rue d’Hauteville, et l’on apprécie la place Franz-Liszt, pensée comme la plus belle place de Paris à sa création, dans toute son ampleur.
Les petites rues qui butent sur l’église Notre-Dame de Bonne-Nouvelle ont une particularité rare à Paris, d’étroites rues diagonales, qui coupent le damier majoritaire nord-sud, est-ouest : rue de Cléry et rue d’Aboukir, deux rues fondées sur l’ancien fossé de l’enceinte de Charles V. De là à dénicher un sens crypté, une volonté de souligner une herméneutique de la ville moderne, il n’y a qu’un pas. Je remarque que cette rue est parallèle aux rues Saint-Denis et Saint-Martin, qui constituaient le prolongement nord des deux « cardo » de Lutèce, quand la ville s’est étendue rive droite à la fin de l’antiquité. Le cardo maximus était situé à l’emplacement de l’actuelle rue Saint-Jacques, se prolongeant au nord dans ce qui deviendrait la rue Saint-Denis. Queneau, qui nous laisse dans le vague par rapport au quartier où se situerait l’action, ne précise que ce seul point : « Il ne sait s’il doit aller au nord ou au midi car la rue est ainsi orientée » (p. 41). Le boulevard de Bonne-Nouvelle étant abondamment filmé, on se trouve à la croisée du nouveau decumanus que constituent les grands boulevards constitués sous Louis XIV après 1660, et du cardo magnifié par la porte Saint-Denis, édifiée en 1672 à la gloire de Louis XIV, au cœur de la ville dans une volonté de quadrillage qui me semble au centre des préoccupations de Queneau autant que de Malle dans ce roman et ce film pré-oulipiens. Le quartier de Bonne-Nouvelle constitue donc un « forum » au sens romain, où se concentrent les aspects essentiels de la vie quotidienne, église comprise, que l’on aperçoit au fond de plusieurs plans. On songe à la phrase de Fédor, au chapitre XI : « qu’ils s’en aillent avec un souvenir inoubliable de st’urbe inclite qu’on vocite Parouart », parodie de Rabelais : « De l’alme, inclyte et celebre academie, que l’on vocite Lutece ». Sur ce plan géométrique, le passage du Grand-Cerf constitue l’abscisse (parallèle au decumanus), suffisant pour épuiser le naïf Turandot. Pour perdre Pédro-surplus, il faudra un surplus géométrique, avec le dédale de la galerie Vivienne, sans compter l’utilisation de la troisième dimension, avec les nombreux déplacements verticaux, escaliers ou toits. On retrouve bien la grille d’entrée du passage du Grand-Cerf, celle par laquelle se glisse Zazie. Elle a juste été remplacée, ainsi que le carrelage du sol du passage (par contre, la mosaïque du sol de la galerie Vivienne n’a pas bougé !) Et pour les enseignes anciennes, autant dire que je n’en ai retrouvé aucune. Dans ces nombreux passages du quartier, entre le Sentier et les Halles, les boutiques récentes luxueuses ou bureaux du tertiaire, le disputent aux grossistes asiatiques qu’on trouve dans les passages moins huppés, comme le passage du Caire, censé être un des lieux de tournage dans le scénario, mais je n’y ai rien retrouvé, cela a sans doute été modifié lors du tournage [13]. Même si certains de ces passages n’ont plus rien à voir avec le Paris pittoresque, il reste néanmoins dans ce quartier vaguement quelque chose de l’antique forum, éradiqué du mal nommé « Forum des Halles ». Si la tour Eiffel, à en croire Gabriel, fait de Paris un homme, il n’y a pas à chercher bien loin pour trouver ce que le trou des Halles fait du centre de cette ville. Boutiques franchisées, marques fadasses, rien de personnel et d’unique ; comme tous les centres historiques de toutes nos villes. Même les arabes du coin, épiceries qu’on croyait indéracinables, eh bien ils ont réussi à les extirper une à une tels des comédons du visage lisse de la ville, et à les remplacer par des « Carouf city », où les enfants de l’arabe du coin seront salariés au smic pour empiler dans les gondoles les promos de yaourts, au profit de fonds de pensions étasuniens… Bientôt ce sera le tour des boulangeries, des coiffeurs, des boucheries, et de tout ce qui subsiste du commerce indépendant, du forum humain d’un Paris pas ripou. Mais trêve de ronchonnage, retour à nos moutons.

Ajoutons à ces considérations le fait que le « Mont-de-piété » du livre est remplacé par un improbable « Paradis », que Malle a volontairement situé non pas à Montmartre, ce qui aurait constitué un lieu commun facile du Paris filmique, mais en haut de l’escalier de la rue Bossuet, qui jouxte l’église Saint-Vincent-de-Paul (photo ci-dessus), symétrique à la rue Fénelon. On ne peut pas croire à une raison économique pour un film qui s’est payé des séances de tournage à la tour Eiffel sans doute très onéreuses (et impossibles aujourd’hui, principe de précaution oblige). J’ignore d’ailleurs s’il existe, en dehors du coût du tournage lui-même, des autorisations, et des ventouseurs, des droits d’auteurs à payer à la Ville de Paris pour montrer les lieux célèbres. Ce n’est quand même pas parce qu’il était racho que Louis Malle a relégué dans le hors-champ tout le pittoresque de Paris ! Donc pourquoi ce « Paradis » à cet endroit inattendu ? Ironie d’abord, de placer ces cabarets sans doute blasphématoires dans ces rues fort pieuses. Agnès Vinas, avec son don typiquement féminin pour fouiller innocemment dans les archives les plus scandaleuses, a trouvé trace d’un cabaret de ce style disparu depuis belle lurette, et qui ne devait pas être piqué des hannetons. La rue Paradis est une rue perpendiculaire à la rue d’Hauteville. Volonté de donner un sens à la quête de Zazie et de tous les personnages ? De suggérer que leurs désirs ont leur aboutissement non pas dans un endroit inaccessible, mais au cœur le plus populaire de la ville ? Ce choix de cette rue la plus banale possible, une rue dépourvue d’habitations, pissotière du quartier hantée par des grappes d’avaleurs de vinasse, me fait penser au chef d’œuvre de Boris Vian, « La rue Watt ». Je ne développerai pas ici, mais il se trouve qu’à différentes périodes de ma vie, j’ai arpenté autant la rue Watt que la rue d’Hauteville, et j’en connais le moindre centimètre… Enfin, dans la lignée de ces noms de cabarets coquins, Louis Malle fait reconnaître à Philippe Noiret du haut de la Tour Eiffel « La Nouvelle Ève », ce qui est fort improbable, s’agissant d’un petit cabaret à l’entrée discrète dans une façade impossible à reconnaître de la tour Eiffel. Il faut donc donner à « Nouvelle Ève » un sens symbolique, comme si Zazie, Mado, la veuve Mouaque, Marceline et même Gabriel(la) manifestaient une nouvelle façon de vivre la féminité, dans la lignée de la parution du Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, ou du film Et Dieu... créa la femme de Roger Vadim en 1956. Bref, il y a à creuser ici, et comme dirait Boris Vian, « j’y retourne immédiatement » ! Sur toutes ces considérations, Agnès Vinas a enquêté avec brio du côté du Paris surréaliste, et arrive à des conditions fort différentes. Voir ses considérations sur le Xe arrondissement de Louis Malle.
La Seine dans tous ses états
Une superbe journée d’hiver, le 16 février 2013, m’a vu randonner tel un vulgaire touriste, le long de la Seine, de Saint-Cloud à Saint-Michel. Belle moisson ! Je suis parti de la passerelle de l’Avre, ne sachant pas si c’était là. Pour s’y rendre, c’est le tramway T2, arrêt Les Milons ou Les Coteaux (également, côté bois de Boulogne, le bus 241, mais ravitaillé par les corbeaux). J’ai scrogneugneunisé à Saint-Lazare autant qu’à La Défense, à cause de ces [censuré] de la SNCF et de la RATP, incapables d’afficher des plans détaillés des lieux que va traverser le moyen de transport qu’on s’apprête à emprunter. Des affiches de pub, alors là, pas un pan de mur ou une colonne qui n’en soit maculé jusqu’à la nausée, mais visualiser le quartier où l’on vous transporte, point de quartier ! Au mieux, on vous donne un dépliant avec un plan des lignes du réseau, mais ce n’est pas une carte précise, comme la RATP vous en donnait de belles dans tous les départements de la petite couronne dans les années 1980. Et pourtant ces cartes existent ; elles ne sont bien entendu pas affichées non plus à l’endroit où l’on en a besoin, à l’intérieur du moyen de transport, mais sur les quais des gares d’arrivée ; il vous faut alors descendre du train, vous rendre compte que l’endroit que vous recherchez est à la station suivante, et… attendre le prochain train, 20 minutes plus tard ! Heureusement, pour cette passerelle, j’eus plus de peur que de Malle, car le tram passe juste dessous. Superbe infrastructure, faisant partie de l’aqueduc du même nom. Cela justifie bien ce « plan leitmotiv » de la passerelle, comme il est dit dans le scénario. Du coup, je songe à la célèbre page d’admiration de Rousseau sur le pont du Gard. Malle l’a-t-il choisie en hommage au natif du Havre qu’est Queneau ? J’ai pu identifier les endroits visibles dans la course-poursuite. L’escalier a été remplacé par une rampe à degrés, pour des raisons sans doute d’accessibilité aux vélos et autres chaises roulantes. Mais, premier émerveillement de la journée, alors que je ne l’attendais pas à cet endroit, j’identifie un des escaliers de la même course-poursuite, celui du plan 244. Je parviens à reconstituer le plan au millimètre près. Heureux homme : rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle… Je vous prie d’accepter mes plus humbles excuses de m’esbaudir pour si peu, mais parfois, une vieille rambarde qui ne vous manque plus, et tout est repeuplé ! Tant que la rambardophilie n’est pas une paraphilie interdite par la loi ! Voici de quoi jouer au jeu des 7 erreurs.

L’Affaire Camoëns : une mystérieuse paire de fesses !
Dans les mêmes parages, Marie-Françoise Leudet, la chipie complice d’Agnès Vinas pour Lettres Chipées, qui participe à cette même chasse à la Malle au trésor, m’a suggéré – avec cette candide perversité hélas toute féminine – que l’escalier-statue-fesses du plan 571 qui nous faisait bisquer depuis le début pourrait se trouver au Parc de Saint-Cloud, ben voyons ! Je ne le ni la crus pas, ayant googlé en vain, et ne l’espérai point, car c’est immense (bien que ce parc resté tel qu’au XVIIe siècle semble valoir le déplacement), et seul mon insigne respect pour la gent féminine me retint de lui conseiller de s’aller purger avec quelques brins d’ellébore. Cet escalier fit nonobstant partie des lieux pourtant anodins qui me résistèrent, et chai ohrreur gon meu raizizteu ! (pardon !) Je fis même trois chronophages crochets pour vérifier que non, ce n’était pas non plus dans les escaliers de l’île aux Cygnes, de la station Passy, ni au square Willette, à Montmartre. Il n’y a pourtant guère de lieux aussi pentus à Paris… Voici l’objet du délire, puis la solution de l’énigme.

C’est en effet à mon troisième déplacement à la tour Eiffel que j’eus l’intuition (voir plus loin) qui me fit découvrir l’Avenue de Camoëns dont les fameux escaliers débouchent sur le boulevard Delessert d’une façon cavalière qui seyait particulièrement à notre Zazie. La statue dont Malle, fidèle à sa rage iconoclaste, ne daigna nous montrer que les fesses et le sein, a disparu. Moi qui me plaignais naguère dans cet article de la propension de Paris à s’encombrer de vieilleries statuaires et de n’oser mettre à la benne des œuvres médiocres, je suis pris en défaut, car je ne citerai pas le nom de l’auteur de la statue hommage à l’immortel Luís de Camões, auteur des Lusiades, qui date de 1987 et a remplacé une statue sans doute déplacée quelque part, elle-même ayant remplacé un précédent buste à Camoëns, victime d’une nouvelle affaire des Hermocopides ! (voir cette page). En revanche, quand j’ai vu son œil borgne, dont l’effet est grossièrement souligné par la statue, je n’ai pu m’empêcher de sourire en songeant que c’était l’esprit de Malle qui me faisait un clin d’œil, fier de m’avoir bien fait courir (comme le pauvre Pédro) pour résoudre sa double énigme du Trocadéro (voir ci-dessous). Pour cette photo, il était impossible de reproduire le cadrage du film, pris depuis une grue pour des raisons évidentes (n’être ni en plongée ni en contre-plongée), et compenser le dénivelé. De plus, le cadrage que j’ai choisi permet d’en profiter pour montrer la si ravissante statue actuelle. Tiens, à propos de statues brisées, la scène du début de la poursuite où Zazie brise les bras d’une statue qui devient La Vénus de Milo constitue à mon sens une mise en abyme du film, puisque c’est en cassant une belle statue qu’on crée une nouvelle icône ! Que fait d’autre Louis Malle ? Le dialogue du roman et du film l’avaient dit d’une autre façon au début de la séquence des Puces : « c’est là où on trouve des ranbrans pour pas cher, ensuite on les revend à un Amerlo » (p. 46). L’Église Saint-Vincent-de-Paul, qu’est-ce d’autre qu’un « ranbran pour pas cher » ? Ne soyons pas injuste : l’église vaut la visite, ne fût-ce que pour ses plaques de lave émaillée peintes par Pierre-Jules Jollivet, enlevées juste après leur installation, pour obscénité, et réinstallées en… 2011 ! Louis Malle ne pouvait donc pas savoir que la nudité d’Ève avait choqué ! La vue depuis la terrasse est magnifique, et Malle aurait pu l’exploiter.
Piquée par une curiosité toute féminine, Agnès la zazipathe a résolu la question de la statue intérimaire : l’ouvrage Les Portugais à Paris d’Agnès Pellerin nous apprend en effet que c’est à cause de l’œil borgne du poète que la statue fut l’objet de dégradations, car elle contrevenait au standing de l’avenue. Je suppose également que le Portugal à l’époque et dans ce quartier évoquait moins Vasco de Gama que les gardiennes d’immeubles ou autres maçons. Elle fut subtilisée mystérieusement en 1913, puis réapparut, mais on n’osa la remettre à sa place. En 1924, on met en place Les Chansons de Bilitis, statue dont la fesse se montre à nous dans le film. L’histoire ne dit pas où est passée cette statue lorsque en 1987, on remit un Camoëns tout aussi borgne à la place de Camoëns ! Avec son obstination mustélidaire, Agnès Vinas a même retrouvé un pagnolesque compte-rendu de conseil d’arrondissement du XVIe arrondissement, du 22 février 2005, où la question comment s’en débarrasser sans froisser le Portugal est posée de façon fort ironique (à télécharger sur le site de la mairie du XVI ; le paragraphe est à la fin du document). On se demandera évidemment si le choix est innocent de cette statue évoquant une célèbre supercherie saphique de Pierre Louÿs, dans un film évoquant de façon discrète le saphisme.
Le pont de Bir-Hakeim
Mon périple du 16 février (je reviens en arrière, avant cette découverte majeure que constitue l’Avenue de Camoëns !) s’est poursuivi, après une marche à pied roborative aux abords du bois, entre les camionnettes de prostituées et les grappes de cyclistes. J’ai retrouvé la ligne 10 du métro, qui m’a déposé au pont Mirabeau, à partir duquel j’ai remonté la Seine à pied ou en Vélib jusqu’à Saint-Michel. J’ai pu identifier certains photogrammes (avec la difficulté déjà évoquée que Malle ne prend pas de plans généraux, mais ne cadre parcimonieusement des ponts ou des places que la partie utilitaire, évacuant tout le pittoresque), et j’ai éliminé des ponts qui ne sont pas dans le film, comme Mirabeau (sauf erreur, bien sûr), et Grenelle. Les choses sérieuses commencent avec le pont de Bir-Hakeim, et l’île aux Cygnes, cette dernière vaguement visible depuis un plan du film pris depuis l’actuelle voie Georges-Pompidou. On s’en donne à cœur joie entre les colonnes métalliques du pont, lieu de tous les délires texaveriens du film. Malheureusement, il est actuellement en travaux, ce qui interdit de photographier l’enfilade de colonnes à travers les arcades de pierre (beau plan au téléobjectif, qui déréalise le lieu). Sur le plan 482, que j’ai tâché de reproduire, j’ai été étonné d’identifier le pont Rouelle, que je croyais récent. Mais j’ai appris que si la branche de RER C actuelle a été ouverte en 1988, le tronçon avait existé depuis 1900, et avait été désaffecté en 1987 ! L’architecture de ce pont typique de l’époque aurait dû me le faire comprendre !
L’escalier de l’extrémité rive droite, visible au plan 243a, a été surchargé d’une passerelle qui le surplombe. Avenue du Président-Kennedy, où je suis passé pour prendre la photo de l’île aux Cygnes telle qu’elle apparaît dans le film, mon côté obseslionel a été récompensé : j’ai identifié un carrefour avec deux entrées d’immeubles que j’avais remarqué dans un plan improbable de la poursuite des « guidenappeurs ». Il s’agit du débouché de l’avenue Frémiet dans l’avenue du Président-Kennedy. Contrairement à ce que laisse croire son nom d’avenue, ce n’est qu’une voie privée fort courte ouverte à la circulation (d’après Wikipédia, Camoëns a l’avenue encore plus courte !). Elle mène à un petit dédale local, et aucun car de touriste n’a jamais dû passer par là ! Or le Cityrama entre, puis sort de cette « avenue » ! J’ai vraiment eu une chance de cocu de l’identifier, genre aiguille dans botte de foin. J’avais, il est vrai, entrepris de regarder tous les porches d’immeubles donnant sur la Seine, mais quelle chance d’être tombé dessus dès le début ! D’autant plus que sur le photogramme, on distinguait une plaque de rue floue côté avenue du Président-Kennedy, avec un seul nom très court sous le nom de la voie. Je pensais à quelque chose du genre « Quai Conti », et je ne cherchais pas vraiment dans ces parages. Le nom actuel de la voie date de 1964, on s’en doute, et le quai s’appelait auparavant « quai de Passy ». J’ai fait la même chose pour les escaliers et les arches de ponts jusqu’à Notre-Dame, et j’ai fait chou-blanc pour un certain nombre ! C’est tellement exaltant, à vrai dire, de parcourir une ville truffée de monuments mondialement connus, en quête d’une rampe d’escalier tortillée de telle manière, d’une arche de pont voûtée à tel degré, ornée de tels claveaux… d’un parapet avec un appareil comme ci ou comme ça… d’un coin de rue tordu… Après un passage éclair à la tour Eiffel, où je repasserai deux fois, j’ai fait un crochet pour aller vérifier que « l’immeuble de la Sécurité Sociale » du plan 524, présenté comme le « point culminant de notre civilisation », n’était pas autour de l’Unesco, place de Fontenoy. Pourtant un immense tabagnon de ce style, ça ne se rate pas… et la fontaine et la sculpture qu’on distingue sur le photogramme me disaient quelque chose, mais quoi…


Le scoop du siècle : le « point culminant de notre civilisation » enfin identifié !
Ah ! La pêche du 20 février s’est avérée zaziraculeuse. C’est en me contorsionnant sous la tour Eiffel pour reconstituer le plan 471i (ci-dessus), que pour me caler sur l’existant, je vois enfin ce que j’avais devant les yeux depuis des semaines sans le remarquer : ce [censuré] de tabagnon : il me crève les yeux, le bougre, en plein milieu du photogramme ! Il trône devant le palais de Chaillot ! Et enfin je reconnais ces statues qui me disaient bien quelque chose, et la fontaine du Trocadéro. Un bâtiment qu’avait l’air flambant neuf, soufflé comme un fétu de paille ! Comme avant lui nombre de bâtiments dans ce lieu longtemps réservé aux expositions universelles, par exemple l’Ancien palais du Trocadéro, construit en 1878, démantelé en 1935. Il n’y avait qu’à faire confiance au scénario, qui pour une fois ne mentait pas : « Nous survolons actuellement la plaine du Trocadéro, patrie des célèbres fromages » (p. 46). Cet immeuble hénaurme que l’ONU a créé, puis que l’OTAN a détruit après que Malle a fait son film, ne réalise-t-il pas l’épigraphe d’Aristote ? On apprend ici que le bâtiment a abrité, après que l’ONU se soit installé à New York en 1951, le siège de l’OTAN, puis que l’OTAN a quitté les lieux en 1959 pour s’installer dans les futurs locaux de l’université Paris-Dauphine, que l’OTAN quittera pour Bruxelles en 1966 à l’occasion de la sortie de la France du commandement intégré de l’OTAN. Les sinécures procurées par ce genre d’institution peuvent s’assimiler à des « fromages » pour certains fonctionnaires internationaux. Pour le voir, voici la meilleure photo disponible sur Internet. J’en ai trouvé une autre, rien que pour vous, dans un livre de 1985, Le Nouveau Trocadéro, d’Isabelle Gournay (Mardaga éditeur). Malheureusement, en dehors de deux photos plus deux photos de maquettes, le texte nous en apprend fort peu : « À Paris, seul le Palais de Chaillot offre à l’ONU, dont le siège new-yorkais n’est pas achevé, une salle de congrès et des locaux assez vastes pour y tenir une assemblée générale ; les délégués s’y réunissent une première fois en 1948. Sous la direction de Jacques Carlu, redevenu architecte en chef, les galeries des musées sont provisoirement métamorphosées en bureaux et salles de réunion. En 1951, on décide de ne pas toucher aux sacro-saints moulages du Musée des Monuments Français et Jacques Carlu construit en trois mois un bâtiment temporaire autour des fontaines » (p. 55). C’est tout ce que nous apprend ce livre, et la chronologie en fin de volume ne nous apprend pas la date de la démolition du bâtiment ! Les cinéphiles reconnaîtront dans le film de Julien Duvivier Sous le ciel de Paris sorti en 1951, une belle scène filmée au Trocadéro juste avant la construction de ce bâtiment. Il serait intéressant d’en trouver trace dans un autre film… À propos, ce film de Duvivier, considéré comme un précurseur de la nouvelle vague, a sans doute influencé la façon de filmer Paris de Louis Malle. On trouve plusieurs points communs, comme l’errance de deux gamins espiègles livrés à eux-mêmes dans Paris, un satyre, une sorte de course-poursuite en voiture, et l’idée de transformer Paris en une sorte de labyrinthe où la caméra va et vient, jusqu’aux interventions du narrateur. Les films de déambulation urbaine sont d’ailleurs une mode de l’époque, tant dans le néoréalisme italien (Les Nuits de Cabiria (1957), puis La dolce vita (1960), de Fellini) que dans le film français, par exemple Les Dragueurs, premier long métrage de Jean-Pierre Mocky (1959), ayant peut-être fourni à Malle l’idée du gag des Norvégiennes (dans le film de Mocky, ce sont des Suédoises que Jacques Charrier et Aznavour draguent et véhiculent dans Paris). Ascenseur pour l’échafaud (1958), premier long métrage de fiction de Malle et l’un des premiers, sinon – à son corps défendant – le premier film de la Nouvelle Vague, contient une déambulation nocturne dans Paris de Jeanne Moreau dont celle de Zazie constitue un pastiche, jusqu’aux néons des bars (Kronenbourg). La fuite des amant assassins se termine d’ailleurs sous le pont Bir-Hakeim, que l’on retrouve dans Zazie. À mille lieux de là, je trouve dans les westerns parlants de John Ford, à partir de La Chevauchée fantastique un même usage anti-réaliste du décor, avec son utilisation délirante et mythique de Monument Valley, dans un seul film d’une part, mais aussi dans ses sept ou huit westerns à partir de celui-ci. En 1972, Louis Malle réalise en dix jours un documentaire, Place de la République (sorti en 1974), dans lequel il filme et discute avec des inconnus rencontrés sur cette place. Le contraire de Zazie, puisqu’on reste au même endroit, mais le même goût pour le populo. Le film s’achève d’ailleurs par un carton contenant une citation de Zazie d’ailleurs déformée si j’ai bien noté : « Pourquoi, qu’il disait, pourquoi qu’on supporterait pas la vie du moment qu’il suffit d’un rien pour vous en priver ? » (p. 119). On retrouvera dans Viva Maria ! (1965) des thèmes zaziques, comme la jeune fille rebelle et le détournement burlesque du music-hall.

Il est donc plus que probable que Louis Malle ait su que ledit bâtiment était sur le point d’être détruit, donc la référence à la citation d’Aristote, s’agissant d’un bâtiment militaire (OTAN), n’est pas élucubratoire ! En effet, l’article de Wikipédia nous apprend que ledit bâtiment fut édifié pour l’ONU dans le temps record de 135 jours ; l’ONU et encore plus l’OTAN ayant un rôle de préservation de la guerre (voire militaire pour l’OTAN), les points communs avec le texte d’Aristote choisi par Queneau pour épigraphe ne semblent pas fortuits. Mes petits agneaux, vous avez là un scoop altersexualite.com : ce bâtiment semble être tombé aux oubliettes, et encore plus le fait que Malle l’ait filmé sciemment avant sa disparition ! Pendant les nombreux plans de la séquence sur la tour Eiffel, Malle nous montre le plus souvent des pâtés de maison anonymes. À trois exceptions près : l’Arc de triomphe en minuscule quand Gabriel fait son rétablissement et « triomphe » de la pesanteur. Le Champ de Mars (que d’aucuns prennent pour les Buttes-Chaumont !). Et le palais de Chaillot, avec une amorce du palais des Nations-Unies, mais tronqué, et de plus caché par des personnages. Voici le photogramme où on le voit le mieux, derrière le marchand de ballons, à comparer avec la vue actuelle.


Entré zaziment en transe grâce à cette découverte bouleversant à tout jamais les fondements de notre civilisation (en toute modestie soit dit !), je me mis à trépigner de joie, à hurler des fulminations barbares, des euréquations en des langues forestières que j’ignorais connaître. Les touristes se mirent à me regarder, vrillant étrangement leurs index sur leurs tempes. Quatre ravissants Norvégiens blonds me sautèrent languissamment sur le râble, qui ne me lâchèrent pas de toute la journée, jusqu’à ce que je les eusse conduits à la Sainte-Pelle, une boîte célèbre du Marais. Enfin, nous sortons du cadre de ce reportage… Mais une anecdote vraie de vraie, c’est que sans le faire exeuprès, j’avais pris des places pour aller voir La Folle de Chaillot de Giraudoux le soir-même ! Et ça vous fait rire ! Pour un narrataire, je vous trouve quelque peu irrespectueux ! Dans ces entrefaites (comme dirait Alexandre Dumas) j’oubliai que j’avais une autre photo à prendre, celle de la sortie de Charles de l’enfer tournoyant de la tour Eiffel. Le scénario parle du pilier Nord, mais c’était le pilier Est. Enfin cela je ne le sus que le lendemain, car après avoir longtemps pesté à cause de cet oubli contre moi-même et le vieillissement accéléré de ma pauvre personne (gestes), je revins sur les lieux une troisième fois le lendemain. Comme disait Boris Vian, un pote à Queneau, dans une chanson consacrée – tiens, tiens – à un oncle bricoleur : « Y’a quelque chose qui cloche là-dedans /
J’y retourne immédiatement ». Descendant du RER C station Champ de Mars, je jette machinalement un regard de satyre zaziesque à gauche et à droite. La nuit portant conseil, je m’étais dit, dans le train qui me menait là, que si ce bougre de Malle avait fait venir à grand frais une équipe de tournage dans ce lieu si pentu, alors qu’il n’avait rien tourné du tout dans les autres lieux pentus de Paris, il en aurait bien profité pour trouver les escaliers dont il avait besoin. C’est à ce moment précis que mes regards – de satyre zaziesque, dis-je – balayent le côté ouest du Trocadéro, au-delà de l’endroit béni où j’avais déniché la présence-absence du palais de l’ONU. Je me rends compte que la pente y est bien plus accusée que du côté est, que j’avais bêtement exploré une semaine auparavant, par pur tropisme d’économie de bouts de semelle, puisque c’était le chemin fainéant pour poursuivre la visite de Paris… Une intuition lumineuse se fait jour, et dès lors rien, ni l’or du soir qui tombe,
ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, rien ne peut stopper l’allure martiale à laquelle je me dirige vers la découverte unique dans les annales malliennes que je pressens. C’est à peine si en passant, je prends le temps de photographier pour Lettres Volées, le panneau de l’avenue des Nations-Unies, ainsi que les sculptures La Jeunesse de Pierre Poisson et La Joie de vivre de
Léon-Ernest Drivier (voir sur le site de Nelly Buscot). Et ce fut comme une apparition, avenue de Camoëns (voir ci-dessus), ou plutôt une disparition – ὁ πλάσας ἠφάνισεν !
Bouquet final à la tour Eiffel
C’est par un superbe dimanche 3 mars qu’un bouquet final couronne cet épuisant zazfari-photo. La météo, soi-disant infaillible (météo, mon cul !), n’arrestoit pas de repousser la date où enfin l’astre du jour remplaceroit la grisaille qui engluoit Parouart depuis des lustres. Hélas, tout va à vau l’eau, et plus ni pape ni météo ne sont infaillibles… Je m’étais endormi tôt le samedi soir, harassé par le travail de Pénélope que constitue cet article. Dimanche à l’heure où l’aurore aux doigts de rose met son doigt dans… enfin bref, avant 8 h du mat, je mate le ciel, et chouette, beau temps, ça constelle un max aux côtés de ce qu’il reste de l’astre argenté. J’engloutis de quoi tenir jusqu’à je ne sais quelle heure, car j’ai bien sûr omis de réserver quelque heure de visite sur le site de la vieille dame de fer, n’ayant pas ce genre de réflexe geek. Je m’attends donc à faire la queue des heures et des heures. Je fais une halte à Concorde, histoire de contenter l’appétit glouton de photos ensoleillées d’Agnès Vinas, qui avec sa pertinacité toute féminine n’arrête pas de me harceler pour que je refasse telle ou telle photo plus ceci ou moins cela, tout ça pour finalement se contenter de la première toute bête que j’ai prise. La Concorde sans bagnole, fallait se lever tôt pour ça ! Et la Madeleine en prime, dans la perspective de la rue Royale… Madame est servie ! Enfin, me voilà devant la tour à 9h37 (ouverture 9h30) ; je vois qu’au pilier sud il y a peu de monde, je suppose que c’est celui où il faut avoir une réservation, mais point du tout, une employée me dit que c’est celui oùsqu’on grimpe à pied et légalement. Bin justement, comme il faut que je prenne des photos, et qu’un sou est un sou, je m’engouffre dans la non-file, n’en croyant pas mes yeux : super beau temps, dimanche, vacances scolaires, et pas une minute d’attente ! Agnès Vinas, avec son sens tout féminin de la calomnie m’avait attribué une chance de ce que vous savez, eh bien soit, mais qu’on veuille bien m’accorder le marida qui va avec ce genre de trophée ! Bref, je pars à l’assaut des deux premiers étages, le cœur aussi léger que Philippe Noiret se rétablit sur une plate-forme à 300 m de haut !

Un peu de sport n’est pas pour me déplaire, d’ailleurs habitant un 5e sans ascenseur, j’ai de l’entraînement. Pendant cette ascension, une pensée m’occupe d’abord pour une élève de mon précédent lycée, à Aubervilliers, qui s’est suicidée depuis la tour, le 24 ou 25 juin 2009, juste après avoir passé les écrits du bac. Si les plates-formes sont davantage sécurisées, rien de plus facile dans les escaliers que de passer au-dessus du grillage. Je chasse ce nuage de mes pensées, puis je médite sur l’apophtegme de Gabriel : « Je me demande pourquoi on représente la ville de Paris comme une femme. Avec un truc comme ça. » Ce n’est pas nouveau que cet objet fractal, selon l’angle de vue, latéral ou sousplombant, se peut voir comme un sexe d’homme ou de femme. Mais quand on songe à la fameuse « Protestation des artistes contre la tour de M. Eiffel » du 14 février 1887, on n’est pas étonné du jugement de Joris-Karl Huysmans : « On ne peut se figurer que ce grillage infundibuliforme soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel » Quand on sait le sens de cet adjectif, on comprend que la pauvre tour a été mise à toutes les sauces. Je croiserai à plusieurs reprises un type en collant qui fait son ludion sur les escaliers, et que je te monte, et que je te descends. Sûr que ce footing vous a plus de gueule que le « ginette-nase-club » ! Un employé de la tour, peut-être ? Quelques photographies en passant de l’ascenseur, que l’on voit dans le film (pour une fois que le pittoresque n’est pas dans le hors-champ, allons-y gaiement ! Pourtant le mot « Eiffel » dans le roman n’est employé que trois fois, et justement pas dans le chapitre consacré à la visite de ladite tour !) On a ajouté à l’ascenseur, pour faire nostalgique, un improbable employé accroché à l’extérieur.
Au premier étage, courte halte de repérage. Le soleil brille, mais une tenace brume de pollution empêche de voir plus loin que la Défense à l’Ouest, à peine si l’on distingue le Panthéon à l’Est (dans le film, Philippe Noiret, bien entendu, « mappe » tous ces monuments du même côté, alors qu’ils sont filmés devant l’île aux Cygnes. Deuxième étage, j’achète mon ticket de supplément pour le 3e. Toujours pas d’attente ! Et en avant pour le 7e ciel. À 47 berges, je n’avais jamais accédé au sommet, m’étant contenté du 2e, allez savoir pourquoi ? Encore mieux que Charles : « Ça faisait bien vingt ans que j’y étais pas monté » (p. 86). Dans cet ascenseur, je comprends comment a été fait le travelling descendant de Zazie colimaçonnant vertigineusement Charles. Voir à ce propos l’analyse brillante de Lettres volées, avec la référence que nos complices ont trouvée au film américain The Lavender Hill Mob de Charles Crichton (1951). C’est dans cet escalier interdit au public, escalier par lequel, apprend-on, Eiffel grimpera à pied 1700 et quelques marches le 31 mars 1889, en compagnie du président Sadi Carnot (deux Bourguignons), le jour de l’inauguration de la tour, que la scène est filmée, et pour le travelling, a priori on ne se cassa point la binette, la seule solution que j’entrevois est d’avoir filmé à travers l’ascenseur, encore fallait-il que pour cette séquence fort longue, l’ascenseur et les acteurs allassent à la même vitesse… Cet escalier hélicoïdal d’origine a été démonté en 1983 et découpé en 24 morceaux dont certains vendus aux enchères, nous apprend Wikipédia. Le film présente donc une séquence doublement historique. L’illusionniste Malle filme ensuite la descente des escaliers plus larges des étages inférieurs, mais pour parfaire son gag de l’arrivée de Charles virevoltant toujours, il insère un rappel de l’escalier en colimaçon juste avant qu’il soit éjecté par la base de l’escalier. Cela dit l’escalier actuel commence aussi par une très courte section en colimaçon, plus large à mon avis que celle de ce plan final.
Parvenu au sommet, je profite enfin de l’orama unique, point encore bousculé par l’affluence. L’article de Wikipédia nous apprend également que c’est à partir de l’après-guerre que l’affluence à la tour s’emballe, passant vers 1960 à 2 millions de visiteurs annuels (pour plus de 6 actuellement). Ce qui explique que Malle ait pu se payer des séances de tournage aussi longues (on imagine mal que le tout ait pu être bouclé en un seul jour, avec le temps idéal en prime). Je me mets alors à mitrailler, les images du film en tête. Le Champ de Mars, bien sûr, et le Trocadéro, avec la Seine en travers. Au Nord-Ouest, on distingue la trouée noire du bois de Boulogne, précédée du triangle de l’université Paris-Dauphine, que je suis fier de connaître désormais comme l’ancien siège de l’OTAN. On s’amusera au jeu des 7 erreurs avec le photogramme du marchand de ballons un peu plus haut, pour constater à quel point cette perspective-là a peu changé !
Les usines que l’on distinguait dans le plan 416 au sud du pont de Bir-Hakeim, ont été remplacées par le Front-de-Seine, et la cheminée d’usine du film n’est pas au même endroit que la Cheminée du Front-de-Seine, nouveau « point culminant de notre civilisation » ! Le balcon courbe avec lentille de Fresnel qui a suggéré la scène du « loup de mer » existe encore, mais sans la lentille. Les bâtiments qu’on distingue derrière Gabriel et le loup de mer sont les mêmes que ceux de la perspective qui m’a donné tant de mal, au débouché rive droite du pont de l’Alma, mais ça ne vous étonnera pas, ledit pont est pile-poil caché derrière les personnages ! Quand j’ai eu repéré ces points essentiels, négligeant le troupeau des ponts qui, cela ne vous étonnera point, dans la brume bêlait ce dimanche matin, je me suis mis à repérer le « best of » de cette déambulation zazique qui m’a fait redécouvrir Paris depuis plus d’un mois sous un pittoresque marginal (le courriel d’Agnès Vinas me lançant ce défi avec la candeur sibylline caractéristique du sexe dit faible, est daté du 3 février, et l’enquête se termine le 3 mars !). À l’instar de Philippe Noiret s’exclamant « La Nouvelle Ève », j’admirai l’Arc de Triomphe dans le smog, puis je m’exclamai « l’escalier de l’avenue de Camoëns » ! Et de mitrailler. Puis « ah ! Mais voici ma rambarde préférée, l’escalier nord-ouest du pont d’Iéna ». On la voyait fort bien de si haut, ma rambarde adorée, l’idole de mon cœur ! Et une pensée émue pour la veuve Mouaque… Et l’angle de l’avenue Frémiet, et la Renommée dudit Frémiet, qui brillait dans la brume, et la cathédrale, puis l’église américaines… Comme je m’extasiais un peu trop démonstrativement (gestes), le zoom en érection vers ces spots pas catholiques, je crus voir les touristes circonvoisins tels des soldats de l’Armée du Salut, me regarder réprobativement, l’index vrillant leur tempe. Je leur fis de grands sourires et pour mettre fin à leur suspicion, orientai de façon propitiatoire mon zoom vers des monuments au pittoresque plus orthodoxe ! Les nouveautés, par rapport au film : la maison de la Radio (1963), le musée du quai Branly (2006). Cette dernière photo, que j’aime bien, n’est pas calquée sur un plan du film, mais montre un de ces râteaux bizarres qu’on voit dans la scène du rétablissement de Noiret (ci-dessus). Qu’est-ce ? Antennes, peut-être, paratonnerre ? en tout cas objet hétéroclite qui dut amuser Malle ! Voir sur Lettres volées, le dossier consacré à la tour Eiffel.
Zazouave au pont de l’Alma
Retour en arrière, à ma première chasse : j’avais traversé la Seine pour éliminer – croyais-je – les jardins du Trocadéro à la candidature d’escaliers-mystères, et le pont d’Iéna à celle d’arches-mystère, ce en quoi j’avais bien tort, car c’est à l’angle nord-est de ce pont d’Iéna que, lors de ma deuxième visite, j’ai retrouvé l’escalier à rambarde sur lequel Mouaque et Zazie se font des amabilités (plan 499), mais même si cette rambarde m’avait donné du fil à retordre, cette trouvaille était fort mineure à côté de l’Eureka majeur de « l’immeuble de la Sécurité Sociale » que je venais de faire ! Cela dit, aussi futile soit-il, je peux vous assurer qu’il n’y a pas deux escaliers semblables sur tout le parcours de la Seine à Paris ! J’ai observé attentivement tous les abords du fleuve pour tenter d’identifier le plan 534, que nous prenions à défaut pour le Cours la Reine, mais en vain (entre ce qui est en travaux, ce qui a disparu, et ce qui a été réaménagé, sans compter ce devant quoi on passe sans le voir, la nostalgie mallienne est un sport de combat !) En attendant qu’un lecteur averti nous donne la solution définitive, je trouve que le quai Malaquais est ce qui ressemble le moins mal à ce plan, à ce détail près du parapet, qui ressemblerait davantage à celui du Cours la Reine. Le quai Malaquais a contre lui d’avoir des bouquinistes, mais il y a 50 ans de cela… Le truc que je ne comprends pas dans ce plan du film, c’est le bout de rambarde perpendiculaire, qu’on voit au fond… Bref, je donne ma langue à Zazie (c’est le nom du chat écossaise d’Agnès !) La « Place du Canada », un des rares lieux dont on parvient à lire le nom sur une plaque de rue dans le film (plan 473b), a sans doute été tronquée pour création de voies rapides, car pour une place, elle est limitée à… deux plaques de rue fichées sur des piquets, sans le moindre bâtiment qui aurait ce nom pour adresse postale ! Je serais le Canada, je coulerais un petit sous-marin nucléaire à la France pour lui apprendre le respect ! Il est intéressant de constater que le scénario indique très précisément : « ils croisent un panneau indiquant le lieu qu’ils traversent « PLACE DU CANADA » » (p. 42). C’est la seule plaque de rue lisible du film… Cela me rappelle ce scandale de la « Place Paul Éluard » que j’ai évoqué ici.
Le pont Alexandre-III présente la même problématique que les autres : là aussi, Malle a cadré bas, de façon à couper les fameux pylônes et leurs Renommées, dont deux sont l’œuvre… d’Emmanuel Frémiet, celui qui donne son nom à l’avenue, et qui, pour la petite histoire, fut élève de François Rude, grand sculpteur romantique à qui on doit le fameux haut-relief Le Départ des volontaires de 1792 (dit La Marseillaise), occulté dans le plan de Zazie de passage place de l’Étoile, sculpteur, soit dit en passant, fort altersexuel, si l’on en croit l’exposition qui lui est consacrée à Dijon dans le joli petit musée qui porte son nom. Tiens, au passage, petite leçon Mallienne : visiter une ville c’est passer par l’avenue Frémiet plutôt que de photographier les sculptures de Frémiet, et guidenapper un parisien typique comme Gabriel, plutôt que de photographier (ou simplement regarder) de vulgaires icônes… Transposition de la formule de Queneau : « Pauvres innocents qui croient que c’est ça, Paris » (p. 124). La perpective du pont Alexandre-III (plan 536) est rive gauche (port des Invalides, en contrebas du quai d’Orsay), en travaux pour l’instant. À la Concorde, j’ai tâché de reproduire les cadrages, au péril de ma vie, puisqu’il fallait s’immerger dans les flots de la circulation. Cet exploit digne des Annabac n’empêchera pas Agnès de chipoter parce que l’obélix n’était pas assez dans l’axe zazique, ou que l’ensoleillement n’était pas top, et de me renvoyer sans pitié à l’ouvrage ! Non mais ! Et dire que si je fusse été renversé par une automobile pendant l’exercice de mes fonctions parascolaires, juspu chausser les palmes académiques… Petit crochet place Vendôme, où la colonne est scrupuleusement évitée. Chat échaudé, j’ai tâché de prendre toujours deux photos, une avec le cadrage mallien, l’autre incluant le monument caché, pour contenter l’appétit ogresque – typiquement féminin – de mon estimée collègue ! J’ai retraversé la Seine, en passant par hasard devant « Cityrama », dont j’ai découvert, ce qui ne m’a pas surpris, que c’était de la vraie marque, et j’ai erré de pont en pont, les inondations actuelles ne m’aidant pas à identifier les plans que j’avais imprimés. Les feuillages fournis que l’on voit sur tous les photogrammes indiquent que le tournage a eu lieu au printemps 1960, et on comprend pourquoi ! J’ai surtout éliminé un à un les ponts et escaliers. Il y en a un qui me résiste, c’est celui dont on distingue l’arche au plan 515. Le pont au Change y ressemble, avec ses balustrades manifestement refaites, mais est-ce celui-là ? Je n’ai pas formellement reconnu les vagues formes de l’arrière-plan. Il me reste du pain sur la planche !

Là encore, c’est à ma troisième visite, décidément fructueuse, à la tour Eiffel, après avoir désespérément inspecté, sur place et sur Wikipédia, un à un, tous les ponts de Paris, que j’eus enfin, grâce au précédent de l’immeuble de l’ONU, l’intuition géniale qui couronna cette journée d’une deuxième énigme résolue. Le fameux pont dont on voit l’arche au plan 515 est le même que celui qu’on traverse en Cityrama au plan 516, alors que Gabriel se fait vamper par les trolles. Il suffisait déjà de constater (après avoir patiemment observé tous les panoramas offerts par les autres ponts), que seul l’Ouest de Paris proposait de si larges perspectives aux abords de la Seine. Puis après avoir éliminé tous ceux qui ne proposent pas de débouché sur de profondes avenues mais sur des monuments, il ne restait que le pont de l’Alma. Pont que j’avais bêtement éliminé à mes deux premiers passages, parce qu’il était de fer et non de pierre. Et là, expérience ONU aidant – ‘ο πλάσας ηφάνισεν – je compris subitement, genre Annonciation faite à Paris, que ledit pont de fer était une reconstruction. Mais c’est bien sûr ! Le fameux Zouave du pont de l’Alma est trop vieux pour coller avec un pont si moderne ! Le pont actuel date des années 1970, il est deux fois plus large que le pont du film ! Il m’était donc impossible de reconstituer le plan, puisqu’on ne peut plus embrasser d’un seul coup (à moins d’avoir une grue) les deux côtés de la Seine. J’ai donc reconstitué le plan 516 en plusieurs photos, ainsi que le plan 515, qui donne sur la rive gauche. Côté nord, on ne distingue comme d’habitude que le petit bout de la queue du chat, je veux dire de la Cathédrale américaine de Paris. Côté sud, le détail qui a attiré mon attention, à force d’observer le photogramme, c’est l’alignement caractéristique des grandes baies de la ligne C du RER, le long de la rive gauche de la Seine. Comme pour le pont Rouelle, je croyais à tort que c’était récent, mais pas du tout, avant d’être le RER C, ce tunnel ajouré faisait partie de la ligne des Invalides à Versailles-Rive-Gauche, ouverte à l’occasion de l’exposition universelle de 1900 ! Tiens, au passage, Invalides, encore une gare présente dans le film, par ce détail minuscule de ce plan ! Et Orsay n’est pas loin, en tout cas le RER C, dorénavant, relie ces trois gares anciennes ! Voici donc pour info le photogramme, avec cette arche d’un pont disparu, et en dessous la perspective avec ce tunnel ajouré, qui permet aussi d’identifier le bizarre monument coupé (ça vous étonne ?) qui n’est autre que l’église américaine de Paris (et non la cathédrale !) Celle-là aussi m’a donné du fil à retordre. Je n’ai pas pu identifier le bâtiment à sa gauche, mais on voit bien que le plan est pris en plongée, ce qui forcément fausse la perspective. Ces photos ont l’air bien anodines, et pourtant, elles sont éminemment – comme dirait Mouaque – non pas « condamnables », mais typiques de la méthode employée pour ce film très particulier.
Un dernier mot au terme de cette épuisante course-poursuite à la poursuite de la course-poursuite Zazico-pedrosurplussienne. Moi qui voyage pas mal, je me dis souvent que la plus belle ville du monde est Paris. Peut-être vrai, mais tant de choses m’exaspèrent, des annonces polyglottes orwelliennes qu’on nous fait subir dans le métro (on nous intime l’ordre de « ne pas tenter les pickpockets » en trois ou quatre langues ; cf. cet article), jusqu’auxdits pickpockets qui vous harcèlent. Avec l’expérience de nombreux voyages dans les villes les plus craignos du monde, j’ai acquis une technique de camouflage en non-touriste (parfois complexe en Afrique ou en Asie, rapport au morphotype ; un problème que ne connaissent pas les Africains qui font du tourisme à Paris !) : mon appareil photo, entre deux stations, est rangé dans un sac banalisé, mon plan n’est pas à la main, et je tâche d’être vêtu normalement si possible sans sac à dos « Quechua ». Eh bien, sur le trajet séquanien, j’ai été pourtant « sélectionné » par trois traîne-savates de je ne sais où (vers l’est de l’Europe), avec une technique que les vrais touristes doivent essuyer cent fois par jour : le type (ou la fille, dans un des trois cas) fait mine de ramasser un truc par terre, et vous interpelle, en demandant si c’est à vous. J’ignore comment est censé se poursuivre le scénario, parce que j’ai rembarré aussi sec ces moucherons, mais j’ai cru observer qu’ils proposaient finalement au touriste naïf d’acheter la bague en or trouvée par un si extraordinaire hasard… En fait il s’agit du fameux « coup de la bague », que nos amis roumains ont emprunté à un très vieux truc de drague exposé dans le film de Jean-Pierre Mocky dont il a été question ci-dessus, Les Dragueurs (1959). C’est comme les arnaques Internet, ça finit bien par marcher… Je m’étonne, alors que la France se vante d’être la première destination touristique mondiale, qu’on n’ait toujours pas de police touristique, alors que les gouvernements de pays fréquentés par les touristes français, en ont mis en place depuis belle lurette… Dans les escaliers qui mènent au Sacré-Cœur, les centaines de touristes ont peine à se frayer un passage entre les centaines de traîne-savates, junkies, revendeurs à la sauvette, etc. Et dire que nous ne sommes pas au bout de la crise… Quand je regarde Paris avec les yeux d’un touriste, je me dis qu’ils doivent parfois être dégoûtés. J’ai quand même rarement éprouvé dans des pays pourtant plus pauvres que le nôtre, d’atmosphère aussi délétère sur les lieux touristiques. Sans parler des véritables dépotoirs que sont d’innombrables endroits de notre capitale, à commencer par ma propre (sic) rue.
Puces / Pigalle et autres lieux
Puces. Un premier repérage un vendredi, jour de fermeture (mais on peut entrer dans les allées désertes) m’a surtout dérouté. Mission aiguille rouillée dans botte de foin pourri. Voilà encore un lieu que j’ai fréquenté assidument dans mon adolescence. J’étais féru de chanson française, faute de goût pour un jeune à l’époque (on ne disait pas encore « djeune »), et je recherchais les plus incunables parmi les vinyles de mes chanteurs favoris (de parfaits inconnus pour la plupart, les Nicolas Bacchus de l’époque). Parmi ceux-là, je me souviens de la voix qui m’émouvait et m’émeut toujours terriblement, du regretté Jehan Jonas, qui entama en 1966 sa carrière d’un tonitruant « Comme dirait Zazie ». J’ai cru reconnaître la brasserie des moules, mais en revisionnant la scène, je me suis trompé. Un coup pour rien… Peu importe, car savez-vous que tout au long de ce reportage, je risquai ma vie pour la science ? Obnubilé par tel coin de rue, telle statue, tel café, tel pas de porte, je zazidéambulais en Vélib sans regarder devant moi, mais en guettant tout les détails possiblement zaziques… si je m’étais cassé la figure, eût-ce été un accident du travail ?
De retour aux Puces un dimanche, beau soleil. J’arpente à nouveau toutes les allées les plus vintage, en quête… de frontons de tôle triangulaires, de hauteurs de bâtiments à l’horizon, de pas grand-chose. Que peut-il rester de baraques de tôles cinquante ans après ? Je me concentre sur les marchés Vernaison (indiqué dans le scénario), Biron et Paul-Bert, qui n’ont pas encore été reconstruits en dur. J’inspecte tous les restaurants, et finis par tomber sur le fameux « Chez Louisette », le seul qui offre une perspective sur des allées couvertes, comme dans le film, et possède bien les portes vitrées permettant de voir de l’extérieur. Pourtant ce choix est étonnant, car c’est une institution des Puces, donc pittoresque, et pour Zazie, le pittoresque, vous savez où kesslemet ! Mais en 1960, ça devait rester un endroit populaire, encore habité par sa créatrice (restaurant ouvert en 1930). J’ai pris quatre photos en désespoir de cause, au hasard, d’allées d’échoppes. Une seule trouvaille, l’immeuble en briques du plan 175, que j’avais repéré sur les photogrammes, parce qu’il semblait assez neuf et facile à distinguer de par sa couleur et son matériau. Il s’élève toujours, défiant le temps, tel le fier Myrmidon devant le Naustathme, au 109 bis avenue Michelet (Saint-Ouen). J’espérais que ce serait la clé permettant de situer le reste, mais peine perdue… Je suis tombé dessus comme une épiphanie, au bout du marché Biron, que j’avais arpenté par pure conscience profeslionelle. Voici donc de quoi comparer. Après tout, un immeuble qui a l’insigne honneur d’apparaître une seconde dans un film de Louis Malle, ça vaut bien la Sainte-Chapelle ! Ironie du sort, mon lycée actuel étant situé dans cette ville, le lendemain, je me retrouve confronté devant la C.P.E. à une élève qui m’a manqué de respect. Celle-là s’inquiète des retards fréquents de l’élève, et lui demande où elle habite pour avoir tant de retards. Réponse : « Avenue Michelet » ! Rétrospectivement je l’ai échappé belle : qu’un de mes élèves m’ait seulement surpris pointant mon objectif vers son appartement, avec le regard animé de la concupiscence zazique qui ne me quitta point pendant mes déambulations ! J’étais bon pour la Santé !


Pigalle. J’ai photographié la fameuse fontaine de la place Pigalle, en retrouvant le cadrage parodique de la veuve et du flic imitant La Dolce Vita, le tout en bâille-naïte, queneau ferait-on pas pour vous ? L’hôtel en arrière-plan a changé de nom, c’est désormais la « Villa Royale ». La fontaine était vide, à cause de l’hiver, mais sinon jussu les pieds dans l’eau ! J’étais content de ma photo, mais voilà-ti pas qu’Agnès, avec l’innocence sardonique qui caractérise le sexe faible, insinue qu’il pourrait s’agir d’un trucage, et me demande, que dis-je, m’ordonne d’y retourner, et de mesurer le monument ! Naïvement, j’y remets donc les pieds, et me place dessous la vasque, bras tendus. Manque 60 centimètres. C’est alors qu’un flash m’illumine. Un touriste japonais qui m’immortalise dans cette pose grotesque ! Ou plutôt un barbouze de chez Fior envoyé par Agnès ! (sur Lettres volées, c’est ici, avec l’extrait de La Dolce Vita).

Pour le Moulin Rouge, voilà encore un exemple de monument Queneau soit qui Malle y montre (pardon !). Malle ne nous le montre pas plus que la Sainte-Chapelle ou les colonnes Bastille ou Vendôme, mais il fait mieux, il filme son reflet dans le capot d’une voiture, sur laquelle s’endort et rêve Zazie (photogramme 666e ci-dessous). Histoire de nous rappeler que l’art n’est pas la réalité mais son reflet ? On reconnaît par contre bien le plan 650b, avec le bar « Le Palmier » qui existe toujours, plan pris depuis l’entrée du Moulin Rouge. Agnès retrouve des photos d’époque, et après bien des courses de votre serviteur totalement inutiles autour de la Place de Clichy, nous permet d’identifier les bars Le Cyrano et La Slavia qu’on distingue sur le plan 635 comme l’actuel étroit bureau de change et le Quick jouxtant à droite le Moulin Rouge, dont l’entrée, si l’on en croit le plan 635b, était alors bleue et non rouge. Agnès Vinas a identifié cet ancien Cyrano comme le quartier général des surréalistes. En revanche, je n’ai pas réussi à identifier la devanture énorme d’un magasin (?) « SOOLS », à côté d’une entrée de métro située devant une façade avec quatre arcades, au plan 637… Avis aux zazipathes ! Dans Adorable Menteuse de Michel Deville, filmé en noir & blanc en 1961 et sorti en 1962, on trouve (vers les deux tiers du film) une scène analogue à Pigalle, faite de montages de plans rapides, dont un plan sur le fameux bar Cyrano, alors que Juliette (Marina Vlady) suit son voisin dont elle a cru surprendre de coupables activités (un peu façon Zazie / Pedro Surplus). Le tout sur une musique jazzy. Hommage ou plagiat ?
Autres lieux Envoyé spécial par Agnès et Marie-Françoise aux quatre coins de la capitale, j’ai photographié également quelques lieux cachés de Paris dans le roman de Queneau, qu’on ne retrouve pas dans le film. La Sainte-Chapelle (cf. infra), la caserne de Reuilly (chef d’œuvre de l’architecture où Queneau fut affecté pour son service militaire, le 16 novembre 1925 (Œuvres complètes I, Édition de la Pléiade, p. LI)), le musée-gare d’Orsay, le Panthéon, la Madeleine, la gare d’Austerlitz, le Tribunal de Commerce, ainsi que le bar le Gymnase que l’on distingue dans l’entrevue de Philippe Colin dans le bonus du DVD. Plus de fausses pistes dues aux indications des premiers repérages évoqués par ledit Colin (par exemple la Rue Colombe, le passage du Caire, etc). Plus le cabaret « La Nouvelle Ève » (cf. supra), nommé dans le film, mais non dans le roman (un cas unique ?). Enfin, je me dois de signaler que le jour même où je mettais provisoirement fin à cet article à rallonge, devenu complètement zazin à force de zazifier, j’avais zappé que j’avais zinvité un zami à déjeuner ! Disons que je ne lui avais pas confirmé mon invitation, puisque c’était d’accord ! Ledit ami se pointe, je dégote une boîte de sardines et une des bouteilles de vodka qui attendent son passage dans mon freezer. Or il s’agissait d’un ami Biélorusse, amateur d’apéro (vodka) et de pousse-café (vodka) comme il se doigt (de vodka). Il m’a d’ailleurs raconté qu’à son arrivée en immigré sans le sou à Pantruche, il visita gratos la tour Eiffel en escaladant un pilier jusqu’à l’escalier ! Je ne sais pas vous, mais moi, la vie m’a appris qu’il est deux types d’êtres dont il faut se méfier. Premièrement le Biélorusse, spécialement alcoolique et vexé qu’on l’oublie (on sait cexé !). Deuxièmement la webmistress de site de lettres, spécialement euphorique, qui joue les pédagogues innocentes et vous enjôle avec ses courriels mielleux qui vous font oublier tout devoir, veau, vache, cochon, couvée, et jusqu’à vos amis pendant un mois ! Bref, au moment du dessert (gâteau sec arrosé de vodka), l’ami, à qui pour meubler la conversation je montrais les quelques photogrammes restant à identifier, s’exclame devant le n° 532 (voir supra) que je prenais pour une rue de banlieue, qu’il connaît cet endroit, il en donnerait sa vodka à couper, c’est entre la prison de la Santé et l’hôpital Sainte-Anne. Sûr ? Dis-je d’une voix dubitative. Sûr ! fait-il d’un ton biélorusse (le genre de ton qu’admet pas de réplique). Alors que je m’étais juré que mon ascension de la tour Eiffel paraphait d’un Z final ce périple zazique, me voilà donc enfourchant à nouveau un Vélib et caracolant le long des hauts murs de la Santé puis de Sainte-Anne. Il y a bien quelque chose de ça, certes, mais pour ce photogramme, de hauts murs des deux côtés de la rue, ça ne se trouve pas sous le pas d’un cheval à Paris ! Je m’approche alors du portail de l’hôpital, me demandant si par hasard ces murs ne se trouveraient pas cachés à l’intérieur. Je m’apprêtais à entrer, quand soudain un flash m’illumine. Un touriste japonais ! Ou plutôt un barbouze de Kiev ! Un permanent stipendié ! Au secours ! À la collusion catalano-biélorusse ! Alors je fuis à toute jambe, hurlant dans les rues de Paris que je ne suis pas fou, ze suis zuste un zeste zazique !
Camérateur / Camérataire
Plus j’arpente Paris dans le sillage de cette caméra, plus je pense que ce film est étrangement habité. Il y a un œil derrière cette caméra, comme dans Shining de Stanley Kubrick (scène du labyrinthe, par exemple, qui donne l’impression que c’est la maison elle-même qui filme). On pourrait aussi réfléchir sur les scènes des Dents de la mer de Steven Spielberg (1975), où la caméra subjective est censée adopter le point de vue du requin blanc qui attaque, mais oblige le spectateur à se positionner par rapport au monstre qui convoite une nageuse ou un nageur, ou au réalisateur, qui choisit ou non de montrer l’horreur. L’homme est-il un requin pour l’homme ? On pense à la scène où Zazie pour la seconde fois se heurte aux grilles du métro, cul de sac du labyrinthe parisien. Elle est filmée depuis l’intérieur de l’ancien pavillon Guimard de la station Bastille, démoli en 1962, comme si une instance mystérieuse la regardait agir, sorte d’œil de Paris. C’est la transposition filmique du narrateur omniscient, mais avec un plus, car la caméra n’est pas placée en hauteur, mais dans un endroit inaccessible, permettant un point de vue non pas tant omniscient que disons « ésotérique », en jouant sur l’étymologie de ce mot : « de l’intérieur », caché aux non-initiés. Le néologisme « camérateur » me vient sous la plume, qui désignerait le narrateur d’un film, non pas au point de vue diégétique mais au point de vue iconographique, de même que dans le domaine de la BD Philippe Marion a créé « graphiateur » (voir dans cet article) [14]. De nombreux plans du film me font penser que par-delà l’épaule de Queneau, Louis Malle et sa camera nous adressent un clin d’œil par ce « camérateur ». Je n’ai pas identifié de « camérataire », comme il y en a dans des films où la mise en abyme est exploitée, par exemple La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, ou dans la belle scène au cinéma du roman La Civilisation, ma Mère !…, de Driss Chraïbi. Il faudrait aussi que je revoie le film fondateur de la notion, le bien nommé L’Opérateur (The Cameraman) de Buster Keaton, où justement le personnage est un camérateur dépourvu de toute diégèse, et ses camérataires imprévus en font un héros.

Si l’on reprend ce que je disais plus tôt de la vision de la rue Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, cette vision depuis une grue, qui prend de la hauteur par rapport à la vision d’un bipède quelconque, n’est-elle pas à mettre au crédit du « camérateur » ? Et dès le générique, le fait de placer la caméra dans la cabine du conducteur du train au lieu d’adopter le point de vue interne d’un personnage, donne une impression étrange que le train raconte l’histoire, choisit lui-même tel ou tel aiguillage. Il ne s’agit pas de caméra subjective, car on ne voit pas le chauffeur, et il n’en est jamais question. Suggérons un point de comparaison avec Les Raisins de la Colère de John Ford (1940), d’après le roman éponyme de Steinbeck : le plan séquence de l’entrée de la famille Joad dans le premier campement à leur arrivée en Californie. Le campement est comme vu par leur camion, dont le ronronnement du moteur couvre tout autre bruit. Cela accentue la déshumanisation des migrants. Enfin, lors de la bataille à la choucroute, lorsque le caméraman se fait bousculer par les bagarreurs, on a une mise en abyme de ce camérateur consécutive à la mise en abyme du film dans le film, représentant les chemises noires, derrière Aroun Arachide. Dans le chaos filmé, on discerne nettement cependant l’un des militaires prendre le « camérateur » et le supporter à bout de bras (plan 871). Est-il tiré par les cheveux de supposer que c’est ce cadreur-là qui aurait filmé les chemises noires, et servirait la propagande militaire ? Vu la violence de cette séquence, si Malle avait voulu montrer le militaire tuant le camérateur, il ne se serait pas gêné. Bien avant la lettre, ne serait-ce pas une mise en évidence de l’ambiguïté de l’« embedded journalist », de sa complicité à l’égard du régime qu’il magnifie en le filmant ? Fasciste, la caméra à l’épaule de la nouvelle vague qui prétend à l’objectivité et voudrait nous dire kouavouar ? On remarque aussi un cheveu sur ce photogramme. Hasard ou volonté ? Cheveu, mon cul ! Choucroute ! rétorque Agnès du tac au tac (de Charles !), avec la moue marilynmonroienne qui la caractérise : ils ont balancé de la choucroute sur la caméra !
Dans le scénario original, le film commençait par une scène à laquelle Malle a renoncé, qui me semble confirmer cette idée de « camérateur » et de « camérataire » : « La caméra avance lentement dans l’immense salle baroque, apparemment vide. Elle va au pas d’un homme, tourne la tête, baisse et relève les yeux, se regarde un instant dans une glace… [Une voix off se fait entendre] La caméra, entendant cette voix, s’est arrêtée net. Elle panoramique brusquement et vient cadrer, en très gros plan, un couple qui s’embrasse furieusement et sur la bouche. […] La dame, face à la caméra, ouvre soudain les yeux et remarque cette présence indiscrète. Elle interrompt son monsieur, lui tape sur l’épaule et lui désigne la caméra. Il se tourne, regarde dans l’objectif ; et, comme s’ils étaient pris en flagrant délit par un tiers, ils se séparent » (p. 10). Là aussi, il ne s’agit pas de caméra subjective, car la caméra ne représente pas d’autre sujet qu’elle-même. On comprend alors mieux la scène finale, également dans une brasserie, où ce camérateur indiscret se fait chahuter ! Pour la scène de la gare de l’Est à l’ouverture du film après le générique, le scénario indique : « Gabriel, donc, remonte la file lentement, en reniflant, avec de temps à autre un regard vers la caméra comme pour la prendre à témoin » (p. 10). Pendant le repas de moules, au plan 193 (24’43), un cadreur filme brièvement une scène derrière Zazie. On relève aussi dans le scénario plusieurs scènes, soit non tournées, soit supprimées au montage ; il serait fort intéressant d’avoir ces chutes dans le bonus. L’une d’elles est signalée p. 29 du scénario, lors de la course-poursuite : « Zazie court. Elle passe devant le caméraman en train de la filmer. Elle lui « pique » la caméra au passage. Il se redresse, sort un papier et au crayon, griffonne hâtivement. Quelques secondes de dessin animé : on y voit le crayon du caméraman dessiner une Zazie qui ramène docilement la caméra à son utilisateur. Celui-ci se remet aussitôt en action. Le film repart. » Autre plan non retenu, p. 34 : « Zazie au milieu de la rue ; elle est installée dans le fauteuil de l’ingénieur du son, casque d’écoute sur les oreilles ; elle manipule les boutons avec dextérité ». Page 41 en note : « Tout à fait en haut, cette fois, c’est-à-dire dans l’antenne, un touriste bostonien est juché, une caméra à la main. Le touriste filme le panorama, comme font les amateurs, c’est-à-dire avec un luxe inouï de panoramique […] Avancée du Pan-Cinor sur la caméra du touriste et « notre » caméra se substitue à celle-ci. C’est un plan vertigineux, qui fait mal aux yeux. Nuages, bouts de ciel, morceaux de Paris, fragments de tour Eiffel, tout cela se succède en un vaste panoramique incohérent ». Dernier plan non tourné signalé par le scénario, p. 56 : à la fin de la scène de drague entre Trouscaillon et Zazie qu’il prend pour Albertine, il s’écrie, conformément au texte quenien (p. 165), « À poil ! À poil ! À poil ! » (ignorant qu’il rendait hommage, 50 ans en avance, aux éditions du même nom !). « Ses mains rencontrent et caressent la caméra », prévoyait le scénario. Et puis, vous y trouverez peut-être un dernier accès de délirium zazique, mais dans la scène du repas chez Gabriel, avec ces plans iconoclastes (panoramique impossible avec Zazie à gauche et à droite de la table, post-synchro sur Gabriel qui cause tout en se gavant d’asperges…) je ne peux m’empêcher de voir dans le rocking-chair qui branle mystérieusement, la place vide du camérateur qui s’invite dans ce qu’il filme… Voir dans Le Guépard de Visconti, une analyse similaire du « camérateur ».
La Sainte-Chapelle enfin dévoilée
Et maintenant, un petit cadeau ekseucluzazif rien que pour les lecteurs fidèles parvenus au bout de cet article. Cette fameuse Sainte-Chapelle dont à laquelle que vous voudasseriez bien susser à kouakelle ressemble, eh bien j’ai fini par la débusquer comme dirait Brassens, dans un coin pourri du pauvre Paris… Je dédie – en vidant un gobelet de grenadet et de muscadine – cette photo à Agnès Vinet, à Marie-Françoise Leudas, à monsieur Pascal Berger, qui l’a bien mérité itou, ainsi qu’à tous les fous zaziques de France, de Cathare [15] et de Biélorussie ! Vous allez enfin savoir cexé que la vérité vraie sur la Sainte-Chapelle !
– Sur le site du forum des images, voir un article de Franck Garbarz sur le Paris de Louis Malle. Une entrevue avec Olivier Gérard sur Devil Dead, à propos du tournage du film.
– Voir l’outrage qu’ont fait subir à notre Zazie les boloss des belles lettres. Voir une carte oulipienne délirante du métro de Paris sur ce site. La station Porte de la Chapelle (à côté de chez moi) devient, je cite : « Le pédé phallocrate » ! Je ne me sens pas du tout visé ! Qui c’est qu’a dit que les « personnes du deuxième sexe » (p. 61) ou plutôt les « entrelardées » sont toutes « perfides ou sournoises » (p. 12), hein, qui ? Qui qu’a traité une innocente petite fille de « petite salope » (p. 27) ou « petite connasse » (p. 48) ? Non mais !
– On peut, à l’opposé du cas Zazie, constater les ravages d’une adaptation calamiteuse d’un roman en lisant notre article sur L’Homme qui rit, de Victor Hugo.
– Lire un article sur « La relation avunculaire en littérature et au cinéma », qui inclut un paragraphe sur notre Zazie et son tonton.
– Retour au dossier lourd de nos éruzazites Agnès Vinas et Marie-Françoise Leudet.
– Retour au début de cet article.
Voir en ligne : Zazie sur « Lettres volées »
© altersexualite.com 2007-2013
Photos © L. Labosse. Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Pour comprendre certaines allusions, il est recommandé de lire le livre et de voir le film ; le « néo-français » quenien est contagieux !
[2] Explication reprise et développée dans cette étude de Lettres volées.
[3] « À l’exemple d’icelluy vous convient estre saiges, pour fleurer, sentir et estimer ces beaulx livres de haulte gresse, legiers au prochaz et hardiz à la rencontre ; puis, par curieuse leçon et meditation frequente, rompre l’os et sugcer la sustantificque mouelle » (prologue de Gargantua).
[4] Laurent Nunez s’est intéressé à cet incipit dans un article du Magazine Littéraire n° 523, septembre 2012. Il évoque le précédent du « Keksekça » de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo, au chapitre IV, VI, 2 (et au chapitre IV, XI, 4).
[5] Le découpage par plans est l’œuvre – herculéenne – d’Agnès Vinas, je l’utiliserai dans cet article.
[6] Pour approfondir la question, voir un article de Guillaume ROUSSEAU : « Zazie dans le métro ou l’échangeur sexué ».
[7] Patrick Cognasson, historien spécialiste du chemin de fer et de l’histoire de Paris, nous fournit en septembre 2013 la réponse suivante : Pour ma part, il me paraît douteux que ce panneau « Nicolas » fût à cet endroit. Je pense plutôt qu’il était placé dans l’une des salles en entresol ou au premier sous-sol en communication avec le métropolitain. À l’entresol, se trouvaient les bureaux de la gare, le service de renseignements, l’agence de la Compagnie des wagons-lits et un bureau pour les opérations postales et télégraphiques. D’autres activités commerciales aux vitrines bigarrées et fleuries étaient installées au premier sous-sol : coiffeur pour dames, disques et phonographes, chemiserie, alimentation, chaussures, affûteur de lames… C’est dans ces espaces que l’on pouvait voir quelques panneaux concernant la « réclame ».
[8] Allusion à l’adaptation des Liaisons dangereuses par Roger Vadim sous le titre Les Liaisons dangereuses 1960, suite à un procès intenté par la SDGL.
[9] Rédigé par Louis Malle et Jean-Paul Rappeneau, publié dans L’Avant-Scène Cinéma n° 104, juin 1970, auquel je me référerai toujours dans cet article.
[10] Y a-t-il un rapport avec le panneau « 23 minutes plus tard… », qui précède la séquence de la discussion Pédro-Gridoux ? Cet aspect oulipien du film a été peu étudié (l’Oulipo était en gestation pendant le tournage du film).
[11] Patrick Cognasson (cf. ci-dessus) nous fournit une précision sur ce point : En 1930, la gare a été dédoublée. On a simplement ajouté les 10 voies que vous connaissez (on est passé de 20 à 30 voies). Le quai 23 n’a pas été raccourci ; il est identique en 1960 à ce qu’il était en 1930, et n’a pas bougé jusqu’à aujourd’hui.
[12] Selon nos informations exclusives, l’O.M.S. s’apprêterait à déclarer le 1er avril 2013 la ferrovipathie et la zazite aiguë fléaux sociaux mondiaux, avec un plan d’éradication.
[13] Lors des journées du patrimoine 2013, j’ai aussi pu visiter le passage Choiseul rénové. J’y ai appris qu’une vaste opération de réhabilitation est en cours, visant à l’inscription de l’ensemble des passages parisiens au patrimoine mondial de l’Unesco. La Galerie Vivienne et sa mosaïque en seront sans doute le fleuron. Le philosophe Walter Benjamin a consacré un ouvrage posthume aux passages parisiens. Lire cet article.
[14] Vous allez me dire, pourquoi pas tout simplement « réalisateur » / « réalisataire » ? Eh bien pour la même raison que l’auteur n’est pas le narrateur. Le réalisateur est la personne physique qui signe le film ; le camérateur est une construction signifiante du réalisateur, susceptible d’adopter un point de vue décalé par rapport à celui du réalisateur.
[15] C’est tiré par la choucroute, mais Agnès Vinas vient de consacrer, avec Robert Vinas un beau livre à l’histoire de La Compagnie catalane en Orient (T.D.O. Éditions, 2012, 240 p., 42 €). Cathare, Catalane, c’est un peu comme Sainte-Chapelle et Vincent-de-Paul, non ?
 altersexualite.com
altersexualite.com










