Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Corydon, d’André Gide
Le premier essai sur l’homosexualité masculine, pour lycéens et adultes
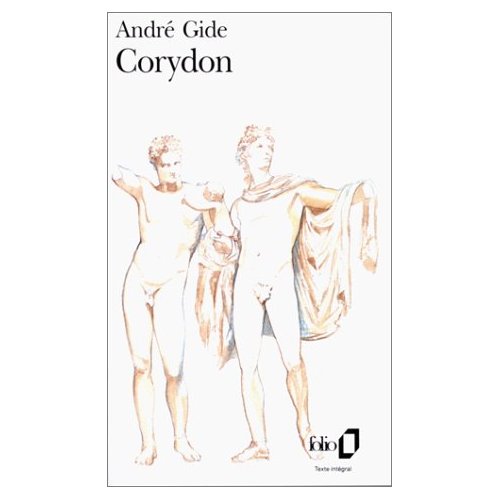 Corydon, d’André Gide
Corydon, d’André Gide
Folio, 1924, 160 p., 5,7 €
dimanche 1er juillet 2012
Malgré la haine qu’il lui valut de la part de certains de ses contemporains, ce livre courageux n’empêcha pas son auteur d’obtenir le prix Nobel des années plus tard. Livre d’intellectuel amoureusement fourbi et peaufiné pendant 13 ans, Corydon n’a guère perdu de son intérêt malgré certains commentaires amusés et faciles sur la partie consacrée aux sciences naturelles. Certains arguments sont toujours d’actualité tellement certains esprits sont restés obtus ; d’autres font pourtant sourire. Le fait que le livre envisage exclusivement l’homosexualité masculine et qu’il semble rejeter ou mépriser les femmes d’une part, les « invertis » d’autre part, n’est pas son meilleur atout, mais il est des réflexions sur la rigueur scientifique qui rachètent ces approximations. Il convient de considérer Corydon (1924) comme le premier acte d’une trilogie de la pédérastie constituée du roman Les Faux-Monnayeurs (1925) assorti de son journal, ainsi que du récit autobiographique Si le grain ne meurt (1926). En plus de l’édition Folio j’ai utilisé l’édition de la Pléiade, Romans et récits II, sous la direction de Pierre Masson, 2009, notamment la notice d’Alain Goulet. Cet article a été relu et corrigé en 2016, à l’occasion de l’inscription des Faux-Monnayeurs au programme de terminale L en 2016-2017.
Plan de l’article
Genèse & importance de l’œuvre
Reniements
Modernité
Le détour par les sciences naturelles
Discours de la méthode : le gay savoir
Autres aspects
En marge de « Corydon »
Genèse & importance de l’œuvre
À la fin de sa vie, selon son journal (janvier 1946) cité par Alain Goulet, Gide considérait « ce livre comme le plus important et le plus serviceable » […] « je veux dire : de plus grande utilité, de plus grand service pour le progrès de l’humanité ». Il émettait cependant des réserves sur la forme. Puis le même Alain Goulet associe cette trilogie de la pédérastie : « Sans doute est-ce aussi celui qu’il a le plus longuement mûri, car cette œuvre polarise toute une partie des autres selon un réseau souterrain qui aboutit à son apparition publique en 1924, au terme d’une lente préparation associée à Si le grain ne meurt et aux Faux-Monnayeurs, qui forment avec elle le manifeste gidien de l’homosexualité, plus exactement de la pédérastie, considérée comme objet d’un traité argumenté, d’une histoire personnelle, et comme élément crucial d’une fiction romanesque ». À l’origine du projet de Corydon figure le suicide de son ami Émile Ambresin « lié à un aveu de penchants homosexuels réprouvés, et il est probable que, de là, datent […] une mutation de son regard sur ses propres penchants et une volonté de réparer sa faute en publiant, un jour, une défense et illustration de l’homosexualité » À son retour d’Afrique du Nord en 1894, son ami Rouart lui fait lire un essai d’Albert Moll paru en 1893, Les Perversions de l’instinct génital. Étude sur l’inversion sexuelle basée sur des documents officiels, préfacé par Richard von Krafft-Ebing. Gide est déçu et annonce « J’écrirais quelque chose de rudement mieux » […] « il me semble qu’il ne différencie pas assez ces deux classes : les efféminés et les « autres » : il les mélange incessamment et rien n’est plus différent, plus contraire — car l’un est l’opposé de l’autre ; car pour cette psychophysiologie, ce qui n’attire pas repousse, et l’une de ces deux classes fait horreur à l’autre » […] « Je ne suis pas du tout misérable. Je me sens au contraire, sans cesse, plus joyeux que les autres hommes, et j’ai la prétention malgré tout d’avoir une vie en laquelle, plus tard, en m’y penchant pour m’y voir, je puisse me trouver beau. […] Je ne veux pas avoir honte. Mais je le sens à présent, cher ami, il va nous falloir de bien robustes épaules, et des convictions, car, tu le sais : je ne veux pas d’hypocrisie ; elle est un suicide — et montre que nous ignorons notre valeur » (Correspondance Gide-Rouart, sept. 1894). À partir de 1898 toujours selon A. Goulet, « Henri Ghéon devient son complice […] en matière d’aventures pédérastiques, partageant partenaires et expériences – valets de ferme, rencontres des rues, des piscines et bains publics —, échangeant des confidences, parfois très crues » (p. 1168). Il n’est pas le seul d’ailleurs, puisque Eugène Rouart jouera également ce rôle dans Le Ramier. « Ce contre quoi j’ai le plus de mal à lutter, c’est la curiosité sensuelle. Le verre d’absinthe de l’ivrogne n’est pas plus attrayant que, pour moi, certains visages de rencontre – et j’abandonnerais tout pour les suivre... Que dis-je ? Il y a là une propulsion si impérieuse, un conseil si insidieux, si secret, une habitude si invétérée, que souvent je doute si j’en puis échapper sans un secours venu d’ailleurs. » (Journal, 19 janvier 1916, cité p. 1168). On songe à la tirade de l’inconstance de Dom Juan : « Quoi qu’il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d’aimable ; et dès qu’un beau visage me le demande, si j’en avais dix mille, je les donnerais tous. » À l’époque, Gide scinde amour et désir ; mais fin 1904, voilà que de conserve avec Ghéon, il tombe pour la première fois amoureux d’un garçon, en l’occurrence Maurice Schlumberger, première expérience de la posture socratique annoncée dans Corydon. Stimulé par l’expérience consignée dans Le Ramier (publié en 2002), Gide se met à l’œuvre en 1907 et 1908. Vingt exemplaires sont imprimés en 1911, qui restent dans un tiroir. Suite aux critiques de Paul-Albert Laurens, il envisage un plan plus sérieux (Journal, 14 janvier 1912), dans lequel il dialoguerait de façon posthume avec son père Paul Gide, à partir d’une phrase relevée dans un livre publié en 1867 : Étude sur la condition privée de la femme dans le droit ancien et moderne : « un amour sans nom, ou plutôt un vice infâme, était honoré dans toute la Grèce comme une vertu. » […] « un sujet si odieux » […] « plus honteux des vices » [1]. Cela révèle le non dit de l’interdit de la bibliothèque paternelle évoqué au chapitre 7 de Si le grain ne meurt. Dans les feuillets de son Journal en novembre 1918, Gide établit une taxinomie pour résumer sa position : « J’appelle pédéraste celui qui, comme le mot l’indique, s’éprend des jeunes garçons. J’appelle sodomite [...] celui dont le désir s’adresse aux hommes faits. J’appelle inverti celui qui, dans la comédie de l’amour, assume le rôle d’une femme et désire être possédé. Ces trois sortes d’homosexuels ne sont point toujours nettement tranchées ; il y a des glissements possibles de l’une à l’autre ; mais le plus souvent, la différence entre eux est telle qu’ils éprouvent un profond dégoût les uns pour les autres ; dégoût accompagné d’une réprobation qui ne le cède parfois en rien à celle que vous (hétérosexuels) manifestez âprement pour les trois. Les pédérastes, dont je suis (pourquoi ne puis-je dire cela tout simplement, sans qu’aussitôt vous prétendiez voir, dans mon aveu, forfanterie ?) sont beaucoup plus rares, les sodomites beaucoup plus nombreux, que je ne pouvais croire d’abord ». 21 exemplaires anonymes de Corydon nouvelle mouture sont imprimés en Belgique en mars 1920, et Si le grain ne meurt est imprimé en mai. Gide écrit à son ami Dorothy Bussy que l’un de ces deux livres « est de nature à me faire mettre en prison » (Gide-Bussy, 31 janvier 1920). Le 14 mai 1921 Gide rencontre Proust, qui l’encourage à tout raconter pour ses mémoires « à condition de ne jamais dire : je ». Il est dépité de s’être fait brûler la politesse par la parution de Sodome et Gomorrhe en 1921 et 1921 : « la question va être mal posée dans l’esprit du public ». En parallèle il découvre Freud en 1920-1921, est enthousiaste, veut une préface de Freud à une édition allemande de Corydon, est mis au courant de l’évolution favorable à Berlin sous l’égide de Magnus Hirschfeld qu’il rencontrera lors de séjours à Berlin en 1928 et 1932. Martin du Gard note : « De longue date, ayant prévu la possibilité d’un scandale public, d’un procès en police correctionnelle, il s’est considéré comme une victime expiatoire prédestinée, l’homme qui doit payer de son repos, de son bonheur, le progrès de l’humanité, l’élargissement des idées vers une plus grande liberté de vie sexuelle : le Christ de l’homosexualité, le rédempteur » (Journal, 14 mars 1922). Dans une lettre à Bussy du 26 déc. 1923, Gide ironise sur son risque : « je me compare à cette caricature d’Abel Faivre qui montre un homme couché en travers de la voie, la tête sur le rail, attendant le train qui va la lui trancher : il tire sa montre et dit « Sapristi ! ce que le rapide a du retard ! » L’édition Gallimard est imprimée en janvier 1924, mais mise en vente seulement en mai ou juin, le plus discrètement possible : « Non seulement je n’ai fait aucun envoi : mais même les libraires ne recevront le livre que sur demande ; de sorte que la divulgation ne se pourra faire qu’assez lentement » (lettre à Bussy, 25 juin 1924). La réception est donc limitée à quelques lettres, et à un pamphlet précipité publié en juillet 1924, L’Anti-Corydon, d’un Dr François Nazier. Gide craint toujours des réactions sévères qui n’arrivent pas, notamment des Dadas (Breton et Soupault). Les critiques littéraires sont plutôt positives, les critiques médicales hostiles, sans surprise. Les Cahiers de la petite dame (de Maria van Rysselberghe, mère d’Élisabeth qui donna une fille à Gide) résument la situation : « Je crois aussi que ceux qui partagent ses mœurs trouvent son cas trop personnel, trop particulier, et se refusent à voir dans Corydon une défense assez générale de leur cause. Quoi qu’il en soit, j’ai le sentiment que Gide a été volé du pathétique qu’il escomptait et auquel il avait préparé son âme ». Eugène Montfort publie dans sa revue Les Marges en 1926 une enquête sur « l’homosexualité en littérature ». Les réponses sont plutôt homophobes ; Jean de Gourmont s’acharne contre Gide et son Corydon. Paraît en 1927 l’essai de François Porché L’Amour qui n’ose pas dire son nom, dont la correspondance avec Gide figure en appendice de Corydon. Citons enfin la lettre de 1934 à Ramon Fernandez par laquelle se termine la notice d’Alain Goulet : « La non-conformité sexuelle est, pour mon œuvre, la clé première, mais je vous sais gré tout particulièrement d’indiquer déjà, par quel glissement, par quelle invitation, après ce monstre de la chair, premier sphinx sur ma route, et des mieux dévorants, mon esprit, mis en appétit de lutte, passa outre pour s’en prendre à tous les autres sphynx du conformisme, qu’il soupçonna dès lors d’être les frères et cousins du premier ».
Reniements
Tourner sept fois sa langue dans sa bouche, Gide a respecté cet adage : « Je me décide après huit ans d’attente à réimprimer ce petit livre. Il parut en 1911, tiré à douze exemplaires, lesquels furent remisés dans un tiroir » (p. 11). Entre-temps Proust a fait paraître sa Recherche, et Gide lui rend hommage dans une note, tout en regrettant qu’il ait trop mis en lumière « certains cas d’homosexualité, ceux dont précisément je ne m’occupe pas dans ce livre – les cas d’inversion, d’efféminement, de sodomie » (p. 8). Ce reniement, difficile à comprendre en ce qui concerne l’accouplement de « sodomie » avec les deux premiers mots, sera réitéré en ce qui concerne l’inversion et l’efféminement, et l’on souffre de cette sauce de haine de soi que Gide croit nécessaire pour faire passer le saignant de son steak. C’est loin d’être le seul reniement du livre. En effet, le narrateur n’assume pas directement le plaidoyer, mais l’inscrit dans le discours de Corydon, un ami qui « ne protestait point […] contre certains penchants dénaturés dont on l’accuse » (p. 15). Au contraire, le mot « pédéraste » est utilisé en bonne part, et le livre que Corydon entend écrire aurait pour titre « Défense de la pédérastie », sans doute le titre que Gide n’a pas osé (p. 19). Il ose par contre « la cause manque de martyrs » (p. 19). Ce dispositif transparent était sans doute censé permettre l’empathie du lecteur pour Corydon, obligé de supporter les allusions du narrateur : « abominables mœurs » ; « turpitudes » (p. 21), alors qu’il exprime difficilement la tentation du suicide (et même le suicide d’un jeune homme qu’il rebuta jadis) et préfère parler de « [s]on anomalie » (p. 22). La fin du livre est l’occasion d’aller plus loin dans le rejet des « invertis » : « Je leur tiens à grief ceci, que les gens mal renseignés confondent les homosexuels normaux avec eux. », et de renchérir par les mots « dégénérés », « maniaques », « malades » (p. 123). Gide ne craint pas non plus, au détour d’une phrase, d’adopter les préjugés de son temps pour mieux défendre sa thèse : « je connais certains enfants trop adonnés à des coutumes solitaires, pour qui j’estime que cette sorte d’attachement serait le plus sûr moyen de guérir » (p. 127) !
Modernité
« l’homosexualité, tout comme l’hétérosexualité, comporte tous les degrés, toutes les nuances : du platonisme à la salacité, de l’abnégation au sadisme, de la santé joyeuse à la morosité, de la simple expansion à tous les raffinements du vice. L’inversion n’en est qu’une annexe. De plus tous les intermédiaires existent entre l’exclusive homosexualité et l’hétérosexualité exclusive. Mais d’ordinaire, il s’agit bonnement d’opposer à l’amour normal un amour réputé contre nature – et, pour plus de commodité, on met toute la joie, toute la passion noble ou tragique, toute la beauté du geste et de l’esprit d’un côté ; de l’autre, je ne sais quel rebut fangeux de l’amour » (p. 29). C’est sans doute pour écrire ce genre de phrase à laquelle il n’y aurait pas grand chose à changer un siècle après, que les reniements sus-mentionnés semblèrent nécessaires. Corydon convoque Pascal pour remplacer « contre nature » par « contre coutume » (p. 37), et avancer un autre argument devenu incontournable dans l’actuel plaidoyer pro d’homo (pardon !) : « dans notre société, dans nos mœurs, tout prédestine un sexe à l’autre ; tout enseigne l’hétérosexualité, tout y invite, tout y provoque, théâtre, livre, journal, exemple affiché des aînés, parade des salons, de la rue. » (p. 38 ; repris p. 100). Le nom « Corydon » est emprunté aux Bucoliques de Virgile, qui l’avait lui-même emprunté à Théocrite. C’est surtout le genre dialogué que Gide imite de Virgile, mais aussi le goût de Corydon pour les garçons, en l’occurrence un « Alexis » qui le dédaigne, ce qui inspire au narrateur de Virgile ce sage conseil : « Ah ! Corydon, Corydon, quelle démence t’a saisi ? […] Si celui-ci te dédaigne, tu trouveras un autre Alexis » (2e églogue).
Le détour par les sciences naturelles
Ce passage important qui, dès la parution, fut reproché à Gide, est beaucoup moins « cucul » que ne le laissent entendre des intellectuels comme Jean-Louis Bory. Gide a semble-t-il passé des années à colliger tous les ouvrages de sciences naturelles qui lui passaient sous le nez, a cherché la petite bête, et a retourné certaines théories comme des tortues pour les voir remuer leurs pattes impuissantes sous la pesanteur de leur carapace morale. L’usage des notes de bas de page est impressionnant, et chaque affirmation est assortie d’une référence précise accompagnée du foliotage permettant de la retrouver. Combien de prétendus « auteurs » d’aujourd’hui, plutôt que d’ironiser sur les idées forcément datées de Gide, devraient s’inspirer de sa rigueur au lieu de parler en l’air ! Ainsi, reprend-il entre autres les idées de Charles Darwin, non seulement celles de son chef-d’œuvre, mais en plus celles de sa thèse sur les cirripèdes (p. 49) ! Il affirme : « Ce n’est pas la fécondation que cherche l’animal, c’est simplement la volupté. Il cherche la volupté – et trouve la fécondation par raccroc » (p. 45). Cela préfigure, dans Les Faux-Monnayeurs, le goût de Vincent Molinier pour les sciences naturelles, qui lui permettent des allusions à l’homme (Livre 1er, ch. 17).
Discours de la méthode : le gay savoir
Gide a le génie d’extrapoler du cas clinique de l’homosexualité à un discours de la méthode à sa sauce, et de renvoyer dans les cordes les scientifiques : « [il] peut accepter d’être mis à l’index, honni par les lois humaines, les coutumes de son temps et de son pays ; mais point de vivre en marge de la nature ; par définition cela ne se peut point ; s’il y a des marges ici, c’est que l’on a posé le cadre trop tôt » (p. 46). Et encore : « À vrai dire je me méfie de cette « voix de la nature ». Chasser Dieu de la création et le remplacer par des voix, la belle avance ! Cette éloquente Nature m’a tout l’air d’être celle qui avait « horreur du vide ». Cette sorte de mysticisme scientifique me paraît bien autrement néfaste à la science que la religion… N’importe ! Prenons le mot « voix » dans son sens le plus métaphorique, encore nierai-je que cette voix dise au mâle : féconde, qu’elle dise à la femelle : choisis. Elle dit, à l’un comme à l’autre sexe : « jouis », simplement ; c’est la voix de la glande qui demande qu’on l’exonère, des organes qui réclament emploi – organes qui sont bien conformés selon ce que leur précise fonction exige, mais que le seul besoin de volupté guidera, rien de plus. » (p. 55). Rien à ajouter ! Après Pascal, c’est Rabelais qui est appelé à la barre, pour une plaisanterie de Panurge, au chapitre XXII de Pantagruel, qui d’ailleurs n’est pas cité, par convenance sans doute, remplacé par des points. Voici un extrait dudit chapitre : « Panurge n’eut achevé ce mot, que tous les chiens qui estoient en l’eglise acoururent à ceste dame pour l’odeur des drogues que il avoit espandu sur elle, petitz & grands, gros & menuz, tous y venoyent tirans le membre & la sentens & pissans par tout sur elle : c’estoit la plus grande villanie du monde. » (Œuvres complètes, La Pléiade, p. 296). Outre la plaisanterie, Gide veut rappeler que ce n’est pas tant la femelle qui fait courir le chien (comprenons l’homme), que la glande, et que l’amour n’intervient pas dans cette panurgie (faudrait-il voir dans cette chiennerie un sens crypté de Panurge ?) Montaigne est cité en note p. 66 pour une phrase anodine de l’Apologie de Raimond Sebond : « On void aussi certains animaux s’adonner à l’amour des masles de leur sexe » (Œuvres complètes, La Pléiade (édition de 1962), p. 451), juste pour souligner que les philosophes qui ont des yeux pour voir sont moins rares que les scientifiques, lesquels ont une fâcheuse tendance à se laisser aveugler par leurs préjugés. Le passage des pp. 67 à 70 serait excellent dans un groupement de textes en classe de première sur le thème « l’homme et la science », avec les textes « Agnus scythicus », de Denis Diderot, etc. (Voir cet article). La pensée de Gide s’égare pourtant parfois sur des voies misogynes : « Et comme nous avons vu ces deux forces, anagénétique et catagénétique, s’opposer, ainsi verrons-nous deux dévouements possibles : celui de la femelle à sa race ; celui du mâle à son art, à son sport, à son chant » (p. 74). Point misogyne, au contraire, sont les considérations, basées sur une phrase du journal de Darwin que nous citâmes jadis dans l’article à lui consacré, sur le fait que « la beauté des jeunes hommes surpasse de beaucoup celle des femmes » (p. 90). Il faut voir là la juste réplique aux propos convenus toujours aussi répandus en notre XXIe siècle, de la bêtise majoritaire chez les mâles, qui croient déchoir de leur mâlitude s’ils reconnaissant quelque beauté que ce soit à un congénère du laid sexe !
Autres aspects
Ce livre est tellement riche, et c’est tellement intéressant de retracer l’univers intellectuel d’un homme qui eut ce rare courage, avant que ce soit la mode, de redresser tant d’opinions tordues, que l’on aimerait retrouver certaines références. Ainsi je tâcherai de voir un tableau peu connu du Titien, dont il est question au ch. III du 3e dialogue : Le Concile de Trente, soi-disant au Louvre, censé représenter dans les coins des seigneurs « en postures peu équivoques ». L’édition de la Pléiade malheureusement ne nous aide pas sur ce point, mais une recherche Internet signale un tableau en fait anonyme. L’envolée finale, très provocatrice pour l’époque, passe par des considérations sur Léon Blum à la limite de l’antisémitisme, à propos de son ouvrage Du mariage, où celui-ci proposait en post-fouriériste, que les jeunes filles destinées au mariage se dévouent pour éliminer la prostitution (p. 109), pour proposer que le même dévouement échoie aux garçons, comme chez les Grecs anciens ! (argument développé p. 126). Le rejet de l’efféminement n’empêche pas quelques remarques justes : « Je ne crois pas qu’il y ait une opinion à la fois plus fausse et plus accréditée que celle qui considère les mœurs homosexuelles et la pédérastie, comme le triste apanage des races efféminées, des peuples en décadence, voire même comme une importation de l’Asie » (p. 119). Soulignons en passant le « voire même », souvent mis à l’index par les puristes… Ces pensées vont de pair avec celles qui montrent que les femmes sont d’autant plus respectées qu’elles sont moins convoitées (quelle belle solution pour éradiquer les violences faites aux femmes !) Terminons par une allusion pré-sartrienne à l’engagement, dans les annexes, notamment un échange de lettres avec François Porché : à propos des « grands lettrés » : « Certes ils ne sont pas tous tenus de parler de l’amour ; mais, s’ils en parlent, ce qui est assez naturel, poètes ou romanciers, devront-ils feindre d’ignorer celui « qui n’ose dire son nom », alors que, si souvent, c’est à peu près le seul qu’ils connaissent ? » (p. 136).
En marge de « Corydon »
L’édition Pléiade présente quelques chutes. Une note intitulée « Chantecler » ironise sur la pièce de Jean Rostand (1910) : « C’est ainsi que l’on voit par extraordinaire une faisane dont le plumage est normalement assez terne, apparaître avec le splendide aspect du faisan. Sous ce revêtement masculin, Chanteclair (sic) aussitôt s’éprend d’elle ». Un extrait de l’édition originale de 1911 révèle que la présentation du personnage de Corydon était plus développée : le narrateur marquait plus franchement sa rupture sociale avec Corydon, et profitait de l’absence de ses amis au moins d’août pour le fréquenter. Il présentait Bazalgette comme son ami. L’origine de cette pestilence sociale se trouve sans doute dans la peur de Gide rencontrant Oscar Wilde à Florence, évoquée dans l’ouvrage de Jean Delay La Jeunesse d’André Gide. La préface de l’édition américaine de 1950, datée de 1949, me semble un texte intéressant à proposer aux élèves de TL, car il boucle la boucle. « j’aurais certainement renoncé au prix Nobel plutôt que de désavouer n’importe lequel de mes écrits. Aucun titre pourtant n’avait été prononcé ; mais lorsque l’interviewer me demanda, sitôt ensuite, quel était celui de mes livres que je considérais comme le plus important, c’est sans hésitation aucune que je nommai Corydon. » […] « l’on m’avait accordé le prix Nobel malgré ce livre ; sans l’ignorer, ce qui devait déjà me suffire ». Gide rappelle que ce livre est sorti le plus discrètement possible en France. Il compte sur cette publication américaine pour le faire connaître, et évoque le Rapport Kinsey, qui vient de paraître et prépare le terrain.
– Un an après cet essai confidentiel, paraît Les Faux-Monnayeurs, « premier roman » d’André Gide qui sonne comme un coming out pédérastique, puis dans la foulée Si le grain ne meurt (1926), récit autobiographique où Gide évoque son homosexualité. Ce triptyque mérite sans doute qu’on s’y attarde un peu plus.
– Lire les excellents articles de Marie-Françoise Leudet sur la pédérastie à propos de Gide.
– Le nom de Corydon est emprunté aux Bucoliques de Virgile, qui l’a lui-même emprunté aux Idylles, de Théocrite.
– Pour se replacer dans le contexte de l’époque, lire un article sur les Recherches sur la sexualité (1928-1932). Archives du surréalisme n°4, où l’on verra que les surréalistes n’étaient pas unanimes à condamner l’homosexualité. On y constatera aussi que le mot « pédérast(i)e » était préféré au mot « homosexuel(le) ». Lire aussi notre article sur Le Ramier, qui permet d’en savoir plus sur la question problématique de l’érotique gidienne. Enfin, lire notre article sur un chef-d’œuvre de Carl Theodor Dreyer : Michaël, film sorti en 1924, l’année de Corydon (d’après un roman danois de 1904), qui nous met dans l’ambiance de ce que pouvait lire et voir un inverti à cette époque. L’histoire très proustienne, est celle d’un peintre riche et célèbre amoureux d’un jeune homme qu’il adopte comme son fils, lequel lui préfère des jeunes femmes, tout en profitant de son compte en banque. Visionner au moins le début pour voir ce peintre regarder avec émotion ses aquarelles d’un voyage en Algérie, leur plus beau souvenir…
– Lire l’article de Jean-Yves sur le blog Culture et débats.
– Un album pour enfants, Et avec Tango, nous voilà trois !, nous semble reprendre les arguments naturalistes de Gide.
Voir en ligne : Les vicissitudes de Corydon par Claude Courouve
© altersexualite.com 2012-2016.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] On reconnaît les arguments de Voltaire dans l’article « AMOUR SOCRATIQUE » de son Dictionnaire philosophique.
 altersexualite.com
altersexualite.com