Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > Maurice, d’Edward Morgan Forster
Roman culte sur l’homosexualité masculine
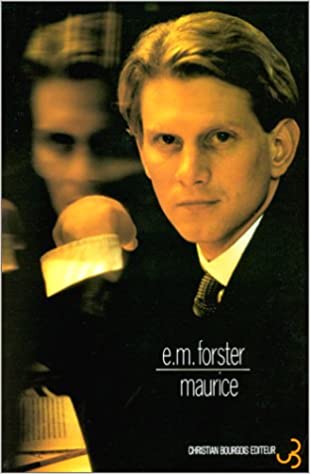 Maurice, d’Edward Morgan Forster
Maurice, d’Edward Morgan Forster
Christian Bourgois, 280 p., épuisé (existe en 10:18)
samedi 16 mai 2020, par
J’ai relu en 2020 ce roman d’E.M. Forster (Edward Morgan Forster) que j’avais lu à la sortie du film éponyme Maurice de James Ivory (1987), dans l’édition brochée Christian Bourgois éditeur, traduit par Nelly Shklar. J’ai d’ailleurs retrouvé, scotchés dans le livre, les deux tickets de cinéma datés du 11 et du 28 décembre 1987, un article de presse et l’affiche du film découpée en couverture de l’Officiel du spectacle. Faut-il rappeler que ce roman est posthume ? Que l’auteur, décédé pourtant en 1970, l’avait laissé de côté pour être publié un an après sa mort ? Faut-il rappeler que l’homosexualité resta quasiment interdite et criminalisée au Royaume-Uni jusque dans les années 1980, et que la Section 28 (ou « clause 28 ») qui interdisait de la présenter sous un angle positif dans les établissements scolaires, prit la relève de la criminalisation ? Voir l’article Droits LGBT au Royaume-Uni. Il s’agissait donc pour Forster de maintenir une veilleuse dans l’obscurantisme, mais « dans un lieu privé » comme le stipulait la loi homophobe sous laquelle il a vécu la fin de sa vie (et qui était déjà une avancée par rapport à celle qui existait lorsqu’il rédigeait ce roman dans les années 1910). Relire ce roman phare de ma jeunesse en cette période de confinement, et donc de chasteté non-désirée, s’est avéré particulièrement émouvant.
Éducation sentimentale en Puritanie
Le roman commence par la même scène que le film, sur la plage, où un prof du jeune Maurice (« quatorze ans et neuf mois ») l’entraîne à part pour lui apprendre les « mystères du sexe » (p. 11). Il s’est auparavant renseigné, sachant que le père est mort : « il n’y a donc que des femmes autour de toi ? – Nous avons un cocher et George qui s’occupe du jardin. Mais vous voulez dire, bien sûr, des gentlemen ? » Pour marquer cette circonstance exceptionnelle, le prof l’appelle par son prénom (p. 11). La leçon de choses gravée sur le sable (sans les mots prononcés dans le film) ne marque guère Maurice : « La puberté était là, mais non sa conscience, et il entrait dans l’âge d’homme, ainsi qu’il est de règle, comme un somnambule » (p. 12). De retour à la maison, il apprend que George a été remercié parce qu’« il devenait trop grand ». Il est triste et dans sa chambre pour conjurer l’obscurité qui lui fait peur, il gémit : « George, George » (p. 18). Cette scène manque au film, car elle prépare la rencontre d’Alec. Le chapitre suivant, évacué du film, évoque la suite des études de Maurice. Il fait souvent deux rêves étranges et pénétrants, dont le second est révélateur : « Il entrevoyait vaguement un visage, il entendait vaguement une voix lui disant : « Voilà ton ami », et il se réveilla ébloui et éperdu de tendresse. Il aurait pu mourir pour un tel ami, il aurait accepté qu’un tel ami meure pour lui ; l’un pour l’autre ils auraient fait tous les sacrifices sans se soucier du monde ni de la mort, rien n’aurait pu les séparer, ni les distances ni les obstacles » (p. 22). Ce rêve me rappelle le songe de la hache dans L’Épopée de Gilgamesh. Le bref passage qui suit est occulté dans le film, mais l’écrivain n’insiste guère : « Dès qu’il eut atteint la puberté, il devint obsédé par le sexe. Il se croyait victime d’une obsession particulière, mais c’était plus fort que lui ». Il a « des pensées impudiques », et « Ses principales indécences furent solitaires » mais il y renonce vite « estimant qu’ils [les actes] lui procuraient plus de fatigue que de plaisir » (p. 23).
Quand Maurice entre à Cambridge, le film suit rigoureusement le roman. Lors d’un cours du doyen, il fait la connaissance de Risley, un poil provocateur, mais « Il avait tout de suite été frappé par le côté sincère de Risley » (p. 33). C’est en se rendant à Trinity college pour revoir Risley, que Maurice fait la connaissance de « Durham », qui cherche des partitions, comme dans le film. Ils rentrent ensemble, et c’est le coup de foudre côté Maurice, qui rejoint son rêve : « Mais dans son cœur une étincelle avait jailli qui plus jamais ne s’éteindrait » (p. 41) ; « Grimper sur le flanc de la montagne, tendre la main vers la cime jusqu’à ce qu’une autre main prenne la sienne, tel était le seul but de son existence » (p. 42). Le chapitre VII est intéressant, bien que quasiment rien n’en soit repris dans le film. La scène entrecroise une discussion théologique au cours de laquelle Durham emporte pied à pied toutes les petites résistances que Maurice lui oppose au plan de la foi ; mais l’essentiel n’est pas là : au cours de leurs discussions, ils se taquinent, Maurice caresse les cheveux de son ami, et Durham « emprisonna dans le sienne la main de Maurice » (p. 49). Bilan en forme d’oxymore : « Bien qu’en apparence vaincu, il trouvait que sa Foi était un pion victorieusement perdu parce qu’en le prenant Durham avait imprudemment exposé son cœur » (p. 54). Comme dans le film, le doyen demande qu’on saute une ligne d’une version : « il s’agit d’une allusion à l’inqualifiable vice des Grecs ». Or après le cours, Durham qualifie le doyen d’hypocrite, et encourage Maurice à lire Le Banquet : « Il n’avait jamais pensé qu’on pût en parler, et quand Durham le fit au milieu de la cour ensoleillée, un souffle de liberté l’effleura » (p. 55). De retour chez lui, Maurice proclame qu’il a un ami, et se livre à un fétichisme épistolaire, couchant avec les lettres de Durham épinglées à son pyjama : « La nuit, il s’éveillait pour les toucher et, contemplant les ombres projetées par le réverbère, il se rappelait ses terreurs enfantines » (p. 58). Par conformisme, il fait la cour à une jeune femme qui fréquente la maison, mais celle-ci le repousse car son contact lui évoque « celui d’un cadavre » (p. 59). Au retour, c’est une discussion très tactile, précisément représentée dans le film : « Très doucement, il caressa les cheveux de Durham et enfonça les doigts dans ses boucles claires » […] « Durham tendit la main vers lui et lui caressa les cheveux. Ils s’étreignirent, poitrine contre poitrine » (pp. 62-63). Mais comme dans le film, les casse-couilles interrompent cette scène juste au moment de la conclusion, et ce sera le mot fatal de Durham qui au départ des autres, au lieu de poursuivre le dialogue des corps, déclare « Je vous aime », ce qui scandalise Maurice : « nous sommes anglais tous les deux, ne dites donc pas de sottises ! » (p. 63). Durham se renferme, persuadé qu’il a couru un grand risque et s’interdit de rester seul avec son ami, estimant qu’il a de la chance si celui-ci ne le dénonce pas (préfiguration de la relation entre Maurice et Alec). Or de son côté Maurice s’en veut et incrimine sa « nature » : « si on lui en laisse le temps, elle est capable d’éprouver et de susciter les plus violents transports ; si on lui en laisse le temps, elle est capable de connaître tous les tourments de l’enfer » (p. 65). Dans l’exemplaire de mes vingt ans que je relis, j’ai oublié de dire que la moitié des phrases était soulignée, et que dans la marge à côté de cette phrase, j’avais écrit « moi » ! La tempête sous un crâne permet à Maurice de voir clair en lui : « Le délire n’est pas toujours fécond. Pourtant celui de Maurice fut comme le coup de tonnerre qui disperse les nuages. L’orage n’avait pas couvé pendant trois jours, ainsi qu’il l’imaginait, mais pendant six ans. Il s’était formé dans les profondeurs obscures de son être et son entourage l’avait épaissi. Il avait éclaté, et Maurice n’en était pas mort. La splendeur du jour l’entourait. Il se tenait sur la crête des montagnes qui enténèbrent la jeunesse ; maintenant, il « voyait » » (p. 67). N’est-ce pas une interprétation personnelle du Voyageur contemplant une mer de nuages (1818) de Caspar David Friedrich ?

Éducation sentimentale en Platonie
Maurice se promet de ne plus se mentir à lui-même : « Il n’aimait et n’avait jamais aimé que les hommes ». C’est alors la belle scène du film, qui ne fait que préparer la future scène avec Alec : comme Durham le repousse dès qu’il essaie de lui parler, Maurice n’y tenant plus, escalade la fenêtre de son ami, et « au moment où il atterrissait dans la chambre, il entendit son nom prononcé en rêve par Durham endormi » […] « Puis posant très doucement la main sur les oreillers, il murmura : « Clive ! » (p. 73). Et c’est la première fois que ce prénom est écrit. Alors attention, ce n’est pas encore Brokeback Mountain, et tout cela restera platonique. Le roman nous offre un chapitre rétrospectif où l’on nous montre qu’il aurait pu s’intituler Clive : « il vit très jeune ses aspirations mystiques confrontées avec ses autres tendances manifestement homosexuelles » (p. 75). Clive vit ses tendances de façon plus claires, moins « confuses » que Maurice. C’est pourquoi après son aveu, il s’était raisonné en se disant que Hall « faisait simplement partie de ces garçons qui lui plaisaient bien » (p. 77). « S’il avait fait confiance au corps, il n’y aurait pas eu de drame » (p. 79). L’idylle est brève, car Maurice enlève carrément Clive, consentant, en side-car, ne daignant pas même s’arrêter lorsque le doyen les interpelle. Cette page ferait un excellent extrait pour le thème de BTS « À toute vitesse ! », car la vitesse du side-car participe de leur brève émancipation : « Ils ne se souciaient plus de rien ni de personne, et la mort, si elle était venue, n’eût fait que prolonger leur course vers un horizon sans cesse recommencé » (p. 82). La machine tombe symboliquement en panne, ce qui n’enlève rien au plaisir, et ils rentrent à pied. Le doyen à qui n’a pas échappé l’affront de Maurice et le danger de cette amitié, exclut Maurice, mais épargne Durham : « bien que, contrairement aux collégiens, les étudiants soient officiellement tenus pour « normaux », les professeurs exerçaient une certaine surveillance et jugeaient bon d’intervenir dans ces amitiés chaque fois qu’ils le pouvaient ». Clive intellectualise le side-car : « Dans son esprit, le side-car était lié à des moments intenses : sa souffrance le jour de la partie de tennis, leur bonheur de la veille. Emportés dans un même élan, c’était là qu’ils étaient le plus près l’un de l’autre. La machine semblait s’animer d’une vie propre dans laquelle ils réalisaient l’unité platonicienne » (p. 86).
De retour chez lui, Maurice joue les hommes face aux trois femmes de la maison, et impose son idée de ne pas s’excuser et d’entamer sa vie d’agent de change avec l’associé de son père en se fichant des diplômes. Madame mère demande alors au Dr Barry, voisin et ami de la maison, de morigéner Maurice, scène reprise dans le film à l’identique. J’avais écrit en marge cette note pleine de bon sens : « le docteur joue le rôle d’un père, mais il n’en a pas été question lors de la scène inaugurale, quand l’instituteur cherchait à savoir s’il y avait dans l’entourage de Maurice un homme qui pût veiller à son éducation sexuelle ». Lorsque Maurice est invité pour la première fois à séjourner à Penge, la propriété familiale de son ami, il ne se laisse guère impressionner par l’habitus aristo, mais remarque la décrépitude de la maison. Ce qui est amusant c’est que lorsque les deux amis se retrouvent ensemble dans la chambre de Maurice, que Clive a choisie parce qu’elle est isolée dans la vaste demeure, voilà de quoi ils se réjouissent : « toute la nuit devant eux pour bavarder. Ils allumèrent leurs pipes. C’était la première fois qu’ils disposaient ensemble d’une telle liberté et ils allaient pouvoir échanger des mots exquis » (p. 97). Le romancier ne se donne même pas la peine de préciser, tant il est évident que ces gentlemen étant anglais, ils ne saurait être question que de bavardage, et en fait de pipes, que de les allumer ! Dans le bavardage de Clive, je retiens une remarque très simple sur l’esthétique des homos, mais qui à l’époque était sans doute fort pertinente et devait leur permettre de se repérer dans les musées ou dans les salles de sport : « Prenons, par exemple, ce tableau. Je l’aime parce que comme l’artiste je suis amoureux de son sujet. Je ne le juge pas avec les yeux d’un homme normal. Je crois qu’il y a deux voies pour arriver à la Beauté – l’une est « publique » : c’est celle qu’emprunte le monde entier pour aller vers Michel-Ange. L’autre est « privée » : nous sommes seulement quelques-uns à l’emprunter. Toutes deux nous mènent à lui. D’un autre côté, prenons Greuze. Je déteste le sujet de ses tableaux. Je n’ai donc à ma disposition qu’une seule voie pour l’atteindre. Le reste de l’humanité en a deux » (p. 100). On pourrait rétorquer, comme pour les calendriers des rugbymen ou les calendriers Pirelli à l’heure actuelle, que le fait d’apprécier ces trucs pour des raisons érotiques ou esthétiques, concerne aussi bien les hommes que les femmes, hétéro que homo. La femme nue dans la peinture n’est pas – pas plus que l’homme nu – seulement un phénomène esthétique. Après avoir subi toute une nuit ce blabla intello, le pauvre Maurice n’ose qu’une question : « Clive, ne voulez-vous pas m’embrasser ? » (p. 101). C’est sans doute de l’humour anglais ! Si l’on n’avait pas bien compris, l’auteur met les points sur les i : « Clive s’était jeté dans cette voie dès qu’il avait compris les Grecs. L’amour que Socrate porte à Phèdre, il l’avait maintenant à sa portée, amour passionné, mais chaste et retenu, tel que seules les natures les plus raffinées sont capables de le comprendre, et il trouvait en Maurice un partenaire dont l’âme n’était sans doute pas si raffinée, mais qui était délicieusement disposé à le suivre » (p. 107). « Raffiné, mon cul », comme dirait Zazie ! Il semble que Clive convainque Maurice de faire ses excuses au doyen, juste pour continuer à se voir à Cambridge, ce qui permet une ellipse : « Ils eurent leur dernière année à Cambridge. Ils voyagèrent en Italie. Puis les grilles se refermèrent : Clive préparait le barreau, Maurice prit le chemin de la Cité. Toutefois, ils étaient encore ensemble » (p. 108). Maurice a grandi : « À vingt-trois ans, il était un parfait tyran domestique en herbe » (p. 111).
Éducation sentimentale en Hystérie
Arrive la scène du film où Clive est malade et fait un malaise, sauf que dans le livre, elle arrive à brûle-pourpoint. C’est la seule grande innovation du scénario du film : dans le film, le changement de Clive est motivé par la mésaventure de Risley, qui se fait piéger par un soldat qu’il drague dans un pub, et livrer à la police. S’ensuit un procès scandaleux pour cet aristocrate traîné dans la boue par la justice et la presse. Clive en est terrorisé et en tombe malade, suite à quoi il se convertit à l’hétérosexualité. Dans le roman, la simple pression du conformisme social suffit. Mais la suite est identique : Maurice embrasse Clive, puis demande à sa mère de ne pas le dire aux autres, puis se met aux petits soins pour son ami, malgré le risque de contagion souligné par le docteur : « Il le porta jusqu’en haut, le déshabilla et le mit au lit » (p. 114). Ah bon ? Et quand Clive se plaint du ventre, ni une ni deux, « Maurice le souleva du lit et l’installa sur la chaise percée », puis « Il emporta le pot et alla le nettoyer » (p. 117). Clive proteste, et préfère que ce soit une « infirmière ».
Clive veut absolument voyager en Grèce, ce qui intrigue Maurice : « Maurice se souciait peu de la Grèce. Il n’avait jamais eu beaucoup de passion pour les classiques et son intérêt pour les textes licencieux s’était évanoui dès qu’il avait connu Clive. Ces histoires d’Harmodios et Aristogiton [1], Phèdre, et toute la clique des Thébains, c’était bon pour ceux dont le cœur était vide, mais cela ne valait pas la vie » (p. 122). Clive préférerait être seul, mais Maurice le suit quand même une dernière fois dans son appartement de Londres où ils ont leurs mercredis depuis des années, chacun dans sa chambre. Clive ne trouve pas le sommeil et finit par demander : « Je peux venir dans votre lit », ce qui donne : « Maurice ne se méprit pas. Il connaissait les idées de Clive et les partageait. Ils restèrent allongés côte à côte sans se toucher » (p. 126). Le chapitre suivant, selon un procédé récurrent, revient en arrière pour expliquer le changement de Clive qui estime être « devenu normal » (p. 127). « Il avait cessé d’aimer Maurice » (p. 128). S’il part en Grèce, c’est pour « que tout sentiment entre eux fût mort » ; « Maurice lui inspirait désormais une répulsion physique qui rendait encore plus délicates leurs futures relations, et il eût souhaité rester ami avec son ancien amoureux » (p. 133). De retour au pays, Clive fait une visite surprise et tombe sur la mère et les sœurs de Hall. Comme dans le film, il accepte de faire le cobaye d’un cours de secourisme, et pendant ce temps est frappé de la ressemblance de Ada avec son frère Maurice : « Il reconnaissait ces cheveux et ces yeux sombres, et cette bouche familière – sauf que celle de Maurice s’ornait d’une moustache –, puis son regard se posa sur les courbes de son corps. Elle était exactement la transition dont il avait besoin » (p. 138). Ce genre de remarque incite à douter que le narrateur joue franc-jeu : c’est un narrateur-thérapeute qui tente de pousser son personnage vers la « normalité ». La scène se poursuit, reprise identiquement par le film : Maurice rentre, est furieux de trouver Clive avec les filles, s’enferme avec lui et exige des explications ; celui-ci a la mauvaise idée de lui parler d’Ada, ce qui met Maurice dans une jalousie folle et le pousse à une « ignominie » vis-à-vis de sa sœur. Clive semble changer à vue, ce qui nous fait douter de la réalité de sa conversion : « L’horreur de la masculinité lui était revenue et il se demandait ce qui se passerait si Maurice essayait de le serrer dans ses bras » (p. 140, alors que Maurice lui a mis la main dans les cheveux !). Clive prend une décision, qui là aussi remet en cause ses prétentions précédentes à la normalité : « Il aimerait une femme. Du fond de son chagrin, il le savait. Il n’épouserait pas Ada – elle n’avait été qu’une transition. Il épouserait quelque déesse de son nouvel univers et rien en elle ne lui rappellerait Maurice Hall » (p. 145).
Éducation sentimentale en Uranie
Suit une période où Maurice songe au suicide, mais la mort de son grand-père contribue à changer son état d’esprit, et il devient plus compréhensif avec sa mère et ses sœurs, plus généreux avec le monde : « Il renonça au golf le samedi afin de jouer au football avec les garçons d’un Centre de Jeunes, et consacra ses mercredis soir à leur enseigner l’arithmétique et la boxe » (p. 157). Mais aucune allusion à un quelconque désir, et l’on se rappelle dans le film, juste un vague regard dans le vestiaire. Étonnamment, ce désir prendra corps non pas avec ces nombreux garçons du Centre, mais avec Dickie, « le jeune neveu du Dr Barry » qu’ils hébergent pour le week-end. Le désir s’empare de Maurice alors qu’il va réveiller le garçon comme il traîne au lit, et que celui-ci se présente comme un tableau reprenant l’allusion au discours esthétique de Clive : « N’importe qui l’eût trouvé beau, mais pour Maurice que deux voies menaient à lui, comme l’eût dit Clive, il devint l’incarnation du Désir ». Le soir, Maurice fait une tentative en expliquant à demi-mot que la chambre qu’occupe Dickie est normalement la sienne, et que lui dort là-haut, et que « si vous avez besoin de quelque chose, je suis seul toute la nuit ». La scène est très cinématographique, et l’on s’étonne qu’elle n’ait pas été gardée pour le film, sans doute pour mieux faire ressortir la rencontre d’Alec comme fatale : « Le garçon ne disait rien non plus. Chacun évolue à sa façon, et il se trouvait qu’il comprenait parfaitement la situation. Si Hall insistait, il ne ferait pas d’histoires, mais il n’y tenait pas : c’était ainsi qu’il voyait les choses » (p. 163). On relève au passage le motif de l’escalade pour atteindre au désir homosexuel (« là-haut »), écho à celle de Maurice dans la chambre de Clive, et à celle d’Alec dans celle de Maurice. Une fois le garçon parti, le surmoi de Maurice l’assaille de remords contre cet accès de « lubricité » : « Le sentiment qui pousse un gentleman vers un individu d’une classe inférieure porte en lui-même sa propre condamnation » (p. 166) ; « Qui aurait pu soupçonner que dimanche dernier il avait presque violé un jeune garçon ? ». Mais la chose le travaille à la façon d’une goutte d’eau sur un rocher… Pendant qu’il rumine ses pensées, comme dans le film, il reçoit un appel téléphonique de Clive lui présentant (au téléphone !) sa fiancée, laquelle lui déclare « vous êtes le huitième ami de Clive à qui je parle » (p. 167), ce qui est amusant vu l’époque à laquelle l’action est censée se passer. J’imagine que si le roman a été écrit dans les années 1914, il a été revu et corrigé subséquemment. Maurice décide de « fuir les jeunes gens » (p. 171), et c’est alors qu’il se fait draguer par un vieux dans un train (scène reprise dans le film), auquel il fiche son poing dans la figure. Complètement désemparé, il se résout à demander l’avis du Dr Barry, maintenant retraité, dans son salon orné de « copies de Greuze », clin d’œil à l’opinion esthétique de Clive. Comme dans le film, le Dr croit d’abord qu’il s’agit d’une maladie vénérienne ou d’impuissance, avant de qualifier de « balivernes » l’aveu de Maurice, ce qui ébranle ce dernier car le Dr Barry incarnait la science infaillible pour la famille Hall. Lors d’un concert où Maurice se rend dans le but de se forcer à courtiser une jeune femme, ironie du sort, non seulement on joue la Symphonie n°6 dite Symphonie pathétique de Tchaïkovsky, mais il rencontre Risley, lequel lui apprend que « Tchaïkovsky était tombé amoureux de son propre neveu et lui avait dédié son chef-d’œuvre ». Or si Maurice fait semblant de rien, il se précipite dans une bibliothèque, où il vérifie ces amours avunculaires pour Vladimir Lvovitch Davydov, ce qui le fait conclure « que les médecins sont des ânes ». Pour apprécier la relativité du chemin parcouru relativement à l’homosexualité selon les pays, je vous invite à lire cette entrevue d’un certain Iouri Arabov, scénariste d’un biopic sur le compositeur, qui estime, je cite, « Je ne souscrirais jamais à un film qui promeut l’homosexualité. C’est un domaine qui se situe en dehors de la sphère artistique ». Sans blague ! Nouvelle impasse pour Maurice, renvoyé à des désirs dont la moralité anglaise ne lui donne pas la clé : « il en revint aux pratiques qu’il avait abandonnées enfant » (p. 179). Il envisage de consulter un hypnotiseur. C’est juste à ce moment-là qu’il séjourne à Penge chez Clive, où il est reçu par son épouse. Les retrouvailles sont décevantes, mais le narrateur nous donne d’avance accès à la misère hétérosexuelle de ce couple : « Ils s’unissaient dans un monde sans point commun avec celui de la réalité quotidienne et ce silence prude se répercuta dans leur vie. Ils avaient tellement de tabous ! Jamais ils ne se virent nus. Jamais ils ne faisaient allusion aux fonctions digestives ni reproductives. Il n’était donc pas question qu’il évoquât devant elle cet épisode de sa jeunesse. Cela faisait partie de ces choses dont on ne parle pas » (p. 182). L’opinion de Clive est verrouillée : « l’acte sexuel proprement dit lui semblait prosaïque et il aimait autant qu’il restât enveloppé du voile de la nuit. Entre hommes, c’était inadmissible ; entre un homme et une femme, on peut le pratiquer puisque la nature et la société le tolèrent du moment qu’on en parle pas et qu’on ne l’étale pas au grand jour » (p. 183).
Éducation sentimentale vers la vraie vie
La figure de celui qui va changer la vie de Maurice apparaît d’abord sous la forme d’une silhouette : « tandis qu’il traversait le parc en voiture, il apercevait un garde-chasse qui batifolait avec deux servantes et son cœur se serra d’envie » (p. 185). Comment peut-il savoir qu’il s’agit d’un « garde-chasse » ? Dans la conversation mondaine, il se montre cynique : « Les pauvres n’ont pas besoin de pitié. Ils ne m’aiment jamais autant que lorsque je mets les gants et que je leur tape dessus » (p. 187). Ce cynisme cache mal son dépit : « Il n’aimait plus Clive, mais il pouvait encore souffrir à cause de lui » (p. 189). L’aventure avec Alec est amenée fort différemment du film. Alors qu’il pleut sur le piano, Maurice laisse les domestiques s’en occuper, cherche un livre pour s’endormir, et s’exclame : « n’y a-t-il donc rien ici ! », ce qui fait dire au valet : « J’espère que c’est pas à nous qu’il parle ». Le lendemain, Clive se rend compte qu’il a oublié l’anniversaire de Maurice. Dans le film, Maurice aide Alec à pousser le piano, et le garde-chasse lui souhaite son anniversaire. Clive rejoint Maurice dans sa chambre, et ravi de sa froideur, lui impose un dernier baise-main réciproque. Comme dans le film, Maurice se met la tête par la fenêtre sous la pluie : « Viens ! cria-t-il soudain, étonné lui-même. Qui avait-il appelé ? Il n’avait pensé à rien » (p. 198). Comme dans le film, Maurice se scandalise que le garde-chasse (qui fait aussi office de domestique) ait refusé son pourboire et accepté celui d’un autre hôte. Il s’étonne de croiser ses « deux grands yeux noirs » alors qu’ils quittent le parc, comme s’il avait couru pour suivre la voiture. La scène de l’hypnotiseur est aussi fidèlement adaptée dans le film. Celui-ci prend Maurice au sérieux, et donne son verdict sans barguigner : « De quoi suis-je donc atteint ? demanda-t-il. Est-ce que ça porte un nom ? – Homosexualité congénitale » (p. 205). La séance s’avère positive car Maurice est réceptif, mais le ton pince sans rire laisse présager une résistance, car pendant que le praticien suggère la présence d’une femme, tout l’inconscient de Maurice est tourné vers un homme ou vers son vieux rêve d’un ami. Et l’ironie du narrateur fait suggérer par l’hypnotiseur à Maurice de se changer les idées, par exemple par « un tour à la chasse » (p. 207). Le narrateur s’amuse dès lors à faire tourner son Maurice en papillon affolé autour de la bougie allumée Scudder, et le tempo est fidèlement respecté dans le film. Scudder lui présente ses excuses pour avoir refusé son pourboire, et tâche de glisser un mot gentil, même si Maurice le renvoie dans les cordes, agissant en « gentleman » (p. 210). Il lui fait proposer de « se baigner dans l’étang ». Maurice refuse, mais alors que le révérend Borenius s’inquiète du fait que Scudder n’ait pas été confirmé, Maurice éprouve sans cesse le besoin de folâtrer dans le parc, se couvrant le chef de pollens dorés, comme un bacchant. Il se lamente : « C’était là qu’il moisirait, pilier respectable de la société, sans avoir eu jamais l’occasion de jeter sa gourme » (p. 212). Agité dans son sommeil, il crie à nouveau « Viens ! » à la fenêtre, mais cette fois-ci son appel est entendu, et Scudder escalade l’échelle opportunément oubliée pour des travaux : « Monsieur, c’est vous qui m’avez appelé ? Je sais, monsieur… je sais… » Et une main se posa sur la sienne » (p. 217). C’est l’écho de la scène où Maurice était monté dans la chambre de Clive, sauf que cette fois, on suppose qu’il y a rapport sexuel, en tout cas ils dorment un peu, mais à l’aurore Alec veut filer pour travailler et ne pas éveiller les soupçons, tandis que Maurice qui n’a rien d’autre à faire, veut parler, parler. Il ne peut s’empêcher d’être condescendant : « Alec, vous êtes un brave garçon, et nous avons été très heureux » (p. 221). C’est le match de cricket dont le déroulement est sans doute difficile à suivre pour un non-britannique. Maurice est bouleversé : « Il avait goûté à une drogue inconnue ; il avait bouleversé sa vie de fond en comble et n’aurait su dire ce qui allait s’écrouler ». Le temps du jeu, l’optimisme revient brièvement : « Ils jouaient pour l’amour l’un de l’autre et du lien fragile qui les unissait, si l’un perdait, il entraînerait l’autre dans sa chute. Ils ne voulaient de mal à personne, mais tant qu’on les attaquerait, ils ne se laisseraient pas faire. Ils devaient rester sur la défensive, et cogner et vaincre. Ils devaient montrer que lorsqu’on est deux, aucune force n’est assez puissante pour triompher. Et au fur et à mesure que la partie avançait, elle s’apparentait à leur nuit et lui donnait son sens » (p. 226). La peur l’emporte et Maurice fuit Penge. Tout le monde croit qu’« il était amoureux », mais comme Clive le reconduit, il feint un air détaché pour se renseigner sur Alec, dont il apprend que son père était boucher. De retour chez lui, il repense au « petit aide-jardinier » de son enfance, et « s’accusa de lubricité » (p. 232). Il reçoit deux lettres maladroites d’Alec qui lui propose de le retrouver au « hangar à bateaux » pour « partager avec vous » : « je meurs de bavarder un bras autour de vous puis de vous entourer avec mes deux bras et de partager ». Maurice croit distinguer des menaces de chantage entre les lignes, et imagine qu’en faisant le mort jusqu’au départ d’Alec pour l’Argentine, « il devrait s’en tirer ». C’est l’écho de l’épisode où Clive redoutait qu’après son aveu, Maurice le dénonce au doyen. Il fait une seconde tentative auprès de l’hypnotiseur, mais il résiste, et celui-ci lui conseille froidement « d’aller vivre dans un pays qui a adopté le code Napoléon » où « l’homosexualité n’est plus considérée comme un délit. — Vous voulez dire qu’un Français peut partager avec son ami sans risquer la prison ? – Partager ? Vous voulez sans doute dire avoir des relations sexuelles ? » (p. 237). Il y a une discussion un peu didactique, mais le narrateur conclut derrière le dos de Maurice : « Contrairement au Dr Barry, il n’était pas choqué ; ce genre-là ne l’intéressait pas, c’est tout, et jamais plus il ne repensa au jeune inverti » (p. 241). Phrase peu compatible avec le fait que ce praticien a révélé que ce problème constituait 75 % de sa clientèle ! Faut pas cracher dans la soupe ! Une sorte de tempête sous un crâne occupe Maurice, qui dissocie ses deux personnalités : « Et surtout ne tourne jamais la tête vers Sherwood comme je risque de le faire » (p. 242 ; Sherwood est la forêt de Robin des Bois). Une 3e lettre d’Alec se fait un peu menaçante. Il dit « Je sais pour vous et Mr Durham » (p. 243). Maurice répond enfin brièvement en fixant rendez-vous au British Museum, scène clé du film que j’ai analysée, et qui se révèle fidèlement adaptée, sauf que James Ivory en a fait un grand moment de cinéma. Sur le chemin, Maurice remet en cause l’éthique même de sa profession, et à l’approche de la scène, « Maurice abordait le jour le plus dangereux de sa vie sans aucun plan, pourtant quelque chose frémissait en lui comme des muscles bien huilés dans un corps d’athlète » (p. 248). Les taureaux assyriens du film sont bien dans le texte, et la rencontre avec le prof du début du roman, identique au film. Le ton me semble donné par une phrase clé : « Ils s’attardaient devant une déesse ou un vase, puis repartaient en cœur, et leur unisson était d’autant plus étrange qu’en surface ils étaient en guerre » (p. 251). Après des menaces non crédibles, Alec reconnaît : « Je vous veux aucun mal. J’ai jamais voulu vous faire de tort » (p. 253). L’ambiance de l’époque est rendue par cette remarque : « Ils en savaient à la fois trop et trop peu l’un sur l’autre. D’où la peur. D’où l’agressivité. Et il se réjouit parce qu’à travers sa propre ignominie, il avait compris celle d’Alec. Il avait affronté ses menaces non pas en héros mais en égal et découvert derrière beaucoup de puérilité, et derrière encore quelque chose d’autre… » […] « À présent, ils étaient amoureux l’un de l’autre consciemment » (p. 255).

Nous retrouvons les deux amants à l’hôtel, mais (comme dans le film) on a raté la scène hot. « Et il avait envie de traîner au lit, de chahuter, et de faire l’amour » (p. 257). Alec vide son sac : « Tu peux pas savoir sur quel ton on parle aux domestiques » (p. 250). La question de savoir comment un traducteur de l’anglais estime judicieux de passer du vouvoiement au tutoiement serait passionnante, hélas je ne suis pas compétent en la matière ! Alec fait ses adieux virilement : « Il repoussa Maurice, puis l’attira contre lui, et l’étreignit de toutes ses forces comme si c’était la fin du monde » (p. 259). Or Maurice est « prêt à affronter n’importe qui, n’importe quoi » (p. 262), mais Alec le laisse en plan, et il croît avoir échoué. Il se rend cependant sur le bateau qui doit conduire Alec avec sa famille au Nouveau monde. Là encore, scène identique au film, avec le pasteur Borenius. « Alec n’était ni un héros ni un dieu, c’était un être humain prisonnier de son milieu comme lui-même l’était du sien » (p. 266). Quand il constate qu’Alec a raté son train, voilà Maurice « éperdu de bonheur » […] « Il leur faudrait vivre en marge, sans amis, sans argent. Il leur faudrait travailler et s’accrocher l’un à l’autre jusqu’à la mort » (p. 270). Maurice retrouve son amant endormi au hangar à bateaux ; il n’avait juste pas reçu son télégramme : « Comme ça, c’est fini, jamais plus nous ne serons séparés » (p. 271). Avant de partir façon « Ramona » (« Ramona, nous étions partis tous les deux / Nous allions lentement / Loin de tous les regards jaloux), Maurice éprouve le besoin (là encore la fin est identique au film) d’avouer tout à Clive : « Je suis amoureux de votre garde-chasse » (p. 274). Clive ne comprend pas : « il avait cru durant ces deux dernières semaines que Maurice était normal et avait encouragé Anne à lui accorder son amitié » (p. 275). Il croit que Maurice a évoqué le « garde-chasse » comme une métaphore, et se réfugie derrière son « intellectualisme ». Maurice exprime les choses crument : « Alec et moi, nous avons couché ensemble », et Clive réplique comme dans le film : « l’amour entre hommes n’est excusable que s’il demeure platonique ! » (p. 276). La fin, fort belle, a été très fidèlement transposée au cinéma.
J’en reviens au début de l’article pour dire comment cette relecture m’a bouleversé en cette période de confinement, en avril 2020, alors que le mot « platonique » a repris un sens prosaïque pour l’altersexuel pratiquant que je suis !
Poème retrouvé dans mes papiers
Maurice m’avait tant plu que j’écrivis aussi sec le poème qui suit. Je viens de le retrouver dans de vieux papiers, et l’ai recopié, sans en changer une virgule. Cela date de 1987, j’avais 21 ans et pas d’ordinateur, seulement une machine à écrire avec, je m’en souviens, une marguerite. Ben oui, quoi, le temps a passé… J’avais alors un cœur qui n’était pas de pierre, comme dirait Ronsard !
Maurice & Alec
Le clop au bec, Alec, frisé sous sa gapette,
Point rouge dans la nuit, crie comme un animal
Sauvage : son amour, défiant la tempête,
L’appelle. Il monte & l’aime, & contre lui se cale
Maurice & son sylvestre amant crotté font fête
À ce bonheur furtif dont pleure leur cœur mâle,
Car ils n’osent rêver à la passion secrète
Qui dure pour la vie & les sauve du Mal.
Leurs jeunesses s’allient en un lit de passage,
Oubliant l’Argentine & l’Or, sublime image
De leur amour fidèle au hangar à bateaux.
La suie à l’or mêlés, leurs crinières au vent,
Maurice amant d’Alec, loin de tous leurs châteaux,
Ils vécurent heureux & n’eurent pas d’enfants.
***
Comme un ciel noir que constelle une étoile,
Roman d’amour que j’eusse voulu vivre,
L’amour crevé qui revit à la voile
Où souffle un cœur naïf & de Joie ivre.
Embrase, Alec, de ton œil animal
La triste nuit où sombrait sous le Livre
Un blond Monsieur taxé de tout le Mal
Dont la devise est l’espoir de te suivre.
Maurice & toi vivrez d’amour & d’air
Pur, corps à corps, du côté de la mer,
Toujours plus loin de l’immortellement
Bête troupeau de ce qui se nomme « hommes »,
& vous irez, croqueurs de toutes pommes,
Main dans la main, jusqu’à la mort amants.
***
Maurice hèle l’amour
Sous la pluie.
Un garde-chasse accourt
Dans son lit,
Ravivant son cœur gourd.
L’espoir luit !
Alec, faune transi,
Noir de boue
Tremble d’un seul souci,
Qu’à ce cou
Son jeune corps rassis
Plaise moult.
La peur n’est plus de mise
& l’amour
Entre Alec & Maurice
Soudain sourd,
S’installe & s’éternise
Au grand jour !
– Lire l’article sur le film Maurice de James Ivory (1987).
– Indépendamment du thème de la chanson « Ramona », l’histoire de Maurice et d’Alec me rappelle le ton de Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, dans la façon émouvante qu’avaient des jeunes gens (là hétérosexuels) d’accéder à l’amour dans un contexte plus ou moins puritain, au début du XXe siècle.
Commentaire d’une fidèle lectrice :
« Merci pour cette note de lecture qui éclaire notre regard sur le film d’Ivory, mais aussi sur l’homosexualité mais aussi sur la sexualité au cinéma…
Qu’il n’y ait que de chastes relations entre Maurice et Clive, adeptes de l’amour platonique, et que seul Alec soit l’initiateur d’un vrai « partage », ne nous paraît pas aussi évident dans le film que dans le roman tel que tu le résumes. Même si Ivory réussit à nous le faire comprendre par des signes discrets (les gestes de caresse arrêtés, le malaise persistant de Maurice obligé de consulter…) nous pouvons tout aussi bien ne voir dans ces allusions que des ellipses auxquelles la censure ou la pruderie cinématographique nous ont habitués. Par ailleurs, on comprend bien que la relation Maurice / Clive n’aboutit pas sexuellement parce que le second est opposé aux relations homosexuelles pour des raisons d’interdit moral et social. Mais l’on peut continuer de penser que Maurice est dans l’attente de relations sexuelles dont il comprend très bien le mode d’emploi. Or, non, Maurice ne sait rien ou presque rien des échanges entre hommes c’est ce que décrivent très bien les quelques passages du roman que tu cites. C’est donc un vrai roman d’initiation. Cela m’explique aussi pourquoi j’ai si souvent rapproché ce film du Messager de Losey qui se déroule dans la même Angleterre et que j’ai découvert à peu près à l’âge où tu découvrais Maurice. Et là aussi il y avait une partie de cricket et un garde-chasse. Et là aussi la découverte, par un enfant, que l’amour est victime expiatoire des préjugés de classes et de la morale victorienne.
Le regard et le discours d’aujourd’hui sur la sexualité fait l’impasse sur l’initiation amoureuse, or c’est bien ce dont il est question dans le roman. On avait oublié ou pas su qu’il s’agissait là d’une histoire d’initiation, à l’amour, à la sexualité. Mais peut-être avons nous aussi oublié que l’amour s’apprend aussi. Merci de nous le rappeler. »
Voir en ligne : L’avis de Jean-Yves sur Culture et débats.
© altersexualite.com, 2020.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Héros mentionnés à la scène 3 de l’acte III de Lorenzaccio.
 altersexualite.com
altersexualite.com






















