Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > Le Docker noir, d’Ousmane Sembène
Meurtre & société, pour lycéens et adultes
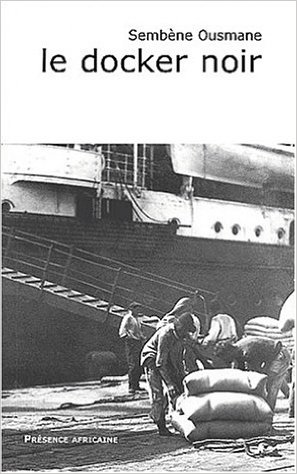 Le Docker noir, d’Ousmane Sembène
Le Docker noir, d’Ousmane Sembène
Présence Africaine, 1956, 224 p., 6,2 €
mercredi 28 juin 2017
Publié 4 ans avant Les Bouts de bois de Dieu, Le Docker noir, premier roman d’Ousmane Sembène, est un roman plus expérimental et autobiographique. Le protagoniste, Diaw Falla, a en effet deux points communs avec l’auteur : ils ont tous les deux été dockers à Marseille, et écrivains. Diaw Falla est condamné pour le meurtre d’une femme, Ginette Tontisane, à qui il avait confié le manuscrit de son premier roman, et qui l’a publié en son nom, obtenant un prix littéraire grâce à cette spoliation. Ce scénario permet à Ousmane Sembène d’inscrire un roman de l’esclavage en abyme dans son roman du prolétariat immigré. Le livre s’ouvre sur une dédicace à la mère de l’auteur, analphabète : « Penser qu’elle y promènera les doigts suffit à mon bonheur ». Personnage brut de décoffrage, Diaw Falla permet à l’auteur d’exposer sans fard la vie quotidienne du travailleur immigré, dans une veine qui préfigure Élise ou la vraie vie, de Claire Etcherelli (1967), paru dix ans plus tard, mais qui évoque la même période de la guerre d’Algérie.
Les Mamelles du roman
Le roman commence symboliquement dans un endroit clé de Dakar, d’où la mère du protagoniste exprime son désespoir : « Le visage en larmes, son regard suivait le bateau qui venait de passer au large des Almadies – « Les Mamelles », seuls points culminants du Sénégal, montagnes ridicules par leur stérilité, moussues ici, dénudées là » (p. 11). Voir dans notre article sur le Sénégal ce qu’il est advenu de cet endroit au XXIe siècle. Il s’agit selon un article de Lamine Diakhité dans Présence Africaine, d’une citation sinon d’un plagiat, du conte de Birago Diop « Les Mamelles », dont le texte semble avoir été modifié par la suite : « ces deux ridicules tas de latérites, moussus ici, dénudés là ». Dans le bus, cette mère reconnaît la photo de son fils sur un journal, dont elle ne peut déchiffrer les gros titres : « LE NÈGRE DIAW FALLA, ASSASSIN DE LA CÉLÈBRE ROMANCIÈRE SERA JUGÉ DANS TROIS JOURS ». Les cancans vont bon train, ou plutôt bon bus : « Cet individu dont tu parles, nous le connaissons, pourquoi est-il allé là-bas ? Pour vivre du proxénétisme. » (p. 17). Cette accusation répétée, sera démentie par le récit, sans que le narrateur ait besoin de mettre les points sur les i. En fait, le personnage est tellement prolétarisé qu’il ne peut se payer qu’un hôtel de passe, où bien loin de « vivre du proxénétisme », il paie comme il peut un maigre loyer à une maquerelle ; mais il est significatif que ceux qui devraient le défendre colportent cette calomnie due à un amalgame. La mère voudrait aider son petit : « si je partais pour Tougueul (France), ils auraient pitié de moi, les toubabs » (p. 21). Cela fait penser au mot « Tougoul » qui désigne le général de Gaulle dans La Civilisation, ma Mère !…, de Driss Chraïbi ; mais le mot sera à nouveau employé dans Les Bouts de bois de Dieu. Catherine Siadem est une jeune fille très simple, amante de Diaw Falla, qui vit dans une chambre avec son père adoptif, lequel « la harcelait de ses insultes » (p. 25) alors qu’elle est enceinte de sept mois. Catherine collectionne les coupures de presse, dont le ton est édifiant : « Lorsque l’on considère sa démarche, semblable à celle d’un fauve traqué, on peut facilement supposer comment le nègre, sous l’emprise d’une passion sexuelle, a saisi la pauvre Ginette Tontisane pour la violer avant de lui cogner la tête sur le rebord de la table. Surpris au moment du vol, il partit en courant, laissant les billets épars dans le studio… Diaw Falla a les épaules arrondies, très musclées. Il semble se replier sur lui-même lorsqu’on lui parle, prêt à bondir, le regard plein de haine et de dédain. On a l’impression de se trouver devant un être n’ayant jamais subi l’influence de la civilisation. Il n’a rien du grand « Mamadou » inoffensif et candide, fort et souriant, cher à nos cœurs de bons Français. » Dominic Thomas, dans son essai Noirs d’encre (La Découverte, 2013), a montré que ce paragraphe était une sorte de plagiat de la traduction française de Un Enfant du pays de Richard Wright. Décidément, dans ce premier roman sur le plagiat, combien le jeune romancier s’est amusé à brouiller les pistes ! Le procès constitue un chapitre. La concierge de l’immeuble où le crime a été découvert fournit un échantillon du racisme ordinaire des années 1950 : « Dans notre quartier, il n’y a pas d’Arabes, ni de Noirs. La première fois qu’il est venu, je l’ai vu regarder la plaque. Quand je lui dis qu’il n’y avait pas d’hommes comme lui, il m’a répondu : « Je sais où je vais » et, sans même s’excuser, il entra. » […] quelles étaient ses relations avec la victime, amicales ou intimes ? — Je ne peux pas croire qu’elles soient intimes… Mademoiselle Ginette était l’honnêteté en personne. S’il avance des choses, c’est pour salir sa mémoire » (p. 47). Quant à l’expert médical, sa déclaration est aussi édifiante : « Vous paraît-il un obsédé sexuel ? — Chez les Noirs, c’est une chose naturelle, et surtout quand il s’agit d’une femme blanche. Ils sont fascinés par la blancheur de la peau qui est plus attirante que celle des négresses » (p. 54). Arrive un moment étonnant de ce récit de procès. Le président du tribunal demande à l’accusé s’il peut « réciter un passage du livre » dont il se prétend l’auteur, « Le dernier voyage du négrier Sirius ». Et le voici qui « récite » le dernier chapitre du roman, ce qui prend cinq pages, avec juste une interruption ! Il s’agit d’un bel exemple de mise en abyme, car ce roman historique évoque une mutinerie sur un bateau négrier, et cette violence anticoloniale renvoie évidemment à la situation du protagoniste qui a tué pour se venger d’une femme qui a fait de lui un « nègre » littéraire sans lui demander son avis. Après cet exploit dont peu d’écrivains seraient capables, le président demande simplement : « Combien de jours vous a-t-il fallu pour l’apprendre ? », et on s’étonne que l’auteur n’ait pas poussé plus loin la curiosité du tribunal (ni de l’avocat de la défense !) sur ce point essentiel sans doute facile à prouver. Au contraire, l’avocat général prononce un réquisitoire des plus raciste juste après avoir entendu cette performance, ce qui manque un minimum de cohérence : « Le crime est si affreux, si bestial, qu’il est bien digne de son auteur, qui n’a rien à envier aux fauves de sa jungle natale… » […] « Ce monstre prétend être l’auteur du « Négrier Sirius » ! Cette insulte à nos lettres est aussi un délit. » (p. 69). L’avocat de la défense n’a pas l’air si nul, mais sa plaidoirie a de grands trous, peut-être un défaut de ce premier roman dont le style est pourtant très abouti. Les théories de Cheikh Anta Diop (1923-1986) sont évoquées : « les savants sont maintenant convaincus, qu’il y a eu une civilisation noire, qui, descendue le long du Nil, a gagné l’Égypte pour donner naissance à la nôtre » (p. 73). En attendant le verdict, le récit prend la forme d’une anamnèse : « Il revivait l’enchaînement qui l’avait conduit à ce tribunal ».
Anamnèse : ce qui conduit au crime
On découvre alors le « quartier des Noirs de Marseille » (p. 74). Et on n’est pas déçu : « tous les groupes ethniques sont représentés. Gardant avec lui les coutumes de sa terre natale, chaque territoire a son propre canton : les bars. Les préjugés et l’originalité sont souvent l’objet de disputes. Il y a des Saracolés, les plus nombreux, pour qui la vie ne serait rien sans la navigation, bavards, criards, nonchalants, les plus conservateurs aussi. Les Soussous sont de nature fourbe, malins et craintifs. Les Mandingues calmes et lourds. Les Toucouleurs très nobles de gestes, descendants du conquérant El Hadj Omar… Les Mandiagues et les Diolas surnommés « les Bretons africains » pour leur amour du vin. Les Bambaras guerriers, sans qui la vaillance du soldat noir ne serait rien, commerçants aussi, marcheurs infatigables, fétichistes plus que tout » (p. 79). On se demande si c’est du lard ou du halouf ! Diaw est censé avoir 22 ans au début de l’histoire ; il est « natif de Yoff, d’une bourgade à quelques lieues de Dakar », détail amusant car Yoff est désormais le quartier dans lequel se trouve le futur ex-aéroport ! Malgré son âge, c’est à lui qu’on confie les formalités d’un enterrement. Son ami Paul est comme lui musulman, ce qui nous vaut une explication intéressante sur le choix des prénoms (sujet déjà abordé ici) : « Ce nom chrétien qu’il portait n’était pas un sobriquet, comme souvent certains de ses compatriotes qui, pour mieux se mêler, croient-ils, à la vie métropolitaine, ou au progrès, se donnent un surnom. Le sien était le résultat de liens d’amitié très profonds… Dans son pays, là-bas dans le Soudan (Mali actuel) avant sa venue au monde, le vieux Bacari Sonko, son père, s’était lié avec un toubabou (« blanc » en bambara), et durant des années les deux hommes fraternisèrent. Au point que les indigènes les surnommèrent « les frères de lait » (balodé). Pour mieux sceller son affection, Bacari promit à Paul de le faire parrain de son prochain fils et à l’encontre de la croyance… Voilà pourquoi le jeune Bambara portait ce nom » (p. 98). On entend les plaintes d’un vieux nègre : « J’ai fait les deux guerres à bord des bateaux. À la fin de la dernière, nous avons rallié la « France Libre ». J’étais graisseur, mes pieds suintaient, mais ils ne trouvaient pas, à ce moment-là, que ma peau salissait les draps, ni que j’étais très sale. Et maintenant ils ne nous acceptent pas. J’ai trente-cinq ans de navigation, j’ai pas droit à la retraite : même pour cela, faut aussi que je me naturalise Français… » (p. 105). Les syndicats ne sont pas épargnés : « ce sont les marins syndiqués qui ne veulent pas partager les cabines avec nous… Tu ne penses pas que le délégué syndical va débarquer son frère ou son cousin pour nous… Ils nous prennent pour des imbéciles » (p. 106). Les points de vue ne sont pas unanimes : « Nos pires ennemis… c’est nous-mêmes ! » (p. 109). On enchaîne avec les ennuis de M. Lazare, dont la fille enceinte de jumeaux, est avortée en secret par sa mère. Elle meurt, et Lazare le père, sombre dans le désespoir et fait arrêter sa femme et le médecin. Il ignore que sa fille était enceinte des œuvres de Paul, l’ami de Diaw : « sa mère n’accepterait pas plus un bâtard qu’un négrillon » (p. 133). Scène secondaire de kermesse, avec comme il se doit dans ces années 1950, « Des « Don Juan » à la figure de jeune premier y faisaient des relations. Les homosexuels déchaînés, guettaient leurs proies. Les madeleines, jupes collantes, racolaient… Au loin, en groupe, à la devanture du bar Ferréol, les Noirs palabraient, ne jetant que de temps à autre un regard indifférent sur ce qui se déroulait devant eux » (p. 119). Diaw ne trouve pas de travail, et se met à son second roman, en se documentant sur la Haute-Volta et sur les « maladies coloniales ». Il n’a pas de vrais amis, et Catherine espace ses visites. Diaw mène une rébellion contre les cadences infernales imposées aux dockers ; il se bat contre N’Gor, le chef d’équipe : « Alors merde ! Nous ne sommes pas des esclaves » (p. 143). Lors de cette séquence de grève, une phrase m’étonne : « C’est faisable ce qu’il a dit ? demanda Diaw à Alassane en sénégalais » (p. 146). Étonnant car à d’autres pages, le « ouolof » est nommé… Peut-être veut-il dire : « dans une langue sénégalaise comprise d’eux ». En tout cas, Diaw trouve de moins en moins d’emploi suite à cet exploit, et doit se replier sur un poste encore plus dur : « Dans la nouvelle entreprise qui l’employait, les machines et les hommes avaient une même consigne : « doubler » le rendement. Il leur passait des centaines de tonnes sur le dos, le travail laissait leurs bras endoloris, leurs cerveaux pantelants. Tous étaient sujets à des vertiges et à la dépression due au surmenage – cadences infernales… accélération de la machine ; chez ces robots humains, la prudence s’éteignait. Un ouvrier s’était fracturé la colonne vertébrale en tombant à fond de cale » (p. 173). Voici des accents qu’on retrouvera intacts cinquante ans plus tard dans La Sardine du cannibale, de Majid Bâ. Certaines discussions tentent de mettre de l’ordre dans les affres de l’intégration : « certains de nos rites pourraient être éliminés, d’accord, mais nos danses, c’est une culture. La nudité n’est pas une sauvagerie, mais purement une question d’acclimatation. Certes, il est parfois plus agréable de loucher vers une personne qui sort de la boutique d’un tailleur, que si elle se pavanait nue comme un ver. Seulement, les vêtements développent chez elle un besoin insatiable, qui la pousse à des vices effrénés. Et souvent, pour être à la page, elle agit d’une façon honteuse. Le respect ici… c’est une question d’accoutrement » (p. 188). C’est lors de cette discussion que Diaw apprend incidemment la publication de son livre volé par Ginette Tontisane. Aussitôt il monte à Paris, et c’est le meurtre en partie involontaire. L’analepse a rattrapé le récit du procès, et le verdict tombe : « travaux forcés à perpétuité ». Le dernier chapitre est une longue lettre de Diaw à son oncle, écrite au bout de trois ans de réclusion. Il se plaint. Sa mère est morte ; Catherine a sombré dans l’alcool et la prostitution. Il est déçu par ses rencontres avec l’aumônier de la prison, un prêtre : « Certes, tu me diras que je ne suis pas plus chrétien que musulman. J’attendais de lui des paroles qui sauraient me faire pleurer. Il ne m’a gratifié que de citations en latin » (p. 211). Il se remémore une « récitation » apprise à l’école : « Le dévouement des tirailleurs sénégalais / Pour leur chef est digne d’admiration. Ces braves gens se donnent tout entier / À celui qui les commande. » Internet nous révèle qu’il s’agirait à l’origine d’un passage en prose de La Force noire (1910) du général Mangin. Rien à voir avec le « Poème liminaire », de Léopold Sédar Senghor ! Cette lettre de colère s’achève en condamnant tous les vices de l’époque, dus selon Diaw au chômage qui sévit en Afrique : « D’où vous viennent les crimes, les avortements, l’empoisonnement, le vol, la prostitution, l’alcoolisme et la pédérastie ? Du chômage ! Vous avez trop de chômeurs ! Une accumulation de misère : tous les délits reposent là-dessus… Est-ce les églises ou les dirigeants qui ne sont plus au service de la masse ? Quoi qu’il en soit, le peuple agonise. Refusez donc de vous laisser diriger par ceux qui n’ont souci que de leurs intérêts personnels. » La « pédérastie » dans le même sac que les fléaux sociaux : voici un colonisé qui a bien appris les leçons du type amendement Mirguet.
– Du même auteur, lire nos articles sur Les Bouts de bois de Dieu et sur Xala et d’autres livres et un film. Sur la littérature africaine, lire cet article : L’arbre à tchatche, ainsi qu’un article sur un voyage au Bénin et au Togo, trois articles sur un voyage au Sénégal, sur la Littérature sénégalaise et sur Birago Diop.
© altersexualite.com 2017
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com