Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > L’Inde, regards croisés d’Alberto Moravia & Pier Paolo Pasolini
L’Inde éternelle, pas si éternelle que ça…
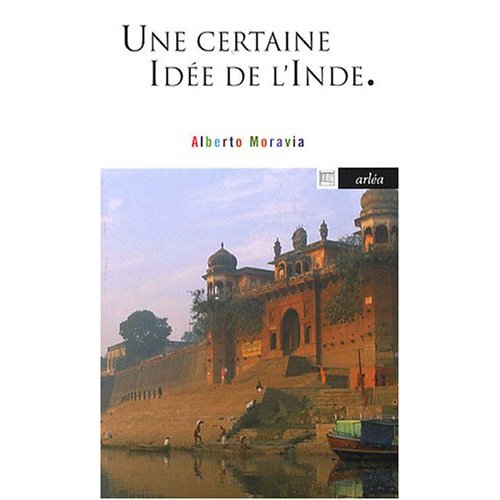 L’Inde, regards croisés d’Alberto Moravia & Pier Paolo Pasolini
L’Inde, regards croisés d’Alberto Moravia & Pier Paolo Pasolini
Mettre ses pas dans les pas des grands hommes
mercredi 23 août 2017
En 1961, Alberto Moravia, son épouse et le jeune Pier Paolo Pasolini voyagent en Inde. Séjour officiel d’une vedette de la littérature mondiale (qui est déjà venu en Inde 24 ans auparavant), reçu par Nehru, cornaqué d’un jeune poète altersexuel. Le circuit est traditionnel, proche de celui de Pierre Loti, mais les propos de Moravia, très documentés, constituent en un minimum de pages, un indispensable bréviaire qui, 56 ans après, m’a aidé à comprendre ce que je voyais, et à constater l’évolution, lente mais déterminée, de l’Inde vers la modernité, notamment par la disparition progressive de la misère évoquée par les deux comparses. Une entrevue finale permet à Moravia d’expliquer sa démarche : « c’est un pays d’une originalité extrême, un pays qui contraint le voyageur à « prendre position ». Pour ma part, cela consiste à accepter sans m’identifier ; pour Pasolini – et on peut le dire de toute sa vie – il s’agissait de s’identifier sans accepter vraiment. » Un article du Monde évoque ces deux visions différentes.
Une Certaine idée de l’Inde, d’Alberto Moravia
Extraits choisis. Éditions Arléa, 2008, 140 p., traduction Ida Marsiglio.
Aller directement à L’Odeur de l’Inde, de Pasolini.
« Les Européens s’imaginent le Moyen Âge comme un temps de malheurs, d’ignorance, de brutalité, d’obscurantisme et de misère. La persistance tenace de ce préjugé contre le Moyen Âge dans l’opinion populaire prouve une fois de plus à notre Indien que l’Europe, au fond, n’est pas religieuse. Et, en effet, les Européens considèrent la Renaissance comme la fin du Moyen Âge, alors que, du point de vue de l’Inde, cette période devrait s’appeler Décadence. » (p. 9).
Les bûchers de Bénarès. « On reste dix, vingt minutes, une demi-heure à regarder ces hommes et ces femmes qui regardent le feu dans lequel brûle leur défunt… À la fin, on comprend que leur indifférence stoïque n’est pas insensibilité, ni froideur, mais la conséquence d’une religion qui considère la mort comme un simple changement d’habit ou de dépouille. Dans ce bûcher, selon une métaphore bien connue, ne se consume pas une personne à jamais unique, mais un vêtement usé et qui ne servira plus, une peau vieille, abandonnée pour une neuve. Il est évident qu’une telle façon d’envisager la mort est préférable à celle que l’on connaît en Occident. Le problème de la mort, si l’on s’en tient à l’aspect formel et rituel, n’a jamais été résolu en Europe, et moins encore en Amérique. La mort, en Europe, est une affaire rhétorique et lugubre, d’une solennité ennuyeuse qui dissimule mal la terreur antique. […] Or en Inde la mort est légère, simple, philosophique et sans importance, comme peut-être elle l’était dans la Grèce antique. L’opération religieuse et psychologique ayant permis cette transformation a coûté – et coûte encore – à l’Inde un prix élevé d’inadaptation à la vie sociale, pratique et politique ».
La femme de Jinnah. « Quant à la géographie, elle ne se prêtait pas davantage à l’option nationaliste : il suffit d’examiner une carte pour se rendre compte que la nation indienne, tout comme l’Italie, a été voulue par la nature avant d’être une nation. » […] « Il n’y a pas d’écart plus important que celui qui sépare les religions musulmane et brahmanique : autant la première est éthique, sociale et politique, autant la seconde est cosmique, philosophique et métaphysique. La première pousse au fanatisme par vocation et nécessité, car elle prône l’universalité et l’expansion au plus haut degré – tous les hommes peuvent et même doivent devenir musulmans ; la seconde se veut tolérante – comme l’étaient les anciennes religions de la Grèce et de Rome ». […] « L’invasion islamique s’est faite par étapes, et de diverses façons. Au début, furent perpétrées toutes les exactions qui d’ordinaire accompagnent les conquêtes sanglantes. Pour ceux des Européens qui aiment l’art, la plus dramatique fut sans doute la destruction sauvage de milliers de temples brahmaniques dans le nord de l’Inde. Mais pour les Indiens, l’offense la plus cruelle fut le prosélytisme acharné auquel les envahisseurs les soumirent » [1]
« On dit que le sentiment d’humiliation et de honte dû à la rupture, puis aggravé et rendu en quelque sorte définitif par la mort de sa femme, influa de façon décisive sur la personnalité de Jinnah. Il s’enferma dans une solitude amère et devint irritable, dur, intransigeant. […] Jinnah rompit avec Gandhi, et cette dissidence donna naissance au Pakistan. La création du Pakistan fut pour l’Inde la source d’innombrables deuils et malheurs. » […] « Pour donner un aperçu de la violence et de la complexité des haines que le changement d’humeur de Jinnah déchaîna en Inde, il faut rappeler au moins un fait : l’islam aux temps les plus forts de son expansion religieuse dans le sous-continent se répandit surtout parmi les intouchables, autrement dit ces populations aborigènes à la peau sombre que les mythiques Aryens à peau claire avaient reléguées dans la caste la plus basse. Les raisons de cette conversion des intouchables à la foi musulmane (comme plus tard au christianisme) sont évidentes : méprisés, opprimés et indigents, les intouchables n’avaient rien à perdre et tout à gagner à devenir musulmans. C’est ainsi que, lors de la création du Pakistan, la fureur religieuse se doubla de haines raciales, sociales et sexistes, surtout au Bengale, où les intouchables étaient les plus nombreux. » [2].
Choc du polythéisme. « On s’explique mal qu’un voyageur venu des États-Unis, où travaillent et prospèrent des milliers de médecins psychanalystes, soit scandalisé, dans le temple de Tanjore, par exemple, où ces pulsions, qui selon la psychanalyse, seraient à l’origine de la plupart de nos actes, sont exprimées de façon symbolique à travers d’innombrables ex-voto naturalistes. » […] « Cette image des singes n’est sans doute pas la mieux choisie pour donner une idée des magnifiques sculptures qui recouvrent entièrement le gopura [du Temple de Mînâkshî de Madurai], mais elle traduit bien le caractère essentiel de l’art indien : la haine du vide, la prolifération délirante des ornements, l’abondance tumultueuse des figures. Un style qui semble directement inspiré de la nature tropicale, elle aussi foisonnante et compacte » […] « Et pourtant, en dépit, et peut-être à cause de tout ce bruit et de ce désordre, les symboles phalliques et naturalistes des divinités, enfermés dans la pénombre de minuscules salles, luisant d’huile votive et couverts de corolles de fleurs, conservent intact leur magnétisme obscur. »
Paperassophilie indienne
Voyager en Inde. « La ville indienne est un immense bazar, un entassement de boutiques aux allures moyenâgeuses et si, au premier abord, elle peut paraître pittoresque, dès lors qu’on y regarde de près elle est extrêmement monotone, de cette monotonie chaotique et un peu irritante qui caractérise la pauvreté comme l’absence de plan urbanistique. Quant à la campagne, elle n’est pas plus variée : de grandes plaines à la sérénité mélancolique, étalées sous une lumière éclatante et funèbre, mornes, sablonneuses, interminables. »
« À la fin du repas, il faudra écrire sur le grand registre son prénom suivi de son nom, de sa profession, âge, nationalité, lieu de provenance, destination, heure d’arrivée à la minute près, heure précise du départ, numéro de passeport, numéro de chambre et, si on le souhaite, quelques remarques ou appréciations sur l’endroit et l’accueil. »
Cet aspect n’a pas changé en 2017. La procédure d’obtention de visa a régulièrement évolué depuis quelques années, et je me souviens qu’elle était déjà fort complexe en 2003. J’avais opté à l’époque pour payer un prestataire, renonçant à jouer des coudes dans une foule compacte devant l’ambassade. Désormais, il vous faut compléter un questionnaire en ligne et en anglais, dans la lignée de celui que décrit Moravia. On vous demande par exemple, de cocher si vous êtes homme, femme, ou transgenre. Vous êtes un peu inquiet, mais il paraît que cela n’a aucune incidence. Tant mieux. Et pourtant, dans les aéroports, et partout dans le pays (toilettes, fouilles), vous n’avez que deux files : homme ou femme. Accordez vos violons ! Mais la rubrique qui m’a le plus fait flipper, est la rubrique des voyages antérieurs. On vous demande si vous êtes déjà venu en Inde. Je clique « oui ». Alors s’ouvre une fenêtre qui n’était pas visible avant qu’on cliquât, laquelle vous demande, lors de ce précédent voyage, quel était votre n° de visa, et quel était votre adresse de résidence ! Or je n’ai plus aucune archive de cette époque, mon passeport étant changé, et dorénavant détruit par l’administration. Comment aurais-je pu, à moins d’être un obsessionnel de la paperasse, prendre cela en note. Quant aux résidences, est-ce qu’on peut se souvenir du nom des hôtels à trois sous où l’on crécha quand on crapahuta 15 ans auparavant ? Mais il est impossible d’inventer un numéro bidon. Si vous ne pouvez pas renseigner la rubrique, vous êtes contraint à cliquer « non » à la question, et vous voilà coupable de fausse déclaration ! Comme on était en plein délire Trump aux États-Unis, j’ai vraiment flippé, et m’attendais à avoir des soucis à la frontière. Eh bien non, cela passe comme une lettre à la poste. C’est juste une pathologie sexuelle négligée par Freud, la paperassophilie ! Et cela se confirme dans les hôtels. Dans la plupart des pays, lorsqu’un groupe arrive dans un hôtel, il suffit souvent à l’accompagnateur de donner une liste des membres avec le numéro de leurs passeports et du visa, ou bien par sécurité, on peut se contenter de montrer une photocopie de notre passeport. Que nenni ! L’hôtelier veut le vrai passeport, qu’il photocopie à la page de l’état civil et à la page du visa, ce qui prend un temps infini. On vous rend en général le passeport le lendemain, et que faites-vous si vous êtes contrôlé en ville ? Et cela va si bien avec l’ignorance totale de toute notion d’écologie dans ce pays ! On gaspille, on photocopie tout et n’importe quoi pour le plaisir de se créer des règlements inutiles, qui empêchent la création de règlements utiles qu’on ne se donne pas la peine d’imaginer. On dirait donc que l’Inde souhaite freiner l’accès des touristes par ces procédures inquiétantes. Et pourtant, en parlant de vaches, le touriste est une sacrée vache à lait. Sur cette photographie prise au fort d’Agra, on distingue un double comptoir. « Foreign tourist » (vous, y compris le routard portant sa tente dans son sac à dos) à gauche : 500 roupies, soit 8 € (le change en 2017 était très facile pour les vieux comme nous, car l’euro valait 65 roupies à peu près, donc 500 roupies c’était 50 francs !) ; « Indian tourist » (eux, y compris les milliardaires de la famille Tata) à droite : 30 roupies. Pour le gouvernement indien, un étranger vaut 17 Indiens…

La pauvreté vue par Moravia
La pauvreté. « Tout étranger, même le plus distrait, qui séjourne à Calcutta et à Bombay, les deux plus grandes ville industrielles de l’Inde, reçoit involontairement un cours de sociologie accéléré sur le paupérisme. Le seul phénomène de la mendicité nous laisse supposer que la pauvreté en Inde n’est pas un problème contingent ni remédiable, mais plutôt un trait constitutif, si bien que toute tentative pour le modifier ou l’enrayer entraînerait de profonds changements dans le caractère même du peuple indien. En effet, ce qu’il y a de singulier chez les mendiants de ce pays, ce n’est pas tant leur nombre, certes très élevé, que leur façon naturelle et nécessaire de s’insérer dans le milieu social, comme des membres de droit d’une société qui justifie et même requiert leur présence.
Des mendiants accroupis dans leurs oripeaux aux portes des temples, la plupart atteints de la lèpre, mutilés ou difformes, alignés sur deux rangées comme des symboles vivants de la douleur, âgés de sept à quatre-vingts ans, aussi bien des hommes que des femmes, avec des visages empreints d’une expression si intense que point n’est besoin de se faire traduire leurs suppliques ; des mendiants autour du taxi, lorsque l’on quitte un magasin ou un hôtel, et dont on ne voit pas les têtes mais seulement les mains, qui se tendent frénétiquement par les vitres baissées jusqu’à vous effleurer le visage : cinq, dix mains, noires au dos, à la paume rosée ; celles, petites, des enfants, celles, menues et gracieuses, des jeunes femmes, celles, grandes et fortes, des travailleurs, et les mains ridées et noueuses des vieillards. » […] « La pauvreté indienne, nous l’avons dit, est visible surtout dans les villes de Bombay, Calcutta et Madras. Ce n’est sans doute pas un hasard si les trois ont été fondées par les Anglais, ce qui en fait des villes de type occidental où ce vieux fléau qu’est la pauvreté revêt une apparence moderne. […] Ces trois villes sont des villes victoriennes, c’est-à-dire un mélange infâme de styles hétéroclites, de laideur industrielle et de conditions de vie épouvantables comme on en rencontre aujourd’hui encore dans les quartiers des slums, à Londres ou Glasgow. » […] « Une seconde raison historique, tout aussi ancienne, explique le sous-développement et la misère de l’Inde. Elle est liée aux religions, ou plutôt à la dérive superstitieuse de conceptions religieuses par ailleurs profondes, telles que le brahmanisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Probablement à cause de son système de castes strict et rigide, l’Inde est peut-être le pays le plus conservateur au monde. C’est pourquoi la vie indienne est pleine de croyances obscures et irrationnelles, qui ont été conservées alors même qu’elles avaient perdu une grande part de leurs fonctions, notamment religieuses ; un peu à la façon de ces ménagères paresseuses ou avares qui gardent dans leurs armoires des chiffons et des bouteilles vides dont elles n’ont pas le courage de se séparer. Cette immense mosaïque de croyances fossiles paralyse la vie indienne car elle provoque des débats économiques considérables – on calcule qu’un tiers des récoltes est dévoré par les vaches, les oiseaux et d’autres bêtes qu’il est interdit de toucher pour des motifs religieux –, et entrave les progrès en matière d’éducation et de culture. » […] « Que représentaient, en effet, ces Anglais, sinon une caste supérieure à toutes les autres qui parvint sans difficulté (alors qu’ils n’étaient que cent mille) à assujettir trois cents millions d’Indiens, ces derniers ayant déjà été hypnotisés par les brahmanes qui leur avaient puissamment inculqué la notion de castes. »
Cauchemars et mirages. « Voir un seul lépreux ou une seule personne atteinte d’éléphantiasis est évidemment une chose triste ; mais voir des dizaines de lépreux, comme à Bénarès, par exemple, ou des dizaines de cas d’éléphantiasis, comme à Cochin, transforme votre tristesse en incrédulité – tout comme pendant un cauchemar on s’accroche à l’idée que rien n’est réel et que tout va disparaître au réveil. Tant d’autres aspects de la pauvreté indienne sont répétés, diffus, insistants sans jamais devenir véritablement normaux et acceptables ».
Tanjore. « Au moment où je lui donne, je vois le vieil homme à la peau presque noire incliner son dos osseux et tendre les deux mains réunies de façon à recevoir les pièces sans avoir à toucher mes mains. Après quoi il s’en va, laissant en suspens l’habituelle question : était-ce un brahmane, qui ne voulait pas se salir au contact de mes mains ou bien un intouchable qui ne voulait pas me salir avec les siennes ? »
« Nous sommes assis dans la voiture arrêtée devant le temple ; le chauffeur est descendu s’acheter des cigarettes. Et voilà qu’un monstre s’approche de nous. Nous disons un monstre car, au premier abord, il nous est difficile de le prendre pour un homme, bien qu’il marche et agisse comme tel. C’est un mendiant. Sa tête ressemble à celle d’un lézard ou d’une tortue : sans front, sans nez, sans menton. Rien que du pus et une bouche. Ce monstre ne dit pas un mot parce qu’il est certainement muet ; il se limite à passer à l’intérieur de la voiture une main noueuse tenant une sébile en aluminium parfaitement propre mais de cette propreté redoutable, caractéristique des objets irrémédiablement et profondément souillés. Nous regardons ses yeux : deux fentes sans éclat, et nous vient alors le doute que le monstre ne soit en plus aveugle, d’autant que sa petite tête, posée sur un cou très gros et très long, s’avance, hésitante, non pas vers nous, mais vers le siège vide du chauffeur. On croirait voir un serpent dirigeant sa gueule çà et là pour trouver quelque chose ou quelqu’un à mordre. »
Colonialisme et symbiose.
Colonialisme et symbiose. « Le colonialisme traditionnel des Français, des Portugais et des Hollandais nous apparaît comme une piraterie raisonnable, qui affiche clairement ses fins et ses moyens, sait se limiter et ne recourt que modérément à la cruauté. Le colonialisme des Anglais, en revanche, même sous des apparences de respectabilité victorienne, a quelque chose d’irrationnel, d’extravagant, d’excessif et, par conséquent, de très dur, de très cruel et punitif. Tandis que les premiers ne cherchaient que leur profit et le faisaient ouvertement et sans vergogne, les Anglais, eux, éprouvèrent dès le début le besoin de se dissimuler et d’apporter des justifications morales à leurs intérêts, si bien que le slogan impérialiste de Kipling, the White Man Burden, le « fardeau de l’homme blanc », fut la dernière trouvaille d’une vieille hypocrisie. […] C’est pourquoi, sans perdre de vue le jugement historique qui ne peut être que négatif, il nous semble que, dans les rapports anglo-indiens, au lieu de parler de colonialisme il serait plus juste d’évoquer une symbiose. […] Que les Anglais aient transformé l’Inde, en bien ou en mal, voilà un fait incontestable. Quant aux transformations que l’Inde a produites en Angleterre, elles sont avant tout de nature politique et psychologique. Sincèrement et intensément vécu dans son inextricable complexité, le problème indien contribua sans nul doute et mieux qu’aucun autre facteur à donner à l’Angleterre son visage de grand pays moderne, exempt de provincialisme, de nostalgie et de toutes les rhétoriques propres aux nations colonialistes. Ce qui est démontré par la façon dont les Anglais ont dissous la symbiose et quitté l’Inde : sans brutalités et avec beaucoup d’élégance. […] si l’on compare le colonialisme anglais aux invasions précédentes, la notion de symbiose devient évidente. Que furent l’invasion et l’occupation islamiques, durant huit siècles, sinon une symbiose plus réussie et féconde, du moins dans le domaine artistique, que celle des Anglais, mais tout aussi absurde et insensée ? L’islam n’avait rien de commun avec l’Inde, en aucune façon, et pourtant il s’y établit durablement, fusionna avec elle pour donner naissance à la civilisation indo-islamique. D’autre part, la mythique migration des Aryens n’était-elle pas elle aussi une symbiose ? Le système de castes qu’ils créèrent au grand dam des populations aborigènes, si ingénieux, si injuste et si pérenne, ne donne-t-il pas l’impression d’un phénomène plus biologique que social et politique ? » […]
« Nous pourrions ainsi en conclure que le colonialisme, du moins jusqu’à ces temps derniers, est une fatalité de l’Inde ; qu’il se présenta toujours sous forme de symbiose ; que ces symbioses, contrairement à celles qu’on observe dans la nature, ne parvinrent jamais à se maintenir tout à fait ; les Anglais furent chassés après un siècle et demi d’occupation ; les envahisseurs islamiques après huit siècles de cohabitation ; quant aux Aryens, aujourd’hui, leur système de castes vole en éclats et l’Inde moderne, démocratique et industrielle, sera probablement tout sauf brahmanique. En réalité, ce qu’on appelle le nationalisme indien, n’est autre que l’éternelle Inde aborigène qui toujours finit par compromettre, repousser et dissoudre les symbioses ».
L’impureté. « L’Europe n’a connu à ce jour que le racisme nihiliste et mortifère des nazis ; mais en Inde, l’Occidental découvrira un système social entier, celui des castes, qui, pendant quelques milliers d’années, s’est appuyé sur un fondement raciste archaïque, cruel certes, mais jamais nihiliste ni destructeur. […] En Europe, on attribue souvent au racisme des causes sociales et économiques. Le racisme archaïque indien semble y avoir ajouté d’emblée d’autres raisons, et en particulier une irritation ou aversion de type irrationnel et physiologique. Cette irritation ou aversion porte un nom, qui revient fréquemment aujourd’hui encore dans la vie indienne : l’impureté. Il est vrai que les castes indiennes furent créées par un peuple envahisseur, les Aryens, afin d’asservir un peuple envahi, les Dravidiens […]. Le sentiment d’impureté en Inde naquit donc de la réaction d’une race à peau claire face à une race à peau brune ; mais il est probable que, bien vite, cela vira à l’obsession. Il suffit de consulter le plus sacré des livres sacrés de l’Inde, les Lois de Manu, pour mesurer l’intensité du sentiment d’impureté chez les Indiens d’autrefois. » […]
« Mais, curieusement, ce qui est impur pour un Indien ne l’est pas pour un Occidental – et réciproquement –, de sorte qu’en Inde l’étranger sera sans cesse surpris de voir avec quel soin méticuleux les Indiens font leurs ablutions ou prennent certaines précautions qui lui sembleront superflues, voire absurdes, alors qu’ils resteront indifférents devant l’aspect sordide et crasseux caractéristique des quartiers les plus pauvres de leurs villes. En fait, ainsi que je l’ai déjà dit, le sentiment d’impureté des Indiens n’a rien de commun avec celui des Occidentaux : pour les premiers, il est intimement mêlé à la religion et revêt une signification symbolique ; pour les seconds, il est lié à des considérations d’ordre hygiénique et scientifique, et il procède de la crainte objective, quoique parfois infondée, de la contagion et des maladies. »
Le scandale de Khajuraho. « D’où vient que les Indiens furent les seuls à ressentir le besoin de représenter l’acte sexuel et à en faire ainsi un objet de beauté ?
La réponse nous est donnée par les sculptures elles-mêmes, par leur signification et leur justification idéologique. Les sculptures de Khajuraho représentent des divinités des deux sexes, lesquelles, en s’accouplant de la façon que nous avons évoquée, témoignent d’une volonté double, qui est de décrire l’acte sexuel avec réalisme et de représenter le désir ineffable, cosmique et divin qui, selon la religion indienne, est à l’origine de toute chose. Autrement dit, à Khajuraho, nous nous trouvons face à un discours analogue à celui de la Genèse. Ces femmes et ces hommes enlacés dans des poses érotiques ne sont guère différents de ces Adam et Ève que l’on voit partout en Occident sculptés sous l’arbre de l’Éden autour duquel s’enroule le serpent tentateur. »
L’Odeur de l’Inde, de Pier Paolo Pasolini
Comme son titre l’indique, le jeune poète, qui écrit après le maître Moravia un texte plus court, s’appuie sur une expérience plus sensible de l’Inde, et rencontre force garçons. Extraits choisis.
« Je ne sais pas très bien ce qu’est la religion indienne ; lisez les articles de mon merveilleux compagnon de voyage, Moravia, qui s’est documenté à la perfection, et, pourvu d’une plus grande capacité de synthèse que moi, a sur ce sujet des idées très claires et bien fondées. […] J’ai essayé d’en parler avec de nombreux hindous : mais aucun d’entre eux n’a la moindre idée à ce sujet. Chacun a son culte, Vishnu, Siva ou Kali et en observe scrupuleusement les rites. »
« Il suffit de considérer leur manière de dire oui. Au lieu de hocher la tête comme nous, ils la secouent, comme quand nous disons non : la différence de geste n’en est pas moins énorme. Leur non qui signifie oui consiste dans une ondulation de la tête (leur tête brune, dansante, avec cette pauvre peau noire, qui est la couleur la plus belle que puisse avoir une peau), avec tendresse, dans un geste empreint de douceur : « Pauvre de moi, je dis oui, mais je ne sais pas si c’est possible ! », et d’embarras, en même temps : « Pourquoi pas ? », de peur : « C’est si difficile », et même de coquetterie : « Je suis tout pour toi. » La tête monte et baisse, comme légèrement détachée du cou, et les épaules ondulent également un peu, avec un geste de jeune fille qui vainc sa pudeur et montre effrontément son affection. Vues de loin, les foules indiennes restent gravées dans la mémoire, avec ce geste d’assentiment, et le sourire enfantin et radieux dans le regard, l’accompagnant toujours. Leur religion tient dans ce geste. »
« La non-violence, en quelque sorte, la douceur, la bonté des hindous. Ils ont peut-être perdu contact avec les sources directes de leur religion (qui est évidemment une religion dégénérée), mais ils continuent à en être des fruits vivants. Ainsi, leur religion, qui est la plus abstraite et la plus philosophique du monde, en théorie, est, en fait, en réalité, une religion totalement pratique : une manière de vivre. »
« Sœur Teresa essaie de faire quelque chose : comme elle le dit, il n’y a que les initiatives de son type qui puissent être utiles, parce qu’elles partent de rien. La lèpre, vue de Calcutta, a un horizon de soixante mille lépreux, vue de Delhi, elle a un horizon infini. »
« En naviguant, je fis un peu mieux connaissance avec Revi mais, pauvre petit, il n’y avait presque rien à savoir à son sujet : il était de Trivandrum, un autre port de l’État de Kerala. […] sa mère, Appawali, était morte, son père, Appukutti, il ne savait plus rien de lui. Il vivait ainsi, au petit bonheur la chance, sur les docks de Cochin » […]. « J’allai faire mon tour, à travers l’île qui était totalement aride et déserte, et lui derrière. À un certain moment, il osa même me prendre par la main ». [Pasolini cherche à venir en aide au jeune garçon par l’intermédiaire d’une organisation caritative] « Il est vrai que les jeunes abandonnés en Inde se comptent par millions : mais il y a aussi des millions de lépreux, et comme il y avait sœur Teresa à Calcutta, il pouvait y avoir ici aussi quelqu’un qui partageât son idéal de vider la mer avec un dé à coudre ».
« Nehru a déclaré publiquement, devant la totalité de ses quatre cents millions de concitoyens qu’il n’était pas croyant, que la religion était certes une belle chose, mais qu’elle ne l’intéressait personnellement pas du tout. Cette extraordinaire liberté de pensée, ce manque intégral d’hypocrisie est l’un des faits les plus remarquables de l’époque où nous vivons ».
« Peut-on concevoir un peuple moderne où soient maintenus des millions d’intouchables ? […] L’unique différenciation entre un individu et un autre est, en pratique, son crédo et son rite religieux : ce à quoi, précisément, les individus se raccrochent avec une folle ténacité, en se spécialisant avec un particularisme qui ne sert à rien, c’est la pure et maniaque extériorité rituelle.
C’est pourquoi tout Indien tend à « se fixer », à se reconnaître dans l’aspect mécanique d’une fonction, dans la répétition d’un acte. Sans ce mécanisme et cette répétition, son sentiment d’identité recevrait un sale coup : il tendrait à se défaire et à s’évaporer. C’est pourquoi, à tous les niveaux, les Indiens apparaissent comme codifiés. C’est ce qu’on appelle conformisme en Europe, mais qui ici, n’étant ni bourgeois ni petit-bourgeois, mais traditionnel, d’une tradition ancienne et désespérée, n’a rien de mesquin ni de restreint : la petitesse à laquelle il réduit l’homme a quelque chose de grandiose. »
« Il serait agréable, par amour pour l’Inde, amour auquel aucun visiteur ne peut se soustraire, que Nehru se rendît compte que l’Inde se trouve dans un « état d’urgence », et que, pour cette raison, il est autorisé à opérer des transgressions dans la rigide grammaire parlementaire anglaise : non seulement autorisé, mais je dirais même obligé. Sans un gouvernement d’urgence, il est difficile de pouvoir arracher les Indiens à la mort à laquelle les vouent les castes, c’est-à-dire de faire avancer l’Inde, ne fût-ce que d’un pas. »
Le Taj Mahal « Un haut soubassement, avec une avancée d’une centaine de mètres, tout en marbre ; la porte, avec le petit escalier de marbre ; la cour, suspendue, de marbre, avec, au milieu, un long canal pour les ablutions, entre quelques zones de gazon brillant ; sur les côtés, le long des murailles de marbre, les quatre portes de marbre, et, en face, le grand édifice, semblable à nos baptistères, en marbre, avec le minaret de marbre. Tout étincelle de blancheur glacée sur le fond d’un ciel qui sombre sur les méandres du large fleuve.
Un vrai glacier. La poésie musulmane, pratique et non figurative en même temps, pragmatique et antiréaliste en même temps, se retrouve en Inde comme dans un monde qui n’est pas le sien. La sensualité cadavéreuse du paysage indien régit, comme des corps étrangers, dans ses clairières salgariennes, les monuments des dominateurs musulmans. Enfermés dans leur géométrie abstraite, fonctionnelle, comme des prisons dorées. »
Des chambres d’hôtel inquiétantes ! « Et les chambres… à vous nouer l’estomac : de misérables petits lits, avec des matelas aux couleurs équivoques, de grosses armoires, royaumes des cafards, et, naturellement, des cobras… »
« Bénarès. Rien de nouveau : les rues du centre sont de grandes rues de marchés, avec les boutiques accumulées sous les maisons bringuebalantes aux vérandas de bois et l’inévitable foule affamée, sale et dévêtue. Naturellement, les vaches.
Mais il flotte un air, comment dire ? plus intègre. Et un plus grand bien-être, comme toujours, là où la religion est l’objet d’une spéculation, fût-elle misérable. […]
Le guide nous recommande de ne donner à personne la moindre aumône : nous descendons du taxi et nous nous dirigeons vers la rive du Gange.
Nous nous engageons dans une rue bordée de murettes, de taudis, d’enclos, peut-être des murs d’entrepôts, de plus en plus étroite et obscure.
Elle grouille de pauvres êtres à demi nus, dans ce ballet inévitable et sordide de va-et-vient : nous en sommes entourés, pressés de tous côtés. Sur le sol scintillant de je ne sais quels atroces liquides, des files de corps sont étendues : il est tard, et beaucoup dorment déjà, là, par terre, au bord de la rue. Chacun a sa place, là où il se couche, le soir ; souvent, ce sont des familles entières enveloppées dans les mêmes charpies. Certains ne dorment pas, mais c’est comme s’ils étaient déjà couchés et attendaient de trouver le sommeil en regardant le paysage. Certains continuent encore à mendier, en tendant la main. Ce sont des lépreux, des aveugles atteints de trachome, des êtres minés par la maladie de Cochin qui dilate monstrueusement les membres : tous patients devant le mal et enragés devant les nécessités immédiates. Ils tendent spasmodiquement la main. Tout le long de la rue, il y a cette assemblée pitoyable, cet amas inextricable de membres et de guenilles. Et puisque l’air est glacé et obscur, on avance comme à tâtons, en perdant le sens de l’orientation sans bien comprendre ce qui nous entoure. »
« Autour des bûchers, nous voyons beaucoup d’Indiens, recroquevillés, avec leurs inévitables guenilles. Aucun ne pleure, aucun n’est triste, aucun ne se préoccupe d’attiser le feu : tout le monde semble simplement attendre que le bûcher s’éteigne, sans impatience, sans le moindre sentiment de douleur, ou de peine, ou de curiosité. Nous marchons entre eux qui, toujours aussi tranquilles, gentils et indifférents, nous laissent passer, jusque tout près du bûcher. On ne distingue rien, simplement du bois bien arrangé et attaché, au milieu duquel le mort est serré : mais tout se consume et les membres sont indiscernables des bûches. Il n’y a aucune odeur, sinon, l’odeur délicate du feu.
Comme l’air est froid, Moravia et moi, nous approchons instinctivement des bûchers, et, en avançant, nous nous apercevons rapidement que nous éprouvons la sensation agréable de nous réchauffer à un feu, l’hiver, avec nos membres transis, heureux d’être là, avec un groupe d’amis de rencontre, dont les visages et les guenilles sont placidement diaprés par une flamme qui laborieusement agonise.
Ainsi, réconfortés par la tiédeur, nous regardons à la dérobée, de plus près, ces pauvres morts qui se consument sans ennuyer personne. Jamais, en aucun lieu, à aucun moment, dans aucun acte, durant tout notre séjour indien, nous n’avons éprouvé un aussi profond sentiment de communion, de tranquillité, et, presque, de joie ».
Je termine cette lecture de Pasolini sur ce point, et suis désolé d’opiner du chef. On va tous mourir, bon, et alors ? En tout cas j’étais bien plus serein à la fin de ce voyage qu’au début.
Facile à dire, et l’on verra si quand viendra le tour de mes proches et de moi-même je serai aussi flegmatique…
– Retourner à mes Notes de voyage en Inde. Lire aussi L’Inde sans les Anglais, de Pierre Loti (1903). À propos de Moravia & Pasolini, lire un article sur le site FantastikIndia.
Voir en ligne : Article sur le site FantastikIndia
© altersexualite.com 2017.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Je présente mes humbles excuses pour publier ces pensées immondes d’un auteur mussolinien qui s’imagine, le salaud, que des gentils musulmans puissent être coupables de colonialisme ! Non, entendons-nous bien : le crime contre l’humanité appelé « colonialisme » ne saurait être que le crime exclusif du méchant Européen blanc et chrétien. Moravia est donc un irréductible fasciste quand il écrit cela.
[2] Le Bengladesh se sépara du Pakistan en 1971, après avoir constitué le « Pakistan oriental » entre 1955 et 1971.
 altersexualite.com
altersexualite.com
