Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > Les Bouts de bois de Dieu, d’Ousmane Sembène
Germinal africain, à partir de la 3e
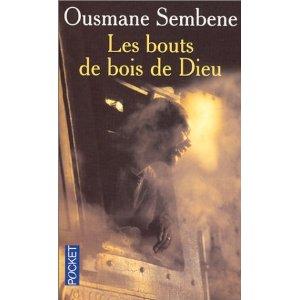 Les Bouts de bois de Dieu, d’Ousmane Sembène
Les Bouts de bois de Dieu, d’Ousmane Sembène
Pocket, 1960, 382 p., 5,7 €
samedi 19 avril 2014
Publié quatre ans après Le Docker noir, Les Bouts de bois de Dieu (Banty Mam Yall en wolof) est l’histoire basée sur des faits vrais d’une longue grève de cheminots qui s’est déroulée « du 10 octobre 1947 au 19 mars 1948 » sur la ligne de chemin de fer de Dakar au Niger. Le texte est daté de « Marseille, octobre 1957-février 1959 ». Le récit nous mène de Thiès à Dakar et Bamako, où des personnages attachants se battent contre les chefs blancs et les chefs noirs affidés, et contre la fatalité. Les femmes jouent un grand rôle, et les relations intimes ne sont pas oubliées. Sans concessions, ce roman constitue un phare de la littérature francophone à ses débuts, moins consensuel que L’Enfant noir, de Camara Laye. On peut le lire ou faire lire à des élèves de seconde par exemple en parallèle avec Germinal d’Émile Zola. Il me semble me souvenir que ce livre figura dans une liste officielle de romans conseillés pour les classes de collège, mais impossible de remettre la main dessus. Parmi les thèmes abordés, la question de la polygamie me semble intéressante avec le recul, car nous avons oublié que déjà à cette époque la colonie se servait de ce prétexte pour discriminer les indigènes qu’elle exploitait, comme la bonne conscience de gauche ou de droite s’en sert encore aujourd’hui pour vouer aux gémonies les communautés allogènes.
Violence
Les chapitres du livre nous font sauter de ville en ville, pour suivre le déroulement de la grève, par laquelle les cheminots réclament l’égalité des salaires avec les blancs, des allocations, une retraite, etc. L’une des premières scènes de violence est insoutenable. L’aveugle Maïmouna, qui traîne ses deux jumeaux dont elle refuse de dire qui est le père, est laissée en arrière par ses compagnes au moment où charge la troupe : « Le jumeau qui lui avait échappé s’amusait avec les rayons d’une roue de bicyclette. Un homme qui fuyait prit le guidon et tira violemment, l’enfant hurla, l’homme abandonna la bicyclette qui tomba sur le bébé. À ce moment arriva Bachirou que poursuivaient les miliciens. Bachirou d’un bond souple sauta par-dessus l’engin, mais les lourds brodequins des soldats passèrent sur le cadre et la roue arrière dont l’axe reposait sur le crâne de l’enfant. Les gémissements s’arrêtèrent sur une petite plainte d’animal blessé. Serrant le deuxième bébé dans un bras, Maïmouna, l’autre main tendue en avant, entendit la plainte, mais au même instant quelqu’un, en courant, la bouscula » (p. 49). Le récit ne s’attarde jamais sur une scène tragique, il suit la grève et va de l’avant, quitte à y revenir plus tard, mimant l’insensibilité des Européens. La scène finale retournera le procédé, puisque la victime sera une blanche. Quant au père des enfants, nous saurons qui il est – un type qui avait profité de l’aveugle pour la violer – peu avant qu’il ne soit tué par la troupe (p. 313). On relève aussi une scène où l’ignoble Isnard tue de sang froid deux enfants (p. 250).
Portraits croisés
Les blancs et les noirs sont présentés sans concession, en quelques lignes qui témoignent d’un sens du détail très cinématographique. Par exemple Dejean, principal chef qui croit mater la grève facilement. Il s’agit d’un « employé zélé » qui doit sa promotion à la guerre : « Lorsque les hommes de Vichy prirent les affaires en mains, le directeur général, qui n’était pas pétainiste, disparut. Dejean le remplaça. Depuis, il avait gardé le poste » (p. 58). Le pire salaud est un garde-chiourme corse, qui maltraite les prisonniers qu’on lui confie avec des raffinements sadiques (p. 362). Une description du quartier colonial n’est pas sans rappeler Un Barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras : « Des fleurs en pots ou en caisses ornaient les balustrades. Dans les jardins qu’ombrageaient les bougainvilliers, des massifs de roses, de marguerites, de gueules-de-loup faisaient des vaches (sic) vives » ; « Les femmes n’attendent pas d’accoucher qu’elles sont déjà pleines » (p. 253/255). Il y a aussi le blanc qui tente de pactiser avec les noirs, nommé… « Leblanc » dans le texte ! : « la déchéance de Leblanc était moins le fait d’une ambition déçue que celui d’une attente découragée. C’est en vain qu’il avait tenté de nouer des relations amicales avec des Africains, son savoir les intimidait, sa timidité les tenait à distance. Cette hostilité ou plutôt cette absence de réponse à ses avances l’avait peu à peu découragé, l’alcool avait accentué son amertume et avait fini par faire de lui un être déchu dont les Noirs riaient et que les Blancs méprisaient » (p. 259).
Beaugosse est un cas intéressant côté noirs : « Beaugosse, toujours en slip, continua de secouer sa couverture. Il méritait bien son surnom – son vrai nom était Daouda — car, au milieu de ce monde de misère, il était agréable de le regarder. Quatre mois plus tôt il était sorti du centre professionnel en qualité de tourneur. Ses premiers contacts avec les ouvriers avaient été très durs, car en tous lieux et en toutes circonstances il aimait à être élégant et sa paie entière était consacrée à satisfaire son perpétuel désir de paraître » (p. 71). N’Deye Touti est l’écrivaine publique. Nourrie de films et de livres européens, elle hait la polygamie et le mode de vie africain, et l’auteur en profite pour glisser une mise en abyme de la littérature africaine : « Les gens parmi lesquels elle vivait étaient polygames et N’Deye n’avait pas tardé à comprendre que ce genre d’union exclut l’amour, du moins l’amour tel qu’elle le concevait. Et cela lui avait permis de mesurer ce qu’elle appelait leur « absence de civilisation ». Dans les livres qu’elle avait lus, l’amour s’accompagnait de fêtes, de bals, de week-ends, de promenades en voiture, de somptueux cadeaux d’anniversaire, de vacances sur des yachts, de présentations de couturiers ; là était la vraie vie et non dans ce quartier pouilleux, où à chaque pas on rencontrait un lépreux, un éclopé, un avorton. » […] Mais elle n’avait jamais lu un livre d’un écrivain africain, elle était sûre d’avance qu’une telle lecture ne lui aurait rien apporté ». (p. 100). N’Deye porte un soutien-gorge en secret : « elle mesurait du doigt la croissance de ses seins et se torturait à la pensée qu’un jour ils tomberaient comme ceux des autres femmes dont elle regardait à la dérobée les poitrines plates ballotter sous les pagnes » (p. 101). On la voit et on la traite de « vache pleine qui se promène tout habillée dans la maison sur deux pattes ». Plus tard, ironie du sort, N’Deye est surprise par une patrouille de soldats blancs. Ils la traitent précisément de « vraie petite vache normande », et renoncent à se la taper pour « deux kilos de riz », de peur de se « faire lapider » (p. 187). Il y a aussi le Tartuffe El Hadji Mabigué, qui cache son avarice et son égoïsme sous le masque de l’islam (cf. p. 81), qui refuse à sa propre sœur de lui prêter un peu d’argent pendant la grève. Les grévistes musulmans pratiquent avec discrétion, et rembarrent les traîtres qui pactisent avec les Européens et tentent d’utiliser la religion comme prétexte pour arrêter la grève (belle scène où le « Sérigne », dignitaire musulman anti-communiste, exhorte les grévistes à arrêter, les traitant d’athées et d’hérétiques, p. 196, ou intervention des imams, p. 318). Fa Keïta est au contraire un musulman sincère, qui tente de prier dans le camp de prisonniers, et doute de l’existence de Dieu quand il constate le mal que lui apportent ces prières (p. 367). Il en tire des paroles de sagesse : « Si l’on tue un homme comme celui-ci, il y en a un autre pour prendre sa place. Ce n’est pas ce qui est important. Mais faire qu’un homme n’ose pas gifler parce que de votre bouche sort la vérité, faire que vous ne puissiez plus être arrêtés parce que vous demandez à vivre, faire que tout cela cesse ici ou ailleurs, voilà quelle doit être votre occupation, voilà ce que vous devez expliquer aux autres afin que vous n’ayez plus à plier devant quelqu’un, mais aussi que personne n’ait à plier devant vous » (p. 367). Bakayoko est conscient de la nécessité du progrès : « L’homme que nous étions est mort et notre seul salut pour une nouvelle vie est dans la machine, la machine qui, elle, n’a ni langage, ni race » (p. 127). Un personnage indécis, Sounkaré, devenu impuissant suite à une maladie, ne fait pas grève, et finit affamé, dévoré par des rats dans la solitude du dépôt qu’il garde (p. 215). Je relève un détail : un personnage parle de « Tougueul » pour désigner la France, mot qu’on avait déjà lu dans Le Docker noir, et qu’on retrouvera dans La Civilisation, ma Mère !…, de Driss Chraïbi, où il est une déformation de « De Gaulle ». On relève une mise en abyme de la vie ouvrière : Bakayoko emmène ses amis Beaugosse et Oulaye au cinéma, voir un film dont le titre n’est pas donné, qui « se déroulait dans une mine ; il y avait eu un éboulement, des gens hurlaient, des femmes pleuraient […] les hommes sur l’écran ressemblaient à des Noirs » (p. 227). De bons extraits sont les scènes de négociation ou d’argumentation. Par exemple, entre les meneurs et les représentants de la compagnie, où c’est à couteaux tirés, p. 278.
Les femmes locomotives
Les femmes montrent leur vaillance et montent en pression comme des locomotives tout au long de l’œuvre. Le parallèle est d’ailleurs proposé par Bakayoko entre la locomotive et la grève : « Quand je suis sur la plate-forme de mon Diesel, je fais corps avec toute la rame, qu’il s’agisse des voyageurs ou des marchandises. Je ressens tout ce qui se passe le long du convoi, dans les gares, je vois les gens. Mais dès que la machine est en route, j’oublie tout. Mon rôle n’est plus que de conduire cette machine à l’endroit où elle doit aller. Je ne sais si c’est mon cœur qui bat au rythme du moteur ou le moteur au rythme de mon cœur. Pour moi, c’est ainsi qu’il en est de cette grève, nous devons faire corps avec elle… » (p. 323). Ces femmes sont en première ligne d’abord pour trouver à manger coûte que coûte, puis pour se défendre contre les flics, avec par exemple une bataille rangée que n’aurait pas désavouée Brassens : « Mame Sofi qui avait repéré près de la cabane un policier de petite taille, l’assomma d’un seul coup de ses bouteilles de sable » (p. 125). Plus tard, elles racontent comment l’une d’elles a voulu « pisser dans la bouche » d’un « cochon » de soldat ! (p. 177). Puis elles participent au jugement d’un « jaune » : « C’est une de ces écervelées de femmes. […] On vit s’avancer une femme au visage couturé de cicatrices, aux lèvres tatouées. Elle avait cru bon de mettre ses plus beaux habits pour la circonstance. Tiémoko lui fit place à côté de lui sur le banc » (p. 150). Cette scène de tribunal populaire constitue un bon exemple de lecture scolaire de texte argumentatif. Ad’jibid’ji, une petite fille, se glisse en profitant de sa petite taille, dans toutes les assemblées d’hommes : « Pourquoi veux-tu tellement assister à ces réunions ? — Il faut bien apprendre son métier d’homme. Le Vieux avait ri de bon cœur : — Mais tu n’es pas un homme ! — Petit père dit que demain femmes et hommes seront tous pareils. — Et quel métier veux-tu faire ? — Conduire l’express comme petit père, il dit que c’est le plus beau des métiers » (p. 157). Ces notations s’opposent à la femme soumise africaine : « Assitan était une épouse parfaite selon les anciennes traditions africaines : docile, soumise, travailleuse, elle ne disait jamais un mot plus haut que l’autre. Elle ignorait tout des activités de son mari ou du moins faisait-elle semblant de les oublier. Neuf ans auparavant, on l’avait mariée à l’aîné des Bakayoko. Sans même la consulter, ses parents s’étaient occupés de tout » (p. 170). Son mari est tué « lors de la première grève de Thiès », mais elle accouche précisément d’Ad’jibid’ji, puis épouse le cadet du défunt : « Elle fut aussi soumise à Ibrahima qu’elle l’avait été à son frère. Il partait pour des jours, il restait absent des mois, il bravait des dangers, c’était son lot d’homme, de maître. Son lot à elle, son lot de femme était d’accepter et de se taire, ainsi qu’on le lui avait enseigné ». On voit comment le progrès des mœurs perce en dents de scie selon Sembène, puisque ce cadet est celui qui, au travers de la grève, impose aux hommes une place de premier plan pour les femmes. Il fait ce qu’il peut pour pousser Assitan à s’émanciper, lui propose par exemple d’« apprendre la langue des toubabs » (p. 364).
Prostitution & polygamie
Penda joue un rôle important. C’est une femme libre de mœurs, qu’Awa, drapée dans sa dignité, traite de « piting » (putain, p. 223). Lahbib, meneur de la grève, l’embauche pour distribuer les vivres. Elle se fait respecter des femmes et des hommes, et finit même par se réconcilier avec Awa, en menant la fameuse marche des femmes (cf. ci-dessous). Elle connaîtra un sort tragique. Extrait : « Un jour qu’au syndicat où elle venait assez souvent et se rendait utile, un ouvrier lui avait maladroitement touché les fesses, elle le gifla publiquement ce qui ne s ’était jamais vu dans le pays » (p. 224). N’Deye Touti, qui demande à Bakayoko de l’épouser en 2e rang, évoque Penda, et Bakayoko défend la prostituée : « Il y a plusieurs façons de se prostituer, tu sais. Il y a ceux qui le font sous la contrainte : Alioune, Deune, Idrissa, moi-même, nous prostituons notre travail à des gens que nous ne respectons pas. Il y a aussi ceux qui se prostituent moralement, les Mabigué, les N’Gaye, les Daouda. Et toi-même ? » (p. 342). Une scène de transition montre des garnements qui surprennent la femme du marchand Syrien nue : « Bientôt, elle fut complètement nue et, de sa main gantée de tissu éponge, elle se mit à laver son corps blanc comme de la chaux » (p. 244). Ces enfants sont commandités par les femmes pour voler de la nourriture aux blancs et au marchand syrien.
La polygamie fait l’objet d’un traitement instructif. Condamné par certains personnages comme pratique rétrograde, elle est aussi condamnée moralement par les blancs comme pratique de sauvages. Mais l’un des blancs les plus pourris, Isnard, tente d’acheter l’un des meneurs en le flattant ainsi : « tu prendras ma place ; et ce n’est pas deux épouses que tu pourras avoir, trois ou quatre… sacré veinard ! » (p. 235). Comme le noir ne se laisse pas corrompre, Isnard se met en colère et le traite de « Salaud, sale bougnoul » (p. 238), injure que je croyais réservée aux Arabes, mais qui est en fait un terme emprunté au wolof, signifiant « esclave ». Voir l’article du Wiktionnaire. La polygamie est un prétexte pour refuser les allocations familiales aux grévistes : « Ce généreux monsieur vient nous annoncer que les allocations familiales sont conditionnées par les résultats du dernier bilan. Ne serait-il pas plus exact de dire qu’on ne veut pas nous les accorder sous prétexte que nous sommes polygames ? » (p. 270). N’Deye Touti évolue sur le sujet, quand elle demande à Bakayoko d’être sa seconde épouse : « Je me suis dit que si tu refusais, ce serait parce que, après t’être déclaré publiquement contre la polygamie, il te serait difficile de te déjuger. Je sais encore que tu es vraiment contre. Moi aussi je l’étais, c’était une de nos coutumes que je ne pouvais comprendre, que je détestais même. Et puis il arrive que l’on se mette à aimer ce que l’on croyait détester… » (p. 343).
« La marche des femmes » : extrait pour une semaine de l’égalité
Voici un extrait du chapitre « La marche des femmes » (pp. 287-291), que j’ai utilisé pour une séance d’AP (Accompagnement personnalisé) consacrée à la « semaine de l’égalité » qui se déroule chaque année dans l’établissement où je bosse. On fait réaliser un tableau pour repérer sept domaines d’égalité, identifier la problématique dans le texte, et évoquer ce qu’il en est en France et dans le monde de nos jours.
« Lahbib parla le premier. Il fit rapidement le compte rendu de la rencontre avec Dejean et ses adjoints, mais il était mauvais orateur et le savait, aussi se hâta-t-il de passer la parole à Bakayoko. Celui-ci attendit que le silence fût complet ; sa voix nette, incisive, n’avait pas besoin de micro et il fut écouté sans une interruption. Il commença par un bref historique de la ligne, depuis la pose des premiers rails, parla de la grève de septembre 1938 et de ses morts ; il sut provoquer la colère de la foule lorsqu’il dit : « On refuse ce que nous demandons sous prétexte que nos mères et nos femmes sont des concubines, nous-mêmes et nos fils des bâtards ! » Puis il conclut :
— Nous ne reprendrons pas le travail et c’est ici que cette grève doit être gagnée. Dans toutes les gares où je suis passé, on m’a affirmé : « Si Thiès tient bon, nous tiendrons. » Ouvriers de Thiès, c’est chez vous qu’il y a une place du 1er septembre et c’est pour cela que vous ne devez pas lâcher. Vous savez que vous êtes soutenus, de Kaolack à Saint-Louis, de la Guinée au Dahomey, et même en France, les secours s’organisent. C’est la preuve que le temps où l’on pouvait nous abattre en nous divisant est bien fini. Nous maintiendrons donc notre mot d’ordre de grève illimitée et cela jusqu’à la victoire totale !
Des cris, des hurlements lui répondirent ; ceux qui étaient restés assis se levèrent, des bras se tendirent. Mais tandis que le tumulte se déchaînait, un petit groupe de femmes qui s’était frayé un passage à travers la cohue, s’approcha des délégués. On vit Bakayoko lever les deux bras :
— Faites silence, cria-t-il, nos braves compagnes ont quelque chose à nous dire. Elles ont le droit qu’on les laisse parler !
Ce fut Penda qui prit la parole, d’abord hésitante puis de plus en plus assurée :
— Je parle au nom de toutes les femmes, mais je ne suis que leur porte-parole. Pour nous cette grève, c’est la possibilité d’une vie meilleure. Hier nous riions ensemble, aujourd’hui nous pleurons avec nos enfants devant nos marmites où rien ne bouillonne. Nous nous devons de garder la tête haute et ne pas céder. Et demain nous allons marcher jusqu’à N’Dakarou.
Un murmure d’étonnement, de curiosité, de réprobation couvrit un instant la voix de Penda, mais elle reprit plus fort :
— Oui, nous irons jusqu’à N’Dakarou entendre ce que les toubabs ont à dire, et ils verront si nous sommes des concubines ! Hommes, laissez vos épouses venir avec nous ! Seules resteront à la maison celles qui sont enceintes ou qui allaitent et les vieilles femmes.
On applaudit, on cria, mais il y eut aussi des protestations. Bakayoko prit Penda par le bras :
— Viens avec nous au syndicat, dit-il, ton idée est bonne, mais il ne faut pas s’engager à la légère dans cette affaire.
En traversant la foule qui s’écoulait lentement dans le soir tombant, ils croisèrent des petits groupes qui discutaient avec animation. De mémoire d’homme c’était la première fois qu’une femme avait pris la parole en public à Thiès et les discussions allaient bon train.
Elles ne furent pas moins vives au siège du syndicat. Balla, le premier, exprima une opinion qui n’était pas seulement la sienne :
— Je ne suis pas pour que les femmes partent. Qu’elles nous soutiennent, c’est normal ; une femme doit aider son mari, mais de là à faire la route de Dakar… Je vote contre. C’est la chaleur ou la colère qui leur monte à la tête ! Toi, Lahbib, tu prendrais la responsabilité de laisser partir les femmes ?
— Nous ne sommes pas ici pour entendre les sentiments ou les opinions de chacun. Si tu veux, nous pouvons voter.
Bakayoko interrompit brutalement la discussion qui menaçait : « Nous n’avons pas le droit de décourager ceux ou celles qui veulent faire quelque chose. Si les femmes sont décidées, il faut les aider. Que le représentant de Dakar parte tout de suite pour prévenir le comité local de leur arrivée. C’est toi qui viens de Dakar ? Ajouta-t-il en s’adressant à Daouda. Combien penses-tu qu’il leur faudra pour faire la route ?
— Je n’ai jamais été à Dakar à pied répondit Beaugosse, le visage fermé. De plus je trouve que ce n’est pas une histoire de femmes. Et puis il n’y a pas d’eau là-bas ; quand je suis parti, Alioune et les autres camarades couraient la ville à la recherche d’une barrique ou d’une bouteille d’eau, ce qui n’est pas un métier d’homme. Enfin, depuis l’affaire du bélier d’El Hadji Mabigué, il y a eu l’incendie et l’attaque des spahis. Les soldats et les miliciens patrouillent partout. Vous allez envoyer ces femmes dans la gueule du loup.
— Tu peux garder ton français pour toi, dit Bakayoko, les hommes comprendront mieux si tu leur parles oulof, bambara ou toucouleur. Quant aux délégués de Dakar, qu’ils fassent la corvée d’eau, le temps n’est plus où nos pères pouvaient considérer cela comme une humiliation. Si tous les ouvriers avaient le même état d’esprit que toi, adieu la grève et les mois de sacrifices !
— Allons, Bakayoko, modère-toi, dit Lahbib, revenons à des questions pratiques. Si les femmes sont décidées à partir, nous devons les aider, leur préparer une escorte. Il faudra aussi nous occuper des enfants, du moins de ceux dont les mères sont parties. Je propose que nous trouvions des camions et que nous emmenions les enfants dans les villages de la brousse. Chacun ici a de la famille dans les villages. Quant à toi, Penda, il faudra que tu veilles à ce que les hommes qui vous accompagnent ne vous embarrassent pas, et si tu t’aperçois que cette marche est trop dure pour les femmes, arrête-les, fais-leur rebrousser chemin. Il n’y aura pas de honte à cela et personne ne vous en fera grief.
En vérité, si Bakayoko, avec cette façon qu’il avait de dédaigner le destin ou de le forcer, était l’âme de la grève, Lahbib, le sérieux, le réfléchi, en était le cerveau. Lahbib comptait les Bouts de bois de Dieu, les pesait, les estimait, les alignait, mais la sève qui était en eux venait de Bakayoko. »
– Retrouvez cet extrait dans un corpus BTS du thème « Seuls avec tous ».
Ousmane Sembène vs Sembène Ousmane
Nous terminerons avec un détail qui m’avait étonné : par le passé, l’auteur était souvent nommé dans l’ordre inverse habituel nom-prénom. Ce qui paraissait une simple erreur de transcription était en fait une volonté consciente, comme nous l’explique dans cet article Jean Jonassaint (Syracuse University) : « Sembène Ousmane, comme l’écrivain algérien Kateb Yacine, a pris un nom d’auteur qui est un maquillage de son nom de l’état civil. Autrement dit, cet autodidacte qui n’a fréquenté l’école qu’environ six ans, au lieu d’écrire son nom d’auteur suivant la syntaxe de la page couverture, prénom + nom de famille (de l’état civil), a préféré celle des listes d’écoliers ou apparaissent d’abord le nom de famille, puis le ou les prénom(s). C’est à la fois une façon de signaler une « dépossession », cette nomination étant une imposition coloniale, notamment de l’école et de l’armée coloniale française dont Sembène Ousmane a été un soldat, puisqu’il a été tirailleur sénégalais comme on disait à l’époque. Mais cette (dé)nomination, Sembène Ousmane, est aussi une façon de la contester, en la détournant, subvertissant du même coup l’usage ou le rituel littéraire. Car nous voila pris avec un nom d’auteur qui n’est ni tout a fait un pseudo ni vraiment un nom d’état civil, qui pose problème aux bibliographes et critiques, qui doivent se demander où l’entrer, à S ou a O ? De fait, ils le rentrent parfois a S, parfois a O, d’autres fois a S et a O. »
– Du même auteur, lire nos articles sur Le Docker noir et sur Xala (1973) et d’autres livres et un film. Sur la littérature africaine, lire cet article : L’arbre à tchatche, ainsi qu’un article sur un voyage au Bénin et au Togo et trois articles sur un voyage au Sénégal, sur la Littérature sénégalaise et sur Birago Diop.
Voir en ligne : Article de Jean Jonassaint sur Ousmane Sembène
© altersexualite.com 2013
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com