Accueil > Classiques > La Religieuse, de Denis Diderot
Premier grand personnage lesbien de la littérature française, pour les lycéens
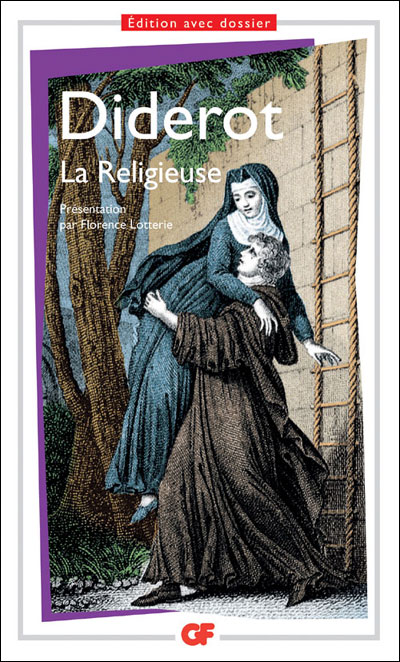 La Religieuse, de Denis Diderot
La Religieuse, de Denis Diderot
GF Flammarion, 1796, (2009), 296 p., 4,5 €
samedi 6 juillet 2013
Publié de façon posthume, à l’instar de Supplément au voyage de Bougainville, Jacques le Fataliste et son maître et nombre d’œuvres majeures, La Religieuse est, en plus de ses qualités, un roman fondateur pour l’histoire de l’homosexualité en littérature française. Le personnage de la mère supérieure du couvent d’Arpajon est une création majeure, le premier personnage de lesbienne, souffrant jusqu’à la folie et la mort de l’impossibilité de concilier ses désirs et une religion haïssant les manifestations hors-norme du désir. Après le film de Jacques Rivette, Suzanne Simonin, la Religieuse de Diderot (1967), qui fit scandale en son temps et agita la censure aux yeux de taureau, film très fidèle au texte, sauf quand le texte va trop loin, une nouvelle version cinématographique de Guillaume Nicloux paraît en 2013. Occasion de lire ou relire ce roman si important, qu’on peut parfaitement proposer en classe de première. On espère qu’Isabelle Huppert, qui aura sans doute le rôle de la supérieure, sera à la hauteur. Le fait que le film de Rivette ait fait scandale a sans doute paradoxalement occulté la force du roman. On s’est dit que si le film a tant fait scandale, c’est qu’il adaptait tout le texte. Or c’est le côté blasphématoire qui a choqué, mais le film est resté largement en-deça de la composante lesbienne, et a donc laissé dans les mémoires une impression fort incomplète. Espérons que le film à paraître en 2013 va restituer à La Religieuse la place de premier plan qu’il mérite dans l’histoire de notre littérature : plus de 60 ans avant Splendeurs et Misères des courtisanes de Balzac, un personnage homosexuel, avec en prime une scène d’orgasme lesbien dans un roman autre que pornographique. Pour cela, il faudra attendre bien après Balzac côté hommes ! Ce roman serait un excellent choix pour l’objet d’étude de terminale littéraire, « Lire, écrire, publier ». Hélas, le film de Guillaume Nicloux déçoit toutes nos espérances. Voir ce que j’en pense à la fin de cet article.
Histoire de la publication posthume
Florence Lotterie évoque dans sa préface la genèse de l’œuvre posthume. Tout part d’un fait divers, le procès en résiliation de vœux, perdu, de Marguerite Delamare, en 1757 et 1758, qui intéressa les philosophes. Entre février et mai 1760, une « petite coterie amicale » (p. I), Grimm, sa maîtresse Mme D’Épinay et Diderot entre autres, inventèrent une « insigne supercherie » (le mot est de Grimm, p. 197) épistolaire pour faire revenir à Paris un de leurs amis, le marquis de Croismare, qui s’était exilé en Normandie. Cette religieuse se serait évadée du couvent, et aurait fait appel à son aide pour trouver une situation discrète de servante. Une Mme Madin aurait servi de boîte postale à son insu. Croismare, selon la préfacière, aurait été bon public, faisant semblant de croire à cette histoire cousue de fil blanc. Grimm évente l’affaire le 15 mars 1770 dans la Correspondance littéraire, fameux courrier manuscrit réservé aux happy few avant la lettre de toute l’Europe. Mais dès la supercherie initiale, Diderot s’était approprié l’œuvre à venir, et se l’appropriera encore plus au gré d’un refroidissement de son amitié avec Grimm, et la publie dans la Correspondance littéraire, en neuf livraisons, entre octobre 1780 et mars 1782, entre Jacques le Fataliste et son maître et Le Rêve de d’Alembert, à une époque où il travaille à mettre au net son abondante œuvre posthume. On pourrait tout aussi bien retenir cette date comme date de l’œuvre, mais on choisit plutôt 1796, date de publication sous forme imprimée par l’éditeur Buisson, avec pour suppléments le texte de Grimm et la correspondance initiale, textes largement révisés. La longue préface tirée de la Correspondance de Grimm prétend que « On n’en pouvait pas lire une page sans verser des pleurs ; et cependant il n’y avait point d’amour » (p. 198), ce qui laisse rêveur. Diderot savait-il ce qu’il avait écrit ? La conclusion de la préface sur le style est fort intéressante : « M. Diderot, après avoir passé des matinées à composer à composer des lettres bien écrites, bien pensées, bien pathétiques, bien romanesques, employait des journées à les gâter en supprimant, sur les conseils de sa femme et de ses associés en scélératesse, tout ce qu’elles avaient de saillant, d’exagéré, de contraire à l’extrême simplicité et à la dernière vraisemblance ; en sorte que si l’on eût ramassé dans la rue les premières, on eût dit : « Cela est beau, fort beau… » et que si l’on eût ramassé les dernières, on eût dit : « Cela est bien vrai… » Quelles sont les bonnes ? Sont-ce celles qui auraient peut-être obtenu l’admiration ? ou celles qui devaient certainement produire l’illusion ? » (p. 223).
Intérêt de l’œuvre
À travers cette mystification, Diderot cherche à expérimenter sa théorie de l’art de l’illusion narrative, qu’il exprime dans ses Essais sur la peinture autant que comme auteur dramatique. Il s’agit de « faire frissonner la peau et couler les larmes » (Les Deux amis de Bourbonne), d’abord les siennes, comme le prouve de façon surprenante Florence Lotterie. Le romancier n’est pas le comédien du Paradoxe. Le genre fort représenté à l’époque du « roman-mémoires » autorise « une sorte de duplicité narrative » (p. XXIII) basée sur la restriction de champ de la focalisation interne. La narratrice innocente ne raconte que ce qu’elle comprend, et se réfugie derrière le rideau pratique d’un « je ne sais » « chaque fois qu’il serait nécessaire de nommer l’indicible par excellence ». Et bien sûr, l’indicible en question, c’est notamment le lesbianisme, qui fait son entrée tonitruante en littérature française. Florence Lotterie évoque les gender studies, pour récuser la pertinence d’un procès en homophobie de Diderot, qui serait bien anachronique. Elle évoque une « schizophrénie narrative » due au processus mis en place, et qui permet à la fois de rapporter cet indicible de la relation sexuelle entre deux femmes, et de le mettre à distance. Mais sans cela, sans cette homophobie implicite, le texte, même en partie posthume, était tout simplement impossible, ou alors il s’agissait d’un texte érotique, ce qui revenait aussi à une mise à distance de nature différente. Suzanne Simonin est la porte-parole de Diderot. Citons pour terminer une formule de Florence Lotterie : « Le matérialisme diderotien articule ici le militantisme des Lumières à un discours sur le droit à la sexualité et contre la répression organisée par le courant »
Résumé et extraits
Après un exorde présentant comme narrataire « M. le marquis de C*** », ce qui justifie la rédaction du livre : « il n’est pas à présumer qu’il se détermine à changer mon sort sans savoir qui je suis ; et c’est ce motif qui me résout à vaincre mon amour-propre et ma répugnance, en entreprenant ces mémoires, où je peins une partie de mes malheurs sans talent et sans art, avec la naïveté d’un enfant de mon âge et la franchise de mon caractère. » (p. 12). La beauté de Suzanne, qui la distingue de ses deux sœurs est la cause de sa mise au couvent, puisqu’elle a la franchise d’avouer à sa mère qu’un de ses prétendus beau-frère la courtise. On la conduit donc dans un premier couvent, Sainte-Marie (à Paris) où elle devient novice. Dès cette première étape, les « flatteries » des sœurs sur sa beauté préparent l’étape ultime du quasi viol de la supérieure du couvent d’Arpajon : « tout le monde se retira, et je restai au milieu du troupeau auquel on venait de m’associer. Mes compagnes m’ont entourée, elles m’embrassent et se disent : Mais voyez donc, ma sœur ; comme elle est belle ! Comme ce voile noir relève la blancheur de son teint ! comme ce bandeau lui sied, comme il lui arrondit le visage, comme il étend ses joues ! Comme cet habit fait valoir sa taille et ses bras !… Je les écoutais à peine ; j’étais désolée ; cependant, il faut que j’en convienne, quand je fus seule dans ma cellule je me ressouvins de leurs flatteries, je ne pus m’empêcher de les vérifier à mon petit miroir, et il me sembla qu’elles n’étaient pas tout à fait déplacées. » Diderot joue sur le double sens à l’époque du mot « séduction » : « Une mère des novices est la sœur la plus indulgente qu’on a pu trouver. Son étude est de vous dérober toutes les épines de l’état ; c’est un cours de séduction la plus subtile et la mieux apprêtée » (p. 17). Suzanne d’est pas dupe, et vu sa candeur dans la suite du roman, on sent que c’est là le philosophe qui s’exprime par sa plume : « elles s’y déterminent, et cela pour un millier d’écus qu’il en revient à leur maison. […] elles mentent toute leur vie, et préparent à de jeunes innocentes un désespoir de quarante, de cinquante années, et peut-être un malheur éternel ; car il est sûr, Monsieur, que, sur cent religieuses qui meurent avant cinquante ans, il y en a cent tout juste de damnées, sans compter celles qui deviennent folles, stupides ou furieuses en attendant.
Il arriva un jour qu’il s’en échappa une de ces dernières de la cellule où on la tenait renfermée. Je la vis. […] Je n’ai jamais rien vu de si hideux. Elle était échevelée et presque sans vêtement ; elle traînait des chaînes de fer ; ses yeux étaient égarés ; elle s’arrachait les cheveux ; elle se frappait la poitrine avec les poings ; elle courait, elle hurlait ; elle se chargeait elle-même, et les autres, des plus terribles imprécations ; elle cherchait une fenêtre pour se précipiter. La frayeur me saisit, je tremblai de tous mes membres, je vis mon sort dans celui de cette infortunée, et sur-le-champ il fut décidé, dans mon cœur que je mourrais mille fois plutôt que de m’y exposer » (p. 19). Suzanne refuse donc de prononcer ses vœux dans une scène célèbre : « — Marie-Suzanne Simonin, promettez-vous à Dieu chasteté, pauvreté et obéissance ? J’hésitai un moment, le prêtre attendit, et je répondis : Non, monsieur » (p. 26).
L’enfant illégitime
Suzanne rentre donc chez ses parents, où elle est à nouveau en prison. Quand enfin on consent à lui parler, c’est pour apprendre le terrible secret de sa mère : elle est une fille illégitime, de surcroît plus belle que ses sœurs, deux crimes de sa mère qu’elle doit d’autant plus expier que celle-ci craint Dieu et se persuade que sa fille doit payer pour elle : « Dieu nous a conservées l’une et l’autre, pour que la mère expiât sa faute par l’enfant » (p. 34). Du côté d’un mariage d’amour, Suzanne est compromise : « Peut-être que si l’on se fût expliqué plus tôt avec moi, après l’établissement de mes sœurs, on m’eût gardée à la maison qui ne laissait pas que d’être fréquentée, il se serait trouvé quelqu’un à qui mon caractère, mon esprit, ma figure et mes talents auraient paru une dot suffisante. La chose n’était pas encore impossible, mais l’éclat que j’avais fait en couvent la rendait plus difficile. On ne conçoit guère comment une fille de dix-sept à dix-huit ans a pu se porter à cette extrémité sans une fermeté peu commune. Les hommes louent beaucoup cette qualité, mais il me semble qu’ils s’en passent volontiers dans celles dont ils se proposent de faire leurs épouses » (p. 32). [1]
Le couvent de Longchamp
Suzanne se force donc à obéir à sa malheureuse mère, et entre à Longchamp, où madame de Moni, la supérieure, est trop bonne pour elle. Suzanne, « presque réduite à l’état d’automate » (p. 45), prononce ses vœux sans s’en rendre compte, ce qui justifie son futur procès. La pauvre Suzanne perd coup sur coup son père (ce n’est pas une grande perte), sa mère et Mme de Moni. Cette dernière est remplacée par la sœur Sainte-Christine, qui bouleverse les règles du couvent, et persécute les favorites de celle à qui elle succède, au premier rang desquelles Suzanne, qui est poussée au suicide, la plus douce des tortures qu’elle subisse. Le film de Rivette est assez fidèle ; il n’a pas osé cependant reprendre la scène où on la fait coucher dans une bière dans le chœur (p. 79). Elle revient par comparaison sur son lien particulier avec Mme de Moni : « si l’on discernait dans les autres qu’elles avaient conversé avec elle, on discernait en elle qu’elle avait conversé avec moi. Mais qu’est-ce que cela signifie, quand la vocation n’y est pas ? » (p. 69). Mme de Moni l’avait prévenue : « Entre toutes ces créatures que vous voyez autour de moi, si dociles, si innocentes, si douces, eh bien ! mon enfant, il n’y en a presque pas une, non, presque pas une, dont je ne pusse faire une bête féroce » (p. 80). Elle conserve « le petit portrait de notre ancienne supérieure […] sur [s]on cœur, il y demeurera tant que je vivrai » (p. 70). Il manque fort peu pour passer à l’amour charnel. Diderot prépare ses effets. Une bonne lecture analytique est le dialogue serré au terme duquel la supérieure décrète que Suzanne, qu’elle n’a pas réussi à convaincre de renoncer à son procès, est « possédée du démon » (p. 74). Un paragraphe fort obscur sur une sœur à qui on avait fait passer Suzanne pour le démon et qui l’avait cru, montre tout ce que la perversion de l’Église pouvait tirer d’un péché qu’il était même interdit de nommer : « On accourt à ses cris, on l’emporte ; et je ne saurais vous dire comment cette aventure fut travestie ; on en fit l’histoire la plus criminelle : on dit que le démon de l’impureté s’était emparé de moi ; on me supposa des desseins, des actions que je n’ose nommer, et des désirs bizarres auxquels on attribua le désordre évident dans lequel la jeune religieuse s’était trouvée. En vérité, je ne suis pas un homme, et je ne sais ce qu’on peut imaginer d’une femme et d’une autre femme, et moins encore d’une femme seule ; cependant comme mon lit était sans rideaux, et qu’on entrait dans ma chambre à toute heure, que vous dirai-je, monsieur ? Il faut qu’avec toute leur retenue extérieure, la modestie de leurs regards, la chasteté de leur expression, ces femmes aient le cœur bien corrompu : elles savent du moins qu’on commet seule des actions déshonnêtes, et moi je ne le sais pas ; aussi n’ai-je jamais bien compris ce dont elles m’accusaient : et elles s’exprimaient en des termes si obscurs, que je n’ai jamais su ce qu’il y avait à leur répondre » (p. 83). Une telle déclaration est difficile à justifier dans ce récit rétrospectif à la 1re personne, et tout cela est trop cousu de fil blanc pour que le narrataire, le marquis de Croismare, soit tombé dans le panneau ! Grâce au procès en vue et à l’avocat, M. Manouri, une visite du grand vicaire met fin aux vexations. Une mise en abîme dévoile l’art poétique de Diderot : « M. Manouri publia un premier mémoire qui fit peu de sensation ; il y avait trop d’esprit, pas assez de pathétique, presque point de raisons » (p. 99). Pourtant ce mémoire contient un discours des plus véhément digne de l’Encyclopédie : « Faire vœu de pauvreté, c’est s’engager par serment à être paresseux et voleur ; faire vœu de chasteté, c’est promettre à Dieu l’infraction constante de la plus sage et de la plus importante de ses lois ; faire vœu d’obéissance, c’est renoncer à la prérogative inaliénable de l’homme, la liberté. Si l’on observe ces vœux, on est criminel ; si on ne les observe pas, on est parjure. La vie claustrale est d’un fanatique ou d’un hypocrite » (p. 102). Au passage on relève l’argument de la crainte de la dépopulation : « ces gouffres, où les races futures vont se perdre » (p. 100). Sa seule amie au couvent vit pour elle d’un amour sublimé : « Sœur Ursule, lui dis-je tout bas, qu’avez-vous ? — Ce que j’ai ! me répondit-elle ; je vous aime, et vous me le demandez ! il était temps que votre supplice finît, j’en serais morte. » (p. 110), qui contraste d’avance avec l’attitude de la supérieure d’Arpajon. Sa mort est l’objet d’une scène particulièrement pathétique (p. 115).
Le couvent d’Arpajon
Son procès perdu, Suzanne fait pourtant l’objet d’une mesure de préservation : on la transfère au couvent Sainte-Eutrope d’Arpajon (il s’agit d’ailleurs d’une erreur de Diderot, Eutrope étant un saint masculin). L’excès de haine de la supérieure de Longchamp y fait place à l’excès d’amour de la supérieure d’Arpajon. Celle-ci est âgée de 40 à plus de soixante ans selon des informations contradictoires du roman. Diderot expose deux formes différentes de l’hystérie causée par la claustration. Dès le portrait charge initial de la supérieure, Diderot abuse de la prétendue innocence de Suzanne, car tout est dit, et fort clairement, pour le lecteur éclairé : « Une religieuse alors manque-t-elle à la moindre chose ? elle la fait venir dans sa cellule, la traite avec dureté, lui ordonne de se déshabiller et de se donner vingt coups de discipline ; la religieuse obéit, se déshabille, prend sa discipline, et se macère ; mais à peine s’est-elle donné quelques coups, que la supérieure, devenue compatissante, lui arrache l’instrument de pénitence, se met à pleurer, dit qu’elle est bien malheureuse d’avoir à punir, lui baise le front, les yeux, la bouche, les épaules ; la caresse, la loue. « Mais, qu’elle a la peau blanche et douce ! le bel embonpoint ! le beau cou ! le beau chignon !… Sœur Sainte-Augustine, mais tu es folle d’être honteuse ; laisse tomber ce linge ; je suis femme, et ta supérieure. Oh ! la belle gorge ! qu’elle est ferme ! et je souffrirais que cela fût déchiré par des pointes ? Non, non, il n’en sera rien » Elle la baise encore, la relève, la rhabille elle-même, lui dit les choses les plus douces, la dispense des offices, et la renvoie dans sa cellule. » (p. 123). Cy Jung n’a guère fait plus érotique ! Et cela continue dans ce registre : mi-figue, mi-abricot : « Le premier soir, j’eus la visite de la supérieure ; elle vint à mon déshabiller ; ce fut elle qui m’ôta mon voile et ma guimpe, et qui me coiffa de nuit : ce fut elle qui me déshabilla. Elle me tint cent propos doux, et me fit mille caresses qui m’embarrassèrent un peu, je ne sais pas pourquoi, car je n’y entendais rien ni elle non plus ; à présent même que j’y réfléchis, qu’aurions-nous pu y entendre ? Cependant j’en parlai à mon directeur, qui traita cette familiarité, qui me paraissait innocente et qui me le paraît encore, d’un ton fort sérieux, et me défendit gravement de m’y prêter davantage. » (p. 127). « C’était toujours un baiser ou sur le front ou sur le cou, ou sur les yeux, ou sur les joues, ou sur la bouche, ou sur les mains, ou sur la gorge, ou sur les bras, mais plus souvent sur la bouche ; elle trouvait que j’avais l’haleine pure, les dents blanches, et les lèvres fraîches et vermeilles » (p. 135). Sainte-Thérèse, la favorite précédente de la supérieure (après une « Agathe » malheureuse évoquée à plusieurs reprises), se trouve évincée et en est fort jalouse, mais le dit à demi-mot, constatant que Suzanne ne comprend pas de quoi il est question, et ayant peur par ses précisions d’aggraver sa disgrâce. Voilà une situation bien particulière où le narrataire (M. de Croismare) doit être bien complaisant pour avaler cette naïveté aussi stratifiée que le site de Troie ! Cela va parfois jusqu’à une ironie quasi-voltairienne que ne renieraient pas les militantes lesbiennes féministes des années 1970 : « Quelquefois, en me regardant de la tête aux pieds, avec un air de complaisance que je n’ai jamais vu à aucune autre femme, elle me disait : « Non, c’est le plus grand bonheur que Dieu l’ait appelée dans la retraite ; avec cette figure-là, dans le monde, elle aurait damné autant d’hommes qu’elle en aurait vu, et elle se serait damnée avec eux. Dieu fait bien tout ce qu’il fait. » (p. 135).
La montée au Golgotha de l’orgasme lesbien
On suppose que Diderot et la « coterie » s’amusèrent follement à composer les scènes de montée progressive du désir et de son assouvissement de la supérieure, narrées avec une désarmante autant qu’érotique innocence par celle qui en est l’objet. De même que dans Un amour de Swann, Marcel Proust utilise « faire cattleya » comme métaphore de « faire l’amour », Diderot utilise ici l’expression « donner une leçon de clavecin ». Ce leitmotiv permet, en trois scènes, d’approfondir le plaisir qu’en tire la supérieure, de la chansonnette de la scène initiale aux grandes orgues de l’orgasme final. Voici un avant-goût déjà prononcé : « entrez, vous me donnerez une petite leçon de clavecin. » Je la suivis. En un moment elle eut ouvert le clavecin, préparé un livre, approché une chaise ; car elle était vive. Je m’assis. Elle pensa que je pourrais avoir froid ; elle détacha de dessus les chaises un coussin qu’elle posa devant moi, se baissa et me prit les deux pieds, qu’elle mit dessus ; ensuite je jouai quelques pièces de Couperin, de Rameau, de Scarlatti : cependant elle avait levé un coin de mon linge de cou, sa main était placée sur mon épaule nue, et l’extrémité de ses doigts posée sur ma gorge. Elle soupirait ; elle paraissait oppressée, son haleine s’embarrassait ; la main qu’elle tenait sur mon épaule d’abord la pressait fortement, puis elle ne la pressait plus du tout, comme si elle eût été sans force et sans vie ; et sa tête tombait sur la mienne. En vérité cette folle-là était d’une sensibilité incroyable, et avait le goût le plus vif pour la musique ; je n’ai jamais connu personne sur qui elle eût produit des effets aussi singuliers. » (p. 136). Il faut citer en entier la scène de l’orgasme, qui commence de façon itérative avant de glisser insensiblement à une scène unique, à partir du premier verbe au passé simple « enfin il vint un moment », ce qui suggère plus que ne sous-entend le texte avec ses « je ne sais », « je ne crois pas qu’il y eût du mal à cela » et autres « d’une manière innocente » ! Et la fin revient à l’imparfait itératif. Bel aveu de l’auteur qu’il manipule autant le thème de l’« innocente » pour le plaisir de son lecteur que ne le fait la supérieure pour son propre plaisir !
« Je voyais croître de jour en jour la tendresse que la supérieure avait conçue pour moi. J’étais sans cesse dans sa cellule, ou elle était dans la mienne ; pour la moindre indisposition, elle m’ordonnait l’infirmerie, elle me dispensait des offices, elle m’envoyait coucher de bonne heure, ou m’interdisait l’oraison du matin. Au chœur, au réfectoire, à la récréation, elle trouvait moyen de me donner des marques d’amitié ; au chœur s’il se rencontrait un verset qui contînt quelque sentiment affectueux et tendre, elle le chantait en me l’adressant, ou elle me regardait s’il était chanté par une autre ; au réfectoire, elle m’envoyait toujours quelque chose de ce qu’on lui servait d’exquis ; à la récréation, elle m’embrassait par le milieu du corps, elle me disait les choses les plus douces et les plus obligeantes ; on ne lui faisait aucun présent que je ne le partageasse : chocolat, sucre, café, liqueurs, tabac, linge, mouchoirs, quoi que ce fût ; elle avait déparé sa cellule d’estampes, d’ustensiles, de meubles et d’une infinité de choses agréables ou commodes, pour en orner la mienne ; je ne pouvais presque pas m’en absenter un moment, qu’à mon retour je ne me trouvasse enrichie de quelques dons. J’allais l’en remercier chez elle, et elle en ressentait une joie qui ne peut s’exprimer ; elle m’embrassait, me caressait, me prenait sur ses genoux, m’entretenait des choses les plus secrètes de la maison, et se promettait, si je l’aimais, une vie mille fois plus heureuse que celle qu’elle aurait passée dans le monde. Après cela elle s’arrêtait, me regardait avec des yeux attendris, et me disait : « Sœur Suzanne, m’aimez-vous ? — Et comment ferais-je pour ne pas vous aimer ? Il faudrait que j’eusse l’âme bien ingrate. — Cela est vrai. — Vous avez tant de bonté. — Dites de goût pour vous… » Et en prononçant ces mots, elle baissait les yeux ; la main dont elle me tenait embrassée me serrait plus fortement ; celle qu’elle avait appuyée sur mon genou pressait davantage ; elle m’attirait sur elle ; mon visage se trouvait placé sur le sien, elle soupirait, elle se renversait sur sa chaise, elle tremblait ; on eût dit qu’elle avait à me confier quelque chose, et qu’elle n’osait, elle versait des larmes, et puis elle me disait : « Ah ! sœur Suzanne, vous ne m’aimez pas ! — Je ne vous aime pas, chère mère ! — Non. — Et dites-moi ce qu’il faut que je fasse pour vous le prouver. — Il faudrait que vous le devinassiez. — Je cherche, je ne devine rien. » Cependant elle avait levé son linge de cou, et avait mis une de mes mains sur sa gorge ; elle se taisait, je me taisais aussi ; elle paraissait goûter le plus grand plaisir. Elle m’invitait à lui baiser le front, les joues, les yeux et la bouche ; et je lui obéissais : je ne crois pas qu’il y eût du mal à cela ; cependant son plaisir s’accroissait ; et comme je ne demandais pas mieux que d’ajouter à son bonheur d’une manière innocente, je lui baisais encore le front, les joues, les yeux et la bouche. La main qu’elle avait posée sur mon genou se promenait sur tous mes vêtements, depuis l’extrémité de mes pieds jusqu’à ma ceinture, me pressant tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre ; elle m’exhortait en bégayant, et d’une voix altérée et basse, à redoubler mes caresses, je les redoublais ; enfin il vint un moment, je ne sais si ce fut de plaisir ou de peine, où elle devint pâle comme la mort ; ses yeux se fermèrent, tout son corps se tendit avec violence, ses lèvres se pressèrent d’abord, elles étaient humectées comme d’une mousse légère ; puis sa bouche s’entr’ouvrit, et elle me parut mourir en poussant un profond soupir. Je me levai brusquement ; je crus qu’elle se trouvait mal ; je voulais sortir, appeler. Elle entr’ouvrit faiblement les yeux, et me dit d’une voix éteinte : « Innocente ! ce n’est rien ; qu’allez-vous faire ? arrêtez… » Je la regardai avec des yeux hébétés, incertaine si je resterais ou si je sortirais. Elle rouvrit encore les yeux ; elle ne pouvait plus parler du tout ; elle me fit signe d’approcher et de me replacer sur ses genoux. Je ne sais ce qui se passait en moi ; je craignais, je tremblais, le cœur me palpitait, j’avais de la peine à respirer, je me sentais troublée, oppressée, agitée, j’avais peur ; il me semblait que les forces m’abandonnaient et que j’allais défaillir ; cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse. J’allais près d’elle ; elle me fit signe encore de la main de m’asseoir sur ses genoux ; je m’assis ; elle était comme morte, et moi comme si j’allais mourir. Nous demeurâmes assez longtemps l’une et l’autre dans cet état singulier. Si quelque religieuse fût survenue, en vérité elle eût été bien effrayée ; elle aurait imaginé, ou que nous nous étions trouvées mal, ou que nous nous étions endormies. Cependant cette bonne supérieure, car il est impossible d’être si sensible et de n’être pas bonne, me parut revenir à elle. Elle était toujours renversée sur sa chaise ; ses yeux étaient toujours fermés, mais son visage s’était animé des plus belles couleurs : elle prenait une de mes mains qu’elle baisait, et moi je lui disais : « Ah ! chère mère, vous m’avez bien fait peur… » Elle sourit doucement, sans ouvrir les yeux. « Mais est-ce que vous n’avez pas souffert ? — Non. — Je l’ai cru. — L’innocente ! ah ! la chère innocente ! qu’elle me plaît ! » En disant ces mots, elle se releva, se remit sur sa chaise, me prit à brasse-corps et me baisa sur les joues avec beaucoup de force, puis elle me dit : « Quel âge avez-vous ? — Je n’ai pas encore vingt ans. [2] — Cela ne se conçoit pas. — Chère mère, rien n’est plus vrai. — Je veux savoir toute votre vie ; vous me la direz ? — Oui, chère mère. — Toute ? — Toute. — Mais on pourrait venir ; allons nous mettre au clavecin : vous me donnerez leçon. » Nous y allâmes ; mais je ne sais comment cela se fit ; les mains me tremblaient, le papier ne me montrait qu’un amas confus de notes ; je ne pus jamais jouer. Je le lui dis, elle se mit à rire, elle prit ma place, mais ce fut pis encore ; à peine pouvait-elle soutenir ses bras. « Mon enfant, me dit-elle, je vois que tu n’es guère en état de me montrer ni moi d’apprendre ; je suis un peu fatiguée, il faut que je me repose, adieu. Demain, sans plus tarder, je veux savoir tout ce qui s’est passé dans cette chère petite âme-là ; adieu… » Les autres fois, quand je sortais, elle m’accompagnait jusqu’à sa porte, elle me suivait des yeux tout le long du corridor jusqu’à la mienne ; elle me jetait un baiser avec les mains, et ne rentrait chez elle que quand j’étais rentrée chez moi ; cette fois-ci, à peine se leva-t-elle ; ce fut tout ce qu’elle put faire que de gagner le fauteuil qui était à côté de son lit ; elle s’assit, pencha la tête sur son oreiller, me jeta le baiser avec les mains ; ses yeux se fermèrent, et je m’en allai.
La maladie contagieuse
Pour évoquer le lesbianisme et sa répression sans le dire, Diderot glisse alors du leitmotiv du clavecin au thème du « mal », de la « maladie », qu’il brode longuement. « Le résultat de mes réflexions, c’est que c’était peut-être une maladie à laquelle elle était sujette ; puis il m’en vint une autre, c’est que peut-être cette maladie se gagnait, que Sainte-Thérèse l’avait prise, et que je la prendrais aussi. » (p. 142). « Je m’aperçus alors, au tremblement qui la saisissait, au trouble de son discours, à l’égarement de ses yeux et de ses mains, à son genou qui se pressait entre les miens, à l’ardeur dont elle me serrait et à la violence dont ses bras m’enlaçaient, que sa maladie ne tarderait pas à la prendre. Je ne sais ce qui se passait en moi ; mais j’étais saisie d’une frayeur, d’un tremblement et d’une défaillance qui me vérifiaient le soupçon que j’avais eu que son mal était contagieux. » (p. 144). Pendant la scène où la supérieure affolée se rend de nuit dans la chambre de Suzanne, l’érotisme le cède à la nosologie : « — Chère mère, lui dis-je, qu’avez-vous ? Est-ce que vous vous trouvez mal ? Que faut-il que je fasse ? — Je tremble, me dit-elle, je frissonne ; un froid mortel s’est répandu sur moi. — Voulez-vous que je me lève et que je vous cède mon lit ? » (p. 151). [3] Ce thème du mal a bien sûr été introduit par le confesseur du couvent, qui n’est pas dupe des visées de la supérieure : « Je m’étais déjà accusée des premières caresses que ma supérieure m’avait faites ; le directeur m’avait très-expressément défendu de m’y prêter davantage ; mais le moyen de se refuser à des choses qui font grand plaisir à une autre dont on dépend entièrement, et auxquelles on n’entend soi-même aucun mal ? » (p. 161). La supérieure tante d’éviter la catastrophe, et Diderot ne la dessert pas ; il la peint elle aussi comme une victime plutôt qu’une coupable : « Eh ! folle, me disait-elle, quel mal veux-tu qu’il y ait à taire ce qu’il n’y a point eu de mal à faire ? » (p. 163). « [le P. Lemoine] m’a représenté la tendresse que vous avez pour moi, les caresses que vous me faites, et auxquelles je vous avoue que je n’entends aucun mal, sous les couleurs les plus affreuses. Il m’a ordonné de vous fuir, de ne plus entrer chez vous, seule ; de sortir de ma cellule, si vous y veniez ; il vous a peinte à mon esprit comme le démon » ; « Mais peut-être reconnaît-il, dans des actions très-innocentes de votre part et de la mienne, un germe de corruption secrète qu’il croit tout développé en vous, et qu’il craint que vous ne développiez en moi. Je ne vous cacherai pas qu’en revenant sur les impressions que j’ai quelquefois ressenties… D’où vient, chère mère, qu’au sortir d’auprès de vous, en rentrant chez moi, j’étais agitée, rêveuse ? D’où vient que je ne pouvais ni prier, ni m’occuper ? D’où vient une espèce d’ennui que je n’avais jamais éprouvé ? Pourquoi, moi qui n’ai jamais dormi le jour, me sentais-je aller au sommeil ? Je croyais que c’était en vous une maladie contagieuse, dont l’effet commençait à s’opérer en moi ; mais le P. Lemoine voit cela bien autrement » (p. 169). On est décidément aux antipodes du récit de Rousseau sur sa mésaventure avec le faux Maure, qui lui servait à étendre aux pères catholiques la réprobation de l’homosexualité. Au contraire, Diderot semble insinuer que sans l’intervention de la répression du directeur, Suzanne se serait laissée aller naturellement sur la pente d’un plaisir décidément bien innocent. Un autre bon extrait de lecture analytique est ce dialogue entre deux femmes où se lit en creux le plaidoyer du philosophe contre la répression du plaisir. La patiente maïeutique de la supérieure est impuissante à accoucher ce que la pauvre Suzanne ignore savoir de son propre plaisir, tant cela a été réprimé en elle dès avant sa naissance. Diderot expose ce qu’il y a de coutumier dans l’hétérosexualité, qui a si peu à voir avec le désir des femmes.
En effet, ma supérieure reprit du calme, et moi aussi. Nous étions l’une et l’autre abattues ; moi, la tête penchée sur son oreiller ; elle, la tête posée sur un de mes genoux, le front placé sur une de mes mains. Nous restâmes quelques moments dans cet état ; je ne sais ce qu’elle pensait ; pour moi, je ne pensais à rien, je ne le pouvais, j’étais d’une faiblesse qui m’occupait tout entière. Nous gardions le silence, lorsque la supérieure le rompit la première ; elle me dit : « Suzanne, il m’a paru par ce que vous m’avez dit de votre première supérieure qu’elle vous était fort chère. — Beaucoup. — Elle ne vous aimait pas mieux que moi, mais elle était mieux aimée de vous… Vous ne me répondez pas ? — J’étais malheureuse, elle adoucissait mes peines. — Mais d’où vient votre répugnance pour la vie religieuse ? Suzanne, vous ne m’avez pas tout dit. — Pardonnez-moi, madame. — Quoi ! il n’est pas possible, aimable comme vous l’êtes, car, mon enfant, vous l’êtes beaucoup, vous ne savez pas combien, que personne ne vous l’ait dit. — On me l’a dit. — Et celui qui vous le disait ne vous déplaisait pas ? — Non. — Et vous vous êtes pris de goût pour lui ? — Point du tout. — Quoi ! votre cœur n’a jamais rien senti ? — Rien. — Quoi ! ce n’est pas une passion, ou secrète ou désapprouvée de vos parents, qui vous a donné de l’aversion pour le couvent ? Confiez-moi cela ; je suis indulgente. — Je n’ai, chère mère, rien à vous confier là-dessus. — Mais, encore une fois, d’où vient votre répugnance pour la vie religieuse ? — De la vie même. J’en hais les devoirs, les occupations, la retraite, la contrainte ; il me semble que je suis appelée à autre chose. — Mais à quoi cela vous semble-t-il ? — À l’ennui qui m’accable ; je m’ennuie. — Ici même ? — Oui, chère mère ; ici même, malgré toute la bonté que vous avez pour moi. — Mais, est-ce que vous éprouvez en vous-même des mouvements, des désirs ? — Aucun. — Je le crois ; vous me paraissez d’un caractère tranquille. — Assez. — Froid, même. — Je ne sais. — Vous ne connaissez pas le monde ? — Je le connais peu. — Quel attrait peut-il donc avoir pour vous ? — Cela ne m’est pas bien expliqué ; mais il faut pourtant qu’il en ait. — Est-ce la liberté que vous regrettez ? — C’est cela, et peut-être beaucoup d’autres choses. — Et ces autres choses, quelles sont-elles ? Mon amie, parlez-moi à cœur ouvert ; voudriez-vous être mariée ? — Je l’aimerais mieux que d’être ce que je suis ; cela est certain. — Pourquoi cette préférence ? — Je l’ignore. — Vous l’ignorez ? Mais, dites-moi, quelle impression fait sur vous la présence d’un homme ? — Aucune ; s’il a de l’esprit et qu’il parle bien, je l’écoute avec plaisir ; s’il est d’une belle figure, je le remarque. — Et votre cœur est tranquille ? — Jusqu’à présent, il est resté sans émotion. — Quoi ! lorsqu’ils ont attaché leurs regards animés sur les vôtres, vous n’avez pas ressenti… — Quelquefois de l’embarras ; ils me faisaient baisser les yeux. — Et sans aucun trouble ? — Aucun. — Et vos sens ne vous disaient rien ? — Je ne sais ce que c’est que le langage des sens. — Ils en ont un, cependant. — Cela se peut. — Et vous ne le connaissez pas ? — Point du tout. — Quoi ! vous… C’est un langage bien doux ; et voudriez-vous le connaître ? — Non, chère mère ; à quoi cela me servirait-il ? — À dissiper votre ennui. — À l’augmenter, peut-être. Et puis, que signifie ce langage des sens, sans objet ? — Quand on parle, c’est toujours à quelqu’un ; cela vaut mieux sans doute que de s’entretenir seule, quoique ce ne soit pas tout à fait sans plaisir. — Je n’entends rien à cela. — Si tu voulais, chère enfant, je te deviendrais plus claire. — Non, chère mère, non. Je ne sais rien ; et j’aime mieux ne rien savoir, que d’acquérir des connaissances qui me rendraient peut-être plus à plaindre que je ne le suis. Je n’ai point de désirs, et je n’en veux point chercher que je ne pourrais satisfaire. — Et pourquoi ne le pourrais-tu pas ? — Et comment le pourrais-je ? — Comme moi. — Comme vous ! Mais il n’y a personne dans cette maison. — J’y suis, chère amie ; vous y êtes. — Eh bien ! que vous suis-je ? que m’êtes-vous ? — Qu’elle est innocente ! — Oh ! il est vrai, chère mère, que je le suis beaucoup, et que j’aimerais mieux mourir que de cesser de l’être. »
Je ne sais ce que ces derniers mots pouvaient avoir de fâcheux pour elle, mais ils la firent tout à coup changer de visage ; elle devint sérieuse, embarrassée ; sa main, qu’elle avait posée sur un de mes genoux, cessa d’abord de le presser, et puis se retira ; elle tenait ses yeux baissés.
Ce dialogue se poursuit cependant, avec cet échange étonnant qui prouve que Suzanne n’est pas tant ignorante : « — Jamais vous n’avez pensé à promener vos mains sur cette belle gorge, sur ces cuisses, sur ce ventre, sur ces chairs si fermes, si douces et si blanches ? — Oh ! pour cela, non ; il y a du péché à cela ; et si cela m’était arrivé, je ne sais comment j’aurais fait pour l’avouer à confesse… » (p. 148). L’ironie de Diderot se signale à nouveau quand, après que la mère supérieure a quitté la chambre de Suzanne sans avoir pu coucher dans son lit, elle entre dans la chambre de Thérèse qui a eu l’impudence de tambouriner à la porte, pour la morigéner : « Cependant j’avais l’oreille au guet, j’attendais avec impatience que notre mère sortît de chez sœur Thérèse ; cette affaire fut difficile à accommoder apparemment, car elle y passa presque la nuit. Que je la plaignais ! » Plus cruche que Suzanne, tu meurs ! Lors d’une réunion chez la supérieure, Thérèse repentante demande à Suzanne d’intercéder pour elle, ce qui nous vaut une belle scène de trouple lesbien : « Elle se jeta à genoux ; elle saisit une de ses mains, qu’elle baisa en poussant quelques soupirs, et en versant une larme ; puis elle s’empara d’une des miennes, qu’elle joignit à celle de la supérieure, et les baisa l’une et l’autre » (p. 157), et Suzanne de conclure : « Cette soirée fut délicieuse » (p. 158).
La répression ecclésiastique
Le discours du confesseur est sans appel, et connaissant le goût des philosophes pour ce genre de prose, est à prendre à contresens comme une condamnation de l’attitude de la religion face à la sexualité, en l’occurrence l’homosexualité : « Sans oser m’expliquer avec vous plus clairement, dans la crainte de devenir moi-même le complice de votre indigne supérieure, et de faner, par le souffle empoisonné qui sortirait malgré moi de mes lèvres, une fleur délicate, qu’on ne garde fraîche et sans tache jusqu’à l’âge où vous êtes, que par une protection spéciale de la Providence, je vous ordonne de fuir votre supérieure, de repousser loin de vous ses caresses, de ne jamais entrer seule chez elle, de lui fermer votre porte, surtout la nuit ; de sortir de votre lit, si elle entre chez vous malgré vous ; d’aller dans le corridor, d’appeler s’il le faut, de descendre toute nue jusqu’au pied des autels, de remplir la maison de vos cris, et de faire tout ce que l’amour de Dieu, la crainte du crime, la sainteté de votre état et l’intérêt de votre salut vous inspireraient, si Satan en personne se présentait à vous et vous poursuivait. Oui, mon enfant, Satan ; c’est sous cet aspect que je suis contraint de vous montrer votre supérieure ; elle est enfoncée dans l’abîme du crime, elle cherche à vous y plonger ; et vous y seriez déjà peut-être avec elle, si votre innocence même ne l’avait remplie de terreur, et ne l’avait arrêtée. » […] Dites avec moi : Satana, vade retro, apage, Satana. Si cette malheureuse vous interroge, dites-lui tout, répétez-lui mon discours ; dites-lui qu’il vaudrait mieux qu’elle ne fût pas née, ou qu’elle se précipitât seule aux enfers par une mort violente. » (p. 165). La nature de Suzanne ne la fait pas rétive a priori à la séduction de la supérieure : « — Vous repousserez mes caresses ? — Il m’en coûtera beaucoup, car je suis née caressante, et j’aime à être caressée ; mais il le faudra ; je l’ai promis à mon directeur » (p. 169). Une phrase ironique souligne la façon dont la religion favorise paradoxalement l’homosexualité chez une personne innocente comme Suzanne : « je réfléchis et je conclus, tout bien considéré, que quoique des personnes fussent d’un même sexe, il pouvait y avoir du moins de l’indécence dans la manière dont elles se témoignaient leur amitié » (p. 171). La supérieure souffre, et Diderot met le lecteur du côté de cette première lesbienne du roman français : « Un jour elle m’arrêta, elle se mit à me regarder sans mot dire ; des pleurs coulèrent abondamment de ses yeux, puis tout à coup se jetant à terre et me serrant un genou entre ses deux mains, elle me dit : — Sœur cruelle, demande-moi ma vie, je te la donnerai, mais ne m’évite pas ; je ne saurais plus vivre sans toi… » (p. 172). L’entrée dans la folie de la supérieure emprunte les codes de la religion, et ironiquement elle retrouve les tortures que subissait Suzanne à Longchamp : « Un jour que je sortais de ma cellule, je la trouvai prosternée, les bras étendus et la face contre terre ; et elle me dit : — Avancez, marchez, foulez-moi aux pieds ; je ne mérite pas un autre traitement » (p. 176)
Les lumières funestes
Le nouveau confesseur, le père Morel, confesse à sa confessée qu’il est comme elle, n’ayant jamais eu de vocation que forcée. Il l’éclaire sur le sort de la supérieure : « la disposition actuelle de cette femme ne durerait pas ; elle luttait contre elle-même, mais en vain ; et il arriverait de deux choses l’une, ou qu’elle reviendrait incessamment à ses premiers penchants, ou qu’elle perdrait la tête » (p. 178). Il se refuse à expliciter l’attitude de son prédécesseur, confirmant l’impossibilité de l’Église à accepter la vérité de la sexualité. Voici encore un bon extrait à étudier en classe :
« Je n’insistai pas, j’ajoutai seulement : — Il est vrai que c’est le P. Lemoine qui m’a inspiré de l’éloignement pour ma supérieure. — Il a bien fait. — Et pourquoi ?
— Ma sœur, me répondit-il en prenant un air grave, tenez-vous-en à ses conseils, et tâchez d’en ignorer la raison tant que vous vivrez. — Mais il me semble que si je connaissais le péril, je serais d’autant plus attentive à l’éviter. — Peut-être aussi serait-ce le contraire. — Il faut que vous ayez bien mauvaise opinion de moi. — J’ai de vos mœurs et de votre innocence l’opinion que j’en dois avoir ; mais croyez qu’il y a des lumières funestes que vous ne pourriez acquérir sans y perdre. C’est votre innocence même qui en a imposé à votre supérieure ; plus instruite, elle vous aurait moins respectée. — Je ne vous entends pas. — Tant mieux. — Mais que la familiarité et les caresses d’une femme peuvent-elles avoir de dangereux pour une autre femme ? » Point de réponse de la part de dom Morel. « Ne suis-je pas la même que j’étais en entrant ici ? » Point de réponse de la part de dom Morel. « N’aurais-je pas continué d’être la même ? Où est donc le mal de s’aimer, de se le dire, de se le témoigner ? cela est si doux ! — Il est vrai, dit dom Morel en levant les yeux sur moi, qu’il avait toujours tenus baissés tandis que je parlais. — Et cela est-il donc si commun dans les maisons religieuses ? Ma pauvre supérieure ! dans quel état elle est tombée ! — Il est fâcheux, et je crains bien qu’il n’empire. Elle n’était pas faite pour son état ; et voilà ce qui en arrive tôt ou tard, quand on s’oppose au penchant général de la nature : cette contrainte la détourne à des affections déréglées, qui sont d’autant plus violentes, qu’elles sont mal fondées ; c’est une espèce de folie. — Elle est folle ? — Oui, elle l’est, et le deviendra davantage. — Et vous croyez que c’est là le sort qui attend ceux qui sont engagés dans un état auquel ils n’étaient point appelés ? — Non, pas tous : il y en a qui meurent auparavant ; il y en a dont le caractère flexible se prête à la longue ; il y en a que des espérances vagues soutiennent quelque temps. — Et quelles espérances pour une religieuse ? — Quelles ? d’abord celle de faire résilier ses vœux. — Et quand on n’a plus celle-là ? — Celles qu’on trouvera les portes ouvertes, un jour ; que les hommes reviendront de l’extravagance d’enfermer dans des sépulcres de jeunes créatures toutes vivantes, et que les couvents seront abolis ; que le feu prendra à la maison ; que les murs de la clôture tomberont ; que quelqu’un les secourra. Toutes ces suppositions roulent par la tête ; on s’en entretient ; on regarde, en se promenant dans le jardin, sans y penser, si les murs sont bien hauts ; si l’on est dans sa cellule, on saisit les barreaux de sa grille, et on les ébranle doucement, de distraction ; si l’on a la rue sous ses fenêtres, on y regarde ; si l’on entend passer quelqu’un, le cœur palpite, on soupire sourdement après un libérateur ; s’il s’élève quelque tumulte dont le bruit pénètre jusque dans la maison, on espère ; on compte sur une maladie, qui nous approchera d’un homme, ou qui nous enverra aux eaux. — Il est vrai, il est vrai, m’écriai-je ; vous lisez au fond de mon cœur ; je me suis fait, je me fais encore ces illusions » (p. 180).
Le roman se termine en eau de boudin. Suzanne confesse au lecteur qu’elle a espionné la confession de la supérieure au père Morel : « Le premier mot que j’entendis après un assez long silence me fit frémir ; ce fut : « Mon père, je suis damnée… » Je me rassurai. J’écoutais ; le voile qui jusqu’alors m’avait dérobé le péril que j’avais couru se déchirait lorsqu’on m’appela ; il fallut aller, j’allai donc ; mais, hélas ! je n’en avais que trop entendu. Quelle femme, monsieur le marquis, quelle abominable femme !… » (p. 183). C’est alors que « les Mémoires de la sœur Suzanne sont interrompus », et que le texte brosse le sommaire de la fin, mais ces quelques lignes suffisent à rendre incohérente la prétendue ignorance de Suzanne narratrice, censée raconter son histoire au marquis après avoir entendu cette confession qui rend la sœur abominable à ses yeux. Et pourtant elle ne la dépeint pas comme telle ! Inadvertance de Diderot, ou fait exprès ? La suite sommaire révèle la folie de la supérieure : « Elle voyait Dieu ; le ciel lui paraissait se sillonner d’éclairs, s’entr’ouvrir et gronder sur sa tête ; des anges en descendaient en courroux ; les regards de la Divinité la faisaient trembler ; elle courait de tous côtés, elle se renfonçait dans les angles obscurs de l’église, elle demandait miséricorde, elle se collait la face contre terre, elle s’y assoupissait, la fraîcheur humide du lieu l’avait saisie, on la transportait dans sa cellule comme morte » (p. 185) ; « Elle fut saignée : on lui donna les bains ; mais son mal semblait s’accroître par les remèdes. Je n’ose vous décrire toutes les actions indécentes qu’elle fit, vous répéter tous les discours malhonnêtes qui lui échappèrent dans son délire. […] On ne tarda pas à la séquestrer ; mais sa prison ne fut pas si bien gardée, qu’elle ne réussît un jour à s’en échapper. Elle avait déchiré ses vêtements, elle parcourait les corridors toute nue, seulement deux bouts de corde rompue descendaient de ses deux bras » (p. 188). Le récit de la mort de la supérieure est plein de compassion : « Après avoir vécu plusieurs mois dans cet état déplorable, elle mourut. Quelle mort, monsieur le marquis ! je l’ai vue, je l’ai vue la terrible image du désespoir et du crime à sa dernière heure ; elle se croyait entourée d’esprits infernaux ; ils attendaient son âme pour s’en saisir ; elle disait d’une voix étouffée : « Les voilà ! les voilà !… » et leur opposant de droite et de gauche un christ qu’elle tenait à la main ; elle hurlait, elle criait : « Mon Dieu !… mon Dieu !… » La sœur Thérèse la suivit de près ; et nous eûmes une autre supérieure, âgée et pleine d’humeur et de superstition. » (p. 188). La fin est encore plus expéditive : évasion du convent en compagnie d’un « jeune bénédictin », pas désigné comme le père Morel ; logement dans « un lieu suspect », dont elle s’évade à son tour. Elle se réfugie à Sainte-Catherine, un couvent accueillant les jeunes filles, mais où « les libertins et les matrones de la ville vont se pourvoir ». Elle arrive à se faire engager comme blanchisseuse, mais craint de se faire identifier et reprendre, elle demande aide au marquis à qui le mémoire est destiné.
Textes complémentaires
Le dossier de l’édition Lotterie propose d’excellents compléments, entre lesquels le savoureux article « Mariage. (Médec. Diete.) » de l’Encyclopédie (plus précisément l’un des nombreux articles consacrés au mariage). Quelques extraits ; mais il faut lire l’article entier :
« Nous ne prenons ici le mariage que dans le point particulier de son exécution physique, de sa consommation, où les deux sexes confondus dans des embrassements mutuels, goûtent des plaisirs vifs & permis qui sont augmentés & terminés par l’éjaculation réciproque de la semence, cimentés & rendus précieux par la formation d’un enfant. Ainsi nous n’envisagerons le mariage que sous le point de vue où il est synonyme à coït & nous avons à dessein renvoyé à cet article présent tout ce que nous avions à dire sur cette matière ; parce que le mariage regardé comme convention civile, politique, religieuse, est suivant les mœurs, les préjugés, les usages, les lois, la religion reçue, le seul état où le coït soit permis, la seule façon d’autoriser & de légitimer cette action naturelle. Ainsi toutes les remarques que nous aurons occasion de faire ici sur le mariage, ne regarderaient chez des peuples qui auraient d’autres mœurs, d’autres coutumes, une autre religion, etc., que l’usage du coït ou l’acte vénérien. En conséquence nous comprenons le mariage dans la classe des choses non naturelles, comme une des parties de la diète ou de la gymnastique. […]
I°. Toute sécrétion semble, dans l’ordre de la nature, exiger & indiquer l’excrétion de l’humeur séparée ; ainsi l’excrétion de la semence devient, suivant ces mêmes lois, un besoin, & sa rétention un état contre nature, souvent cause de maladie, lorsque cette humeur a été extraite, préparée, travaillée par les testicules devenus actifs, & qu’elle a été perfectionnée par son séjour & son accumulation dans les vésicules séminales. […] D’autres fois au contraire, les impressions que la semence trop abondante & trop active fait sur les organes & ensuite sur l’esprit, sont si fortes, qu’elles l’emportent sur la raison. L’appétit vénérien parvenu à ce degré de violence, demande d’être satisfait ; il les jette dans ce délire furieux connu sous le nom de fureur utérine. […] Tous les praticiens conviennent que les différents symptômes de vapeurs ou d’affections hystériques qui attaquent les filles ou les veuves, sont une suite de la privation du mariage »
On trouve aussi dans le dossier des extraits sur l’esthétique de Diderot, et quelques exemples de critiques à la parution en 1796, qui se divisent en deux clans, « de gauche » et « de droite », selon qu’on est sensible ou non à la politique de Terreur et de déchristianisation violente et forcée qui a précédé cette parution, ce que Diderot, évidemment, ne pouvait prévoir. Sur le lesbianisme, on est stupéfait à la lecture de l’avis d’un certain Andrieux, qui avait tout compris : « La pauvre supérieure d’Arpajon se prenait non pas de goût, mais de passion pour ses religieuses successivement. Ce n’est pas du libertinage, c’est de l’amour le plus ardent, le plus emporté ; c’est Sapho ; c’est Phèdre […] Elle quitte la sœur Sainte-Thérèse pour la sœur Sainte Suzanne. La jalousie de la pauvre délaissée, sa douleur, ses regrets touchants font oublier quel en est l’objet ; et l’on s’y intéresse, comme s’il s’agissait d’un amour de bon aloi » (p. 273). Bien sûr, d’autres sont horrifiés, ou font semblant de l’être, ainsi Naigeon, ami de Diderot, argumente avec subtilité : « la peinture très-fidèle, sans doute, mais aussi très-dégoûtante des amours infâmes de la supérieure. Les divers moyens qu’elle emploie pour séduire, pour corrompre une jeune enfant, dont tout lui faisait un devoir sacré de respecter la candeur et l’innocence ; cette description vive et animée de l’ivresse, du trouble et du désordre de ses sens à la vue de l’objet de sa passion criminelle ; en un mot, ce tableau hideux et vrai d’un genre de débauche, d’ailleurs assez rare, mais vers lequel la seule curiosité pourrait entraîner avec violence une âme mobile, simple et pure, ne peut jamais être sans danger pour les mœurs et pour la santé ; et quand il ne ferait qu’échauffer l’imagination, éveiller le tempérament, de tous les maîtres le plus impérieux, le plus absolu, et le mieux obéi, et hâter, dans quelques individus plus sensibles, plus irritables, ce moment d’orgasme marqué par la nature, où le désir, le besoin général et commun de jouir et de se propager, précipite avec fureur un sexe vers l’autre, ce serait encore un grand mal. » (p. 275).
Le film de Guillaume Nicloux
Moi qui avais lu ce livre dans l’attente de la sortie du film, ma déception fut proportionnelle à mon impatience. Malgré une fin vraiment idiote, on ne peut pas dire que ce soit un navet intégral, comme la récente version de L’Homme qui rit, de Victor Hugo, mais ce film ne tient pas la route à côté de celui de Jacques Rivette, il est purement illustratif, et rate complètement la seule chose qui manquait à celui de Rivette, l’approfondissement de ce superbe personnage de lesbienne rendue hystérique par la répression sexuelle propre à la religion.
Le scénario établit des modifications par rapport à l’histoire de Diderot, ce qui est bien sûr légitime, mais dans la plupart des cas on se demande pourquoi, et à mon sens cela affadit l’histoire. Par exemple, pourquoi aller inventer au début que Suzanne demande à aller au couvent, et dise que Jésus est l’homme de sa vie ? C’est l’histoire de Richard dans Jacques le Fataliste, mais surtout pas celle de Suzanne. La mort de Mme de Moni par accident ou suicide pendant la perte de conscience de Suzanne n’est pas une meilleure idée. Une absurdité est la scène où Suzanne est conduite au couvent d’Arpajon par son avocat, seule à seule avec lui dans un carrosse, conduit par un cocher, sans une sœur avec eux, en rase campagne. Comment justifier qu’on laisse sans surveillance une sœur qui a renoncé au monde et a voulu résilier ses vœux, en compagnie d’un homme qui a cherché à appuyer sa demande, et qu’ils ne profitent pas de ce moment pour s’évader, alors que, autre modification, c’est le même avocat qui la fera évader du même couvent à la fin du film ! Pour Diderot, le couvent est une prison !
De même, le goût niais pour les jolis costumes et les belles demeures conduit à un contresens : au lieu de situer la famille de Suzanne dans un milieu de bourgeoisie moyenne, on a droit aux costumes les plus somptueux, château, carrosse, laquais, et à ce que savait faire sans doute de plus tape à l’œil le décorateur. Mais s’ils croulent sous le fric, comment justifier que ces gens sacrifient Suzanne pour payer la dot de ses sœurs ? Rappelons-nous la demeure modeste du film de Rivette. On a l’impression que comme nos élèves les gens qui ont fait ça confondent noblesse et bourgeoisie. Quant au récit-cadre, qui prépare le happy-end, c’est d’une grossièreté sans nom, qui m’a fait sortir en colère de la salle de cinéma. Là, on peut parler de trahison de l’esprit de Diderot, tourné vers l’empathie à l’égard des basses classes. Dans le livre, Suzanne finit blanchisseuse, pas marquise, mais sans doute fallait-il plaire à la ménagère de moins de cinquante ans susceptible d’acheter la lessive vantée par les pubs qu’on diffusera après le film. Comme pour L’Homme qui rit, si l’on voulait prendre le recul d’un récit-cadre, ce qui était une bonne idée, il aurait fallu nous montrer Diderot, Grimm et leur coterie mystifiant le marquis de Croismare, et s’amusant de leur création romanesque, et non pas ces espèces de retrouvailles nunuches et moliéresques.
Pour le motif qui nous intéresse, la sexualité et plus précisément le lesbianisme, tout est raté. Les passions successives que suscite Suzanne et sa beauté sont édulcorées et modifiées, ce qui ôte son sens à l’aboutissement que constitue l’épisode de la supérieure d’Arpajon. La même actrice joue le rôle de la supérieure cauteleuse de Sainte-Marie, et celui de la mère de Moni, qui symbolise l’amour oblatif et contraste d’avance avec la supérieure d’Arpajon : c’est aplanir ce superbe personnage. L’amitié absolue de Sœur Ursule pour Suzanne est banalisée, on va jusqu’à imaginer qu’elle l’ait reniée pour obéir à sa mère, alors que dans le roman, elle meurt presque d’amour pour elle. Toutes ces relations exacerbées entre femmes constituent un savant nuancier dans le roman, mais le film nous amène directement à l’aboutissement du labyrinthe. Isabelle Huppert s’économise dans le rôle pourtant en or de la supérieure d’Arpajon. La scène de l’orgasme et celle du clavecin qui la précède sont inversées et réduites à pas grand-chose, alors que justement, c’est là qu’on attendait que le réalisateur osât ce que ne pouvait oser Rivette ! Aucune scène où la mère dévore Suzanne de baisers, bref, on dirait que le lesbianisme n’a pas intéressé le réalisateur. Il n’a pas du tout rendu explicite une composante essentielle du texte de Diderot, l’innocence invraisemblable de Suzanne (dont auraient pu se gausser les auteurs de la supercherie dans un récit cadre mieux inspiré). Au contraire, il ajoute même une question à l’interrogatoire du grand vicaire, inconcevable dans l’esprit de l’époque et celui de Diderot, où il demande clairement à Suzanne si elle aurait eu des gestes déplacés ou indécents, je ne sais plus, pour une sœur, qui justifieraient la punition dont elle fait l’objet. Enfin, le choix d’une jeune fille pour le rôle-titre, et de lui faire dire à la fin du film qu’elle a dix-sept ans, soit un an de plus qu’au début, confirme ce gâchis. Comment un personnage pourrait-il en si peu de temps s’enrichir de tant d’expériences qui la font mûrir sans perdre son innocence ? Bref, ne perdez pas votre temps avec ce film.
– Voir aussi pour le groupement de textes en première, un extrait du chapitre XII, 6 de De l’esprit des lois de Charles de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu ; un extrait des Confessions de Rousseau, qui constitue le pendant exact de la scène de l’orgasme de la mère supérieure à l’insu de l’innocente Suzanne ; l’article « Amour socratique » de Voltaire, un extrait d’un texte de Jeremy Bentham (1748-1832) : Défense de la liberté sexuelle (1785), et pourquoi pas, un extrait de Histoire de ma vie, de Jacques Casanova (1797, posthume, 1820).
– Voir un exemple de séquence pédagogique sur ce roman, sur le site de l’académie de Rouen. Un article d’Anne Coudreuse, « Pour un nouveau lecteur : La Religieuse de Diderot et ses destinataires ». Un article de l’université de Bologne : « Dynamiques de séduction dans La Religieuse de Denis Diderot ».
– Lire les articles sur les deux autres œuvres posthumes et très altersexuelles de Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, et Supplément au voyage de Bougainville.
– Lire l’article de Jean-Yves Alt.
Voir en ligne : Texte intégral de l’œuvre sur Wikisource
© altersexualite.com, 2013
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] À noter que dans l’édition GF, que j’ai respecté jusqu’ici, les phrases sont courtes. Le texte de Wikisource, qui se base sur des éditions anciennes, propose des périodes avec des segments séparés par des points virgules, qui semblent plus conformes au style XVIIIe. N’étant pas spécialiste, je m’abstiens d’autres commentaires.
[2] C’est le texte proposé par Wikisource ; la version GF est « dix-neuf ans », et une note précise qu’elle aurait plutôt 26 ans si l’on suit la chronologie interne du roman.
[3] Cette scène très pathétique n’est pas sans rappeler la légende de Julien l’Hospitalier, et Diderot est loin de charger la barque de la supérieure.
 altersexualite.com
altersexualite.com