Accueil > Culture générale et expression en BTS > Paris, ville capitale ? > Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages, de Walter (...)
Chantier monumental d’un livre inachevé
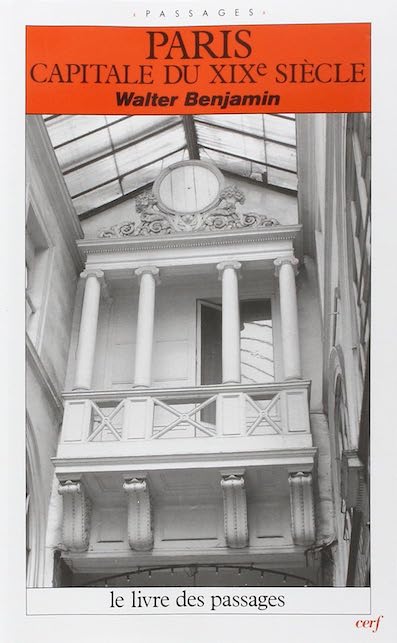 Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages, de Walter Benjamin
Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages, de Walter Benjamin
Les Éditions du Cerf, 1982 (1927-1940), 976 p., 68 €
samedi 6 janvier 2024, par
Paris, capitale du XIXe siècle. Le Livre des Passages de Walter Benjamin figure sur la liste du BO pour le thème « Paris, ville capitale ? » au programme de l’épreuve de BTS de Culture Générale & Expression en 2024. Je l’ai choisi parmi les 8 livres désormais traditionnels sur lesquels je fais un article, pour la notoriété du livre, constamment cité par exemple dans L’Invention de Paris, d’Éric Hazan. C’est un livre inachevé, un immense chantier, publié 40 ans après la mort de l’auteur, sous la forme d’un pavé de près de 1 000 pages écrites très petit, avec quelques cahiers d’illustrations. Aucun étudiant ne se tapera ça, et moi-même je vais finir par faire quelques coupes, surtout pour les chapitres qui ne concernent pas Paris. Il existe des livres qui portent ce nom ou qui contiennent une minuscule part du projet initial, inspiré par le surréalisme, notamment la lecture du Paysan de Paris de Louis Aragon. Ce projet avait été mis au net du vivant de l’auteur, et il est repris successivement dans ses deux versions connues, de 1935 et de 1939, qui ne constituent qu’une poignée de pages au début de ce volume. Je m’efforcerai de trouver quelques extraits utiles pour le cours. La traduction de ce volume est de Jean Lacoste, d’après l’édition originale établie par Rolf Tiedemann. Pour des raisons pratiques, il m’arrivera d’emprunter des passages à d’autres traductions.
Exposés de 1935 et 1939
Cet exposés ont été rédigés sous forme de note d’intention par l’auteur, en allemand puis directement en français. Ils présentent des variantes. Je citerai de préférence la version écrite en français par l’auteur. Voici un extrait du tout premier chapitre, qui attaque fort, sur l’architecture en fer :
« La deuxième condition requise pour le développement des passages est fournie par les débuts de la construction métallique. Sous l’Empire on avait considéré cette technique comme une contribution au renouvellement de l’architecture dans le sens du classicisme grec. Le théoricien de l’architecture Boetticher exprime le sentiment général lorsqu’il dit que : « Quant aux formes d’art du nouveau système, le style hellénique » doit être mis en vigueur. Le style Empire est le style du terrorisme révolutionnaire pour qui l’État est une fin en soi. De même que Napoléon n’a pas compris la nature fonctionnelle de l’État en tant qu’instrument de pouvoir pour la bourgeoisie, de même les architectes de son époque n’ont pas compris la nature fonctionnelle du fer, par où le principe constructif acquiert la prépondérance dans l’architecture. Ces architectes construisent des supports à l’imitation de la colonne pompéienne, des usines à l’imitation des maisons d’habitation, de même que plus tard les premières gares affecteront les allures d’un chalet. La construction joue le rôle du subconscient. Néanmoins le concept de l’ingénieur, qui date des guerres de la Révolution commence à s’affirmer et c’est le début des rivalités entre constructeur et décorateur, entre l’École Polytechnique et l’École des Beaux-Arts.
Pour la première fois depuis les Romains un nouveau matériau de construction artificiel, le fer, fait son apparition. Il va subir une évolution dont le rythme au cours du siècle va en s’accélérant. Elle reçoit une impulsion décisive au jour où l’on constate que la locomotive – objet des tentatives les plus diverses depuis les années 1828-29 – ne fonctionne utilement que sur des rails en fer. Le rail se révèle comme la première pièce montée en fer, précurseur du support. On évite l’emploi du fer pour les immeubles et on l’encourage pour les passages, les halls d’exposition, les gares – toutes constructions qui visent à des buts transitoires » (p. 48).
Les Panoramas attirent aussi l’attention de l’auteur dès les exposés, et ils constitueront le premier chapitre du livre : « En même temps que les panoramas proprement dits s’est développée une littérature de panorama dont font partie Le Livre des Cent-et-Un, Les Français peints par eux-mêmes, Le Diable à Paris, La Grande Ville. […]. Ce sont des séries d’esquisses dont le prétexte anecdotique correspond aux figures situées au premier plan des panoramas, tandis que le tableau qu’ils donnent de la société est l’équivalent du décor peint à l’arrière-fond. Même du point de vue social, cette littérature est panoramique. C’est la dernière fois que l’ouvrier, détaché de sa classe sociale, apparaît dans le décor d’une idylle.
Les Panoramas, qui annoncent un bouleversement dans le rapport entre l’art et la technique, sont dans le même temps l’expression d’une nouvelle sensibilité existentielle. Le citadin, dont la supériorité politique sur la campagne s’exprime de multiples manières au fil du siècle, s’efforce désormais d’intégrer la campagne à la ville. Celle-ci s’étend, dans les panoramas, pour devenir un paysage, comme elle le fera plus tard, d’une manière plus subtile, pour le flâneur. Daguerre est un élève de Prévost, un peintre de panoramas dont l’atelier se trouve passage des Panoramas. […] En 1839 le panorama de Daguerre est détruit par un incendie. La même année Daguerre annonce l’invention du daguerréotype » (p. 38).
Les deux exposés évoquent Baudelaire, avec deux versions très différentes. Voici un extrait de 1935 : « Ce qui est unique en son genre dans la poésie de Baudelaire, c’est que les images de la femme et de la mort, se compénètrent dans une troisième qui est celle de Paris. Le Paris de ses poèmes est une ville engloutie, plus sous-marine que souterraine. Les éléments chtoniens de la ville – sa formation topographique, le vieux lit abandonné de la Seine – trouvent sans doute un écho dans son œuvre. Mais il y a chez Baudelaire un substrat social, moderne, qui joue un rôle déterminant dans l’« idylle funèbre » de la ville. La modernité est un accent essentiel de sa poésie. C’est elle qui, avec le spleen, fait voler en éclats l’idéal (« Spleen et Idéal »). Mais la modernité précisément cite toujours la préhistoire. Cela se fait ici grâce à l’ambiguïté qui est propre aux productions et aux rapports sociaux de cette époque. L’ambiguïté est la manifestation figurée de la dialectique, la loi de la dialectique à l’arrêt. Cet arrêt est utopie et l’image dialectique est donc une image de rêve. La marchandise considérée absolument, c’est-à-dire comme fétiche, donne une image de ce genre, de même que les passages qui sont à la fois rue et maison, et que la prostituée, qui est en une seule personne vendeuse et marchandise » (p. 43).
Et voici pour Haussmann :
« L’idéal d’urbaniste d’Haussmann, c’étaient les perspectives sur lesquelles s’ouvrent sans cesse de longues enfilades de rues. Cet idéal correspond à la tendance courante au XIXe siècle à ennoblir les nécessités techniques par des pseudo-fins artistiques. Les temples du pouvoir spirituel et temporel de la bourgeoisie devaient trouver leur apothéose encadrés par des enfilades de rue, que l’on dissimulait par une toile qui était levée le jour de l’inauguration, comme pour les monuments. – L’activité d’Haussmann s’intègre à l’impérialisme napoléonien. Celui-ci favorise le capital financier. Paris connaît une période faste pour la spéculation. Celle qui se joue à la Bourse refoule les formes du jeu héritées de la société féodale. Aux fantasmagories de l’espace auxquelles s’abandonne le flâneur correspondent les fantasmagories du temps qui font rêver le joueur. Le jeu transforme le temps en drogue. Lafargue voit dans le jeu une reproduction en miniature des mystères de la conjoncture économique. Les expropriations d’Haussmann suscitent une spéculation frauduleuse. La jurisprudence de la Cour de cassation qui est inspirée par l’opposition bourgeoise et orléaniste accroît le risque financier de l’haussmannisation.
Haussmann tente d’étayer sa dictature et de placer Paris sous un régime d’exception. En 1864, dans un discours à la Chambre, il donne libre cours à sa haine de la population déracinée des grandes villes. Laquelle ne cesse de s’accroître du fait même de ses travaux. Le renchérissement des loyers chasse le prolétariat dans les « faubourgs ». Les « quartiers » de Paris perdent ainsi leur physionomie propre. La « ceinture rouge » apparaît. Haussmann s’est baptisé lui-même « artiste démolisseur ». Il sentait en lui une véritable vocation et il y insiste dans ses Mémoires. Cependant il fait des Parisiens des étrangers dans leur propre ville. Ils n’ont plus le sentiment d’y être chez eux. Ils commencent à prendre conscience du caractère inhumain de la grande ville. L’œuvre monumentale de Maxime Du Camp, Paris, doit sa naissance à cette prise de conscience. Les Jérémiades d’un haussmannisé lui donnent la forme d’une lamentation biblique.
La vraie finalité des travaux d’Haussmann était de prémunir la ville contre la guerre civile. Il voulait rendre à jamais impossible l’édification de barricades à Paris. C’est dans le même esprit que Louis-Philippe avait introduit le pavage de bois. Pourtant les barricades jouèrent un rôle pendant la révolution de Février. Engels s’intéresse à la tactique des combats sur les barricades. Haussmann veut les empêcher de deux façons. La largeur de la chaussée doit en interdire la construction et les nouvelles rues qui sont percées doivent conduire le plus rapidement possible des casernes aux quartiers ouvriers. Les contemporains baptisèrent l’entreprise l’« embellissement stratégique ». » (version 1935, p. 44).
Les Dossiers
Dans ce pavé, les brefs projets de 1935 et 39 sont suivis de dossiers répartis d’abord selon l’alphabet en chapitres de A à Z, puis une seconde salve de chapitres de a à r, puis viennent des appendices, des notes et des illustrations…
Le chapitre A s’intitule « Passages, magasins de nouveautés, calicots ». Une note du traducteur nous apprend que « Le premier passage parisien, le passage du Caire (dans le IIe arrondissement, à l’emplacement de l’ancien couvent des Filles-Dieu) a été inauguré en 1799. Le passage des Panoramas (IIe, bld Montmartre) a été percé l’année suivante par l’Américain James Thayer, entre deux rotondes des panoramas ».
Voici l’illustration 12 de ce livre (en noir & banc dans le livre), qui représente une scène de prostitution au Palais-Royal sous le titre « Palais-Royal. 1815. La sortie du n° 113 », aquarelle de Georg Emanuel Opiz (1775-1841).
Le chapitre B s’intitule « Mode ».
J’en extrais juste cette citation provocatrice, qui n’a rien à voir avec Paris : « La station horizontale avait les plus grands avantages pour les femelles de l’espèce homo sapiens, si l’on songe à ses représentants les plus anciens. Elle leur facilitait la grossesse comme l’indiquent les bandages et les ceintures que les femmes enceintes ont l’habitude d’utiliser aujourd’hui. Il est possible, partant, de se demander si la station verticale n’est pas apparue d’une manière générale chez l’homme plus tôt que chez la femme. Celle-ci aurait été à l’époque la compagne à quatre pattes de l’homme, comme l’est aujourd’hui le chien ou le chat. Un pas de plus, et l’on peut imaginer que l’union face à face des partenaires dans la procréation a été une sorte de perversion, et c’est peut-être précisément cette dépravation qui a initié la femelle à la marche debout » (issu d’une note sur Eduard Fuchs, p. 106).
Chapitre C : « Paris antiquisant ».
Benjamin évoque l’un de ses illustres prédécesseurs, Maxime Du Camp : « Du Camp, en effet, n’hésita pas d’exercer les métiers les plus divers, se faisant conducteur d’omnibus, balayeur, égoutier pour se procurer les matériaux de son livre. Cette opiniâtreté l’avait fait surnommer le « préfet de la Seine in partibus » et elle ne fut certes pas étrangère à son élévation à la dignité de sénateur » […] Il cite Paul Bourget donnant la parole à Maxime, un jour qu’il se rendait chez un opticien : « L’âge me touchait. Je ne lui fis pas un accueil aimable. Mais je me soumis. Je commandai un binocle et une paire de besicles. » […] « L’opticien n’avait pas les verres demandés. Il lui fallait une demi-heure pour les préparer. M. Maxime Du Camp sortit pour tuer cette demi-heure en flânant au hasard. Il se trouva sur le Pont-Neuf […] L’écrivain était dans un de ces moments où l’homme, qui va cesser d’être jeune, pense à la vie, avec une gravité résignée qui lui fait retrouver partout l’image de ses propres mélancolies. La toute petite déchéance physiologique dont sa visite chez l’opticien venait de le convaincre, lui avait rappelé ce qui s’oublie si vite, cette loi de l’inévitable destruction qui gouverne toute chose humaine. […] Il se prit soudain, lui, le voyageur d’Orient, le pèlerin des muettes solitudes où le sable est fait de la poussière des morts, à songer qu’un jour aussi cette ville dont il entendait l’énorme halètement, mourrait comme sont mortes tant de capitales de tant d’Empires. L’idée lui vint de l’intérêt prodigieux que nous présenterait aujourd’hui un tableau exact et complet d’une Athènes au temps de Périclès, d’une Carthage au temps des Barca, d’une Alexandrie au temps des Ptolémées, d’une Rome au temps des Césars. […] Par une de ces intuitions fulgurantes où un magnifique sujet de travail surgit devant notre esprit, il aperçut nettement la possibilité d’écrire sur Paris ce livre que les historiens de l’Antiquité n’ont pas écrit sur leurs villes. Il regarda de nouveau le spectacle du pont, de la Seine et du quai. […] L’œuvre de son âge mûr venait de lui apparaître » (p. 116).
Chapitre E : « Haussmannisation, combats de barricades ».
C’est un des chapitres les plus riches pour notre thème. « Le sous-sol a été profondément remué pour la pose des tuyaux de gaz et pour la construction des égouts […] Jamais on n’avait à Paris remué tant de matériaux de construction, tant bâti de maisons d’habitation et d’hôtels, tant restauré ou édifié de monuments, tant aligné de façades en pierre de taille… il fallait faire vite et tirer le meilleur parti d’un terrain acheté fort cher : double stimulant. À Paris, les sous-sols ont pris la place des caves qui ont dû s’enfoncer d’un étage sous terre ; l’emploi des bétons et ciments, dont les découvertes de Vicat sont le principe, a contribué à l’économie et à la hardiesse de ces substructions. » (Extrait de E. Levasseur, Histoire des classes ouvrières et de l’industrie en France de 1789 à 1870) p. 147).
– Corrélation entre les chemins de fer et les travaux d’Haussmann. Dans un mémoire d’Haussmann : « Les gares des chemins de fer sont aujourd’hui les principales entrées de Paris. Les mettre en relation avec le cœur de la ville par de larges artères est une nécessité de premier ordre » […] « Cela vise essentiellement le boulevard du Centre qui devait prolonger le boulevard de Strasbourg jusqu’au Châtelet, par ce qui est aujourd’hui le boulevard Sébastopol » (p. 151).
– Sur Haussmann : « Paris a cessé pour toujours d’être un conglomérat de petites villes ayant leur physionomie, leur vie, où l’on naissait, où l’on mourait, où l’on aimait à vivre, qu’on ne songeait pas à quitter, où la nature et l’histoire avaient collaboré à réaliser la variété dans l’unité. La centralisation, la mégalomanie ont crée une ville artificielle où le Parisien, trait essentiel, ne se sent plus chez soi ; aussi, dès qu’il le peut, il s’en va, et voici un nouveau besoin, la manie de la villégiature. À l’inverse, dans la ville désertée par ses habitants, l’étranger arrive à date fixe : c’est la « saison ». Le Parisien, dans sa ville devenue carrefour cosmopolite, fait figure de déraciné. »
– Sous Louis-Philippe : « À l’intérieur de la ville, l’idée directrice paraît avoir été de réaménager les lignes stratégiques qui avaient joué le principal rôle dans les journées de Juillet : la ligne des quais, la ligne des boulevards… Enfin, au centre, la rue de Rambuteau, aïeule des voies haussmannisées, présenta, des Halles au Marais, une largeur qui parut alors considérable, treize mètres. »
– « On avait beau construire, les bâtiments neufs ne suffisaient pas à recevoir les expropriés. Il en résulta une grave crise des loyers : ils doublèrent. La population était de 1.053.000 âmes en 1851, elle passa après l’annexion à 1.825.000 en 1866. À la fin de l’Empire, Paris comptait 60.000 maisons, 612.000 logements, dont 481.000 d’un loyer inférieur à 500 francs. On avait surélevé les maisons, abaissé les plafonds : une loi dut fixer un minimum, 2 m 60 » (Dubech-D’Espezel, Histoire de Paris, cité pp. 153, 155 & 156).
Cela ne manque pas de sel : avec des moyens techniques modernes de construction et une augmentation massive de la taille moyenne des Français, on en arrive à une moyenne de 2,5 m de hauteur sous plafond ! En ce qui concerne ce dernier extrait, il se trouve que j’ai la chance d’habiter dans un immeuble parisien de 1884, pas de type haussmannien, mais avec un plafond à 272 cm, des tas de fenêtres, presque pas de mur, une vraie « passoire thermique » selon la nomenclature orwellienne en vogue. Eh bien j’ai l’impression de ne pas être oppressé comme dans les cages à lapins que l’on construit actuellement sous la tyrannie écolo-bobo !
– « Les maçons, dont les mœurs sont plus tranchées que celles des autres émigrants, appartiennent ordinairement à des familles de petits propriétaires-cultivateurs établis dans des communes rurales pourvues de pâturages indivis, comportant au moins l’entretien d’une vache laitière par famille […] Pendant son séjour a Paris, le maçon vit avec toute l’économie que comporte la situation de célibataire ; sa nourriture […] lui revient environ à 38 francs par mois ; le logement […] coûte seulement 8 francs par mois : dix ouvriers de même profession sont ordinairement réunis dans une même chambre, où ils couchent deux à deux. Cette chambre n’est point chauffée ; les compagnons l’éclairent au moyen d’une chandelle de suif, qu’ils fournissent à tour de rôle […] Parvenu à l’âge de 45 ans, le maçon […] reste désormais sur sa propriété pour la cultiver lui-même […] Ces mœurs forment un frappant contraste avec celles de la population sédentaire : cependant elles tendent visiblement à s’altérer, depuis quelques années […] Ainsi, pendant son séjour à Paris, le jeune maçon se montre moins éloigné qu’autrefois de contracter des unions illégitimes, de se livrer à des dépenses de vêtement et de se montrer dans les lieux de réunion et de plaisir. Dans le temps même où il devient moins capable de s’élever à la condition de propriétaire, il se trouve plus accessible aux sentiments de jalousie qui se développent contre les classes supérieures de la société. Cette dépravation, contractée loin de l’influence de la famille par des hommes […] chez lesquels l’amour du gain s’est développée sans le contre-poids du sentiment religieux, prend parfois un caractère de grossièreté qui ne se trouve pas […] chez l’ouvrier parisien sédentaire » (F. Le Play, Les ouvriers européens, Paris, 1855, cité p. 158).
– Petite précision que je n’avais jamais entendue : « Aux thèses d’Haussmann correspond le calcul de Du Camp selon lequel la Commune de Paris se serait composée à 75 % d’étrangers et de provinciaux » (p. 165). Dommage qu’il ne précise pas le ratio de provinciaux. C’est intéressant parce qu’on a ce cliché de Paris ville révolutionnaire, alors que même à ces époques d’avant l’immigration extra-européenne, il fallait des étrangers pour faire la révolution !
– Citation d’Engels (La Question du logement, 1872) : « En réalité, la bourgeoisie n’a qu’une méthode pour résoudre la question du logement à sa manière – ce qui veut dire : la résoudre de telle façon que la solution engendre toujours à nouveau la question. Cette méthode porte un nom, celui d’Haussmann. Par là j’entends ici non pas seulement la manière spécifiquement bonapartiste du Haussmann parisien de percer de longues artères droites et larges à travers les quartiers ouvriers aux rues étroites, et de les border de chaque côté de grandes et luxueuses constructions ; le but poursuivi – outre leur utilité stratégique, les combats de barricades étant rendus plus difficiles –, était la constitution d’un prolétariat du bâtiment, spécifiquement bonapartiste, dépendant du gouvernement, et la transformation de la ville en une cité de luxe. J’entends ici par « Haussmann » la pratique qui s’est généralisée d’ouvrir des brèches dans les arrondissements ouvriers, surtout dans ceux situés au centre de nos grandes villes […] Le résultat est partout le même : les ruelles et les impasses les plus scandaleuses disparaissent et la bourgeoisie se glorifie hautement de cet immense succès – mais ruelles et impasses resurgissent aussitôt ailleurs et souvent dans le voisinage immédiat » [fin de la citation d’Engels] – C’est ici qu’on pourrait rappeler la fameuse question de concours : « Pourquoi la mortalité est-elle beaucoup plus grande dans les nouveaux quartiers ouvriers de Londres (vers 1890) ? – Parce que les gens se nourrissent mal, pour pouvoir payer les loyers élevés. Et la remarque de Péladan : le XIXe siècle a forcé chacun à se procurer un logis, fût-ce au détriment de son alimentation et de son habillement » (p. 168).
Chapitre F : « Construction en Fer ».
– « Le verre venu trop tôt, le fer prématuré. Le matériau le plus fragile et le matériau le plus solide ont été brisés, pour ainsi dire déflorés dans les passages. On ne savait pas encore au milieu du siècle précédent comment il fallait construire avec le fer et le verre. C’est pourquoi le jour qui tombe des verrières portées par les poutres en fer du plafond est si sale et si triste » (p. 172). À vérifier avec le film Zazie dans le métro, qui comporte de nombreuses scènes dans les passages parisiens.

– « En 1791, le terme d’« ingénieur » apparaît en France pour désigner les officiers spécialisés dans le génie militaire. « À la même époque, et dans le même pays, l’opposition entre la « construction » et l’« architecture » commença à s’exprimer de façon consciente et à prendre même la forme d’antagonismes personnels […] Elle avait été complètement ignorée dans le passé […] mais les « constructeurs » s’opposèrent aux « décorateurs » dans les innombrables traités esthétiques qui remirent l’art français sur le droit chemin après les tempêtes de la Révolution, et l’on se demanda à cette occasion si les « ingénieurs », qui étaient les alliés des premiers, ne devaient pas occuper socialement le même camp » (A.G. Meyer, Eisenbauten, 1907).
– « On prend conscience de l’absolutisme technique qui est à la base de la construction en fer, du seul fait du matériau, lorsqu’on se rappelle à quel point celui-ci était en opposition avec les conceptions traditionnelles concernant la valeur et l’emploi des matériaux de construction. « On nourrissait une certaine méfiance envers le fer parce qu’on ne le trouvait pas tel quel dans la nature et qu’il fallait le fabriquer artificiellement. Cela n’est qu’une application particulière d’un sentiment universellement répandu à la Renaissance » (p. 179).
– « En 1779 le premier pont de fonte (celui de Coalbrookdale), en 1788 son architecte reçoit la médaille d’or de la Société anglaise des arts. « Comme d’ailleurs, c’est en 1790 que l’architecte Louis terminait à Paris la charpente en fer forgé du Théâtre Français, il est vraiment permis de dire que le Centenaire des constructions en métal coïncide presque exactement avec celui de la Révolution française » (A. de Lapparent, Le Siècle du fer, Paris, 1890, cité p. 187).
Chapitre I : « L’intérieur, la trace ».
– « Vers 1830, Paris s’amusait de lithos grivoises avec des portes et des fenêtres coulissantes. C’étaient les « images dites à portes et à fenêtres de Numa Bassaget » (écrit par erreur avec un j, p. 232). On trouvera un article sur ce chapitre avec des illustrations : « Les images du Livre des passages et l’exposé « Paris, capitale du XIXe siècle ». Ici, « Paris » désigne de façon synecdochique la France.
Chapitre J : « Baudelaire ».
– « Larchey est le témoin oculaire de la première visite académique de Baudelaire, rendue à Jules Sandeau. Larchey entre dans l’antichambre peu de temps après Baudelaire. « J’étais […] arrivé à la première heure, quand un spectacle bizarre m’avertit qu’on m’avait précédé. Tout autour des patères de l’antichambre s’enroulait un long boa de couleur écarlate, un de ces boas en chenille dont raffolaient alors les petites ouvrières » (p. 266). L’anecdote du boa, de même que les cheveux verts, est bien référencée, moins que l’homosexualité du poète.

Je n’ai trouvé aucune caricature de Baudelaire au boa, ce qui m’a étonné vu la richesse de l’époque en caricatures. En voici une de Sébastien Charles Giraud.
– La prédilection de Baudelaire pour Juvénal pourrait bien venir de ce qu’il voit en lui l’un des premiers poètes citadins. À comparer avec cette remarque de Thibaudet : « Nous voyons, aux grandes époques de la vie urbaine, la poésie repoussée d’autant plus violemment hors de la ville que la ville fournit davantage au poète et a l’homme leur vie intellectuelle et morale. Lorsque cette vie […] du monde grec a pour centre les grandes cités cosmopolites, Alexandrie et Syracuse, naît de ces cités la poésie pastorale. Lorsque la même place est occupée par la Rome d’Auguste, la même poésie des bergers […], de la nature fraîche apparaît avec les Bucoliques et les Géorgiques de Virgile. Et, au dix-huitième siècle français, au moment le plus brillant […] de la vie parisienne, reviennent les bergeries, doublées du retour à l’antique […] Le seul poète chez qui on trouvera déjà quelque crayon de l’urbanisme baudelairien (et d’autres choses baudelairiennes encore) serait peut-être, à ses heures, Saint-Amand » (Albert Thibaudet, Intérieurs, 1924, cité p. 268).
– « Un sonnet comme la Passante, un vers comme le dernier vers de ce sonnet […] ne peuvent éclore que dans le milieu d’une grande capitale, où les hommes vivent ensemble, l’un à l’autre étrangers et l’un près de l’autre voyageurs. Et, de toutes les capitales, Paris seul les produira comme un fruit naturel », idem, p. 269.
J’ai fini par zapper ce long chapitre qui sort de notre thème, pour passer au suivant, puis j’ai lu le livre en diagonale.
Chapitre K : « Ville de rêve et maison de rêve… ».
– « Les travaux de M. Haussmann ont donné l’essor, au moins dans l’origine, à une foule de plans bizarres ou grandioses […] C’est par exemple M. Hérard, architecte, qui publie en 1855 un projet de passerelles à construire au point de rencontre des boulevards Saint-Denis et de Sébastopol : ces passerelles, à galeries, figurent un carre continu, dont chaque côté est déterminé par l’angle que forment en se croisant les deux boulevards. C’est M. J. Brame, qui expose en 1856, dans une série de lithographies, son plan de chemins de fer dans les villes, et particulièrement dans Paris, avec un système de voûtes supportant les rails, de voies de côté pour les piétons et de ponts volants pour mettre ces voies latérales en communication […] À peu près vers la même date encore, un avocat demande, par une Lettre au ministre du Commerce, l’établissement d’une série de tentes dans toute la longueur des rues, afin de préserver le piéton […] de prendre une voiture ou un parapluie. Un peu plus tard, un architecte […] propose de reconstruire la Cité tout entière en style gothique, pour la mettre en harmonie avec Notre-Dame » (Victor Fournel, Paris nouveau et Paris futur, 1868, cité p. 418).
Je n’ai pas trouvé trace de ces projets de Hérard ou Brame (cette manie de ne pas donner les prénoms !) alors voici une illustration de Robida vue à l’exposition « Métro ! Le Grand Paris en mouvement ».

– Sur le chapitre de Fournel intitulé « Paris futur » : « Il y avait […] des cafés de première, de deuxième et de troisième classe […] et pour chaque catégorie était régie avec prévoyance le nombre des salles, des tables, des billards, des glaces, des ornements et des dorures […] II y avait les rues de maître et les rues de service, comme il y a les escaliers de maître et les escaliers de service dans les maisons bien organisées […] Sur le fronton de la caserne, un bas-relief […] représentait dans une gloire l’Ordre Public, en costume de fantassin de la ligne, avec une auréole au front, terrassant l’Hydre aux cent têtes de la Décentralisation […] Cinquante sentinelles, postées aux cinquante guichets de la caserne, vis-à-vis des cinquante boulevards, pouvaient, avec une lunette d’approche, apercevoir, à quinze ou vingt kilomètres de là, les cinquante sentinelles des cinquante barrières . . . Montmartre était coiffé d’un dôme, orné d’un immense cadran électrique qui se voyait de deux lieues, s’entendait de quatre et servait de régulateur à toutes les horloges de la ville. On avait enfin atteint le grand but poursuivi depuis si longtemps : celui de faire de Paris un objet de luxe et de curiosité plutôt que d’usage, une ville d’exposition, placée sous verre, […] objet d’admiration et d’envie pour les étrangers, impossible à ses habitants » (idem).
– La ville de rêve de Napoléon Ier : « Napoléon, qui avait d’abord voulu ériger l’Arc de Triomphe à n’importe quel endroit de la ville – comme le premier, décevant, de la place du Carrousel – s’était laissé convaincre par Fontaine d’édifier à l’ouest de la ville, où l’on disposait d’un vaste espace, un Paris impérial surpassant la ville royale, y compris Versailles. Entre le haut des Champs-Élysées et la Seine, sur le plateau aujourd’hui bordé par le Trocadéro, devait s’édifier, avec « des palais pour douze rois et leurs suites », non seulement la plus belle ville qui fût, mais même la plus belle ville qui pût être. L’Arc de Triomphe devait être le premier édifice de cette ville. » (Fritz Stahl, Paris, 1929, cité p. 422).
Chapitre K : « Maison de rêve, Musée, Pavillon thermal ».
– « L’Opéra est une des créations caractéristiques du Second Empire. Entre cent-soixante projets, on choisit celui d’un jeune inconnu, Charles Garnier. Son théâtre, construit de 1861 à 1875, est conçu comme un lieu de parade […] C’est la scène où le Paris impérial se contemple avec complaisance ; classes récemment parvenues au pouvoir et à la fortune, mêlées d’éléments cosmopolites, c’est un monde nouveau qu’on désigne par un nom nouveau : on ne dit plus la Cour, on dit le Tout-Paris […]. Un théâtre conçu comme un centre de vie sociale et urbaine, voila encore une idée neuve et un signe des temps » (Dubech-D’Espezel, Histoire de Paris, cité p. 428).
Chapitre M : « Le Flâneur ».
– « Cette ivresse anamnestique qui accompagne le flâneur errant dans la ville, non seulement trouve son aliment dans ce qui est perceptible à la vue, mais s’empare du simple savoir, des données inertes, qui deviennent ainsi quelque chose de vécu, une expérience. Ce savoir senti se transmet de l’un à l’autre surtout par le bouche à oreille. Mais au cours du XIXe siècle il s’est également déposé dans un nombre presque infini d’ouvrages. Avant même Lefeuve qui a décrit Paris « rue par rue, maison par maison », on n’a cessé de peindre ce décor de paysage pour l’oisif qui rêve. L’étude de ces livres constituait une deuxième existence déjà tout entière préparée pour la songerie, et ce qu’il apprenait en les lisant prenait forme et figure lors de la promenade de l’après-midi, avant l’apéritif. La montée assez raide derrière l’église Notre-Dame-de-Lorette ne se faisait-elle pas sentir avec plus d’insistance dans ses jambes quand il savait qu’on attelait ici le « cheval de renfort », en sus des deux autres, aux premiers temps des omnibus parisiens ? »
– Ce n’est qu’après l’exposition de 1867 qu’on commença à voir poindre les vélocipèdes qui devaient, quelques années plus tard, obtenir une vogue aussi grande que peu durable. Disons d’abord que sous le Directoire, on avait vu des incroyables se servir de vélocifères qui étaient des vélocipèdes lourds et mal construits ; le 19 mai 1804 on représenta au Vaudeville une pièce intitulée les Vélocifères et on y chantait ce couplet :
Vous, partisans du petit trot,
Cochers qui ne vous pressez guère,
Voulez-vous arriver plus tôt
Que le plus prompt vélocifère ?
Sachez remplacer aujourd’hui
La rapidité par l’adresse.
Mais dès le commencement de 1868 les vélocipèdes circulèrent, et bientôt les promenades publiques en furent sillonnées ; le Velocemen remplaça le canotier. Il y eut des gymnases, des cercles de vélocipédistes et des concours furent ouverts pour stimuler l’adresse des amateurs […] Aujourd’hui, le vélocipède est fini, oublié » (H. Gourdon de Genouillac, Paris à travers les siècles, 1882, cité p. 443).
Chapitre N : « Réflexions théoriques sur la connaissance, théorie du progrès ».
– « C’est dans les escaliers battus par le vent de la tour Eiffel ou, mieux encore, entre les poutres métalliques d’un « pont transbordeur », qu’on découvre l’expérience esthétique fondamentale de l’architecture d’aujourd’hui : les choses – les navires, la mer, les immeubles, les mâts, le paysage, le port – passent au travers du mince filet de fer qui demeure tendu dans l’espace. Elles perdent leur forme bien délimitée, elles se mêlent dans un même mouvement tournant vers le bas, elles se confondent toutes en même temps » (Sigfried Giedion, Construire en France). L’historien également n’a, aujourd’hui, qu’à édifier une structure élancée mais solide – une structure philosophique – pour prendre dans son filet les aspects les plus actuels du passé. De même, cependant, que les perspectives grandioses que les nouvelles constructions offraient sur les villes […] furent longtemps exclusivement réservées aux travailleurs et aux ingénieurs, le philosophe qui veut découvrir ici les points de vue inédits doit être un travailleur indépendant, insensible au vertige et, s’il le faut, solitaire » (p. 475).
Benjamin métaphorise sa méthode : « Comment a été écrit ce travail : échelon après échelon, selon les appuis étroits que le pied rencontrait par hasard, comme en escalade des sommets périlleux sans pouvoir un seul instant jeter un regard autour de soi, par peur du vertige (mais aussi pour garder pour la fin dans toute sa force le panorama qui va s’offrir) » (p. 477).
Chapitre O : « Prostitution, jeu ».
– « Sur la façon dont Blücher jouait à Paris, voir le livre de Gronow. Quand il eut perdu, il obligea la Banque de France à lui avancer 100 000 francs et dut quitter Paris lorsque le scandale éclata. « Blücher ne quittait pas le tripot du n° 113 au Palais-Royal et dépensa six millions pendant son séjour ; toutes ses terres étaient engagées lorsqu’il quitta Paris. » Paris a gagné davantage d’argent avec les troupes d’occupation qu’il n’a payé d’indemnités de guerre » (p. 509).
– « La danse où la vulgarité […] s’exhibe avec une impudence sans exemple jusqu’ici, est le quadrille français traditionnel. Lorsque les danseurs offensent déjà par des pantomimes tout sentiment délicat, mais sans encore aller jusqu’au point de devoir craindre d’être expulsés de la salle par les agents de police en faction, ce type de danse s’appelle le cancan. Mais lorsque tout sentiment moral est foulé aux pieds par la façon de danser, lorsque les « sergents de ville » se sentent enfin, après un long moment d’hésitation, autorisés à rappeler les danseurs a plus de décence, avec la formule habituelle – « Dansez plus décemment ou l’on vous mettra à la porte ! » –, ce degré supérieur ou, plus exactement, cette forme dégradée s’appelle le chahut […] Cette grossièreté bestiale […] a fait naître un règlement de police […] stipulant que les hommes ne peuvent se rendre ni masqués ni costumés dans ces bals. D’abord, afin qu’ils ne soient pas tentés de profiter de l’arrangement pour se comporter avec encore plus de vulgarité, mais surtout afin qu’un danseur qui sera parvenu en dansant au nec plus ultra parisien de la dépravation, et qui, de ce fait, aura été mis à la porte par les sergents de ville, ne puisse réapparaître dans la salle de danse […] Les femmes, en revanche, n’ont pas le droit d’y apparaître autrement que masquées » (Ferdinand von Gall, Paris und Seine salons, 1844, cité p. 511).
– « La ferme des jeux comprenait : la maison du cercle des Étrangers, rue Grange-Batelière, n° 6 ; la maison de Livry, dite Frascati, rue Richelieu, n°103 ; la maison Dunans, rue du Mont-Blanc, n°40 ; la maison Marivaux, rue Marivaux, n° 13 ; la maison Paphos, rue du Temple, n° 110 ; la maison Dauphine, rue Dauphine, n° 36 ; au Palais-Royal, le n° 9 (jusqu’au n° 24), le n° 129 (jusqu’au n° 137), le n° 119 (depuis le n° 102), le n° 154 (depuis le n° 145). Ces établissements, malgré leur grand nombre, ne suffisent pas aux joueurs. La spéculation en ouvre d’autres que la police ne peut pas toujours surveiller assez efficacement. On y joue l’écarté, la bouillotte et le baccarat. De vieilles femmes, débris honteux et grotesques de tous les vices […] en ont la direction. Ce sont de soi-disant veuves de généraux, protégées par de soi-disant colonels qui se partagent les produits de la cagnotte. Cet état de choses se prolonge jusqu’en 1837, époque de la suppression de la ferme des jeux » (Édouard Gourdon, Les Faucheurs de nuit, 1860, cité p. 514).
– « Palais-Royal : « Le deuxième étage est surtout habité par « les femmes perdues » de la classe la plus distinguée […] Au troisième étage et « au paradis », dans les mansardes, habitent celles de la classe inférieure ; leur gagne-pain les oblige à résider au centre de la ville, au Palais-Royal, rue Traversière et aux alentours […] Peut-être 600 à 800 filles habitent-elles au Palais-Royal – mais un nombre bien plus grand va le soir s’y promener parce que c’est là qu’on trouve la plupart des oisifs. Le soir, on les trouve les unes à côté des autres, rue Saint-Honoré et dans quelques rues adjacentes, par rangs comme les cabriolets de louage au Palais-Royal, pendant la journée. Mais leur nombre diminue en ville à mesure qu’on s’éloigne du Palais-Royal » (J. F. Benzenberg, Briefe geschrieben auf einer Reise nach Paris, 1805) L’auteur estime à « environ 16 000 » le nombre des « femmes perdues ». « Elles étaient 28 000 avant la Révolution selon un rapport de police » (cité p. 515).
– « Extrait de l’ordonnance de police du 14 avril 1830 réglementant la prostitution : « Art. 1 […] II leur est également interdit de paraître dans aucun temps et sous aucun prétexte, dans les passages, dans les jardins publics et sur les boulevards. Art. 2. Les filles publiques ne pourront se livrer à la prostitution que dans les maisons de tolérance. Art. 3. Les filles isolées, c’est-à-dire celles qui n’habitent pas dans les maisons de tolérance, ne pourront se rendre dans ces maisons qu’après I’allumage des réverbères. Elles devront s’y rendre directement, être vêtues simplement, avec décence […] Art. 4. Elles ne pourront, dans une même soirée, quitter une maison de tolérance pour se rendre dans une autre. Art 5. Les filles isolées devront avoir quitté les maisons de tolérance, et être rentrées chez elles a onze heures du soir […] Art. 7. Les maisons de tolérance pourront être indiquées par une lanterne, et, dans les premiers temps, par une femme âgée qui se tiendra sur la porte […] Signé Mangin (F. F. A. Béraud, Les Filles publiques de Paris et la police qui les régit, 1839, cité p. 517).
– « On est d’abord porté à croire à un grand nombre de filles publiques par le fait d’une espèce de fantasmagorie que produisent les allées et venues de ces filles toujours sur les mêmes points, ce qui semble les multiplier à l’infini […]. Il est une autre circonstance qui prête à cette illusion, ce sont les travestissements nombreux dont s’affublent très souvent les filles publiques dans une même soirée. Avec un œil tant soit peu exercé, il est facile de se convaincre qu’une fille, à huit heures, dans un costume élégant, riche, est la même qui paraît en grisette à neuf heures et qui se montre à dix en paysanne et vice versa. Il en est ainsi sur tous les points de la capitale ou affluent habituellement les prostituées. Par exemple, suivez une de ces filles sur le boulevard, entre les portes Saint-Martin et Saint-Denis ; elle est maintenant en chapeau à plumes et en robe de soie recouverte d’un schall (sic) ; elle se rend dans la rue Saint-Martin, en côtoie la droite, aborde les petites rues qui touchent à la rue Saint-Denis, entre dans une des nombreuses maisons de débauche qui s’y trouvent, et peu de temps après, elle en sort vêtue en grisette ou en villageoise » (idem, cité p. 519).
Dans ce chapitre on trouve également une remarque intéressante pour notre thème (« Paris, ville capitale ? ») qui ne semble pas avoir de rapport avec le titre du chapitre. « C’est par la faculté de son esprit, nommée réminiscence, que les vœux de l’homme condamné à la brillante captivité des villes, se portent […] vers le séjour de la campagne, sa primitive demeure, ou du moins vers la possession d’un simple et tranquille jardin. Ses yeux aspirent à se reposer sur la verdure, des fatigues du comptoir ou de la brûlante clarté de la lampe du salon. Son odorat, blessé sans relâche par les émanations d’une fange empestée, recherche le parfum qui s’exhale des fleurs. Une bordure de violettes humbles et suaves le ravirait d’extase […] Ce bonheur […] lui est-il refusé, il voudra pousser l’illusion encore jusqu’à transformer les bords de sa fenêtre en jardin suspendu, et la cheminée de sa modeste habitation en un parterre émaillé de verdure et de fleurs. Tel est l’homme de la ville, telle est la source de sa passion pour les fleurs et les champs […]. Telles sont les réflexions qui me conduisirent à l’établissement des nombreux métiers sur lesquels je fis exécuter des dessins imitant les fleurs de la nature […]. Le débit de ces sortes de châles fut prodigieux […] Les châles étaient vendus avant d’être faits. Les ordres à livrer se succédaient sans interruption […] brillant période des châles, cet âge d’or de la fabrique […] a duré peu de temps, et a fait couler cependant en France un Pactole dont les flots étaient d’autant plus riches, que leur principale source venait de l’étranger. Après avoir parlé de ce débit remarquable, il peut être intéressant […] de savoir dans quel ordre il se propagea. Ainsi que je m’y étais attendu, Paris consomma peu de châles en fleurs naturelles. Les provinces en demandèrent en proportion de leur distance de la capitale, et l’étranger en proportion de son éloignement de la France. Leur règne n’est point encore fini. J’approvisionne toujours des pays, séparés entre eux de tout le travers de l’Europe, et où il ne faudrait pas envoyer un seul châle à dessins imités du cachemire. […] De ce que Paris n’a point fait de cas des châles à dessins de fleurs naturelles […] ne pourrait-on pas dire, en reconnaissant Paris comme le centre du goût, que plus on s’éloigne de cette ville, plus on se rapproche des goûts et des sentiments naturels ; ou en d’autres termes, que le goût et le naturel n’ont en ceci rien de commun, et s’excluent même réciproquement ? » (J. Rey, Fabricant de cachemires, Études pour servir à l’histoire des châles, Paris, 1823, cité p. 523).
– « Le sentiment de bonheur propre à celui qui gagne au jeu se caractérise par le fait que l’argent et la richesse, qui sont d’ordinaire les choses les plus massives, les plus lourdes du monde, lui sont donnés par le destin, comme la récompense d’une étreinte parfaitement heureuse. Elles peuvent se comparer au témoignage d’amour d’une femme complètement satisfaite par l’homme. Les joueurs sont des types d’hommes auxquels il n’est pas donné de satisfaire la femme. Don Juan est-il joueur ? » (p. 531).
Chapitre P : « Les rues de Paris ».
– « La fonction des saints dans la toponymie des rues parisiennes est apparue d’un coup très clairement pendant la Révolution française. Les rues Saint-Honoré, Saint-Roch, Saint-Antoine furent appelées pendant un moment rues Honoré, Roch et Antoine, mais ces noms ne parvinrent pas à s’imposer ; il en résultait un hiatus que l’oreille du Français ne pouvait supporter » (p. 534).
Chapitre T : « Types d’éclairage ».
– « Note se rapportant à 1824 : « Paris a été éclairé cette année au moyen de 11,205 becs de réverbères […] L’entrepreneur est tenu de faire l’allumage de toutes les parties de la ville en quarante minutes au plus, c’est-à-dire en commençant vingt minutes avant l’heure prescrite journellement et en finissant vingt minutes après ; il ne peut confier plus de vingt-cinq lanternes à chaque allumeur » (Dulaure, Histoire (physique, civile et morale) de Paris depuis 1821 jusqu’à nos jours, 1835, cité p. 579).
– « En matière d’édilité, les deux grandes œuvres de la Restauration furent l’éclairage au gaz et la création des omnibus. Paris était éclairé, en 1814, par 5.000 réverbères, dont le service occupait 142 allumeurs. En 1822, le gouvernement décida que les rues seraient éclairées au gaz à mesure que les anciens contrats viendraient à échéance. Le 3 juin 1825, premier essai, par la Compagnie du Gaz portatif français, d’éclairage d’une place : la place Vendôme reçut quatre candélabres aux angles de la colonne et deux réverbères aux angles de la rue de Castiglione. En 1826, il y avait dans Paris 9.000 becs de gaz, 10.000 en 1828, 1.500 abonnés, trois compagnies et quatre usines, dont une sur la rive gauche » (Dubech-D’Espezel, Histoire de Paris, cité p. 582).
– « À l’occasion de l’installation définitive des lanternes dans les rues parisiennes (en mars 1667) : « Je ne sais guère que l’abbé Terrasson, parmi les gens de lettres, qui ait médit des lanternes […]. À l’entendre, la décadence des lettres datait de leur établissement : « Avant cette époque, disait-il, chacun, dans la crainte d’être assassiné, rentrait de bonne heure chez soi, ce qui tournait au profit du travail. Maintenant, on reste dehors le soir et l’on ne travaille plus. » C’est là certainement une vérité, dont l’invention du gaz est loin d’avoir fait un mensonge. » (Édouard Fournier, Les Lanternes. Histoire de l’ancien éclairage de Paris, 1854, cité p. 584).
Sur ce sujet, voir ce dossier « « Fiat lux », ou l’éclairage à Paris » et, plus complet, « Histoire de l’éclairage public à Paris ». Ce dernier site propose d’ailleurs une visite sur réservation de ses collections, à Nanterre. Voici une des photos de nuit de Brassaï, dont on peut consulter la collection ici.

Chapitre V : « Conspirations, compagnonnage ».
– « Le 25 mars 1831, rétablissement de la Garde Nationale. « Elle […] nommait elle-même ses officiers, les chefs de légion exceptes […] La garde nationale formait […] une véritable armée comptant 24 000 hommes environ […] cette armée était […] une force de police […] Aussi, eut-on soin d’en écarter les ouvriers […]. On y parvint en imposant au garde national d’avoir l’uniforme et de s’équiper à ses frais […]. Cette garde bourgeoise fit d’ailleurs en toutes circonstances bravement son devoir. Dès que passaient les tambours battant le rappel, chacun quittait ses occupations, les boutiquiers fermaient leurs magasins, et, l’uniforme endossé, on allait joindre le bataillon au lieu de rassemblement » (A. Malet, P. Grillet, XIXe siècle, 1919, cité p. 624).
Après la série de 26 chapitres selon l’alphabet qui court jusqu’à Z, sans explication commence une nouvelle série avec les lettres minuscules a, b, etc., jusqu’à r. Les notes de l’éditeur sont peu claires, mais il en ressort que ce sont les classements de Benjamin lui-même qui sont repris, et qu’il avait d’ailleurs deux livres en projet, un sur Baudelaire, un sur les passages.
Chapitre a : « Mouvement social ».
J’ai lu en diagonale ces chapitres, mais je relève ici la citation écourtée d’une célèbre page de Victor Hugo, Les Misérables, IV, 10, 5. « Originalité de Paris », dont je reprends ici le texte intégral :
« Depuis deux ans, nous l’avons dit, Paris avait vu plus d’une insurrection. Hors des quartiers insurgés, rien n’est d’ordinaire plus étrangement calme que la physionomie de Paris pendant une émeute. Paris s’accoutume très vite à tout, – ce n’est qu’une émeute, – et Paris a tant d’affaires qu’il ne se dérange pas pour si peu. Ces villes colossales peuvent seules donner de tels spectacles. Ces enceintes immenses peuvent seules contenir en même temps la guerre civile et on ne sait quelle bizarre tranquillité. D’habitude, quand l’insurrection commence, quand on entend le tambour, le rappel, la générale, le boutiquier se borne à dire :
– Il paraît qu’il y a du grabuge rue Saint-Martin.
Ou :
– Faubourg Saint-Antoine.
Souvent il ajoute avec insouciance :
– Quelque part par là.
Plus tard, quand on distingue le vacarme déchirant et lugubre de la mousqueterie et des feux de peloton, le boutiquier dit :
– Ça chauffe donc ! Tiens, ça chauffe !
Un moment après, si l’émeute approche et gagne, il ferme précipitamment sa boutique et endosse rapidement son uniforme, c’est-à-dire, met ses marchandises en sûreté et risque sa personne.
On se fusille dans un carrefour, dans un passage, dans un cul-de-sac ; on prend, perd et reprend des barricades ; le sang coule, la mitraille crible les façades des maisons, les balles tuent les gens dans leur alcôve, les cadavres encombrent le pavé. À quelques rues de là, on entend le choc des billes de billard dans les cafés.
Les théâtres ouvrent leurs portes et jouent des vaudevilles ; les curieux causent et rient à deux pas de ces rues pleines de guerre. Les fiacres cheminent ; les passants vont dîner en ville. Quelquefois dans le quartier même où l’on se bat. En 1831, une fusillade s’interrompit pour laisser passer une noce.
Lors de l’insurrection du 12 mai 1839, rue Saint-Martin, un petit vieux homme infirme, traînant une charrette à bras surmontée d’un chiffon tricolore dans laquelle il y avait des carafes remplies d’un liquide quelconque, allait et venait de la barricade à la troupe et de la troupe à la barricade, offrant impartialement – des verres de coco – tantôt au gouvernement, tantôt à l’anarchie.
Rien n’est plus étrange ; et c’est là le caractère propre des émeutes de Paris qui ne se retrouve dans aucune autre capitale. Il faut pour cela deux choses, la grandeur de Paris, et sa gaîté. Il faut la ville de Voltaire et de Napoléon.
Cette fois cependant, dans la prise d’armes du 5 juin 1832, la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu’elle. Elle eut peur. On vit partout, dans les quartiers les plus lointains et les plus « désintéressés », les portes, les fenêtres et les volets fermés en plein jour. Les courageux s’armèrent, les poltrons se cachèrent. Le passant insouciant et affairé disparut. Beaucoup de rues étaient vides comme à quatre heures du matin. On colportait des détails alarmants, on répandait des nouvelles fatales. – Qu’ils étaient maîtres de la Banque ; – que, rien qu’au cloître de Saint-Merry, ils étaient six cents, retranchés et crénelés dans l’église ; – que la ligne n’était pas sûre ; – qu’Armand Carrel avait été voir le maréchal Clauzel et que le maréchal avait dit : Ayez d’abord un régiment ; – que Lafayette était malade, mais qu’il leur avait dit pourtant : Je suis à vous. Je vous suivrai partout où il y aura place pour une chaise ; – qu’il fallait se tenir sur ses gardes ; qu’à la nuit il y aurait des gens qui pilleraient les maisons isolées dans les coins déserts de Paris (ici on reconnaissait l’imagination de la police, cette Anne Radcliffe mêlée au gouvernement) ; – qu’une batterie avait été établie rue Aubry-le-Boucher ; – que Lobau et Bugeaud se concertaient, et qu’à minuit, ou au point du jour au plus tard, quatre colonnes marcheraient à la fois sur le centre de l’émeute, la première venant de la Bastille, la deuxième de la porte Saint-Martin, la troisième de la Grève, la quatrième des Halles ; – que peut-être aussi les troupes évacueraient Paris et se retireraient au Champ de Mars ; – qu’on ne savait ce qui arriverait, mais qu’à coup sûr cette fois, c’était grave. – On se préoccupait des hésitations du maréchal Soult. – Pourquoi n’attaquait-il pas tout de suite ? – Il est certain qu’il était profondément absorbé. Le vieux lion semblait flairer dans cette ombre un monstre inconnu.
Le soir vint, les théâtres n’ouvrirent pas ; les patrouilles circulaient d’un air irrité ; on fouillait les passants ; on arrêtait les suspects. Il y avait à neuf heures plus de huit cents personnes arrêtées ; la préfecture de police était encombrée, la Conciergerie encombrée, la Force encombrée. À la Conciergerie, en particulier, le long souterrain qu’on nomme la rue de Paris était jonché de bottes de paille sur lesquelles gisait un entassement de prisonniers, que l’homme de Lyon, Lagrange, haranguait avec vaillance. Toute cette paille, remuée par tous ces hommes, faisait le bruit d’une averse. Ailleurs les prisonniers couchaient en plein air dans les préaux les uns sur les autres. L’anxiété était partout, et un certain tremblement, peu habituel à Paris.
On se barricadait dans les maisons ; les femmes et les mères s’inquiétaient ; on n’entendait que ceci : Ah mon Dieu ! il n’est pas rentré ! Il y avait à peine au loin quelques rares roulements de voitures. On écoutait, sur le pas des portes, les rumeurs, les cris, les tumultes, les bruits sourds et indistincts, des choses dont on disait : C’est la cavalerie, ou : Ce sont des caissons qui galopent, les clairons, les tambours, la fusillade, et surtout ce lamentable tocsin de Saint-Merry. On attendait le premier coup de canon. Des hommes armés surgissaient au coin des rues et disparaissaient en criant : Rentrez chez vous ! Et l’on se hâtait de verrouiller les portes. On disait : Comment cela finira-t-il ? D’instant en instant, à mesure que la nuit tombait, Paris semblait se colorer plus lugubrement du flamboiement formidable de l’émeute » (cité partiellement p. 728).
Chapitre p : « Matérialisme anthropologique, histoire des sectes ».
Voici un discours en avance sur son temps d’une certaine Claire Démar (1799-1833), dont je n’avais jamais entendu parler (ou j’ai oublié) : « L’union des sexes dans l’avenir devra être le résultat des sympathies […] les mieux étudiées […] ; et alors même qu’on reconnaîtrait l’existence des rapports intimes, secrets et mystérieux de deux âmes […] Tout cela pourra bien encore venir se briser contre une dernière épreuve décisive, mais nécessaire, indispensable. L’ÉPREUVE de la MATIÈRE par la MATIÈRE ; l’ESSAI de la CHAIR par la CHAIR ! ! ! […] C’est que bien souvent, au seuil de l’alcôve, une flamme dévorante est venue s’éteindre ; c’est que bien souvent, pour plus d’une grande passion, les draps parfumés du lit sont devenus un linceul de mort ; c’est que plus d’une […] lira ces lignes, qui le soir était entrée dans la couche d’hymen, palpitante de désirs et d’émotions, qui s’est relevée le matin froide et glacée. » (Claire Démar, Ma Loi d’avenir, Paris, 1834, cité p. 807).
Chapitre r : « École polytechnique ».
– « Au milieu du désordre qui régnait, écrit Vaulabelle, leur uniforme connu, aimé de tous, leur donnait une sorte de caractère officiel qui les rendit […] les agents les plus actifs et les plus utiles du pouvoir qui s’organisait. […] Quand nous avions à donner un ordre exigeant l’appui d’une force quelconque, dit M. Mauguin, nous en confiions en général l’exécution à un élève de l’École polytechnique. L’élève descendait le perron de l’Hôtel de Ville ; avant d’être parvenu aux derniers degrés il s’adressait a la foule devenue attentive et prononçait simplement ces mots : deux cents hommes de bonne volonté ! Puis il achevait de descendre et s’engageait seul dans le passage. À l’instant même on voyait se détacher des murailles et marcher derrière lui, les uns avec des fusils, les autres seulement avec des sabres, un homme, deux hommes, vingt hommes, puis cent, quatre cents, cinq cents ; il y en avait toujours le double de ce qui avait été demandé » (G. Pinet, Histoire de l’École polytechnique, Paris, 1887, cité p. 816).
– Arago se bat pour l’« enceinte continue » contre les « forts détachés » : « Le but qu’il faut se proposer en fortifiant Paris, est évidemment de donner à cette immense ville les moyens de se défendre à l’aide de sa seule garde nationale, de ses ouvriers, de la population des environs et de quelques détachements de troupes de ligne […] Ceci convenu, les meilleurs remparts pour Paris seront ceux que la population trouvera les meilleurs ; les remparts qui se coordonneront le plus intimement avec les goûts, les habitudes, les idées, les besoins de la bourgeoisie armée. Poser ainsi la question, c’est repousser entièrement le système des forts détachés. Derrière une enceinte continue, le garde national aura à toute heure des nouvelles de ses proches. En cas de blessure leurs soins ne lui manqueront pas. Dans une semblable position, les timides eux-mêmes vaudraient des soldats aguerris. On se ferait, au contraire, étrangement illusion en imaginant que des citoyens assujettis aux obligations journalières de chefs de famille, de chefs de commerce, iraient sans de vives répugnances s’enfermer entre les quatre murailles des forts ; qu’ils se prêteraient à une séquestration complète, tout juste au moment où la difficulté des circonstances exigerait plus impérieusement leur présence au foyer domestique, au comptoir, au magasin, ou à l’atelier. J’entends déjà la réponse à ces graves difficultés : les forts seront occupes par la troupe de ligne ! On reconnaît donc que dans le système des forts la population ne pourrait pas se défendre seule. C’est […] un immense, un terrible aveu » (Arago, Sur les fortifications de Paris, 1841, cité p. 819).
Le livre se poursuit par des pages de notes et de brouillons, qui reprennent parfois des éléments déjà vus mais constituent des textes intéressants, puis des appendices, et un cahier photo assez poussiéreux. J’ai parcouru cela en diagonale, sans en retirer d’extraits, par fatigue. J’estime qu’un éditeur aurait pu opter pour une solution intermédiaire entre le pavé indigeste destiné aux thésards et le livre de synthèse destiné au grand public, qui reste à faire.
© altersexualite.com 2024
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique. Abonnez-vous à ma chaîne Odysee et au fil Telegram Lionel Labosse.
 altersexualite.com
altersexualite.com