Accueil > Culture générale et expression en BTS > À toute vitesse ! > Paysages en mouvement, de Marc Desportes
Transports et perception de l’espace XVIIIe-XXe siècle
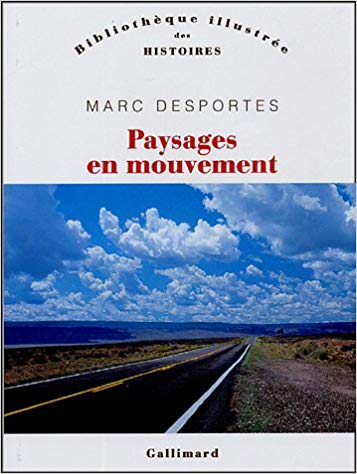 Paysages en mouvement, de Marc Desportes
Paysages en mouvement, de Marc Desportes
Gallimard, 2005, Bibliothèque illustrée des histoires, 414 p., 45,7 €
samedi 9 novembre 2019, par
Marc Desportes est polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, docteur en urbanisme. Paysages en mouvement, sous-titré Transports et perception de l’espace XVIIIe-XXe siècle est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « À toute vitesse ! ». Je l’ai choisi sur cette liste au hasard, et aussi parce que c’est un livre illustré (117 illustrations), à la limite du « beau livre », avec un coût élevé. Ce livre m’a enthousiasmé surtout dans ses débuts, consacrés à l’histoire des infrastructures ; un peu moins à la fin, où les réflexions philosophiques m’ont semblé à mille lieues de la réalité des routes, et d’une expression inutilement complexe pour nos étudiants en BTS. En dehors de ce thème, c’est un livre à recommander pour la spécialité de BTS Travaux publics.
Introduction
Cette intro contient des réflexions alléchantes.
« Une technique de transport impose en effet au voyageur des façons de faire, de sentir, de se repérer. Chaque grande technique de transport modèle donc une approche originale de l’espace traversé, chaque grande technique porte en soi un « paysage ». […] Ce sont les « paysages de la technique », termes qui désignent donc non pas les espaces marqués par l’omniprésence des infrastructures de transport, mais les regards induits par ces infrastructures sur le cadre qui les environne. […] La vitesse est sans doute la première donnée qui vient à l’esprit lorsque l’on pense à l’incidence des transports sur la perception de l’espace. « Un paysage traversé ou rompu par une auto ou un rapide perd en valeur descriptive, mais gagne en valeur synthétique, écrit le peintre Fernand Léger en 1920 ; la portière des wagons ou la glace de l’auto ont changé l’aspect habituel des choses. » Mais d’autres données, le glissement mécanique ou la signalisation, par exemple, ont également une influence. L’incidence des transports doit donc être pensée dans un cadre conceptuel élargi, susceptible de prendre en compte les aspects les plus divers de l’innovation technique » (p. 10).
« Contrairement à ce que pourrait laisser croire une approche sommaire, une nouvelle technique ne s’impose pas parce qu’elle serait plus performante que les précédentes. Car cette technique ne préexiste pas au développement à la fois scientifique, économique, et social qui lui permettra d’actualiser ses virtualités. […] Au Moyen Âge, les moulins à eau ne s’imposent pas pour des raisons énergétiques, mais parce que leur implantation permet aux seigneurs locaux d’établir à leur profit un nouveau monopole, les paysans étant obligés d’y faire moudre leur grain. Le processus de l’évolution recoupe la mise en place de tout un ensemble de faits, dont les facettes intéressent les multiples dimensions de la société, y compris la sphère des valeurs. Né dans les monastères, l’art horloger se développe à la Renaissance dans les grandes cités, en partie parce qu’il permet aux citadins de disposer de leur temps de façon plus libre, répondant ainsi aux aspirations de l’individualisme naissant.
Ces éléments généraux de l’histoire des techniques sont transposables dans le domaine des transports. Ainsi, le développement des chemins de fer au XIXe siècle ne peut être compris sans référence à l’industrialisation de la production et à l’urbanisation du territoire » (p. 10).
Chapitre Premier. Déserts et paysages. La route, 1730-1770
La construction des routes connaît un essor au XVIIIe d’une part par la continuation de la corvée féodale, d’autre part par l’uniformisation du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées en 1713, qui régentent désormais tout le territoire (cf. pp. 21-22).
Le progrès technique permettant de gagner en vitesse est étudié en détail : « À la fin du XVIIe siècle, cependant, la construction des véhicules connaît plusieurs progrès. L’effort d’innovation qui se prolonge après 1700 porte surtout sur la suspension. Pour améliorer le dispositif traditionnel des suspentes, c’est-à-dire ces simples bandes de cuir qui soutiennent la caisse, d’ingénieux systèmes de ressort sont introduits. […]
D’autres améliorations voient également le jour. Pour éviter que la caisse ne bascule latéralement, on fixe sur le côté des glissières, dans lesquelles passent des courroies dont la tension est réglée par des crics. Afin de permettre aux roues avant de tourner plus facilement, des pièces de fer courbées prolongent les flèches au-dessus de l’avant-train. Divers bancs, porte-bagages, arceaux de protection, marchepieds, coffres améliorent également le véhicule. La caisse, constituée d’un châssis de bois et de panneaux renforcés par des bandes de toile collées à chaud, est matelassée de crin à l’intérieur, tendue d’étoffe et munie de fenêtres qui peuvent s’abaisser dans l’épaisseur de la portière. Enfin, après le charron et le sellier, le carrossier fait montre de son art en proposant mille raffinements pour le décor extérieur.
Cette série de progrès donne naissance à de multiples véhicules et la France rattrape ainsi son retard au cours de la première moitié du XVIIIe siècle. Parmi toutes les voitures, les plus utilisées pour les voyages sont la chaise et la berline. La chaise est ce véhicule léger, monté sur deux roues, dérivé de la chaise à porteurs. Apparue à la fin du XVIIe siècle, longtemps limitée à une seule personne, c’est, selon l’Encyclopédie, « une voiture, commode, légère, et difficile à renverser, dans laquelle on peut faire en diligence de très grands voyages […]. Le tems (sic) et l’industrie des ouvriers l’ont protée à un degré de perfection auquel il n’est presque plus possible d’ajouter ». Plus importante, montée sur quatre roues et tirant son nom de la ville allemande où elle était en usage, la berline est, selon la même source, un « espèce de voiture de la nature des carrosses, fort en usage depuis peu […] plus légère qu’un char, et moins sujette à verser ».
Le voyageur bénéficie ainsi de voitures bien suspendues, claires et confortables. Dans le cas de la chaise, par exemple, « les chocs que les roues éprouvent sur les chemins sont amortis par défaut de résistance, et se font (sic) presque point sentir à celui qui est dans la chaise ». C’est donc une « voiture très douce, malgré les chaos et la célérité de la marche ». Les portières et le panneau avant sont munis de vitres, permettant au voyageur de regarder à l’extérieur. Quant à la berline, elle offre également de bonnes suspensions et, au lieu des lourds rideaux de cuir dont sont munis les traditionnels coches, est pourvue de « paravents que l’on baisse lorsque le temps est mauvais, et que l’on élève quand il fait beau ».
La diffusion de ces progrès rencontre plusieurs obstacles. Leur coût élevé, tout d’abord : seuls y ont accès les riches particuliers ou les entrepreneurs de messageries exploitant des liaisons très fréquentées [1]. L’état des routes, ensuite. Tous les progrès accomplis sont inutiles sur des chemins fangeux et défoncés, mais font merveille sur les nouvelles routes. En retour, ces progrès participent au maintien des chaussées : les roues munies de jantes ne les creusent pas et les ressorts diminuent les frictions entre la voiture et la voie, comme le montrent les études de mécanique. Aussi convient-il d’envisager de façon réciproque les liens entre les progrès de la route et les progrès des véhicules.
Troisième obstacle à signaler : l’état de la poste aux chevaux. Dans ce domaine comme dans celui des routes, de nets progrès sont nécessaires : à quoi bon améliorer les véhicules si les chevaux manquent !
Lorsqu’il parcourt une longue distance, le voyageur fortuné loue des chevaux au fur et à mesure de son avancée afin de disposer de montures reposées et aptes à fournir un effort important. Toutes les quatre lieues (soit environ 9,4 km), il « relaisse » les chevaux pour en louer de nouveaux d’où le nom de « relais » donné aux points d’étape. La poste aux chevaux regroupe l’ensemble des relais disposés le long des routes dites « de poste », ou encore « montées en poste ». Établi à la fin du XVe siècle, constitué lentement, sans plan préétabli, au gré des circonstances, le réseau des routes de poste présente deux faiblesses, l’une liée à son équipement en chevaux, l’autre à son extension.
Étant donné leur poids, les véhicules exigent pour leur traction un nombre important de chevaux qui excède les capacités des relais » (pp. 44-47).
« La poste aux chevaux offre un service onéreux, réservé aux gens fortunés. Les personnes moins aisées doivent, quant à elles, ménager leur monture. Alors que les premiers peuvent aller au trot, voire au galop (à cette allure, la vitesse est d’une poste par heure), les secondes se contentent du pas » (p. 48).
« À l’aune du siècle, les progrès sont notables : entre 1700 et 1770, les messageries gagnent deux jours sur huit en hiver, sur sept en été pour un trajet donné. L’aire desservie autour de Paris en deux jours s’amplifie : en 1765, elle va jusqu’à Dieppe et Auxerre dans la direction nord-ouest/sud-est, mais se limite à Châteaudun et Soissons dans la direction perpendiculaire : en 1780, elle est plus uniforme, s’étendant de Caen à Châlons et de Châteauroux à Lille.
L’information donnée au voyageur est le dernier élément qui contribue à modeler le nouveau voyage. En sus des traditionnelles affiches indiquant l’arrivée ou le départ des voitures de messagerie, indicateurs et guides se multiplient, à la faveur du développement de l’édition » (p. 50).
L’illustration de la p. 49 est le « Plan d’une diligence appellée diligence de Lyon, servant à transporter les voyageurs de Paris à Lyon, & de Lyon à Paris », tirée de L’Encyclopédie.
L’auteur signale le glissement de sens du mot « paysage », qui désigna d’abord un genre de tableau, avant de désigner un site (cf. p. 60). Il évoque aussi « la filiation entre jardin et routes » (p. 68).
« Outre la nature des informations recueillies par le voyageur, on saisit à ces expériences l’importance de la vitesse à laquelle progresse la voiture. À l’allure du pas, le cadre défile trop lentement pour que le voyageur puisse en apprécier les variations sans que son attention se lasse ; au pas, c’est toujours après coup et sous la forme d’un constat que le voyageur s’aperçoit d’un changement. À l’allure du galop, le voyageur est absorbé par l’impression de vitesse et par l’effort des chevaux ; le cadre semble défiler trop vite pour que l’attention puisse se fixer ; tout se passe comme si la grande vitesse brisait la continuité analysée par Condillac entre le mouvement et la vision, interdisant les substitutions de l’un à l’autre et privant la vision de ses pouvoirs. Le trot offre ce juste milieu, qui arrache le voyageur de l’univers de la marche sans le projeter dans celui du galop » (p. 81).
Chapitre II. Les paysages artificiels. Les chemins de fer, 1830-1860.
« Il se forme en effet, lors des voyages en train, un nouveau regard, que l’on qualifiera de panoramique et dont la compréhension exige de faire référence aux modes d’expression contemporains tels que la photographie ou la peinture » (p. 101).
« Autour des années 1840, les trains roulent à des vitesses comprises entre 30 et 40 km/h. Vingt ans plus tard, les vitesses s’élèvent à 80 km/h pour les trains express tractés par des Crampton. En 1853, Napoléon III signe un décret autorisant la vitesse de 120 km/h sur les lignes du Nord, mais seulement, il est vrai, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard » (p. 113).
Les débuts des chemins de fer en France sont improvisés : « Pour les voyageurs aisés, on monte des caisses de diligence sur des châssis. Pour les moins fortunés, on installe des bancs dans des tombereaux destinés normalement au transport des matériaux. » On crée alors une classe intermédiaire, de sorte que « l’inconfort imposé en troisième classe force le bourgeois à révéler la valeur qu’il accorde au service rendu et l’incite à payer un prix plus élevé » (p. 113, 126). À maintes reprises, fait remarquable pour un historien, l’auteur note l’absence de toilettes dans les trains (cf. p. 115), ce que nous avait appris Roger-Henri Guerrand. Une note est consacrée à la catastrophe ferroviaire de Meudon le 8 mai 1842, dont les causes sont expliquées dans l’article de Wikipédia : pente excessive de la ligne, vitesse, et présence de deux locomotives de puissance différente. Mais le nombre des morts, 55, s’explique par le fait que les portes des wagons étaient fermées à clé, décision destinée à empêcher les suicides ! Voici un tableau d’un peintre inconnu dont le prénom ne nous est pas donné, trouvé dans l’article de Wikipédia : Catastrophe ferroviaire entre Versailles et Bellevue le 8 mai 1842, A. Provost (1834-1855).

Le tracé des premières lignes peut suivre des logiques différentes : le plus rectiligne possible, « en arrête de poisson » et desservant les villes par des embranchements, ou bien sinueux pour desservir les villes principales. « Les premiers tracés préconisés par l’Administration tendent à cet idéal. Ils présentent de grandes lignes droites, de larges courbes et des pentes très faibles. L’Administration redoute non seulement le manque de puissance des locomotives, mais encore le glissement des trains sur les pentes trop fortes et le renchérissement des coûts d’exploitation. Les normes qu’elle impose sont calculées pour des vitesses de l’ordre de 60 à 80 km/h. L’ensemble machinique formé par le train et la voie est donc abordé selon une approche radicale : tout doit concourir à son fonctionnement optimal, cette adéquation dût-elle être obtenue au prix de travaux colossaux.
Pour le Paris-Versailles-Rive-Gauche, l’Administration impose des pentes inférieures à un millimètre par mètre et des rayons supérieurs à huit cent mètres. En résultent des ouvrages spectaculaires : une profonde tranchée à Clamart et un long viaduc pour franchir le Val-Fleuri à Meudon » (p. 120). Voir l’article de Wikipédia Viaduc de Meudon.
La sévérité de ces normes sera critiquée comme coûteuse et inutile, et allégée (5 millimètres de pente par mètre, et rayons de 700 voire 500 mètres selon la desserte (cf. p. 121).
« L’espace et le temps sont vaincus, tel est le poncif de tous les discours officiels, tel est le constat que tous partagent. Cette victoire s’apprécie en termes de vitesse : alors que les diligences parcourent environ de quatre-vingt-dix à cent kilomètres par jour et que les malles-poste atteignent au mieux une vitesse de 20 km/h, le train roule à une vitesse moyenne se situant entre 60 et 80 km/h sous le second Empire. Techniquement, et en faisant abstraction des contraintes d’exploitation courantes, Napoléon III aurait pu parcourir à la vitesse moyenne de 100 km/h le trajet Paris-Marseille dès 1854. L’espace national se réduit comme peau de chagrin » (p. 122). Les premiers voyageurs sont terrorisés à la pensée des catastrophes, et par les tronçons sous tunnels dans le noir absolu. En témoigne une illustration de Daumier pour Le Charivari en 1848. L’auteur a eu l’idée d’agrandir le paysage vu de la fenêtre, que les voyageurs ne regardent pas, typique du changement dans la perception du paysage induit par le chemin de fer.

« Parmi les traits qui dérangent le plus les premiers voyageurs figure le caractère collectif du voyage. Ce ne sont plus les dix personnes qui montaient en même temps dans une diligence, mais cent, voire deux cents, qui, après avoir attendu parquées comme un troupeau, s’élancent sur le quai de la gare, dirigées par les employés de la compagnie. À l’arrivée, un spectacle similaire se reproduit : « Enfin, on entend un roulement », rapporte Mme Girardin en 1837 : « c’est l’arrivée des voyageurs de Saint-Germain […] ; toutes les voitures, tous les wagons s’arrêtent ; la cour est vide : çà et là deux ou trois inspecteurs, rien de plus ; mais on ouvre les portières de wagons… et alors, en un clin d’œil, une fourmilière de voyageurs s’échappe des voitures, et la cour est pleine de monde subitement. Ceci est véritablement impossible à décrire […]. »
« Quelle que soit la classe empruntée, les voyageurs ont l’impression d’être traités comme de simples paquets dont la compagnie assure le transport. […] Un colis à l’image du train-projectile, selon l’expression de l’époque, une entité totalement matérielle, sans âme ni conscience. L’impression n’est pas anecdotique. En reléguant le corps du voyageur, en en faisant une marchandise, le chemin de fer provoque une sorte de dichotomie entre le sujet et sa condition corporelle. Le nouveau mode de transport participe ainsi à cette évolution profonde de la société moderne, qui voit disparaître les liens ancestraux tissés entre l’homme et le monde qui l’entoure, liens si forts que jamais ne pouvait se défaire l’unité de son être en une subjectivité et un corps, l’une étant réputée libre, l’autre appartenant à la sphère matérielle » (p. 131). Une lettre de Flaubert est citée : « Je m’embête tellement en chemin de fer qu’au bout de cinq minutes je hurle d’ennui. On croit, dans le wagon, que c’est un chien oublié ; pas du tout, c’est M. Flaubert qui soupire ! » (p. 132). Victor Hugo ou Paul Verlaine sont plus inspirés, et témoignent de ce changement dans la perception du paysage qui est au centre de ce livre. « C’est un mouvement magnifique et qu’il faut avoir senti pour s’en rendre compte. La rapidité est inouïe. Les fleurs du bord du chemin ne sont plus des fleurs, ce sont des taches ou plutôt des raies rouges ou blanches ; plus de points, tout devient raie ; les blés sont de grandes chevelures jaunes, les luzernes sont de longues tresses vertes ; les villes, les clochers et les arbres, dansent et se mêlent follement à l’horizon ; de temps en temps, une ombre, une forme, un spectre debout paraît et disparaît comme l’éclair à côté de la portière ; c’est un garde du chemin qui, selon l’usage, porte militairement les armes au convoi » (cité p. 142) On trouvera la lettre originale entière sur ce site ; elle ferait un bon document pour un corpus. J’ai restitué une phrase coupée. Et Verlaine : (La Bonne chanson, 1869, VII, cité p. 142)
« Le paysage dans le cadre des portières
Court furieusement, et des plaines entières
Avec de l’eau, des blés, des arbres et du ciel
Vont s’engouffrant parmi le tourbillon cruel
Où tombent les poteaux minces du télégraphe
Dont les fils ont l’allure étrange d’un paraphe ».
« L’ancienne approche du cadre extérieur n’est donc plus d’actualité. Celle-ci impliquerait une perception du proche et du lointain, un certain regard porté sur chaque chose, une appréciation des distances à partir d’éléments pris comme repères. Les premiers plans se volatilisant dans la vitesse, c’en est fini de ce mode de découverte. Celui qui s’attacherait à détailler le cadre de la voie s’exposerait, selon les médecins, à de violents maux de tête. « La vitesse et la diversité des impressions fatiguent nécessairement l’œil comme le cerveau. La distance des objets qui se transforme sans cesse exige un continuel travail d’adaptation de l’appareil oculaire à travers lequel ils s’impriment sur la rétine ; et la fatigue intellectuelle du cerveau à les recevoir est à peine moindre, même si elle est inconsciente » » (p. 144 ; la citation dans la citation est issue de « The influence of Railway Travelling on Public Health », From the Lancet, Londres, 1862)
« S’il parvient à faire abstraction du premier plan, le voyageur peut en effet, diriger son regard au loin. Alors ce qui s’offre à la vue peut être observé même animé d’un mouvement de grande amplitude. « Et qu’on ne vienne pas nous dire qu’on ne jouit pas du paysage quand on est emporté par la locomotive, note le commentateur du voyage inaugural sur le Paris-Rouen : le paysage n’est pas à vos pieds, il est au loin, dans les masses surtout ; et si les objets qui bordent le chemin fuient avec une rapidité qui vous donne le vertige, ceux qui sont à bonne distance posent complaisamment devant vous, et vous avez tout le temps d’en saisir l’ensemble et le détails » [L’Illustration, 6 mai 1843]. Commentateurs et guides désignent cette nouvelle forme de vision par le terme de panorama. Ainsi, le guide Richard, dans son édition de 1846, écrit à propos du chemin de fer de Strasbourg à Bâle : « Parcourez le rapide rail-way de Strasbourg à Bâle ; suivez des yeux cette riche et belle contrée qui semble fuir et va vous échapper ; le mot de panorama [2] n’est-il point venu tout naturellement se présenter à votre pensé ? » » (p. 145).
Marc Desportes cite (p. 148) le chapitre II de La Bête humaine d’Émile Zola (1890), dont je restitue l’extrait entier, fort utile pour ce thème de BTS. C’est le moment où Jacques Lantier est témoin du meurtre depuis le bord de la voie :
« Jacques vit d’abord la gueule noire du tunnel s’éclairer, ainsi que la bouche d’un four, où des fagots s’embrasent. Puis, dans le fracas qu’elle apportait, ce fut la machine qui en jaillit, avec l’éblouissement de son gros œil rond, la lanterne d’avant, dont l’incendie troua la campagne, allumant au loin les rails d’une double ligne de flamme. Mais c’était une apparition en coup de foudre : tout de suite les wagons se succédèrent, les petites vitres carrées des portières, violemment éclairées, firent défiler les compartiments pleins de voyageurs, dans un tel vertige de vitesse, que l’œil doutait ensuite des images entrevues. Et Jacques, très distinctement, à ce quart précis de seconde, aperçut, par les glaces flambantes d’un coupé, un homme qui en tenait un autre renversé sur la banquette et qui lui plantait un couteau dans la gorge, tandis qu’une masse noire, peut-être une troisième personne, peut-être un écroulement de bagages, pesait de tout son poids sur les jambes convulsives de l’assassiné. Déjà, le train fuyait, se perdait vers la Croix-de-Maufras, en ne montrant plus de lui, dans les ténèbres, que les trois feux de l’arrière, le triangle rouge.
Cloué sur place, le jeune homme suivait des yeux le train, dont le grondement s’éteignait, au fond de la grande paix morte de la campagne. Avait-il bien vu ? et il hésitait maintenant, il n’osait plus affirmer la réalité de cette vision, apportée et emportée dans un éclair. Pas un seul trait des deux acteurs du drame ne lui était resté, vivace. La masse brune devait être une couverture de voyage, tombée en travers du corps de la victime. Pourtant, il avait cru d’abord distinguer, sous un déroulement d’épais cheveux, un fin profil pâle. Mais tout se confondait, s’évaporait, comme en un rêve. Un instant, le profil, évoqué, reparut ; puis, il s’effaça définitivement. Ce n’était sans doute qu’une imagination. Et tout cela le glaçait, lui semblait si extraordinaire, qu’il finissait par admettre une hallucination, née de l’affreuse crise qu’il venait de traverser ».
Revenons à notre ouvrage : « Un parcours en cheval ou en voiture permettait au voyageur de faire halte où bon lui semblait, à tout moment. […] Lancé à vive allure sur ses rails, le train, lui, n’offre plus la possibilité d’hésiter, de ralentir, d’esquisser un changement de direction, de dévier son chemin vers la butte, la rivière, le bosquet aperçus au loin, ou tout simplement de marquer une pause. […] Ce n’est pas seulement le fait d’être emporté qui frappe, mais cette impression que plus rien ne résiste à la force mécanique. Les tranchées donnent la sensation au voyageur de s’enfoncer sans résistance dans le flanc des collines selon un ample mouvement. Finie, cette progression qui sonnait comme une lutte gagnée à chaque instant, disparus, ces indices qui la matérialisaient, qu’il s’agisse de la fatigue des chevaux ou de ces petits détails que l’on se plaisait à relever au bord de la route » (p. 151).
J’apprécie la photo publiée p. 157, La gare de Toulon par Édouard Baldus. Elle permet de constater que la gare n’est qu’un porche, incapable d’arrêter le train dans sa vitesse. Pourtant dans les grandes villes, de nombreuses gares sont des terminus, qu’il faut prendre le métro ou le bus pour relier, alors que dans certaines capitales au contraire, le train traverse comme en province, soit conception initiale, soit travaux récents pour relier les gares (Bruxelles, Berlin, Vienne…).
L’auteur établit une similitude entre photographie et ferroviaire : « Pour l’un comme pour l’autre, l’instantané est un absolu » (p. 158 ; p. 185), mais plus convaincant, entre vision ferroviaire et impressionnisme : « La vue du train sur les choses proches est imprécise : ce sont des traînées colorées que l’on perçoit et non des contours distincts ; le regard capte tout ce qui se présente, la vitesse du défilement ne permettant aucune sélection. À ces « défauts » de la vision ferroviaire correspondent les reproches qui sont faits aux œuvres impressionnistes, critiquées pour leur flou, leur imprécision ; elles aussi montrent des grands traits de couleur posés vivement sur la toile ; elles aussi représentent tous les aspects de la vie moderne sans y rechercher la « beauté » (p. 161).
« L’emploi de la technique impressionniste trouve un terrain de prédilection dans la représentation des atmosphères changeantes, qu’il s’agisse de ciels, d’étendues d’eau, d’effets de lumière ou d’ombres transparentes. Parfois, ce sont des mouvements rapides, telles les courses de chevaux peintes par Manet [3], mais ces sujets sont plus rares. Quels que soient les mouvements, les vibrations, les modulations représentés, le travail du peintre repose toujours sur une forme de prestesse. Larges coups de pinceaux, aplats vigoureux, touches légères suscitent chez le spectateur les sensations liées aux vibrations, aux scintillements, aux mouvements. Les gestes picturaux transcrivent ainsi la perception initiale du peintre et la rendent sensible au spectateur. Cependant, le caractère spontané des touches ne doit pas tromper. Les gestes sont repris plusieurs fois, ce qui nécessite de gratter la toile ou de les différer afin que les couches précédentes aient eu le temps de sécher. Ces œuvres, qui frappent par leur apparente rapidité d’exécution, sont en réalité le résultat de séances de travail parfois très espacées dans le temps » (p. 162).
Chapitre III. L’épreuve du pittoresque. Visiter les villes d’art au tournant du siècle
La réflexion sur le train se poursuit. Vitesse et glissement sont les deux caractéristiques du voyage en train, qui modifient notre perception. « Au-delà des abords immédiats, faits de longues traînées de couleurs, d’objets indistincts surgissant et disparaissant aussitôt, le voyageur saisit quelques éléments : maisons, bosquets, champs cultivés… Pour ceux-là, la perception se réduit à un processus d’identification. Ce long bandeau vert avec ces blocs bruns posés par groupe et qui pivotent sur eux-mêmes, c’est une plaine cultivée avec ses hameaux, auxquels conduit la route dont un mince ruban beige trahit le tracé » (p. 185). « Ne ressentant plus les frayeurs des premiers voyageurs, le sujet éprouve un vif plaisir à la seule vue des choses et des lieux, et au sentiment de s’abstraire ainsi de leur matérialité. Le voir a gagné une sorte d’autonomie. Dans l’approche rythmique de l’espace, le mouvoir et le voir s’étayent l’un l’autre ; dans le voyage ferroviaire, tout se passe comme si une sublimation du mouvoir en voir était constamment entretenue, ce qui constituerait une forme de perversion au sens freudien du terme » (p. 188).
Chapitre IV. À la ville, à la campagne. L’essor de l’automobile, 1900-1920.
J’apprécie l’aquarelle d’un certain « L. Sabatier », tirée de L’Illustration, 1906, reproduite p. 211. Il m’a fallu une longue recherche pour identifier l’artiste comme Louis Rémy Sabattier (1863-1935), et son œuvre comme « Perdus ! ». Mais pour coller à l’actualité de l’automne 2019, j’y ajouterais quelques œuvres de Henri de Toulouse-Lautrec vues au Grand Palais, comme la lithographie au crayon L’Automobiliste (1898), l’affiche publicitaire (litho) pour « La Chaîne Simpson » ou encore la peinture Nice, souvenir de la promenade des Anglais. En dépit de son handicap, le peintre était amateur de vitesse, cheval, vélo ou automobile, et il a vécu une vie de patachon à toute vitesse avant de mourir à 37 ans.

« Autre différence : l’automobile offre un contact plus direct avec le cadre traversé. Alors que le tracé rigide de la voie ferrée nie les inflexions du paysage, la route, inscrite de façon ancestrale sur le terrain, permet la découverte des sites. Ce sont, sur les routes les plus pittoresques, des montées et des descentes, des courbes et des contre-courbes, et autant de manœuvres à exécuter pour le conducteur, autant de surprises pour les passagers ; ce sont aussi des panneaux qu’il faut lire, des villages qu’il faut reconnaître, autant d’invitations à découvrir les pays traversés » (p. 237). Suit une belle citation de Proust, qu’on trouvera plus complète sur cet article de Norwich : « L’invitation au voyage : Proust en train en voiture ».
« Le paysage de l’automobile se fonde sur un contact étroit avec les sites que le nouveau véhicule permet de parcourir en toute liberté. Mais la qualité de ce paysage ne tient pas tant aux lieux visités qu’à une sorte de conjonction entre le site et la conduite. L’appréciation du paysage suppose en particulier que la conduite ne prenne pas le dessus, du fait d’une vitesse trop élevée, de pannes trop fréquentes ou d’une orientation difficile. Sous ces conditions, le paysage se dévoile. C’est un paysage dynamique, tissé de relations inédites entre des lieux dont l’aura s’est irrémédiablement ternie » (p. 243).
La « tension nerveuse permanente » (p. 252) générée par les déplacements en automobile est selon l’auteur à l’origine de la notion de stress qu’auraient inventé des psychologues américains.
Marc Desportes note un lien entre cinéma, ville et automobile : « Le cinéma procure ainsi une version positive de l’expérience urbaine née avec l’automobile, gommant la violence, le non-sens, l’absence de rythme, le sentiment d’impuissance éprouvé par le piéton ou l’automobiliste apeuré, perdu, éperdu » (p. 266).

Je reproduis ici l’illustration de la p. 265 : Le Reporter pressé (Roving reporter) (1926) de Umbo (Otto Umbehr, 1902-1980). « Ce collage fait du reporter un être hybride dont les pieds sont une voiture et un avion, l’œil un appareil photo, l’oreille un pavillon de gramophone… La sensibilité de l’homme moderne est médiatisée par des prothèses artificielles ».
Chapitre V. Un monde frontal. Genèse et développements de l’autoroute 1920-1940.
Développées aux États-Unis et en Europe, les autoroutes modifient la ville et mettent à rude épreuve les perceptions du passager.
« Rapidement, cependant, on reproche aux tracés rectilignes de fatiguer l’automobiliste par leur monotonie. De plus, leur rigidité en rend la réalisation difficile. On adopte alors des tracés souples, permettant une certaine adaptation au terrain et, de ce fait, une attention au paysage traversé. Le projet allemand de 1933, par exemple, présente des tracés variés, les rayons de courbure allant de six cents à dix-huit cents mètres et les vitesses envisagées de 120 km/h à 160 km/h, selon le relief traversé. Afin d’assurer la stabilité du véhicule, les ingénieurs allemands conçoivent les raccordements entre sections droites et sections courbes suivant des courbes clothoïdales » (p. 295).
« Les concepteurs attachent une grande attention à la qualité architecturale des réalisations. Les Américains appliquent ainsi des ornements Art déco sur les ponts de la Merrit Parkway tandis que les Français confient la conception de l’entrée du tunnel de Saint-Cloud à un architecte en chef des Monuments historiques. Mais rares sont ceux qui s’interrogent sur la perception qu’en auront les conducteurs. Dans la vitesse, distinguent-ils les bas-reliefs ornant les piles d’un pont ou les motifs d’un garde-corps ? Non, vraisemblablement. Seuls les ingénieurs allemands semblent prendre en compte cette donnée en concevant de vastes ouvrages à l’échelle des sites traversés et dont le traitement offre une grande pureté de ligne » (p. 296).
L’auteur s’intéresse à l’expérience du conducteur : « Jamais le proche n’est regardé : le proche, c’est ce qui a été aperçu au loin – un virage par exemple – et qui a déjà été pris en compte dans la conduite, c’est ce que la normalisation du tracé réduit à une anticipation en train de se produire. Pas plus que le proche, l’à-côté ne fait l’objet d’une quelconque observation. Le manque d’informations latérales n’est cependant pas inquiétant puisque l’autoroute est conçue pour éliminer tout danger qui pourrait subvenir d’un côté ou de l’autre de la voie. L’espace découvert au cours de l’expérience autoroutière est comme une sorte de trouée vers l’avant, dont les bords fuiraient inexorablement. La perception générale du cadre extérieur est modelée par cette orientation frontale : les éléments très lointains apparaissent presque immobiles, formant le fond de décor, les éléments distants se présentent selon des vues changeantes, tandis que les éléments situés à proximité de la voie sont animés d’un vif mouvement.
La vitesse et l’orientation du regard interdisent de s’attacher au moindre détail. D’où l’impression de pauvreté, que renforce l’industrialisation des équipements » […] « La vitesse […] diminue le temps d’information, abrège la réflexion et impose une décision rapide alors que toute précipitation est dangereuse » (p. 312). Si l’on rate un embranchement, c’est ressenti comme une catastrophe, de même qu’il a fallu du temps pour que les conducteurs s’habituent aux échangeurs qui obligeaient à se diriger vers la droite pour aller à gauche !
« Lorsqu’il ne rencontre aucune difficulté dans la performance de sa tâche, un circuit simplifié s’instaure entre la prise d’information et la manœuvre correspondante, et le conducteur est à même d’apprécier les plaisirs de la conduite. Alors il peut croire un instant ne faire plus qu’un avec son véhicule. L’impression de puissance procurée par la conduite automobile aidant, un sentiment d’exaltation s’empare de lui » (p. 313).
Une photographie de l’échangeur de la porte de Bagnolet (p. 323) illustre parfaitement l’impossibilité pour l’automobiliste d’avoir une vision globale : « L’aménagement conçu par l’ingénieur diffère ainsi de l’aménagement parcouru par l’usager. Le rôle de l’approche ergonomique apparaît clairement : il s’agit de relier le second – l’échangeur perçu – au premier – l’échangeur conçu ». Un excellent dossier de l’Apur (Atelier parisien d’urbanisme), utilisable en classe, m’a fourni une photo de l’échangeur (photo © Philippe Guignard).
L’automobiliste trouve le parcours « déshumanisé » : « Alors le conducteur se perd et son errance apparaît comme le signe d’une désinsertion spatiale fondamentale, forme dernière de la désorientation. C’est ainsi que l’expérience de l’autoroute peut donner lieu à la panique, comprise comme l’épreuve d’une déréliction » (p. 331). Je suis d’autant plus sensible à ces pages, que c’est précisément à cet échangeur que j’eus jadis une contravention pour avoir traversé une ligne blanche après avoir hésité sur mon chemin, paniqué par ce choix à faire en vitesse ! Les flics ne m’ont pas raté ! L’auteur s’intéresse maintenant aux vides créés par ces aménagements.
« À la plénitude de l’espace mineur s’opposent les interstices, les délaissés créés par les aménagements majeurs. Le chemin de fer avait donné l’exemple de tels vides. L’autoroute les multiplie : milieux d’un échangeur, biseaux entre deux bretelles, dessous de viaduc, sortes de « creux » de l’espace autoroutier. Le sentiment de panique, voire de déréliction, qu’éprouve à certains instants le sujet s’explique alors. C’est en fait la réaction émotionnelle du sujet face au vide laissé par la pensée technique » (p. 332). C’est au Japon que j’ai constaté la limite de cette réflexion, puisque dans ce pays, ces vides urbains sont inexistants : tout semble y avoir été pensé !
Chapitre VI. Métamorphoses urbaines.
Dans ce dernier chapitre, qui ne concerne plus notre thème de la vitesse, l’auteur s’intéresse à la vision de la ville. Il utilise le terme d’imagibilité, emprunté à Kevin Lynch : « L’imagibilité est la qualité des espaces urbains dont la représentation se forme aisément, ce qui peut être testé en faisant dessiner le sujet » (p. 349). Mais il fait remarquer que certaines données « sont mémorisées sous forme de suite de numéros, de noms, cet encodage ne faisant intervenir aucune présentation graphique ». Dans les grands ensembles, l’habitant focalise souvent son attention non pas sur la conception architecturale, mais tel défaut, cassure, imperfection, et l’auteur y voit « une forme d’arte povera »
L’architecture souterraine fait l’objet de réflexions judicieuses, notamment quand l’auteur remarque l’inutilité de l’installation de sculptures que l’usager ne peut percevoir car il ne dispose pas de plan et cherche sa correspondance : « Ainsi, la non-attention portée aux dispositions, attitude inverse de l’emphase architecturale, est également une erreur puisqu’elle est source de conflit, comme l’illustre le cas des Halles » (p. 370). Une sculpture de Claude Viseux est reproduite p. 370, et effectivement je ne l’avais pas vraiment identifiée comme sculpture, mais plutôt comme déco, et je suis incapable sans y retourner, de situer l’endroit exact où elle se trouve ! Mais promis, j’irai !
Je vous renvoie à ma rubrique transports, mais je trouve les analyses de Desportes un peu intellectuelles, car il semble ignorer que ce n’est pas seulement l’architecture et la signalisation qui peuvent engendrer un sentiment d’abandon sinon de panique dans les transports publics notamment souterrains, mais le contraste entre l’hypertrophie de la publicité et des annonces sonores inutiles et l’absence d’informations utiles, l’absence de maintien de l’ordre et de la propreté face aux indésirables qui pullulent dans ces espaces et les dénaturent. Cela dit, je suis d’accord qu’un énorme travail spécifique devrait être accompli par la RATP (j’en demande pardon aux lecteurs non franciliens, mais je parle de ce que je connais !) pour permettre à l’usager de se repérer dans les grandes stations souterraines comme Bastille, Montparnasse, Strasbourg-Saint-Denis, sans parler de Châtelet. Il n’y a que quelques années que ces têtes pensantes ont enfin eu l’idée, au lieu d’indiquer comme direction « Creil » ou « Villeneuve-Saint-Georges », d’indiquer les points cardinaux, bien plus utiles au touriste ou au provincial à qui ces noms de villes de banlieue n’évoquent rien ! De même dans le métro, la RATP serait bien inspirée d’ajouter, peut-être même en anglais, les points cardinaux à côté des terminus comme « Créteil » ou « Balard », etc. Au Japon, à Tokyo, la station de métro Shinjuku est censée avoir une cinquantaine de sorties. Alors quand vous cherchez un endroit précis pour y sortir, c’est la catastrophe ; et quand en entrant, vous cherchez l’unique guichet du JR pass, cela fait de vous un spermatozoïde en quête d’un ovule !
Conclusion : le paysage en survol
« Dès la Renaissance, l’art de la perspective, et plus spécialement la branche nommée catoptique, avait permis de construire la vue d’un bâtiment, d’une ville, d’une contrée, qu’en aurait non pas un cavalier, mais un oiseau, dans une position inaccessible à l’œil humain et qui, pour les contemporains, devait le rester à jamais. Dès le XIXe siècle, cependant, l’aérostat fait de cette fiction scopique une réalité. En 1855, Nadar prend des photographies depuis un ballon » (p. 381). La photographie aérienne permettra une « géo-graphie », écriture de la terre : « Les aperçus procurés par l’avion intéressent tous ceux qui prennent le fait humain pour objet d’étude. Les archéologues scrutent à contre-jour les traces de fondations antiques, les sociologues observent les grands rassemblements, les urbanistes recueillent des documents qui attestent de la nouvelle échelle atteinte par les métropoles multimillionnaires » (p. 386). Terminons sur ce brillant paragraphe : « Notre expérience des aménagements techniques contemporains diffère totalement de l’expérience des espaces traditionnels. L’usager est enfermé dans une attitude passive, partielle, et, s’il parvient encore à lui attacher un sens, c’est de façon subreptice et selon une approche qu’il ne peut partager avec autrui. L’échangeur autoroutier illustre le dédoublement entre la vision d’en bas, celle du conducteur qui, ne parvenant pas à se représenter l’espace, doit se reporter à une signalétique, et la vision d’en haut, celle qu’en a l’ingénieur qui conçoit l’infrastructure. L’insistance avec laquelle nous sont montrées tant de vues aériennes d’agglomérations, d’infrastructures, de réseaux, sonne comme une conjuration contre l’hyposignifiance de l’espace contemporain : oui, ces aménagements ont un sens et, si celui-ci n’est pas perçu du sol, c’est du fait de notre propre myopie. L’ingénieux Dédale fabrique des ailes pour échapper au Labyrinthe qu’il a lui-même conçu mais dont il est prisonnier. Une fois dans les airs, il voit de haut le plan qu’il a dessiné. Nos aménagements modernes sont comparables à autant de labyrinthes. La signalétique en est le fil d’Ariane et la vue aérienne, indisponible sur le moment, exhibée par la suite, sert d’icône pour témoigner de la raison qui a présidé à leur conception » (p. 387).
– On peut écouter Marc Desportes dans une émission de France Culture sur les autoroutes, en 2012. Cela commence vers le tiers de l’émission.
– « Ce train de nuit qui traverse Lausanne sans s’arrêter » : un article du journal suisse Le Temps sur les impératifs sécuritaires, bureaucratiques et économiques qui nuisent à la vitesse du ferroviaire.
Voir en ligne : Marc Desportes sur France Culture
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Une note précise : « Pour ces dernières [liaisons], les traditionnels coches – non suspendus, équipés d’une caisse en osier le plus souvent – sont remplacés vers 1740 par des sortes de berlines, permettant de couvrir vingt-cinq lieues par jour et appelées « diligences » pour cette raison. La diligence utilisée pour la liaison Paris-Lyon en donne un exemple : c’est une sorte de berline tirée par quatre chevaux, munie de simples suspentes, ayant deux portières vitrées, chacune entourée par deux petites ouvertures vitrées, qu’un rideau peut occulter ».
[2] Le panorama est une innovation de la fin du XVIIIe en peinture, qui reproduit un paysage à l’intérieur d’une rotonde.
[3] Voir par exemple Les Courses à Longchamp.
 altersexualite.com
altersexualite.com