Accueil > Littérature en TL (terminales littéraires) > Correspondance de Gustave Flaubert
Flaubert altersexuel ?
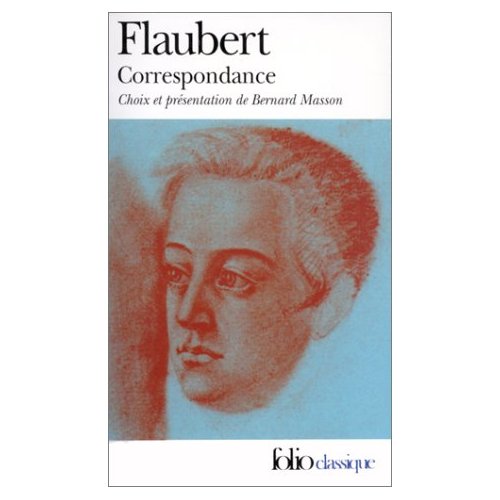 Correspondance de Gustave Flaubert
Correspondance de Gustave Flaubert
Folio classique, 850 p., 1998, 10,5 €.
jeudi 21 février 2008
La publication par Jean Bruneau de la correspondance de Gustave Flaubert dans la collection de la Pléiade aura duré 34 ans, entre 1973 et 2007, après celle de Louis Conard, qui datait des années 20. L’édition Conard était systématiquement épouillée de tout morpion érotique voire altersexuel, comme un exemple ci-dessous le montrera. Pour les flemmards qui veulent aller au vif dans ces cinq volumes, il existe un petit pavé de 850 pages publié en 1998 dans la collection Folio, qui vous fera gonfler les poches pour des raisons purement culturelles. Bernard Masson y a réuni 300 lettres (dans la version de Jean Bruneau), suivies d’un index et de quelques notes. C’est l’occasion de visiter l’intimité du maître, et de voir par son œil acéré un XIXe siècle plus altersexuel qu’il n’y paraît. Voici quelques extraits choisis, qui se passent de commentaire.
– À Alfred Le Poittevin, 17 juin 1845. « Mon éducation sentimentale n’est pas achevée, mais j’y touche peut-être. — As-tu réfléchi quelquefois, cher et tendre vieux, combien cet horrible mot « bonheur » avait fait couler de larmes ? Sans ce mot-là, on dormirait plus tranquille et on vivrait plus à l’aise. Il me prend encore quelquefois d’étranges aspirations d’amour, quoique j’en sois dégoûté jusque dans les entrailles. Elles passeraient peut-être inaperçues, si je n’étais pas toujours attentif et l’œil tendu à épier jouer mon cœur. »
– À Maxime Du Camp, 7 avril 1846. « Et toi, bon vieux Max, que deviens-tu ? Prends garde d’aimer trop cette bonne Marthe. Tu goûtes avec elle de grandes joies ; c’est triste. La félicité est un manteau de couleur rouge qui a une doublure en lambeaux. Quand on veut s’en recouvrir, tout part au vent, et l’on reste empêtré dans ces guenilles froides que l’on avait jugées si chaudes. — J’ai peur pour toi quand je te vois une amour sérieuse. La vérole est moins à craindre que la passion. On cautérise les chancres de la pine, mais non pas ceux du cœur. Adieu. Je t’embrasse. Tibi. »
– À Louise Colet, 8-9 août 1846. « Oublie-moi si tu peux, arrache ton âme avec tes deux mains, et marche dessus pour effacer l’empreinte que j’y ai laissée. […] — Non, je t’embrasse, je te baise, je suis fou. Si tu étais là, je te mordrais. J’en ai envie, moi que les femmes raillent de ma froideur et auquel on a fait la réputation charitable de n’en pouvoir user, tant j’en usais peu. Oui je me sens maintenant des appétits de bêtes fauves, des instincts d’amour carnassier et déchirant, je ne sais pas si c’est aimer. C’est peut-être le contraire. Peut-être est-ce le cœur en moi, qui est impuissant. La déplorable manie de l’analyse m’épuise. Je doute de tout, et même de mon doute. Tu m’as cru jeune et je suis vieux. J’ai souvent causé avec des vieillards des plaisirs d’ici-bas, et j’ai toujours été étonné de l’enthousiasme qui ranimait alors leurs yeux ternes, de même qu’ils ne revenaient pas de surprise à considérer ma façon d’être, et ils me répétaient : À votre âge ! à votre âge ! vous ! vous ! — Qu’on ôte l’exaltation nerveuse, la fantaisie de l’esprit, l’émotion de la minute, il me restera peu. Voilà l’homme dans sa doublure. Je ne suis pas fait pour jouir. »
– À Louise Colet, 31 août 1846. « Oui, je t’aime, je t’aime, entends-tu ? Faut-il le crier plus fort encore ? Mais si je n’ai pas l’amour ordinaire qui ne sait que sourire, est-ce ma faute ? Est-ce ma faute de ce [que] tout mon être n’a rien de doux dans ses allures ? Je te l’ai déjà dit, j’ai la peau du cœur, comme celle des mains, assez calleuse. Ça vous blesse quand on y touche. Le dessous peut-être n’en est que plus tendre. »
– À Louise Colet, 7 mars 1847. « C’est une créature que j’aime à voir, encore plus de loin que de près, car de près tout perd et se rétrécit. Je me suis gardé de vouloir être autre chose auprès d’elle qu’un analyste. Car si « j’avais été serré dans ses bras » je ne l’aurais plus jugée. Ceci s’adresse à l’Artiste : cette femme-là me semble le type de la femme avec tous ses instincts, un orchestre de sentiments femelles. Or pour entendre l’orchestre on ne se met pas dedans, mais au-dessus, au fond de la salle. » […]
« Jamais tu n’as, je ne dis pas répondu, mais eu la moindre pitié pour mes instincts de luxe. Un tas de besoins qui me rongent comme de la vermine, et dont je te laissais voir le moins possible n’ont excité en toi que le dédain dont le bourgeois m’accable. Les trois quarts de ma journée habituellement se passent à admirer Néron, Héliogabale ou quelque autre figure secondaire, qui converge comme des astres autour de ces soleils de beauté plastique. Quel enthousiasme alors voulais-tu que j’aie pour les petits dévouements moraux, pour les vertus domestiques ou démocratiques que tu voulais que j’admirasse ? »
Le voyage en Orient
– La fameuse lettre à Louis Bouilhet du 15 mars 1850 n’a pas été retenue. C’est pourtant un chef d’œuvre, et la plus explicite quant à la bisexualité de Flaubert. Voici les extraits olé-olé, pris dans l’édition pléiade, mais la lettre aborde aussi bien d’autres points touristiques, esthétiques, politiques, etc. On trouvera la version Conard expurgée ici (c’est la première).
« Ce matin à midi, cher et pauvre vieux, j’ai reçu ta bonne et longue lettre tant désirée. Elle m’a remué jusqu’aux entrailles. J’ai mouillé. Comme je pense à toi, va ! inestimable bougre ! Combien de fois par jour je t’évoque — et que je te regrette ! Si tu trouves que je te manque, tu me manques aussi, et marchant le nez en l’air dans les rues, en regardant le ciel bleu, les moucharabiehs des maisons et les minarets couverts d’oiseaux je rêve à ta personne comme toi dans ta petite chambre de la rue Beauvoisine, au coin de ton feu, pendant que la pluie coule sur tes vitres et que Huart est là. Il doit faire froid à Rouen maintenant, de ce vieux bougre de froid embêtant. On a les pattes mouillées et on s’emmerde en pensant au soleil. Quand nous nous reverrons il aura passé beaucoup de jours. Je veux dire beaucoup de choses. Serons-nous toujours les mêmes, n’y aura-t-il rien de changé dans la communion de nos êtres ? J’ai trop d’orgueil de nous-mêmes pour ne pas le croire. Travaille toujours, reste ce que tu es. Continue ta dégoûtante et sublime façon de vivre. Et puis nous verrons à faire résonner la peau de ces tambours que nous tendons si dru depuis longtemps. […]
De Saltatoribus
Nous n’avons pas encore vu de danseuses : elles sont toutes en Haute Égypte, exilées. Les beaux bordels n’existent plus non plus au Caire. La partie que nous devions faire sur le Nil, la dernière fois que je t’ai écrit, a raté. Du reste il n’y a rien de perdu. Mais nous avons eu les danseurs. Oh ! Oh ! Oh !
[…] Comme danseurs figure-toi deux drôles passablement laids, mais charmants de corruption, de dégradation intentionnelle dans le regard et de féminité dans les mouvements, ayant les yeux peints avec de l’antimoine et habillés en femmes, pour costume de larges pantalons, une veste brodée qui descend jusqu’à l’épigastre, tandis que les pantalons retenus par une énorme ceinture de cachemire pliée en plusieurs doubles ne commencent à peu près qu’à la motte, de sorte que tout le ventre, les reins et la naissance des fesses sont à nu, à travers une gaze noire collée sur la peau ; retenue par les vêtements inférieurs et supérieurs, elle se ride sur les hanches comme une onde, ténébreuse et transparente, à tous les mouvements qu’ils font. La musique va toujours du même train, sans arrêter pendant deux heures. La flûte est aigre, les tambourins vous retentissent dans la poitrine, le chanteur domine tout ; les danseurs passent et reviennent, ils marchent remuant le bassin avec un mouvement court et convulsif. C’est un trille de muscles (seule expression qui soit juste) : quand le bassin remue tout le reste du corps est immobile ; lorsque c’est au contraire la poitrine qui remue, tout le reste ne bouge. Ils avancent ainsi vers vous, les bras étendus en jouant des crotales de cuivre, et la figure sous leur fard et leur sueur plus inexpressive qu’une statue — j’entends par là qu’ils ne sourient point. L’effet résulte de la gravité de la tête en opposition avec les mouvements lascifs du corps. Quelquefois ils se renversent tout à fait sur le dos par terre, comme une femme qui se couche pour se faire baiser, et se relèvent avec un mouvement de reins pareil à celui d’un arbre qui se redresse une fois le vent passé. Dans les saluts et révérences leurs grands pantalons rouges se bouffissent tout à coup comme des ballons ovales, puis semblent fondre, en versant l’air qui les gonfle. De temps à autre, pendant la danse, le cornac ou maquereau qui les a amenés folâtre autour d’eux, leur embrassant le ventre, le cul, les reins, et disant des facéties gaillardes pour épicer la chose qui est déjà claire par elle-même. C’est trop beau pour que ce soit excitant. Je doute que les femmes vaillent les hommes : la laideur de ceux-ci ajoute beaucoup comme art. […] Je ferai revenir ce merveilleux Hassan el Bilbeis, il me dansera L’Abeille en particulier. Par un tel bardache ce ne doit pas être poires molles.
Puisque nous causons de bardaches, voici ce que j’en sais. Ici c’est très bien porté : on avoue sa sodomie et on en parle à table d’hôte. Quelquefois on nie un petit peu, tout le monde vous engueule et cela finit par s’avouer. Voyageant pour notre instruction et chargés d’une mission par le gouvernement, nous avons regardé comme de notre devoir de nous livrer à ce mode d’éjaculation. L’occasion ne s’en est point encore présentée, nous la cherchons pourtant. C’est aux bains que cela se pratique : on retient le bain pour soi y compris les masseurs, la pipe, le café, le linge, et on enfile son gamin dans une des salles. Tu sauras que tous les garçons de bain sont bardaches ; les derniers masseurs, ceux qui viennent vous frotter quand tout est fini, sont ordinairement de jeunes garçons assez gentils. Nous en avisâmes un tout proche de chez nous. Je fis retenir le bain pour moi seul, j’y allai : le drôle était absent ce jour-là ! J’étais seul au fond de l’étuve, regardant le jour tomber par les grosses lentilles de verre qui sont au dôme. L’eau chaude coulait partout. Étendu comme un veau, je pensais à un tas de choses et mes pores tranquillement se dilataient tous. C’est très voluptueux et d’une mélancolie douce que de prendre ainsi un bain, perdu dans ces salles obscures où le moindre bruit retentit comme un bruit de canon, tandis que les kellahs nus s’appellent entre eux et qu’ils vous manient et vous retournent comme des embaumeurs qui vous disposeraient pour le tombeau. Ce jour-là (avant-hier lundi) mon kellah me frottait doucement. Arrivé aux parties nobles, il a retroussé mes boules d’amour pour me les nettoyer puis, continuant à me frotter la poitrine de la main gauche, il s’est mis à tirer sur mon vit et, le polluant par un mouvement de traction, s’est penché sur mon épaule en me répétant : batchis, batchis (ce qui veut dire « pour boire pour boire »). C’était un homme d’une cinquantaine d’années, ignoble, dégoûtant — vois-tu l’effet — et le mot batchis, batchis... Je l’ai un peu repoussé en disant la’, la’ — « non, non » —, il a cru que j’étais fâché et a pris une mine piteuse. Alors je lui ai donné quelques petites tapes sur l’épaule en répétant d’un ton plus doux la, la ; il s’est mis à sourire d’un sourire qui voulait dire : « Allons ! tu es un cochon tout de même, mais aujourd’hui c’est une idée que tu as de ne pas vouloir. »
Pauvre cher bougre, j’ai bien envie de t’embrasser, je serai content quand je reverrai ta figure. Hier en lisant tes vers j’ai exagéré mon exagération pour me faire plaisir et m’illusionner comme si tu étais là. […] Va voir ma mère souvent, soutiens-la, écris-lui quand elle sera absente, la pauvre femme en a besoin. Tu feras là un acte de haut évangélisme, et comme étude tu y verras l’expansion pudique d’une bonne et droite nature. Ah vieux bardache, sans elle et toi je ne penserais guère à ma patrie, je veux dire à ma maison. […]
Le soir, quand tu es rentré, que les strophes ne vont pas, que tu penses à moi et que tu t’ennuies appuyé du bout du coude sur ta table, prends un morceau de papier et envoie-moi tout, tout : j’ai mangé ta lettre et l’ai relue plus d’une fois.
En ce moment j’ai l’aperception [sic] de toi en chemise auprès de ton feu, ayant trop chaud, et contemplant ton vit. À propos, écris donc cul avec un l et non cu. Ça m’a choqué.
Adieu, je t’embrasse et suis plus que jamais maréchal de Richelieu, juste au corps bleu mousquetaire gris, régence et cardinal Dubois, sacrebleu.
À toi, mon solide. Ton vieux. Gustave Flaubert ».
– À Louis Bouilhet, le 13 mars 1850. « De retour à Benisouëf nous avons tiré un coup (ainsi qu’à Siout) dans une hutte si basse, qu’il fallait ramper pour y entrer. On ne pouvait s’y tenir que courbé ou à genoux. On baisait sur une natte de paille, entre quatre murs de limon du Nil sous un toit de bottes de roseaux, à la lumière d’une lampe posée dans l’épaisseur de la muraille. » […]
« Eh bien ! je n’ai pas baisé (le jeune Du Camp ne fit pas ainsi), exprès, par parti pris, afin de garder la mélancolie de ce tableau et faire qu’il restât plus profondément en moi. Aussi je suis parti avec un grand éblouissement, et que j’ai gardé. Il n’y a rien de plus beau que ces femmes vous appelant. Si j’eusse baisé, une autre image serait venue par-dessus celle-là et en aurait atténué la splendeur. » […]
À titre d’exemple — et nous n’en donnerons qu’un —, voici la version édulcorée de ce même paragraphe dans l’édition Conard : « Eh bien ! j’ai résisté, exprès, par parti pris, afin de garder la mélancolie de ce tableau et faire qu’il restât plus profondément en moi. Aussi je suis parti avec un grand éblouissement et que j’ai gardé. Il n’y a rien de plus beau que ces femmes vous appelant. Si j’eusse cédé, une autre image serait venue par-dessus celle-là et en aurait atténué la splendeur. » Sans commentaire !
« Je n’ai pas toujours mené avec moi un artistisme si stoïque. À Esneh j’ai en un jour tiré 5 coups et gamahuché 3 fois. Je le dis sans ambage ni circonlocution. J’ajoute que ça m’a fait plaisir. Kuchuk Hanem est une courtisane fort célèbre. […] C’est une impériale bougresse, tétonneuse, viandée, avec des narines fendues, des yeux démesurés, des genoux magnifiques, et qui avait en dansant de crânes plis de chair sur son ventre. […] Le soir, nous sommes revenus chez Kuchuk Hanem. Il y avait 4 femmes danseuses et chanteuses, almées (le mot almée veut dire savante, bas bleu. Comme qui dirait putain, ce qui prouve, Monsieur, que dans tous les pays les femmes de lettres !!!…). La feste a duré depuis 6 heures jusqu’à 10 heures 1/2, le tout entremêlé de coups [baisers dans l’édition Conard !] pendant les entractes. » […] « Je l’ai sucée avec rage ; son corps était en sueur, elle était fatiguée d’avoir dansé, elle avait froid. […] Quant aux coups, ils ont été bons. Le 3e surtout a été féroce, et le dernier sentimental. Nous nous sommes dit là beaucoup de choses tendres, nous nous serrâmes vers la fin d’une façon triste et amoureuse. » [1]
« Dans l’absorption de tout ce qui précède, mon pauvre vieux, tu n’as pas cessé d’être présent. C’était comme un vésicatoire permanent qui démangeait mon esprit et en faisait couler le jus en l’irritant davantage. Je regrettais (le mot est faible) que tu ne fusses pas là. Je jouissais pour moi et pour toi, je m’excitais pour nous deux et tu en avais une bonne part, sois tranquille. »
« Quant au vice, il [le jeune Du Camp] se calme. Il nous semble que j’hérite de ses qualités car je deviens cochon. Je le sens profondément. Si le cerveau baisse, la pine se relève. »
– À Théophile Gautier, le 13 août 1850. « Au Caire j’ai vu un singe masturber un âne. L’âne se débattait, le singe grinçait des dents, le foule regardait, c’était fort. […] Nous allons donc voir la place où fut Sodome. Quelles idées ça va faire naître en nous !? »
– À Louis Bouilhet, le 14 novembre 1850. « Nous avons passé (rien de plus) dans la rue des bordels d’hommes. J’ai vu des bardaches qui achetaient des dragées, sans doute avec l’argent de leur cul, l’anus allait rendre à l’estomac ce que celui-ci lui procure d’ordinaire. Dans les salles du rez-de-chaussée j’ai entendu les sons d’un violon aigre, on dansait la romaïque. Ces jeunes garçons sont ordinairement des Grecs ; ils portent de longues chevelures. » […]
« Chaque soir et matin je pansais mon malheureux vi. Enfin cela s’est guéri. Dans deux ou trois jours la cicatrice sera fermée. Je me soigne à outrance. Je soupçonne une Maronite de m’avoir fait ce cadeau, mais c’est peut-être une petite Turque. Est-ce la Turque ou la Chrétienne, qui des deux ? problème ? pensée !!! voilà un des côtés de la question d’Orient que ne soupçonne pas La Revue des Deux-Mondes. — Nous avons découvert ce matin que le young Sassetti a la chaude-pisse (de Smyrne), et hier au soir Maxime s’est découvert, quoiqu’il y ait six semaines qu’il n’a baisé, une excoriation double qui m’a tout l’air d’un chancre bicéphale. Si c’en est un, ça fait la troisième vérole qu’il attrape depuis que nous sommes en route. Rien n’est bon pour la santé comme les voyages. » […]
« À Mouglah, dans les environs du golfe de Cos, Max s’est fait polluer par un enfant (femelle) qui ignorait presque ce que c’était. C’était une petite fille de 12 à 13 ans environ. Il s’est branlé avec les mains de l’enfant posées sur son vi » (Phrase reprise dans La Comédie indigène, de Lotfi Achour.)
Retour en France
– À Louise Colet, 24 avril 1852. « Causons un peu de Graziella. C’est un ouvrage médiocre, quoique la meilleure chose que Lamartine ait faite en prose. […] Et d’abord, pour parler clair, la baise-t-il ou ne la baise-t-il pas ? Ce ne sont pas des êtres humains, mais des mannequins. — Que c’est beau, ces histoires d’amour où la chose principale est tellement entourée de mystère que l’on ne sait à quoi s’en tenir ! l’union sexuelle étant reléguée systématiquement dans l’ombre comme boire, manger, pisser, etc. ! Ce parti pris m’agace. Voilà un gaillard qui vit continuellement avec une femme qui l’aime et qu’il aime, et jamais un désir ! Pas un nuage impur ne vient obscurcir ce lac bleuâtre ! Ô hypocrite ! S’il avait raconté l’histoire vraie, que c’eût été plus beau ! Mais la vérité demande des mâles plus velus que M. de Lamartine. — Il est plus facile en effet de dessiner un ange qu’une femme. Les ailes cachent la bosse. […] Mais c’est que Naples n’est pas ennuyeux du tout. — Il y a de charmantes femelles, et pas cher. Le sieur de Lamartine tout le premier en profitait, et celles-là sont aussi poétiques dans la rue de Tolède que sur la Margellina. Mais non, il faut faire du convenu, du faux. Il faut que les dames vous lisent. Ah mensonge ! mensonge ! que tu es bête ! »
– À Louise Colet, 16juillet 1852. « C’est cette pudeur-là qui m’a toujours empêché de faire la cour à une femme. — En disant les phrases po-ë-tiques qui me venaient alors aux lèvres, j’avais peur qu’elle ne se dise : « Quel charlatan ! » et la crainte d’en être un effectivement m’arrêtait. » […]
« Sont de même farine tous ceux qui vous parlent de leurs amours envolées, de la tombe de leur mère, de leur père, de leurs souvenirs bénis, qui baisent des médaillons, pleurent à la lune, délirent de tendresse en voyant des enfants, se pâment au théâtre, prennent un air pensif devant l’Océan. Farceurs ! farceurs ! et triples saltimbanques ! qui font le saut du tremplin sur leur propre cœur pour atteindre à quelque chose. »
– À Louise Colet, 19 septembre 1852. « Mais il y a d’autre part une telle idée reçue qu’il faut être chaste, idéal, qu’on doit n’aimer que l’âme, que la chair est honteuse, que le cœur seul est de bon ton. Le cœur ! Le cœur ! oh ! voilà un mot funeste ; et comme il vous mène loin ! »
– À Louise Colet, 27 décembre 1852. « À la fin le héros veut se châtrer, par une espèce de manie mystique. J’ai eu, au milieu de mes ennuis de Paris, à dix-neuf ans, cette envie (je te montrerai dans la rue Vivienne une boutique devant laquelle je me suis arrêté un soir, pris par cette idée avec une intensité impérieuse), alors que je suis resté deux ans entiers sans voir de femme. (L’année dernière, lorsque je vous parlais de l’idée d’entrer dans un couvent, c’était mon vieux levain qui me remontait.) Il arrive un moment où l’on a besoin de se faire souffrir, de haïr sa chair, de lui jeter de la boue au visage, tant elle vous semble hideuse. »
Voilà déjà trop d’extraits pour vous allécher ; à vous de découvrir la suite, avec bien sûr les extraordinaires aperçus sur la poétique du maître, dont on trouve des extraits dans les manuels scolaires de lettres, les échanges de courtoisies avec les auteurs, la suite et la fin de la relation avec Louise Colet, etc. Je note simplement deux extraits des dernières années, qui apportent un éclairage sur l’attitude de Flaubert :
1. Dans une lettre à Maxime du Camp du 24 février 1877, après avoir, à la demande de Maxime, détruit une grande partie de leur correspondance de jeunesse, il écrit : « Étais-tu gentil dans ce temps-là ! étais-tu gentil ! et comme nous nous sommes aimés ! ». Quelques jours après, à une correspondante féminine, il précise : « Vous ai-je dit que l’autre soir avec Maxime Du Camp, nous avons relu et brûlé toutes nos lettres de jeunesse ? Celles-là du moins échapperont à la postérité, elles parlaient uniquement de la littérature et des dames. »
2. À deux reprises il évoque en se moquant le « sieur de Germiny arrêté comme boulgre » ; « Ô Humanité ! Ô Turpitude ! » (lettre à Ivan Tourguéniev du 14 décembre 1876, puis à Edma Roger des Genettes, du 15 février 1877). Une note précise « Fils de bonne famille, le comte Eugène Lebègue de Germiny, conseiller municipal et personnalité notoirement dévote, avait été surpris en flagrant délit d’attentat à la pudeur dans un urinoir des Champs-Élysées en compagnie d’un bijoutier nommé Chouard. » Flaubert se moque-t-il du « boulgre », ou de son côté dévot, ou de la justice qui condamne lesdits « bougres » ?
– Lire une pénétrante analyse du voyage en Orient dans « Un Normand en Orient », article de Frédéric Gournay paru dans Social traître n°1. [2] Enfin, plus courageux que moi, Jean-Yves s’est tapé le tome 1 de la Pléiade, et y a pioché des perles compromettantes !
– Lire aussi nos articles sur Par les champs et par les grèves, sur Madame Bovary, sur Gemma Bovery, de Posy Simmonds (1999), et le film éponyme sorti en 2014, ainsi que les articles sur Pierrot au sérail & La Tentation de Saint-Antoine et sur Salammbô, c’est-à-dire les œuvres de Flaubert contemporaines de Bovary, publiées dans le volume III de la Pléiade en 2013.
– Lire « Flaubert — L’Égyptien de la famille » sur le site Pile ou Face, consacré à l’œuvre de Philippe Sollers, qui nous fait l’honneur d’un lien vers le présent article.
– Sur la bisexualité de Flaubert, lire l’article de Michel Larivière. On peut lire dans une version non-censurée la longue lettre à Louis Bouilhet du 15 janvier 1850 sur Gallica.
Voir en ligne : La correspondance de Flaubert, site de l’Université de Rouen
© altersexualite.com 2008
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Kuchuk Hanem est devenue grâce à Flaubert une icône des voyageurs orientaux. André Gide l’évoque en modèle de ses virées à Biskra, entre deux bardaches (il n’utilise pas ce mot-là) dans des brouillons de Si le grain ne meurt.
[2] Le lien précédent, c’est pour les archives ; voici le nouveau site de Social traître.
 altersexualite.com
altersexualite.com