Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > L’Attrape-cœurs, de Jerome David Salinger
L’homophobie, ce douloureux problème, pour les lycéens
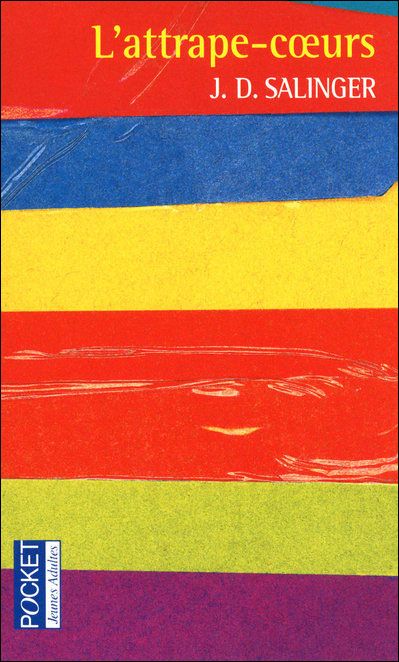 L’Attrape-cœurs, de Jerome David Salinger
L’Attrape-cœurs, de Jerome David Salinger
Pocket, 1951, 254 p., 5,2 €
vendredi 15 juin 2012
Ce best-seller mondial du XXe siècle se passerait bien d’une « critique » sur ce site. Aussi ne vais-je pas raconter l’histoire ; je vous renvoie à l’article de Wikipédia L’attrape-cœurs. Je me contenterai d’évoquer un aspect du roman important s’agissant d’un livre consacré à l’adolescence, et considéré comme un des meilleurs romans pour adolescents. Il s’agit de l’homophobie très présente dans les propos du personnage et ceux de son entourage. Le romancier né en 1919 avait 32 ans quand il a publié ce chef-d’œuvre, traduit en français en 1953. Nous avons utilisé la seconde traduction française, due à Annie Saumont (1986). Un détail : j’ignore pourquoi on désigne cet auteur par ses initiales. Le double prénom semble s’écrire sans trait d’union ni accents.
Le rapport avec les adultes
Caulfield, le narrateur, adresse son récit à un « vous » qu’on identifie à la fin du roman avec un psy du centre où il est venu « pour [se] retaper » (p. 9). Dès lors on est fondé à remettre en cause sa sincérité quand il parle d’adultes : n’essaie-t-il pas de donner une bonne image de lui à ses lecteurs-thérapeutes ? Ainsi dès la première page, à propos de ses parents : « Pour ça ils sont susceptibles, spécialement mon père. Autrement ils seraient plutôt sympa et tout – d’accord – mais ils sont aussi fichument susceptibles ». Le « d’accord » entre parenthèses n’est-il pas une concession ? Chaque fois qu’il s’adresse à des adultes, le narrateur est mal à l’aise, et s’observe, attentif à ne pas choquer autrui. Ce qui peut nous étonner est son rapport direct avec ses professeurs, à qui il rend visite à leur domicile, ainsi du professeur cacochyme qui le reçoit dans sa chambre, Caulfield s’asseyant sur son « pageot » au début du récit, avant de quitter son collège. Il y a les chauffeurs de taxi, inconnus à qui il ose poser sa question obsessionnelle sur les fameux canards : que deviennent les canards de Central Park lorsque le lac est pris par le gel ? Il y a cette mère de famille qu’il rencontre dans le train, qui s’imagine que son fils est « un garçon très sensible ». Cela « tue » Caulfield (expression qui revient souvent) : « Elle avait pas l’air d’une andouille. Elle avait l’air d’une personne très capable de se faire une idée claire du genre de petit con qu’elle a pour fils. Mais on peut jamais dire, avec les mères. Elles sont toutes légèrement fêlées » (p. 72). Le récit se termine sur une autre rencontre avec un prof, M. Antolini, qui le comprend mieux semble-t-il, mais qui a un geste que Caulfield interprète mal : il lui caresse les cheveux tandis qu’il dort. Ce geste paternel est immédiatement interprété de façon négative : « Je rencontre plus de foutus pervers dans les collèges et tout que n’importe qui de vos connaissances et ils se mettent toujours à leurs trucs de pervers quand moi je suis là. » (p. 229). Quelques pages plus tard, il s’interroge : « je me posais la question de savoir si j’avais pas eu tort de croire qu’il me faisait des avances de pédé » (p. 233). La question n’est pas résolue, mais tout est dit de la névrose de ce garçon dont les parents sont les grands absents du livre. Quand un prof se comporte comme un père devrait se comporter, il ne comprend pas. Qu’est-ce que ça serait à notre époque d’hystérie anti-pédophile ?
Les rapports avec les filles
Caulfield s’oblige à draguer par conformisme sans doute, je veux dire pour conformer son récit à ce que le lecteur, dont on ne doit pas oublier qu’il est sans doute un psychothérapeute de l’institut où il séjourne, attend d’un adolescent mâle. Ainsi, il drague trois filles dans un dancing : « Les filles c’est comme ça, même si elles sont plutôt moches, même si elles sont plutôt connes, chaque fois qu’elles font quelque chose de chouette on tombe à moitié amoureux d’elles et alors on sait plus où on en est. Les filles. Bordel. Elles peuvent vous rendre dingue. Comme rien. Vraiment. » (p. 92). Quand « Maurice », le jeune proxénète liftier de l’hôtel où il descend, lui propose une prostituée, il accepte, mais nous confie qu’il est puceau (p. 114). Puis il ne fait rien avec la fille, et la paie, mais elle veut 10 dollars et non 5 comme convenu. C’est alors l’affrontement avec « Maurice », substitut de rapport sexuel. La proposition de celui-ci dans l’ascenseur n’était-elle pas ambiguë ? « C’que ça vous intéresse de passer un bon moment ? Ou bien c’est trop tard pour vous ? » Je lui ai demandé de quoi il parlait. Je voyais pas où il voulait en venir » Il s’agit « d’une pépée », mais Caulfield, en refusant le chantage du proxénète, n’agira-t-il pas de façon à obtenir ce qu’il recherche vraiment : « un terrible coup de poing dans l’estomac » (p. 127) ? Ça vaut bien un coït avec une fille ! De fait, dans les toutes dernières lignes du récit, de qui se souvient Caulfield avec nostalgie ? Des filles ? De la prostituée ? Relisons plutôt : « Les gens dont j’ai parlé, ça fait comme s’ils me manquaient à présent, c’est tout ce que je sais. Même le gars Stradlater par exemple, et Ackley. Et même, je crois bien, ce foutu Maurice. C’est drôle. Faut jamais rien raconter à personne. Si on le fait, tout le monde se met à vous manquer » (p. 253) [1]. Quand il parle de ses tentatives avec les filles, Caulfield nous fait des confidences utiles : « On sait jamais si les filles elles veulent vraiment qu’on arrête ou si elles ont juste une frousse terrible, ou si elles vous disent d’arrêter pour que, si vous continuez, ce soit votre faute et pas la leur. En tout cas moi j’arrête. » (p. 115). Par contre avec les garçons, il n’arrête jamais, jusqu’à obtenir qu’ils le frappent ! CQFD !
Les rapports avec les garçons
Ses camarades de chambrée changent sans cesse. Caulfield les observe. Il y a « le gars Stradlater » : « Sans chemise ni rien. Il circulait toujours torse nu parce qu’il se trouvait vachement bien bâti. Il l’était. Faut bien le reconnaître. » (p. 38). Alors que – on l’apprend plus loin – Caulfield est puceau, il s’échange les filles avec son camarade : « Prends-la. Mais elle est trop vieille pour toi. » (p. 42). C’est une dispute avec celui-ci qui est à l’origine de la fugue de Caulfield. Il ne supporte pas l’idée que Stradlater ait eu un rapport sexuel avec une fille qu’il a connue. Leur bagarre peut être considérée comme un succédané de rapport homosexuel.
L’homophobie est omniprésente dans les rapports avec le sexe mâle, sans avoir forcément un lien avec une homosexualité réelle. Ainsi cette saillie significative sur un homme dans un cabaret : « À ma droite il y avait un mec typiquement “Yale” en costume de flanelle grise avec un gilet à carreaux genre pédé […] En tout cas ce mec typiquement “Yale” était avec une fille extra » (p. 107). Mais encore dans un bar : « À l’autre bout du bar c’était plein de pédés qu’avaient pas trop l’air de pédés – je veux dire qu’étaient pas trop à manières ni rien – mais on voyait tout de même bien que c’était des pédés » (p. 174). Il évoque un type, Luce, dont l’homosexualité et autres « perversions » est la discussion principale. Il connaît tous les homos célèbres et planqués : « bon Dieu y en avait même qui étaient mariés » (p. 175). Caulfield n’est pas entièrement dupe : « ce gars, j’avais l’impression qu’il était lui-même un peu pédé ». Il précise : « J’ai connu quelques vrais homos au collège », mais bizarrement n’en dit pas un mot plus précis ! Dans les dernières pages, au moment où il rejoint sa petite sœur, il insiste lourdement sur des graffitis qui le choquent : « Quelqu’un avait écrit « je t’enc… » sur le mur. Ça m’a presque rendu cinglé. Je me suis dit que Phoebé et les autres petits mômes allaient voir ça et qu’ils se demanderaient ce que ça signifiait et alors un gosse taré leur dirait – et bien sûr tout de travers – et pendant deux ou trois jours ils y penseraient et peut-être même se tracasseraient » (p. 239). Cela entraîne un vrai délire dans les pages suivantes, il va même imaginer que sur sa tombe quelqu’un écrirait « Je t’enc… » ! (p. 243). On se demande si l’expression originale est seulement « fuck », ou bien un mot plus précis qui évoquerait la pénétration anale.
En conclusion, ce livre qui ne parle pas d’homosexualité ne fait que parler d’homosexualité. C’est l’immense non-dit. Quand on songe à la date d’écriture et à l’âge de l’auteur, on est sidéré de la différence entre la névrose étasunienne et ce qu’il ressort de Bonjour tristesse, de Françoise Sagan, publié en 1954, et surtout du Rempart des Béguines, de Françoise Mallet-Joris publié en 1951. Comme quoi le tabou sur la sexualité engendre diverses maladies mentales, lesquelles sont moins prégnantes en France. Voir aussi Comment réussir sa schizophrénie, de Robert Dôle. À mettre en relation avec une nouvelle récente (en 2012) : « Dans cet état contrôlé par les conservateurs [Utah], où vit une forte proportion de Mormons, il sera désormais interdit également de parler d’homosexualité en classe ou des questions sexuelles en général, sauf si cela concerne l’abstinence avant le mariage. » Voir l’article de Libération.
– Voir Caulfield : sortie interdite, de Harald Rosenlow Eeg, Éditions Thierry Magnier, 2007, dont le titre rend hommage au roman de Salinger. Et le contenu explicite de l’ouvrage semble illustrer mes propos.
© altersexualite.com 2012
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com