Accueil > Culture générale et expression en BTS > À toute vitesse ! > Éloge de l’immobilité, de Jérôme Lèbre
Philosophie de l’immobilité, pour étudiants et adultes
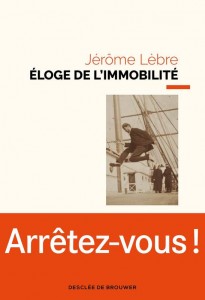 Éloge de l’immobilité, de Jérôme Lèbre
Éloge de l’immobilité, de Jérôme Lèbre
Desclée de Brouwer, 2018, 380 p., 17,9 €.
samedi 4 janvier 2020, par
Éloge de l’immobilité (2018) de Jérôme Lèbre (né en 1967) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « À toute vitesse ! ». Je l’ai choisi sur cette liste parce que c’est un des essais les plus récents qui y figure. Malgré un titre proche, on est loin de Du bon usage de la lenteur de Pierre Sansot. On est dans le noyau dur de la philo, pas une page sans son lot de citations d’auteurs ; mais un livre relativement facile à lire (si l’on compare au style « rhapsodique » de Paul Virilio selon Hartmut Rosa), et ordonnancé en de nombreux courts chapitres (répartis en 5 sections), pour s’avaler à petites doses d’une station de métro à la suivante… On peut cependant s’interroger sur le choix du titre, car « Critique de la vitesse » m’eut semblé plus pertinent, vu le contenu.
Introduction.
La « station debout » est « ce qui différencie l’homme de l’animal » : « Il y a quantité de manières de se tenir debout, qui sont autant de manières de faire sens : elles expriment le défi, la détente, l’attente, la peur, l’assurance, etc. ; les hommes et les femmes ne se tiennent pas de la même manière et dans les différentes « cultures ». Mais à chaque fois s’exprime de manière différente l’effort permettant de rester vertical, de maintenir l’horizontalité d’un regard prêt à en rencontrer un autre, de se dresser en commun à l’écart de la mort. Il en ressort d’autant mieux que la station debout est le signe de la finitude de l’homme : celui-ci ne peut tenir longtemps ainsi, il lui faut s’accroupir ou s’asseoir, s’allonger, il lui faut finalement mourir » (p. 25). De l’autre côté du spectre, « L’agitation est une fuite de la mort qui va dans tous les sens. L’agité, ou l’insensé, se laisse prendre par son quotidien, absorbé par lui et par toutes les choses à faire (en latin, les agenda) sans prendre le temps de penser ou d’exister, et c’est ainsi qu’il passe à côté de l’existence quitte à la rejoindre trop tard, à la minute de la mort. Il veut trop, il en fait trop, s’écarte trop du monde, et finalement ne fait rien, n’avance pas, n’a le temps pour rien : l’action lui est insupportable, mais le repos également, car il l’ennuie à mourir » (p. 26).
Je reproduis ici une citation (p. 28) du Gai savoir (I, 6) de Friedrich Nietzsche, mais dans la traduction d’Henri Albert disponible sur Wikisource : « Dignité perdue. — La méditation a perdu toute sa dignité de forme, on a tourné en ridicule le cérémonial et l’attitude solennelle de celui qui réfléchit et l’on ne tolérerait plus un homme sage du vieux style. Nous pensons trop vite, nous pensons en chemin, tout en marchant, au milieu des affaires de toute espèce, même lorsqu’il s’agit de penser aux choses les plus sérieuses ; il ne nous faut que peu de préparation, et même peu de silence : — c’est comme si nous portions dans notre tête une machine d’un mouvement incessant, qui continue à travailler même dans les conditions les plus défavorables. Autrefois on s’apercevait au visage de chacun qu’il voulait se mettre à penser — c’était là une chose exceptionnelle ! — qu’il voulait devenir plus sage et se préparait à une idée : on contractait le visage comme pour une prière et l’on s’arrêtait de marcher ; on se tenait même immobile pendant des heures dans la rue, lorsque la pensée « venait » — sur une ou sur deux jambes. C’est ainsi que cela « en valait la peine » !
1re partie : Une pensée arrêtée. Il s’agit ici de passer en revue les cultures du passé. L’auteur mentionne un certain nombre d’exemples de temples ou œuvres d’art donnant l’exemple de postures de médiation devant lesquelles on peut se recueillir, que ce soit dans des temples au Japon ou en Europe : « Devant les tableaux votifs chrétiens, le spectateur, qu’il prie à genoux ou non, voit les donateurs de l’œuvre priant à genoux ; la Trinité de Masaccio les montre en contemplation devant Marie et Saint Jean, eux-mêmes arrêtés devant le Christ, crucifié et soutenu par Dieu ; même la colombe du Saint-Esprit est posée, et le mystère de la Trinité se tient dans la diversité de ces postures. Les portraits de penseurs sont des variations sur des postures immobiles : assis ou appuyés sur un bâton » (p. 34). Pour coller à l’actualité, je vous propose la photo du Christ en croix adoré par deux donateurs (1595), que j’ai prise à l’exposition Le Greco au Grand Palais en novembre 2019 (mais qui est au Louvre).
La pensée chinoise antique fait l’objet d’un chapitre, dont j’ai trouvé ce paragraphe remarquable inspiré par le Dao de jing : « La voie du vide, wu, est donc wu wei, le non-agir, ou agir vide. L’action hors du vide, qu’elle tende vers la maîtrise, le pouvoir, le mérite ou la possession, ne trouble que celui qui croit agir : c’est un faux mouvement, un mauvais rêve. Mais le sage, lui, voit ce qui n’a pas de forme, entend ce qui n’a pas de son, exprime ce qui ne s’exprime pas, voit sans voir, entend sans entendre, ne parle et n’écrit que dans le silence ; il marche sans marcher, connaît le monde sans voyager, combat sur place, sans adversaire, cédant d’avance à l’adversaire qui se présente alors en tombant. Il accomplit sa tâche en la déposant avant qu’elle ne commence à lui poser des problèmes. Le sage est l’essieu qui permet à la roue de tourner, il suit le cours du monde comme une feuille morte suit le cours du fleuve » (p. 42) [1]. Cette métaphore de l’essieu m’amène aux derviches tourneurs de Konya (si je suis passé à Konya jadis, c’est en Syrie que j’ai vu tourner un jeune derviche, dont je garde un fort souvenir). Comme c’est un fait culturel intéressant pour le thème « À toute vitesse ! », je note ici ce que nous apprend Wikipédia (Samā‘) : « Les derviches tourneurs se déplacent d’abord avec lenteur et font trois fois le tour de la piste. Chaque derviche se tourne vers celui qui est derrière lui et tous deux s’inclinent avant de reprendre leur circumambulation. Ce déplacement est le symbole des âmes errantes cherchant à la périphérie de l’existence. Après le troisième tour, le maître prend place sur son tapis et les danseurs attendent. Alors les chanteurs chantent et quand ils s’arrêtent, les derviches, en un geste triomphal, laissent tomber leur manteau noir, dévoilant leur vêtement blanc. La chute du manteau est celle de l’illusion. Quand le manteau noir qui représente l’enveloppe charnelle est abandonné, c’est la résurrection. Les derviches, bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules, se mettent à tourner lentement, sur eux-mêmes puis écartent les bras, la main droite tournée vers le ciel pour récolter la grâce de Dieu et la main gauche tournée vers le sol pour la dispenser vers les hommes. En même temps qu’ils tournent sur eux-mêmes, ils tournent autour de la salle. Ce double tour figure la loi de l’univers, l’homme tourne autour de son centre, son cœur, et les astres gravitent autour du soleil. Ce double symbolisme cosmique est le véritable sens du Sema : toute la création tourne autour d’un centre ».
Revenons à nos moutons. Sur l’Inde, on apprend entre autres que « Shiva [est le] responsable du désordre et de l’ordre, de l’écroulement du monde et de son maintien, dont le symbole et le linga, pilier cosmique et phallus dressé, qui tient la nature en contenant son désir de dissémination et de croissance » (p. 47). La Bhagavad-Gita est évoquée : « Dans ce texte étonnant, une épopée est suspendue, arrêtée, parce que son héros lui-même s’immobilise, refusant de continuer la guerre contre ses ennemis qui sont de sa famille. Krishna enseigne alors au guerrier la seule action encore possible, car non agissante. Celui qui sait agir accompagne le cours des choses, mais se détache du fruit de ses actes ; il prépare son repos, son retrait, le moment où il pourra s’asseoir devant son maître Krishna. Alors il pourra vraiment saisir son souffle et son cœur pour s’établir dans ce qui ne bouge jamais » (p. 51 ; cf. aussi p. 297).
C’est l’occasion de citer ici un passage du Chant VI « De la méditation » de la Bhagavadgita dans la traduction de Marc Ballanfat (GF 2007, pp. 67-70). Rappelons l’enjeu de ce texte majeur de l’hindouisme : Arjuna, le héros de la Bhagavad-Gita, est convaincu par Krishna qu’il n’est pas contraire à la non-violence de participer à la guerre contre les Kaurava, dont certains sont membres de sa famille.
« Le Bienheureux continua ainsi :
« Ne plus dépendre des bénéfices de l’acte, l’accomplir seulement parce qu’il le faut : c’est cela, être renonçant, être ascète. Ce n’est pas négliger le feu des sacrifices ni le rituel.
Sache que le « renoncement », comme les sages le nomment, n’est pas différent de l’ascèse car on ne peut être ascète sans renoncer à la volonté.
Celui qui désire gravir les degrés de l’ascèse doit encore s’appuyer sur les actes. Quand il y est parvenu, il peut alors cesser d’agir.
Et ces degrés de l’ascèse, on dit qu’il les a gravis quand il ne s’investit plus ni dans les objets sensibles ni dans les actes, et qu’il a renoncé à toute volonté.
Que l’ascète s’élève et non qu’il s’abaisse par lui-même. On est son propre ami et son propre ennemi. Qui s’est vaincu soi-même, ni le chaud ni le froid, ni le plaisir ni la douleur, ni l’estime ni le déshonneur ne troublent sa paix : il s’est absolument recueilli.
Quand la connaissance et l’expérience de la vérité le comblent, qu’il maîtrise ses sens et porte un regard égal sur une motte de terre, une pierre ou une pépite d’or, l’ascète tient un équilibre parfait. On dit qu’il « a trouvé l’unité ». Alors, l’homme généreux, l’ami ou l’ennemi, l’indifférent, le modéré, l’homme haïssable ou aimable, le vertueux ou le vicieux, eux tous, il les juge d’égale valeur. Voilà ce qui le rend remarquable.
L’ascète doit se discipliner sans relâche. Qu’il se fixe dans un lieu solitaire, seul avec lui-même, contrôlant son esprit : il n’a pas d’attente, rien ne lui fait envie. En un lieu purifié, qu’il installe fermement un siège, ni trop haut ni trop bas, couvert d’un tissu, d’une peau ou garni d’herbes. Puis, une fois entré dans la posture, qu’il concentre son esprit sur un point, en maîtrisant son activité mentale et ses sens. Qu’il pratique l’ascèse pour se purifier. Qu’il tienne fermement ensuite, alignés et immobiles, le corps, la tête et le cou, concentrant son regard vers l’extrémité de son nez, sans le laisser errer ailleurs.
Paisible, toute crainte chassée, fidèle à son vœu de chasteté, il se maîtrise mentalement, recueilli en moi, dans la posture : moi seul l’occupe. Il poursuit son ascèse sans interruption, maître de son mental, et accède à la paix, la suprême libération : il prend demeure en moi.
Mais l’ascèse, ce n’est ni l’excès de nourriture ni le jeûne intégral, ni un sommeil excessif ni davantage une privation de sommeil ; c’est doser nourriture et exercice, économiser ses gestes quand on agit, mesurer son temps de sommeil et de veille. Voilà l’ascèse qui met fin à la misère.
Quand son activité mentale, une fois contrôlée, se stabilise d’elle-même, et qu’il s’est coupé de tout désir, on dit alors que l’ascète « a trouvé l’unité ».
La flamme de la lampe, sans un souffle d’air, ne vacille pas. Tel est, dit-on, l’ascète qui soumet son mental et pratique le détachement de soi-même.
Quand l’esprit se calme, résorbé par la pratique de l’ascèse, qu’on ressent alors la joie de se contempler par soi-même et qu’on aperçoit par la pensée un bonheur sans égal, au-delà des sensations, si l’on s’y tient, on ne s’écarte pas du vrai. Quand on l’a trouvé, on juge que rien d’autre ne lui est supérieur. Aucun malheur, aussi funeste soit-il, ne peut ébranler celui qui s’y tient.
Sache que cet état se nomme « détachement » puisqu’il a pour but de rompre le lien avec la misère. C’est l’ascèse, qu’il faut pratiquer avec persévérance, l’esprit mobilisé. Quand on s’est affranchi de tous les désirs qui naissent de l’imagination, tous sans exception, que l’esprit contrôle l’ensemble des sens, on s’installe peu à peu dans le calme, avec la ferme résolution de fixer son esprit sur soi et de ne penser à rien d’autre.
Chaque fois que l’esprit se disperse, incapable de repos, instable, il faut le discipliner, le soumettre à soi.
Un bonheur sans égal comble l’ascète à l’esprit apaisé ; la passion s’est éteinte, toute tache s’en est allée : il vit en l’absolu.
L’ascète se discipline sans relâche, pur de toute tache et découvre sans effort le bonheur infini d’éprouver l’absolu.
Il se voit en tous les êtres et voit tous les êtres en soi. Maintenant qu’il a trouvé l’unité par l’ascèse, il porte un regard égal sur tout.
Il me voit en toutes choses et voit toutes choses en moi. Alors, je ne disparais pas à ses yeux, il ne disparaît pas aux miens.
L’ascète qui m’adore en tous les êtres, conscient de leur unité, où qu’il vive maintenant, il vit en moi.
Il voit que tout se vaut à l’aune de l’absolu : bonheur ou malheur. On reconnaît en lui le suprême ascète ».
Sur Bouddha, je relève ce paragraphe : « Que l’on multiplie des statues identiques ou différentes, il s’agit toujours d’insérer une constance dans la diversité du monde, de se détacher de ce monde tout en lui appartenant. C’est alors en foule que Bouddha ne revient plus : il reste dans chaque être qui en allant vers la mort part sans revenir. C’est pourquoi Bouddha, si souvent statufié, peut aussi être figuré par l’empreinte de ses pieds joints : trace d’une statue absente, d’un départ effectué sans un pas » (p. 55). Cela me fait penser à l’immense statue de Bouddha couché de Kyauk Htat Gyi dont j’ai photographié le non moins géant pied au Myanmar. Cela ne correspond pas au texte, et j’ai aussi vu des empreintes de pieds de bouddha, mais c’est quand même une immense statue d’un personnage divin en train de se reposer !

J’apprécie aussi ce paradoxe : « En prenant la posture de Bouddha, l’adepte rejoint sa nature, qui est le vide même : et comme la voie est vide, elle s’atteint sans étapes. Cette position est aussi bien celle de celui qui a voyagé sur un âne en cherchant l’illumination, et se rend compte que l’illumination est l’âne ; pour la trouver, il cesse de chercher et descend. Descendre de son âne, c’est alors aussi bien vaquer à ses actions quotidiennes, puisque l’action n’accomplit rien. L’adepte peut donc transporter de l’eau, couper du bois : quoi qu’il fasse, il ne voyage plus » (p. 57). Cela fait penser au poème d’Antonio Machado. Le chapitre « Ithaque » commence par une antimétabole : « Le pire serait de « croire savoir », en particulier de croire qu’en Orient la pensée s’immobilise, alors qu’en Occident l’immobilité se pense » (p. 59). Suivent des réflexions passionnantes sur l’immobilité, au cœur de l’action de l’Iliade (« un vent qui tombe et immobilise la flotte ») et l’Odyssée (« détour indéfini d’Ulysse, en guerre avec l’impossibilité de revenir »). Cela me rappelle l’épigraphe de Zazie dans le métro. « Même réussir à quitter une île, ce n’est pas sortir de l’immobilité : c’est plutôt se libérer d’un attachement sans se détacher et donc voyager immobile, attaché au bateau. Ulysse lie les rameurs drogués par les fleurs de lotus ; plus tard, il demande à son équipage de le lier au mât pour entendre les sirènes tout en leur résistant » (p. 60). Le chapitre « Souci de soi » propose une définition de la sagesse qui rappelle la Bhagavad-Gita : « À l’opposé, le sage ne fuit pas, il se sauve ; et se sauver c’est prendre soin de soi, se retirer en soi pour se préparer à ce qui arrive, devenir un athlète des événements qui garde son équilibre et atteint le seul bonheur possible, l’absence de trouble, l’ataraxie. Il faut pour cela toute une culture de soi, des entraînements et des exercices de méditation, d’installation en soi, d’examen de soi » (p. 76). Athlète, ascète, même combat ! Dans le même chapitre : « Le disciple se tient devant le maître qui parle et cela s’apprend. L’écoute, signale Plutarque, est d’abord trop passive, trop influençable – c’est bien pourquoi Ulysse doit se faire lier à son mât pour résister au chant des sirènes. Il faut donc une vraie ascèse pour la rendre active, pour qu’elle devienne une attitude qui anticipe et incorpore la parole du maître » (p. 79).
À propos de Jésus, il semble y avoir paradoxe entre sa vie et sa mort : « Jésus ne cesse de cheminer et tous ses actes et paroles impliquent autant de rencontres que de haltes. Il va jusqu’à ce chemin qui mène du mont des Oliviers au Golgotha et de là au tombeau et à la résurrection. Au centre de cette vie, se trouve la mort sur la croix, c’est-à-dire une exposition fixe du corps qui est aussi exposition de l’âme. Étonnamment, cette partie ne mentionne pas la figure du stylite, pourtant champion du monde de l’immobilité religieuse.
Cette 1re partie se clôt sur une évocation effrayante de « La production technologique » : « Dominatrice sans être souveraine, elle n’a pas de territoire déterminé, elle règne donc sur le monde sans viser la paix. Décrochée de toute visée d’immobilisation, elle mobilise et soutient toutes les guerres entre États ; elle les rend indéfiniment efficaces. Ainsi la production comme la destruction du monde ne peut plus être que technologique. Sans attendre de catastrophe finale, d’arrêt brutal du monde, cette production-destruction semble dépourvue de pauses, de stations, d’arrêts. Elle n’a ni maître ni texte, mais seulement une exigence impersonnelle d’activité, de travail, de mouvement » (p. 96). Avant de lire la suite, puis-je vous suggérer de faire un petit somme ?
2e partie : Un temps de repos.
Nous voyageons chez les philosophes. Paradoxe de Blaise Pascal : « D’un côté, « tout le malheur des hommes est de ne savoir pas se tenir en repos dans une chambre ». De l’autre, « notre nature est dans le mouvement ; le repos entier est la mort » (p. 100 ; la 1re citation est d’ailleurs interpolée, car l’édition Garnier donne « demeurer en repos » (p. 215)). Comme le chantait Moustaki dans sa chanson « La Philosophie » : « Nous avons toute la vie pour nous amuser / Nous avons toute la mort pour nous reposer » !
« Le Cimetière marin » de Paul Valéry est cité pour la fameuse strophe consacrée à
« Zénon ! Cruel Zénon ! Zénon d’Élée !
M’as-tu percé de cette flèche ailée
Qui vibre, vole, et qui ne vole pas !
Le son m’enfante et la flèche me tue !
Ah ! le soleil… Quelle ombre de tortue
Pour l’âme, Achille immobile à grands pas ! » (cité p. 103).
Retour à la religion, avec une allusion à la Terre promise : « Rien n’assure du repos éternel, sinon la foi dans une Terre promise ; celle-ci permet au moins de se tenir assis dans le cours agité du monde, en espérant se tenir debout ailleurs » (p. 120). La question du repos dominical inspire un chapitre. De l’Esprit des lois de Montesquieu est cité : « Tantôt détruit par les conquérants, tantôt gêné par les monarques, [le commerce] parcourt la terre, fuit d’où il est opprimé, se repose où on le laisse respirer » (p. 129). Le monde se divise « entre le monde où les hommes sont actifs et riches, et celui où ils sont immobiles et pauvres » ; « le monothéisme occidental, selon Weber, oblige les hommes à conquérir par leur action dans ce monde leur salut dans un autre monde. Il limite le temps du rite au bénéfice de l’agir social ; il convertit l’union mystique avec Dieu en une ascèse qui consiste à se confronter au monde de la manière la plus régulée et la plus méthodique possible » (p. 130). D’où la citation de Benjamin Franklin : « Souviens-toi que le temps, c’est de l’argent » (cité p. 131). Encore une conclusion pessimiste : « Le capitalisme est devenu sa propre religion : « La célébration d’un culte sans trêve et sans merci », écrit Walter Benjamin. Le dénuement propre au non-travail touche alors aussi bien le travail, ce culte sans culte qui fait payer à la conscience une dette infinie vis-à-vis d’un dieu manquant : l’argent lui-même. L’argent manque par définition pour qui travaille ; renoncer au repos est donc inévitable mais insuffisant ; le dimanche disparaît, il n’y a plus de jours pour se trouver serré dans les bras de qui que ce soit » (p. 135). Sur la machine, voici deux extraits qui résonnent fort, pour moi, avec Les Temps modernes, de Charles Chaplin : « Ainsi la force motrice de l’animal, limitée par son besoin de repos, est remplacée par un fluide homogène, la vapeur. L’homme change alors de position : il n’est plus le seul être capable d’accomplir le mouvement naturel et de le dépasser ; il devient un accessoire de la machine » (p. 143). « Ainsi le sens du repos est inversé. L’homme ne se sent libre que dégagé de son travail, libre comme un animal quand il peut manger, boire, procréer, dormir. Le capitalisme lutte alors contre les dimensions les plus propres à l’homme : la vie familiale, l’éducation des enfants, les jours de repos et de fête. Il entame même le temps nécessaire à la reproduction de la force de travail, celui des repas et du sommeil. Et ce peu de temps qu’il laisse, il le hante : l’ouvrier vit dans une « maison hantée par une puissance étrangère », celle du propriétaire de son logement. Comment dormir quand on sait que son travail ne paye plus son loyer ? […] Le capitalisme qui hante le sommeil de l’ouvrier n’est pas qu’un mode de production, il est ce qui rend le repos impossible et spectral » (p. 146). Marx et Lénine s’opposent : « Marx le reproche à l’utopie fouriériste selon laquelle les hommes dorment mieux en dormant peu et trouvent leur bonheur dans un travail communautaire intensif, agrémenté de quelques fêtes nocturnes. Le communisme historique a pris le même chemin, en ajoutant au temps de travail un temps de mobilisation politique bientôt transformée en mobilisation productive : en 1920, Lénine invente les « samedis communistes », suivis des « dimanches communistes », des jours de travail gratuit pour l’édification du socialisme, que Lénine passait officiellement à transporter des poutres sur le chantier du Kremlin. Mais pour Marx, la vraie liberté commence toujours là où le travail finit » (p. 150). Cela débat dans les cercles communistes, et l’auteur de citer une critique d’Ernst Bloch par Hans Jonas : « Le risque est alors que chaque hobby se transforme en métier, auquel s’ajoute un plaisir subjectif. Alors il redevient travail ; l’utopie perd son rêve, la liberté redevient contrainte, le loisir devient aussi prenant et aliénant que l’activité productive » (p. 151).
Autre sujet, et passionnant : l’évolution des espèces : « Ainsi toutes les espèces sont autant de stations : en chacune d’elles l’élan vital s’est inséré dans la matière et s’est organisé en s’arrêtant dans son empreinte. Il en va de même des organes : la vue, acte simple, s’est matérialisée en une organisation complexe, celle de l’œil. Chaque organisme est ainsi un succès de la vie sur la matière, mais un succès contraint, qui peut piétiner, régresser comme faire un bond en avant par un brusque changement de forme. L’évolution tout entière est une divergence de voies et de vitesses, déposant en chemin des êtres qui s’endorment tandis que d’autres se réveillent, tous luttant à leur manière avec une matière qui ne cesse de se dégrader, de rejoindre l’entropie ou la répétition d’ébranlements élémentaires.
Les plantes vivent en prenant la voie la plus courte, celle de la torpeur. Elles s’organisent sur place, transforment l’eau et les minéraux en matière organique, captent la lumière du soleil, accumulent de l’énergie en fixant le carbone et l’azote. Chacune s’entoure ainsi « d’une membrane de cellulose qui la condamne à l’immobilité » tout en continuant à croître. Mouvement et conscience sommeillent donc dans les plantes « comme des souvenirs qui peuvent se réveiller » [citation de H. Bergson, L’Évolution créatrice]. L’animal est ce réveil : il accumule l’énergie fournie par les végétaux et la dépense d’une manière explosive. Sa vie est un mouvement libre, brusquement déclenché par son organisation devenue système sensori-moteur » (p. 156-7). Ces réflexions me rappellent celles de Jean-Claude Ameisen dans Le Corps, le sens, à propos de la mort cellulaire, mais aussi le poème de Francis Ponge « Faune et Flore » extrait de Le Parti pris des choses (1942) :
« La faune bouge, tandis que la flore se déplie à l’œil.
Toute une sorte d’êtres animés est directement assumée par le sol.
Ils ont au monde leur place assurée, ainsi qu’à l’ancienneté leur décoration.
Différents en ceci de leurs frères vagabonds, ils ne sont pas surajoutés au monde, importuns au sol. Ils n’errent pas à la recherche d’un endroit pour leur mort, si la terre comme des autres absorbe soigneusement leurs restes », etc.
3e partie : L’immobilité contrainte, ou de la peine.
Cette partie me semble sortir à la fois de notre thème (« À toute vitesse ! ») et du titre du livre, car il y est surtout question d’emprisonnement. On part de la notion développée par Mircea Eliade, de « dieu lieur » : « Ce nouage est ambivalent : il est engin de capture (les maladies, la mort même sont des liens) ou force de liaison entre les êtres ; il maintient la justice et l’ordre du monde ou les contredit. Le dénouage a donc la même ambivalence. Et c’est ainsi que les dieux et les hommes se lient ou se délient, demandent à être déliés ou reliés, libérés ou resserrés » (p. 178). Le mythe de Prométhée est bien sûr développé. Différentes peines sont évoquées avec des précisions utiles à notre culture générale : « Traduite souvent à tort par « crucifixion », la suspension consiste à être enchaîné dehors et s’avère, une fois correctement nommée, l’une des peines les plus courantes de l’Antiquité ; celle aussi dont « la variation est le seul terme fixe ». Le supplicié peut être maintenu par des chaînes, d’autres liens ou des clous à une variété tout aussi indéfinie de supports : mur extérieur, planche, statue, pilori, croix. Il peut être simplement immobilisé ou l’être de telle sorte que sa position soit plus douloureuse. Une fois lié, il se trouve exposé à la vue de tous (c’est en soi une peine, l’infamie), mais aussi aux agressions du froid, du soleil, du feu, des animaux sauvages (l’aigle de Prométhée). Il peut être détaché encore vivant, mourir suspendu ou être suspendu une fois mort » (p. 190). On songe évidemment à la Ballade des pendus de Villon et au Gibet de Montfaucon. C’est en effet une immobilité radicale qui met fin à une existence des plus mobiles ! L’auteur se penche plusieurs chapitres durant sur la situation des détenus, qui émeut peu les foules. Voyez mon article « Canicule, prisonniers, clandestins et usagers ». Un des premiers films d’Alfred Hitchcock, connu sous le titre anglais de The Lodger ou français Les Cheveux d’or (1926) propose, y compris dans son affiche, une illustration de cette « suspension » sous l’avatar très hitchcockien d’un faux coupable poursuivi par une foule lyncheuse, qui franchissant une grille, se trouve suspendu par ses menottes à ladite grille, proie facile pour la foule, avant d’être sauvé in extremis parce que le vrai coupable a été trouvé dans l’intervalle. La façon dont il est dépendu constitue une « descente de croix » fort originale.

Sans transition, on passe au dressage animal. « À l’immobilité imposée au cheval répond celle du cavalier. Leur double posture, variable historiquement, est détaillée dans les traités de dressage. Le passage de l’allure à l’arrêt doit se faire sans transition visible ; aux trois allures, le cavalier doit sembler immobile, comme s’il guidait sans guider. Selon Pluvinel, dresseur et formateur de Louis XIII, il faut faire agir le cheval « de bonne grâce » et surtout « dresser l’homme en premier ». Son traité s’adresse donc au roi pour le dresser : plus souverain que lui, Pluvinel le fige dans une posture « dont je veux qu’il ne change jamais, pour quelle que chose (sic) que fasse son cheval ». Cette position est immortalisée dans les statues équestres qui ornent les places royales et figurent l’immobilisation souveraine.
Le dressage de l’animal implique l’immobilité de l’homme ; d’où un transfert inévitable du mouvement de l’homme à l’animal qui travaille à sa place. Rousseau le dit : en dressant les animaux comme en fabriquant des outils, l’homme renonce à ses propres forces, nie sa capacité de mouvement et sa liberté. Les normes du dressage se nouent de cette manière à la nécessité technique, et c’est ainsi que l’homme s’aliène en aliénant sa relation avec l’animal avant que les machines ne remplacent outils et animaux : dès lors la loi de la technique règne, imposant son accélération – et son immobilisation » (p. 223).
En ce qui concerne l’école, l’auteur rappelle d’une part la traditionnelle dénonciation de l’immobilité carcérale imposée aux enfants, synthétisée en 1997 par l’artiste italien Maurizio Cattelan avec son « Charlie don’t surf » (p. 227) : un élève crucifié à une table par des stylos plantés dans les mains ; d’autre part la dénonciation tout autant traditionnelle de cette situation et les tentatives pour y remédier, que ce soit Montaigne, Rousseau ou Freinet. Rabelais est oublié, mais je me permettrais de rappeler que la folle journée de la royale éducation procurée à Gargantua par Ponocratès au chapitre XXIII du livre éponyme contient quand même entre ébats champêtres, deux cours de trois heures ou plus le cul sur une chaise : « Ensuite, pendant trois bonnes heures, la lecture lui était faite » […] « puis se remettait à son principal objet d’étude pour trois heures ou davantage, tant pour répéter la lecture du matin que pour poursuivre le livre entrepris »… Les propos convenus de ces pages m’agacent un peu ; je cite : « Mais si l’immobilité à l’école reprend le dessus, c’est par le biais d’une nécessité extérieure qui n’est pas naturelle, mais bien plutôt économique et technique. Il faut tout simplement faire avec l’obligation matérielle de réunir un grand nombre d’enfants dans la même salle et devant le même maître » (p. 230). Voilà donc cette éternelle tarte à la crème de l’enfant victime (ce XXIe siècle sera-t-il définitivement le siècle de la sacralisation des victimes ?) de l’immobilisation imposée par des profs criminels ? L’auteur a-t-il déjà oublié ses propos de la p. 79 ? (« Le disciple se tient devant le maître qui parle et cela s’apprend »). On sera tellement bousculé par la vie : ne pourrait-on pas profiter de cette période où l’on vous apporte la connaissance à la cuiller ? La jeunesse d’aujourd’hui a-t-elle plutôt besoin de calme, ou d’agitation ? Quand je vois les fous furieux qu’on reçoit dans certaines sections de BTS, qui ont eu leur bac et qui ont échoué là surtout pour toucher une bourse, je me demande s’il est vraiment utile de ressortir cette tarte à la crème de l’école-prison. Et puis oui, la démocratie, ce n’est pas l’aristocratie : chaque être humain n’a pas un Ponocratès ou un Mentor pour lui torcher le cul, boudiou ! Après les prisons et les écoles, voici la psychiatrie et ses camisoles de force. On pense aux films étasuniens des années 60, comme La Cage aux femmes de Hall Bartlett (1963), Shock Corridor de Samuel Fuller ou Un enfant attend de John Cassavetes, trois films sortis en 1963.
4e partie : Pour une résistance statique.
Jérôme Lèbre évoque d’abord quelques œuvres de Jean Tinguely, dont Le Cyclope de la forêt de Milly : « L’œuvre et l’archive résistent au temps qui finalement les emporte. Tinguely parodie le goût futuriste pour la destruction en élaborant une machine qui se dirige contre elle-même, se martelant jusqu’à disperser ses pièces, et dont il ne reste qu’un film ; mais surtout, il laisse faire le temps » (p. 258). Il évoque des embouteillages cinématographiques : « La comédie musicale La La Land commence par un travelling sur un embouteillage avant que tout le monde ne sorte de voiture pour danser. La version tragique précédait : c’était le Grand embouteillage de Comencini. Dans la circulation romaine bloquée, se manifestent les inégalités sociales, la violence hiérarchique, celle qui couve dans le couple ou la famille, la prostitution, le viol, la lâcheté. Un hélicoptère représente le contrôle de l’État et survole l’embouteillage en cercles inutiles. La vitesse technique, une fois figée, révèle la vitesse à laquelle la technique détruit toute l’éthique » (p. 262). Et du coq-à-l’âne, nous voici dans les camps de migrants : « Les migrations ne sont pas seulement des flux que les États tentent d’arrêter en construisant des murs ; ce sont des mouvements de sédentaires visant un autre lieu et arrêtés, en deçà ou au-delà des murs, dans des camps. Ces derniers sont l’inverse des camps d’extermination : ils sont des lieux de survie que les États tolèrent et des formes de vie qu’ils cherchent à démanteler, ne sachant que faire de cette vie stationnaire qui ne cesse de se reformer » (p. 266). Le constat est pessimiste : « Alors, comme dans une file d’attente pour prendre un avion ou décrocher un emploi, nous sommes face à cette question : « Que faire ? » Et la réponse semble être qu’on ne peut rien faire, qu’on est même dépossédé de toute capacité de faire. Cela signifie que la catastrophe est déjà arrivée. Nous sommes déjà dans un monde défini par la simultanéité et non par l’avenir » (p. 268). « Cette mélancolie s’achève dans le nihilisme passif que détecte Anders en relisant Beckett : laissés sur place par leurs techniques, les hommes sont encore en vie sans être au monde ; « la vie n’avance plus », il n’y a rien à attendre, vivre consiste à rester pour ne rien attendre ; les personnages d’En attendant Godot sont ainsi paralysés au point d’être « incapables de pouvoir renoncer au concept de sens » et ce n’est qu’ainsi qu’ils gardent le sens » (p. 270).
La sensation de perdre son temps est vieille comme le monde, et Juvénal se plaignait déjà dans ses satires : « quand je me hâte, une foule grossière / M’arrête par devant, me presse par derrière » (cité p. 274). Extrait à utiliser en cours.
L’abstraction philosophique nous amène jusqu’à une réflexion sur la notion de caractère : « Les liaisons les plus anciennes et les plus solides, celles qui se sont formées pour composer avec les interdits parentaux, constituent le caractère du moi, c’est-à-dire le maintien de son énergie statique dans une manière organisée de composer avec le réel, de s’insérer en lui en se contraignant soi-même. Ce « caractère » est bien un ethos, qui seul permet de « satisfaire aux urgences de l’action ». Il n’y aurait pas de liberté, pas même de plaisir ou de vie possible, sans cette armure ou cette armature » […] Ne pas céder sur son désir, c’est en faire sa loi, mais sans s’y soumettre ; c’est tenir en lui comme Ulysse est tenu à son mât, ou comme on tient face à la loi » (p. 284).
On retrouve Marx : « Mais Marx reprochait aux socialistes de s’en tenir à cette vision incohérente de la grève. La vraie contradiction, c’est bien plutôt que la production se retourne contre le travail, que les progrès techniques fassent baisser sa valeur, que les grèves mêmes soient l’occasion d’installer de nouvelles machines » (p. 303). Une note renvoie au chapitre XV « MACHINISME ET GRANDE INDUSTRIE » de la section IV du livre I du Capital : « Il reste encore à savoir », dit John Stuart Mill, dans ses Principes d’économie politique, « si les inventions mécaniques faites jusqu’à ce jour ont allégé le labeur quotidien d’un être humain quelconque. » Ce n’était pas là leur but. Comme tout autre développement de la force productive du travail, l’emploi capitaliste des machines ne tend qu’à diminuer le prix des marchandises, à raccourcir la partie de la journée où l’ouvrier travaille pour lui-même, afin d’allonger l’autre où il ne travaille que pour le capitaliste. »
Une affirmation sur la sculpture m’étonne : « L’œuvre en se figeant maintient la vie au-delà d’elle-même. Les yeux fermés de Bouddha figurent la sérénité parfaite du vivant qui pense la mort à jamais et celle-ci n’a pas plus de prise sur les yeux fermés des masques mortuaires. Même la raideur des gisants implique que les plis des drapés restent horizontaux : les figures sont sculptées debout avant d’être couchées, elles restent debout couchées » (p. 331). Cette affirmation est confirmée par l’article gisant de Wikipédia, et il n’est qu’à regarder le gisant de Clément VI dans l’abbatiale de la Chaise-Dieu ou celui de Richard Cœur de Lion à Rouen pour s’en persuader.

« L’Homme qui marche I de Giacometti n’avance pas plus, ni Les Ramoneurs en marche de Charles Nègre, cet instantané d’avant l’instantané où les figures semblent avancer mais posent ; ni Les chaussures délacées peintes par Van Gogh [2], ni la marche musicale dans la Parade de Darius Milhaud [3]. Toutes ces œuvres sont comme les aiguilles de la montre de Lewis Carroll, qui donnent l’heure exacte deux fois par jour précisément parce qu’elles sont arrêtées » (p. 334). L’auteur n’évoque pas la photo de couverture de son livre, « Instantané pris à bord du paquebot La Gascogne » de Franck Lackama, que l’on retrouvera dans cet article. On pourrait aussi évoquer la fameuse Gradiva chère à Sigmund Freud.
5e partie : L’écriture, la ville.
C’est une brève partie qui présente quelques belles pages : « Écrire contraint à l’immobilité les enfants comme des adultes ; cette contrainte se continue dans la lecture. L’informatique a semble-t-il donné aux textes une mobilité interne (couper, coller, déplacer) et externe (la transmission par internet), les ordinateurs portables et les smartphones se substituent aux machines de bureau. Mais il en découle une extension à l’infini de la loi du texte : même le son et l’image sont lus et il n’y a plus de différence à faire entre le travailleur fixé à sa machine et celui qui écrit ou lit, y compris dans les transports et dans la rue. Répondre à ses sms en conduisant ou même en marchant est un défi inutile et dangereux ; heureusement que les véhicules s’arrêtent (ou bientôt se conduisent tout seuls) ou que la marche se continue dans un bus ou un métro : c’est alors que nous retrouvons vraiment notre monde qui est textuel comme jamais » (p. 341). Je relève une information intéressante, à propos de Paul Celan : « Le 11 novembre 1963, le poète est à Paris où il vit et l’on commémore ce moment très ambigu de la relation franco-allemande que l’on nomme l’armistice : littéralement l’arrêt ou la station dans l’usage des armes, qui n’est pas vraiment une paix, qui dans ce cas précis a bien plutôt été un facteur important de la montée du nazisme » (p. 346). Relevons encore deux citations contradictoires de Charles Baudelaire : « Je suis belle, ô mortels, comme un rêve de pierre […] Je hais le mouvement qui déplace les lignes » (« La beauté ») et « À une passante » : « Agile et noble, avec sa jambe de statue. » (cité p. 368).
Au lieu d’une conclusion, un dernier chapitre bref est consacré aux « Stations et places », et il y est question du film Gare du Nord de Claire Simon, mais aussi de l’architecte Paul Andreu qui aurait conçu « l’extension de la gare du Nord », ce qui me semble erroné, car il a plutôt conçu la gare d’interconnexion RER / TGV à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Voir en ligne : Le site de Jérôme Lèbre
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Anecdote : comme je lisais ce paragraphe à une classe de BTS 1re année, j’ai demandé si le mot « l’essieu » était connu. Une étudiante lève la main : « C’est le pluriel du ciel ». Aucun autre étudiant présent ne connaissait le mot.
[2] L’auteur fait référence à un texte qu’il a publié en 2008 : « Délacement. La déconstruction, analyse frivole ou inventive ? », mais au-delà, aux analyses de Jacques Derrida sur une série de tableaux de Van Gogh, notamment Les Vieux Souliers.
 altersexualite.com
altersexualite.com