Accueil > Culture générale et expression en BTS > À toute vitesse ! > Accélération. Une critique sociale du temps, de Hartmut Rosa
Étude sociologique des effets de l’accélération, pour étudiants et adultes
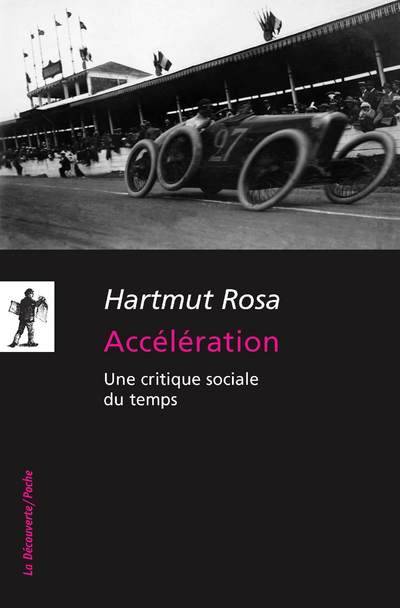 Accélération. Une critique sociale du temps, de Hartmut Rosa
Accélération. Une critique sociale du temps, de Hartmut Rosa
La Découverte, 2010 (2005), 480 p., 29,5 €
samedi 28 décembre 2019, par
Accélération. Une critique sociale du temps de Hartmut Rosa (né en 1965) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « À toute vitesse ! », avec Aliénation et accélération (2012) du même auteur. Je l’ai choisi sur cette liste au hasard, pour ma culture générale et celle de mes étudiants. Ce pavé est bâti très sérieusement, en 13 chapitres avec avant-propos, intro, conclusion, bibliographie, notes, etc. C’est un excellent livre qui m’a beaucoup apporté, et m’a réconcilié avec ce nouveau thème que jusque-là je trouvais trop limité. En étudiant aussi l’accélération du rythme de vie, on aborde des sujets passionnants. Je crois qu’il s’agit en fait de la thèse d’habilitation de l’auteur, puisqu’elle fut publiée dans sa langue en 2005, alors qu’il avait 40 ans. Comme d’habitude, cet article sera principalement constitué de citations d’extraits utilisables en classe ; j’ai même repris intégralement un tableau sur les changements de la modernité qui me semble fort pédagogique.
Avant-propos & intro (chapitre 1)
Deux ou trois paraboles entament le propos, pour démontrer le paradoxe de l’époque moderne : « « Le rythme de la vie s’est accéléré » et, avec lui, le stress, la frénésie et l’urgence, cette plainte résonne partout – quoique nous puissions enregistrer […] dans presque tous les domaines de la vie sociale, grâce à la technique, d’immenses gains de temps du fait de l’accélération. Nous n’avons pas le temps, alors même que nous en gagnons toujours plus. Le but du présent livre est d’expliquer ce gigantesque paradoxe du monde moderne et de traquer sa logique secrète » (p. 7). Nos contemporains sont confrontés à « trois types différents d’accélération. En premier lieu, ils ont affaire à l’accélération technique qui […] devrait avoir pour conséquence de ralentir le rythme de la vie. Mais l’accélération du rythme de vie représente, compte tenu de l’accélération technique, une forme sociale d’accélération paradoxale qui […] est peut-être en relation avec une troisième manifestation de l’accélération sociale, indépendante du point de vue analytique : celle de l’accélération de la vitesse des transformations sociales et culturelles » (p.12). L’introduction rappelle quelques principes de la sociologie, comme la possibilité « d’analyser les transformations sociales soit d’un point de vue macrosociologique comme des transformations de structures sociales ou systémiques « objectives », soit microsociologiquement, du point de vue du sujet, comme une transformation de ses logiques d’action ou du rapport qu’il entretient avec lui-même » (p. 17).
On distingue 4 types de conscience du temps dans les sociétés : « temps cyclique où ce dernier est éprouvé comme un cycle de processus et d’états récurrents. La forme primaire de l’expérience du temps distingue ainsi un avant et un après, mais passé et avenir y sont structurellement identiques […] » « dans la société plus différenciée des temps modernes, s’impose progressivement une conscience du temps linéaire qui remplace le cercle du temps par une ligne irréversible venant du passé et se dirigeant, en passant par le présent, vers l’avenir. Ce n’est qu’alors que l’expérience d’un temps divisé entre passé, présent et futur, devient dominante ». Dans la « modernité avancée », « la conception prédominante est celle d’un temps linéaire à l’avenir ouvert » dont l’« issue demeure incertaine » (p. 18-19 ; c’est moi qui souligne en gras).
« Plus le degré de routine et d’habitude diminue dans la modernité tardive, plus le temps devient alors un problème » (p. 21).
« Mon hypothèse directrice est ici que l’accélération sociale présente de manière constitutive dans la modernité franchit, dans la « modernité tardive », un point critique au-delà duquel il est impossible de maintenir l’ambition de préserver la synchronisation et l’intégration sociales » (p. 35).
« De la même manière, par exemple, que l’accélération de la projection d’une série d’images peut subitement, au-delà d’une certaine vitesse, les « faire vivre », puisqu’elle transforme des clichés séparés en « images animées », donc en un film, ou de même que le mouvement accéléré de molécules, à des seuils critiques, modifie l’état de la matière (solide, liquide, gazeux), l’accélération des processus sociaux engendre parfois une transmutation de ces processus eux-mêmes » (p. 40).
Partie I. Chapitre 2 « De l’amour du mouvement à la loi de l’accélération : regards sur la modernité
Dans cette partie I composée de deux chapitres : « les fondements conceptuels d’une théorie de l’accélération sociale », l’auteur inventorie d’abord avec précision dans le chapitre II les recherches de ses prédécesseurs. En musique, l’accélération semble avoir toujours été la règle : « le début d’une sonate pour piano de Schumann porte l’indication surprenante de tempo « aussi vite que possible », immédiatement suivie d’une autre : « encore plus vite » », puis l’auteur mentionne le Boléro de Ravel « où les changements de l’instrumentation visent à donner l’illusion d’une accélération », puis le jazz : « Le mot « jazz » semble provenir d’une expression argotique désignant la « vitesse ». Quand aux musiques pop, elles sont de plus en plus rapides « jusqu’à atteindre un seuil critique » (p. 57). Les accélérations diverses se heurtent systématiquement à des « mises en garde [qui] allaient de la « déformation faciale du cycliste », due à l’exposition du visage à une trop forte résistance du vent, à la décomposition du cerveau ou à des troubles digestifs dus à la vitesse des voyages en train, plus tard en automobile, jusqu’aux visions apocalyptiques d’une disparition définitive de la culture due à la consommation massive de télévision » (p. 60). Au contraire, « Des mouvements comme le futurisme, en particulier dans les écrits de Marinetti […] qui célèbrent l’ivresse et le triomphe de la vitesse, une vérité (désormais) « éternelle et omniprésente », et y voient une esthétique, voire une religion et une morale nouvelles, restent plutôt l’exception ». Les « partisans de la décélération » eurent des succès limités ; l’auteur mentionne cependant « la mode en 1840, observée par W. Benjamin dans Le Flâneur, qui consistait à promener des tortues dans les passages parisiens » (pp. 60-61). Cette anecdote rappelle le chapitre IV de À rebours de Joris-Karl Huysmans, dans lequel Des Esseintes, qui est un exemple frappant de « partisan de la décélération », installe une tortue dans son salon, dont il fait incruster la carapace de pierres précieuses. À lier bien sûr à la fable de La Fontaine.
Quant à Paul Virilio, s’il lui rend hommage, Hartmut Rosa lui taille une veste tant sur le style que sur la forme : « Cependant, ses travaux ne peuvent pas constituer le fondement d’une théorie de l’accélération, d’abord parce que P. Virilio refuse par principe d’élaborer une théorie systématique à laquelle il préfère une présentation rhapsodique fonctionnant par associations, enrichie d’innombrables néologismes, d’analogies obscures et d’allusions quasi ésotériques ». […] « il ne saisit l’accélération que sous un angle technologique, et […] il ne laisse aucune place aux deux autres formes de l’accélération, analytiquement indépendantes, de la transformation sociale et du rythme de vie » (p. 78).
Chapitre 3 : « Qu ’est-ce que l’accélération sociale ? »
L’auteur distingue d’abord deux types d’accélération : « les formes d’une accélération intentionnelle et visant un but comme l’accélération « technique » » et « une augmentation des rythmes de transformation sociale, comme par exemple l’accélération des changements de métier, de parti politique ou de conjoint, ou encore de la transformation des structures familiales et professionnelles, des styles artistiques […] qui ne poursuivent pas en elles-mêmes un but défini » (p. 86). Puis il ajoute un troisième type : « la tentative d’économiser du temps grâce au fast food, au speed dating et à la « sieste éclair », ou encore au multitasking, en essayant d’abréger, ou de concentrer des séquences d’action, représente une réaction à la réduction des ressources temporelles ». Il remarque que « Le manque de temps, au regard des multiples accélérations technologiques, est en soi un paradoxe qui exige une explication. […] l’augmentation du rythme de vie par l’augmentation du nombre d’épisodes d’action et/ou de vécu par unité de temps — augmentation liée à la réduction des ressources temporelles et du sentiment d’« urgence » qui en résulte – représente une troisième forme autonome de l’accélération sociale dans les sociétés modernes » (p. 87). Le paradoxe est explicité : « Même la capacité de fabriquer plus vite une quantité déterminée de marchandises est en soi indépendante d’un accroissement de la production. Si la quantité de biens produits et transportés ainsi que d’informations communiquées reste stable, le rythme de vie, comme conséquence de l’accélération technologique, se réduit au lieu d’augmenter, puisque le temps nécessaire à l’accomplissement d’une tâche donnée diminue – il en résulte alors du « loisir », c’est-à-dire la libération de ressources temporelles auparavant non disponibles. […]
Quand on affirme ainsi que, dans la modernité, plus ou moins « tout » irait plus vite, et que les phénomènes subjectifs comme le stress, la frénésie ou le sentiment d’urgence sont attribués à l’accélération technique gigantesque qui concerne de nombreux processus, et qui semble constituer à première vue le plus puissant ressort de l’accélération sociale et culturelle, on est ici en présence d’une inférence erronée, aussi frappante que répandue. La dynamique et les contraintes temporelles de la vie sociale et psychique dans la société industrielle et postindustrielle ne peuvent être déduites des progrès de l’accélération technique, et constituent même face à ces derniers une contradiction logique. L’augmentation du « rythme de vie », la pénurie de temps de la modernité ne naissent pas à cause de, mais en dépit des énormes gains de temps réalisés par l’accélération dans presque tous les domaines de la vie sociale » (p. 90). De ce paradoxe l’auteur tire son « hypothèse centrale » […] : dans la société moderne, comme « société de l’accélération », se produit une combinaison (aux nombreux présupposés structurels et culturels) des deux formes d’accélération – accélération technique et augmentation du rythme de vie par la réduction des ressources temporelles – et donc une combinaison de croissance et d’accélération » (p. 91). S’appuyant sur diverses études sur les tâches ménagères, l’auteur montre que l’apparition d’outils ménagers (lave-linge, aspirateur, four micro-ondes) a plutôt tendance à augmenter le temps passé au ménage ou à la préparation des repas car le temps libéré est converti à l’« amélioration de la qualité » « De la même manière, le temps consacré au ménage, face à une augmentation disproportionnée du volume des tâches en regard de l’accélération technologique peut néanmoins rester stable, par exemple si l’on passe l’aspirateur en même temps que l’on cuisine, alors qu’auparavant ces tâches étaient exécutées successivement. Dans ces cas, les taux de croissance dépassent les taux d’accélération et, par conséquent, le rythme de vie augmente puisque des « microressources » temporelles autrefois disponibles dans la durée consacrée à un type d’activité sont maintenant utilisées » (pp. 92-93).
« L’augmentation de la vitesse de transport est à l’origine de l’expérience, universellement répandue dans la modernité, de la « compression de l’espace ». L’expérience que le sujet fait de l’espace est dans une très grande mesure fonction de la durée nécessaire pour le traverser. C’est ce que montrent, par exemple, certaines manières contemporaines d’exprimer les distances (Quelle distance y a-t-il entre Berlin et Paris ? » – « Dix heures de route ou une heure d’avion ») S’il fallait encore au XVIIIe siècle plusieurs semaines pour aller d’Europe en Amérique, six heures d’avion suffisent aujourd’hui. C’est pourquoi le monde, depuis le début de la révolution industrielle, semble s’être réduit jusqu’à environ un soixantième de sa taille originelle. Les innovations ayant produit une accélération, en particulier dans les transports, sont principalement à l’origine de ce que l’on peut appeler […] l’anéantissement de l’espace par le temps » (p. 95).
« il s’est écoulé trente-huit ans entre l’invention du poste de radio à la fin du XIXe siècle et sa diffusion à cinquante millions d’appareils ; pour la télévision, introduite un bon quart de siècle plus tard, il n’a fallu que treize ans pour arriver au même résultat, tandis que cela n’a pris que quatre ans pour passer de la première à la cinquante millionième connexion Internet » (p. 99).
« Ici, l’hypothèse formulée par H. Lübbe a une importance décisive : au sens de cette définition, les sociétés modernes sont de plus en plus soumises à une compression du présent, en raison d’une « vitesse de vieillissement » sociale et culturelle croissante, ou d’une « densification de l’innovation » socioculturelle croissante » (p. 100).
« On peut définir cette troisième forme d’accélération de deux manières, à l’aide d’une composante objective et/ou d’une composante subjective. Objectivement, l’accélération du rythme de vie représente un raccourcissement ou une densification des épisodes d’action. On entend par là, par exemple, la réduction de la durée consacrée aux repas ou au sommeil, ou du temps de communication moyen entre membres de la famille, mais aussi des tentatives pour abréger la durée totale d’activités telles qu’une sortie au cinéma, un repas de fête, un enterrement – en réduisant la durée entre la fin d’une activité et le début de la suivante. On y parvient d’une part par une « densification » des épisodes d’action, soit par une augmentation immédiate de la vitesse d’action (on mastique ou on prie plus vite) mais aussi en réduisant les pauses et les temps morts entre les différentes activités. L’augmentation du nombre d’épisodes d’action par unité de temps n’est pas seulement atteinte, comme nous l’avons vu, par l’accélération immédiate des actions mais aussi par le fait qu’elles se chevauchent, autrement dit par l’exécution simultanée de plusieurs activités (multitasking), ce qui peut entraîner de facto un ralentissement des activités individuelles, mais permet aussi de venir à bout plus rapidement des actions dans leur totalité » (p. 103).
Selon Hartmut Rosa, s’il existe des limites de vitesse dans différents domaines (temps de gestation, temps de guérison d’une maladie, temps de recyclage de déchets, temps de croissance végétal…) il faut rester prudent car l’activité de l’homme repousse sans cesse les limites : « comme par exemple de réduire le temps nécessaire à la ponte en raccourcissant l’alternance du jour et de la nuit à l’aide d’éclairages artificiels ». Il donne l’exemple du « train, dont la vitesse était inconcevable au XVIIIe siècle et considérée comme dangereuse pour la santé, et qui atteint aujourd’hui des vitesses bien plus élevées, passe désormais pour un moyen de transport lent et tranquille et, comparé aux voitures et aux avions, l’exemple même du mode de transport « slow time ». Il en est de même de certaines formes de jazz qui, au moment de leur apparition dans la première moitié du XXe siècle, furent ressenties comme haletantes, frénétiques, d’une vitesse époustouflante, machinales, assourdissantes et chaotiques – en cela le reflet fidèle de leur époque – et sont aujourd’hui recommandées comme musique de « relaxation » » (p. 107). Il évoque rapidement (!) les « oasis de décélération » que constituent certains groupes marginalisés, comme les communautés Amish de l’Ohio (cf. p. 109). Il évoque ensuite différents types de ralentissement, qu’ils soient structurels ou idéologiques.
Partie II. Chapitres 4 à 6 : Accélération technique et révolution du régime spatio-temporel.
Chapitre 4 : « l’accélération technique est elle-même une conséquence de préconditions culturelles, économiques et socio-culturelles, et le fait qu’elle influence massivement les formes de subjectivité et de socialité ne signifie pas qu’elle les détermine » (p. 125). La cartographie par exemple permet de « conceptualiser l’espace comme une dimension que l’on peut maîtriser et dépasser, puisqu’elle transforme le rapport de l’observateur à l’espace ». Je glisse ici une remarque sur la régression que l’on connaît à présent à Paris à cause de nos édiles : jusqu’à la décision absurde de remplacer les anciens abribus par les nouveaux qui sont si mal conçus, il y avait sur chaque abri un plan du réseau de bus de tout Paris. Maintenant ces imbéciles ont mis des plans du quartier, de sorte que l’on ne peut plus avoir une vue d’ensemble, et par exemple étudier deux stratégies différentes pour aller d’un point à un autre. Ils considèrent que les gens n’ont qu’à avoir des smartphones, donc à consommer de l’électricité pour obtenir une information. Revenons au livre. Le temps a été unifié au début du XXe siècle, notamment à cause des réseaux ferrés, qui exigeaient une standardisation du temps. La perception de l’espace est modifiée par la construction du réseau routier : « désormais, on ne le parcourt plus, on le franchit avec une efficacité maximale » (p. 128). Cela me rappelle au Japon, la 9e des cinquante-trois Stations du Tōkaidō de Hiroshige, Odawara-juku (illustration ci-dessus). Le Shogun avait interdit la construction d’un pont, exprès pour ralentir les seigneurs qui devaient se rendre à Edo. C’est un exemple de ce que Paul Virilio appelle dromocratie : l’utilisation de la vitesse, ici des déplacements, comme arme de pouvoir.
Il fournit une carte (p. 129) du « rétrécissement de l’espace à travers l’accélération du transport », inspirée des recherches de David Harvey.

« In fine, l’espace perd totalement sa fonction d’orientation là où des processus matériels de transport sont remplacés par la transmission électronique d’informations : sur Internet, l’heure de sauvegarde ou d’accès à des données est encore enregistrée, mais le lieu ne l’est pas ; il est devenu totalement indifférent pour la plupart des activités, alors que les données temporelles ne cessent de prendre de l’importance pour la coordination et la synchronisation de chaînes globales d’action. Un nombre croissant d’événements sociaux deviennent ainsi « sans lieu » à l’âge de la mondialisation » (p. 129).
Les objets eux-mêmes « deviennent à la fois contingents et éphémères ». On ne peut plus s’attacher aux choses : « la modernité se caractérise par le fait que l’usure physique est continuellement supplantée par l’usure morale (Marx) comme raison du remplacement matériel des objets et des agencements » (p. 135). Je me suis permis grâce aux notes, d’aller chercher le texte original du Capital de Marx, qui se trouve p. 944 du tome I des Œuvres de Karl Marx en Pléiade (traduction Joseph Roy revue par M. Rubel) : « La machine est en outre sujette à ce qu’on pourrait appeler son usure morale. Elle perd de sa valeur d’échange à mesure que des machines de la même construction sont reproduites à meilleur marché, ou à mesure que des machines perfectionnées viennent lui faire concurrence. Dans les deux cas, si jeune et si vivace qu’elle puisse être, sa valeur n’est plus déterminée par le temps de travail réalisé en elle, mais par celui qu’exige sa reproduction ou la reproduction des machines perfectionnées. Elle se trouve en conséquence plus ou moins dépréciée. Le danger de son usure morale est d’autant moindre que la période où sa valeur totale se reproduit est plus courte, et cette période est d’autant plus courte que la journée de travail est plus longue. Dès la première introduction d’une machine dans une branche de production quelconque, on voit se succéder coup sur coup des méthodes nouvelles pour la reproduire à meilleur marché, puis viennent des améliorations qui n’atteignent pas seulement des parties ou des appareils isolés, mais sa construction entière. Aussi bien est-ce là le motif qui fait de sa première période de vie, la période aiguë de la prolongation du travail ». J’y ajoute un second extrait, p. 948-949 : « La machine entre les mains du capital crée donc des motifs nouveaux et puissants pour prolonger sans mesure la journée de travail ; elle transforme le mode de travail et le caractère social du travailleur collectif, de manière à briser tout obstacle qui s’oppose à cette tendance ; enfin, en enrôlant sous le capital des couches de la classe ouvrière jusqu’alors inaccessibles, et en mettant en disponibilité les ouvriers déplacés par la machine, elle produit une population ouvrière surabondante qui est forcée de se laisser dicter la loi. De là ce phénomène merveilleux dans l’histoire de l’industrie moderne, que la machine renverse toutes les limites morales et naturelles de la journée de travail. De là ce paradoxe économique, que le moyen le plus puissant de raccourcir le temps de travail devient par un revirement étrange le moyen le plus infaillible de transformer la vie entière du travailleur et de sa famille en temps disponible pour la mise en valeur du capital. « Si chaque outil, tel était le rêve d’Aristote, le plus grand penseur de l’antiquité, si chaque outil pouvait exécuter sur sommation, ou bien de lui-même, sa fonction propre, comme les chefs-d’œuvre de Dédale se mouvaient d’eux-mêmes, ou comme les trépieds de Vulcain se mettaient spontanément à leur travail sacré, si, par exemple, les navettes des tisserands tissaient d’elles-mêmes, le chef d’atelier n’aurait plus besoin d’aides, ni le maître d’esclaves. » Et Antipatros, un poète grec du temps de Cicéron, saluait l’invention du moulin à eau pour la mouture des grains, cette forme élémentaire de tout machinisme productif, comme l’aurore de l’émancipation des femmes esclaves et le retour de l’âge d’or ! Ah ces païens ! ». Une note de bas de page nous donne la citation d’Antipatros : « Épargnez le bras qui fait tourner la meule, ô meunières, et dormez paisiblement ! Que le coq vous avertisse en vain qu’il l’ait jour ! Dao a imposé aux nymphes le travail des filles et les voilà qui sautillent allégrement sur la roue et voilà que l’essieu ébranlé roule avec ses rais, faisant tourner le poids de la pierre roulante. Vivons de la vie de nos pères et oisifs, réjouissons-nous des dons que la déesse accorde. » De citation en citation, j’ai tenté de trouver des informations sur cet « Antipater », ancêtre méconnu des apologistes de la paresse. Je n’ai trouvé que cet article sur le cite de la « Fédération des moulins de France » !
Chapitre 5 : « Des pentes qui s’éboulent »
L’accélération du rythme de vie nous fait vivre des vies de plus en plus instables. Nous n’avons plus un métier pour la vie, mais « Dans la modernité tardive, en revanche, les professions et les emplois semblent de moins en moins durer le temps d’une carrière professionnelle […] : de multiples changements de métier ou d’emploi au cours d’une vie (souvent accompagnés de périodes de chômage plus ou moins longues), qui étaient autrefois l’exception, tendent à devenir la règle » (p. 142).
Voici un excellent paragraphe qui pourrait servir à un corpus : « Le statut des personnes âgées dans la société se trouve transformé. L’institution, dans les sociétés traditionnelles, des « vieux sages », auxquels revient un statut privilégié puisqu’ils ont « tout vu » et tout connu, et qu’ils ne risquent donc pas d’être surpris par les vicissitudes de l’existence, a pratiquement disparu dans les sociétés de la modernité tardive : les personnes âgées se voient plutôt reprocher de ne plus s’y retrouver et de ne plus suivre le mouvement. La perte de l’ouverture au monde et la perte de la flexibilité qui menacent les sujets vieillissants deviennent un handicap stigmatisant : dans certains secteurs professionnels, on répugne déjà à engager des quadragénaires parce qu’on les considère comme insuffisamment flexibles et audacieux, en conséquence, les carrières professionnelles à leur tour doivent être accélérées, puisqu’elles doivent être accomplies pour l’essentiel entre vingt-cinq et quarante-cinq ans. Le « jeunisme » de la société moderne, parfois raillé par certains critiques de la culture contemporaine, trouve ici son origine dans l’accélération. L’image idéale des gens âgés n’est plus celle du « vieux sage », mais de celui ou de celle qui, encore souple et ouvert au changement, « ne vieillit pas vraiment », et qui ne répugne pas à assimiler activement les nouveautés. La condamnation à rester jeune, si ce n’est à une « éternelle puberté », n’est pas une « lubie culturelle » de la société de la modernité tardive, elle est profondément inscrite dans ses structures temporelles » (p. 147). Comme exemple, pour sortir de cette recension, on pourrait évoquer le fait que les médias et politiciens du monde entier ont décidé en 2019 de mettre en vedette, sur le thème de l’écologie, une ado, Greta Thunberg, alors que des milliers d’adultes qui y ont consacré leur vie sont bien plus capables d’argumenter pour l’écologie, et alors que les jeunes sont loin d’être les plus écolos de nos concitoyens. L’époque où le discours écolo était porté par des ancêtres (Tazieff, Cousteau, Dumont) est bien révolue. Désormais il faut avant tout que cela rapporte de l’argent à Facebook et Cie, donc il faut des djeunes, et surtout qu’ils n’aient rien à dire de précis ; et par dessus tout, rien de rien contre la publicité par panneaux lumineux électriques, un truc énergivore qu’on pourrait éradiquer du jour au lendemain, mais chut ! Lisez l’entrevue de Michel Onfray sur cette imposture.
L’auteur en tire la métaphore, voire l’allégorie des « pentes qui s’éboulent » et du « tremblement de terre » : celui qui ne bouge pas en permanence est condamné à « sombrer dans l’anachronisme ». « Les conditions de l’action et de la sélection se transforment constamment et de manière multidimensionnelle, ce qui exclut une position de repos à partir de laquelle on pourrait examiner sereinement les options et les connexions possibles » (p.148). Comme preuve, il évoque « la naissance des journaux quotidiens, à la fin du XVIIIe siècle » [1], et maintenant les sites web des journaux actualisés plusieurs fois par jour, et les textes défilants sur les écrans de télé (p. 149).
Chapitre 6 : « L’accélération du rythme de vie et les paradoxes de l’expérience du temps »
Ce chapitre est l’un des plus stimulants. Voici un paragraphe clair sur l’« augmentation de la vitesse d’action » : « La thèse d’une accélération du rythme de vie postule une augmentation empiriquement vérifiable du nombre d’épisodes d’actions et/ou d’expériences vécues par unité de temps. Pour y parvenir, on dispose fondamentalement de trois stratégies distinctes mais combinables : d’abord, on peut accélérer l’action elle-même (marcher plus vite, mastiquer plus vite, lire plus vite), ensuite on peut réduire la durée des pauses et les temps morts, ou même les supprimer ; enfin, on peut exécuter plusieurs tâches simultanément (multitasking). » [des sociologues] « en ajoutent une quatrième consistant à remplacer des activités lentes par des activités plus rapides (par exemple, commander une pizza par téléphone plutôt que de faire la cuisine) » (p. 154). Un étrange exemple est donné, à propos du « débit oratoire » : « une étude du politologue U. Torgersen a montré que, dans les discours au Parlement norvégien […] le nombre de phonèmes articulés par minute a augmenté progressivement de près de 50 %, passant de 584 en 1945 à 863 en 1995 » (p. 155).
Dans le même registre, voici une remarque judicieuse sur ce que l’auteur nomme « modernité tardive » : « La fragmentation du temps et l’effacement des frontières qui contribuent à différencier les types d’activités, leurs lieux et leur durée » (p. 162). Il évoque le fait que les activités se mélangent, qu’on effectue parfois à la maison des activités professionnelles. On peut écouter du Beethoven en travaillant, et trouver subitement la solution d’un problème professionnel en plein milieu d’un concert. Le métier d’enseignant serait l’un des meilleurs exemples car les trois quarts du boulot se font à la maison, et l’enseignant est enseignant même pendant ses loisirs. Le présent article que vous lisez nonchalamment, celui qui l’a rédigé et qui a lu ce livre pour le rédiger est-il au travail ou en loisir ; et vous-même, que vous soyez enseignant ou étudiant ? Un autre paragraphe allant dans le même sens du mélange travail / vie privée se trouve p. 213 : « celui ou celle qui retrouve le soir des collègues pour une partie de bowling, mais qui glane à cette occasion de précieuses informations », etc.
Voici un autre paragraphe judicieux, et dans lequel le Parisien pressé que je suis a honte de se reconnaître : « il reste à expliquer pourquoi les personnes interrogées se plaignent d’une pression temporelle croissante et d’une contrainte d’accélération. Ce n’est pas en soi l’élévation du rythme, mais le sentiment que l’on est harcelé qui peut nous surprendre : ainsi, il est étonnant de constater, d’après les données recueillies auprès des sondés, que le temps libre estimé diminue constamment, en même temps qu’augmente le temps libre « réel » ; non seulement il est fréquemment estimé à moins de la moitié du temps libre calculé d’après les agendas, mais il est même en moyenne inférieur au temps passé de facto devant la télévision ! La seule chose que l’on puisse en déduire avec certitude, c’est que le temps libre ainsi établi par le calcul n’est pas perçu par les acteurs comme un réservoir de ressources temporelles libres, mais comme un volume de temps pris par des actions (et des expériences) qui s’écoule à toute allure.
Ce sentiment de pression temporelle s’explique spontanément de deux manières : par la peur de manquer quelque chose et par la contrainte d’adaptation, qui ont des origines totalement différentes. La peur de passer à côté de quelque chose (d’intéressant) et donc le désir d’augmenter le rythme de vie sont […] le résultat d’un projet culturel qui se déploie à l’époque moderne, et qui consiste pour chacun à « profiter des possibilités du monde » à un rythme élevé, c’est-à-dire à multiplier les expériences en vue de mener une « vie bonne », plus épanouie et riche en expériences. C’est la promesse de l’accélération comme projet culturel, qui a pour conséquence que les sujets veulent vivre plus vite » […] « Même dans les périodes dont le sujet dispose librement, c’est-à-dire des ressources temporelles soustraites à la nécessité de l’action, son environnement continue à se transformer rapidement. Lorsque ces périodes sont écoulées, il a accumulé des retards qu’il doit combler : à titre d’exemple, un universitaire qui revient de huit jours de vacances trouvera sa messagerie électronique débordant de questions de toutes sortes, des paquets de copies à corriger, une quantité impressionnante de nouvelles parutions en rapport avec sa recherche, etc. On peut donc aisément se représenter comment, dans une société très dynamique, peut naître le sentiment oppressant d’un temps qui fuit à toute allure même dans les périodes de congé. Le cours des événements objectifs » est bien trop rapide pour que l’on puisse réagir et l’assimiler, au niveau de l’action ou de l’expérience vécue. En cela consiste la contrainte d’accélération structurelle de la modernité qui oblige les sujets à vivre plus vite » (pp. 166-167). « C’est désormais la puissance de l’échéance (deadline) qui détermine l’ordre de succession des activités, d’où le fait que dans une situation où les ressources sont maigres, les objectifs non liés à des délais ou à des deadlines sont peu à peu perdus de vue, pour ainsi dire écrasés sous le poids de ce qu’il faut (d’abord) « régler » et finissent par ne laisser que le vague sentiment que l’on « n’arrive plus à rien faire ». Il nous faut sans cesse « éteindre des feux » qui renaissent constamment au fil des contraintes de coordination de nos activités, et nous ne parvenons plus à développer des projets à long terme et encore moins à les suivre » (p. 169).
L’auteur résume la pensée de Walter Benjamin (il écrit toujours « W. Benjamin » pour accélérer sa typographie !) sur la différence entre vécu et expérience : « Ainsi, le vécu ne peut se transformer en expérience que si l’on peut établir entre eux une relation significative entre le passé et l’avenir, individuel et collectif. On peut en déduire que les expériences authentiques s’incorporent à l’identité des sujets, à l’histoire de leur vie : les traces mémorielles qu’elles laissent sont extrêmement résistantes à l’usure. Elles sont toutefois exclues d’un monde dont les horizons d’attentes se transforment constamment et dont les espaces d’expériences se reconstruisent en permanence » (p. 179). Benjamin parle pour la modernité de temps du joueur, « enchaînement non cumulatif de vécus-chocs, non reliés entre eux », que les sujet se rappellent notamment grâce à des photos. Il n’en est pas question dans le livre, mais cela me fait penser au catalogue de femmes de Don Giovanni, ou aux sites de rencontres. Pour ces épisodes, « l’impossibilité de les traduire en expérience fait d’eux de simples épisodes et accélère l’érosion des traces mémorielles qui leur sont liées » (p. 180).
On en arrive à un changement radical dans l’identité : « Le concept d’une identité personnelle stable pourrait donc s’avérer être le corrélat « naturel » d’un changement social dont le rythme est synchronisé avec l’alternance des générations, et donc l’indice constitutif de la « modernité classique ». Dans les sociétés traditionnelles, aux rythmes de transformation plus faibles, les individus sont définis par des structures préexistantes et permanentes donc, dans une certaine mesure, en fonction d’identités « intergénérationnelles », tandis que, dans les sociétés de la modernité tardive, les identités individuelles stables et durables ne sont pas en mesure de suivre le rythme élevé des transformations et sont marquées de « fractures », de sorte que l’on en arrive à des successions intragénérationnelles (voire intrapersonnelles). Le rythme de la modernité tardive impose donc des changements correspondants dans les rapports à soi et dans les modèles d’identité des individus, sous la forme d’une valorisation de la flexibilité et de l’aptitude au changement, face à la permanence et à la continuité : les sujets doivent soit se concevoir d’abord comme ouverts, flexibles, favorables au changement, soit courir le risque de souffrir en permanence de la frustration causée par l’échec de projets identitaires orientés vers la stabilité face à un environnement en mutation rapide » (p. 183).
Chapitre 7 : « L’accélération sociale comme processus autoalimenté : la spirale de l’accélération »
L’auteur revient sur le paradoxe de l’accélération technique qui n’entraîne pas de décélération du rythme de vie (déjà entrevu en intro et p. 91). Il propose p. 190 ce petit schéma qui d’ailleurs sera repris de façon plus complexe p. 238. Il propose un exemple dans les transports : « Les effets sociaux de la diffusion massive de l’automobile et, avec elle, quelques décennies plus tard, du transport individuel, sont eux aussi largement attestés, et ils permettent en particulier de montrer la transformation des formes du lien social et des modèles relationnels qui a été engendrée par l’accélération : l’introduction de l’automobile a transformé l’espace où se déploient les relations sociales ainsi que la géographie de la société industrielle, en autorisant par exemple des distances bien plus grandes entre lieu de travail et lieu d’habitation, déterminant ainsi massivement la structure de l’habitat des villes, des banlieues et même des territoires ruraux » (p. 190).

« La spirale de l’accélération » a un impact « macrosocial » : « Dans la vie quotidienne, cela se reflète dans notre exigence d’une accélération maximale de tous les processus routiniers, ce qui implique que tous les autres, ceux et celles avec qui nous entrons en contact, sont supposés se presser autant que possible, pour que nous puissions prendre notre temps – une stratégie qui, de toute évidence, se voue d’elle-même à l’échec » (p. 193). Comme dit l’autre, « qui n’avance pas recule ». On pense aux escalators que ces [censuré] de provinciaux ne savent pas utiliser, se carrant en plein milieu avec leurs valises alors que nous autres Parisiens avons tant à faire ! Dans ces conditions, seule une décision politique qui s’impose à la collectivité peut créer des « oasis de décélération » (p. 196).
Chapitre 8 : « Accélération et croissance : les forces motrices externes de l’accélération sociale. »
« Il n’est pas nécessaire de chercher très loin pour identifier un élément constitutif de la société moderne qui rassemble les deux principes – accélération et augmentation quantitative, ou bien accélération en vue de l’augmentation – et les associe dans la même logique d’action : le système capitaliste, dans lequel l’accélération devient une contrainte objective inévitable, inscrite dans les structures matérielles de la société. Par la disparition de la relation traditionnelle, « naturelle », entre la production et la satisfaction des besoins, dans le cadre d’une réorientation de la gestion au profit d’une logique de mise en valeur du capital ou de production de plus-value – autrement dit, « la production pour la production elle-même » –, se déclenche une dynamique qui transcende toutes les limites d’une économie vouée à la satisfaction des besoins. Elle transforme l’augmentation de la production et de la productivité, et avec elles les efforts pour utiliser le temps avec un maximum d’efficience, en impératif systémique incontournable d’une production qui s’autonomise et qui, d’une certaine manière, contribue à susciter elle-même les besoins qui lui correspondent » (p. 200).
« il en va du temps comme pour l’argent : quelque quantité qu’on en ait, il est toujours un peu « juste », et l’on peut, exactement comme l’argent, le perdre, l’investir, le gaspiller, l’économiser, le répartir, etc. Et ainsi que des devises étrangères, on peut convertir le temps et l’argent l’un en l’autre et dans les deux sens : celui qui est un peu « juste » en argent doit investir son temps à faire du baby-sitting, tondre des pelouses ou exercer un travail salarié, pour gagner de l’argent, ou bien il doit dépenser du temps par exemple en se déplaçant à pied, en faisant la lessive à la main, ou en reprisant de vieilles chaussettes pour économiser de l’argent. Celui, à l’inverse, qui est un peu « juste » en temps peut investir de l’argent pour gagner du temps : se déplacer en taxi, pour être rentré chez lui plus vite, et faire appel à un jardinier, au pressing, au service de livraison de pizzas, etc., pour économiser le temps passé à cuisiner, laver, jardiner. Comme on le sait, cette convertibilité trouve ses limites lorsqu’il n’y a plus de demande pour le temps (chômage) et dans l’impossibilité d’épargner (avec intérêts) le temps pour l’avenir » (note 9 p. 444).
« Sur la genèse de la dynamique de l’accélération moderne, il est intéressant de remarquer qu’historiquement l’accélération imputable à la mise en valeur du capital ne fut pas d’abord appliquée à la sphère de la production, mais justement à celle de la distribution ou de la circulation : les transports et la communication s’accélèrent sensiblement à partir du XVIIe siècle, bien avant les grandes innovations technologiques qui allaient conduire à l’accélération des processus de production. La raison principale en est qu’aux XVIe et XVIIe siècles, c’est d’abord entre les mains du commerce que s’accumule le capital et que c’est là que naît la pression en faveur d’une augmentation de la vitesse de rotation, tandis que, du côté de la sphère de la production, l’économie de subsistance et les corporations continuent de peser de tout leur poids. L’accélération du commerce et du transport précède ainsi historiquement l’accélération de la production, qui ne devait atteindre une première et spectaculaire apogée qu’avec la révolution industrielle » (p. 203).
« Les tentatives d’imposer ces temps de travail fixes et ces cadences dans les fabriques se heurtèrent, pendant la révolution industrielle, à des résistances parfois acharnées, là où les travailleurs, par exemple, détruisaient symboliquement les pointeuses ou « se faisaient la belle », découvrant aussi du même coup le système de sanctions du nouveau régime de production. Dans le processus d’intériorisation de ce nouveau concept du temps, les institutions de la société moderne dans son ensemble (et donc, à côté des usines, les hôpitaux, les prisons, les casernes, les écoles maternelles, et avant tout les écoles), dans lesquelles les orientations et les pratiques de la contrainte temporelle sont exercées couramment, ont été – et sont toujours – les plus importantes et les plus efficaces. Le temps s’avère au fond l’instrument principal de la société disciplinaire de la modernité, comme l’a analysé M. Foucault. La nécessité de se conformer à une discipline temporelle stricte joue un rôle central dans toutes ces institutions, dont les modèles d’activités sont toujours régis par un schéma temporel le plus souvent extrêmement rigide et abstrait (que l’on pense par exemple à la cadence des emplois du temps, des programmes, des « retenues », etc. Les horloges y sont les instruments de contrôle par excellence, puisqu’elles brisent les rythmes propres tels que les avaient définis la nature ou l’habitude ; elles sont, dans le même sens, des conditions préalables du déchaînement de la dynamique de l’accélération et de la croissance de la modernité » (p. 207).
« Les tendances actuelles à la flexibilité de la production, à la dérégulation spatiale et temporelle du travail, à la fabrication et à la livraison « just in time » ont tendance à éroder le modèle rigide du temps de travail normalisé, elles réintroduisent manifestement la tâche et l’événement dans la sphère du travail et produisent peu à peu une nouvelle dédifférenciation du travail et de « la vie », autrement dit du temps libre. […] Il est ainsi de plus en plus fréquent que le travail ne prenne pas fin lorsque l’horloge affiche cinq heures, ou que le calendrier signale le début du week-end, mais lorsque la tâche fixée est accomplie. […] C’est ainsi que l’on peut voir aujourd’hui des entreprises – y compris des entreprises de production traditionnelles – se débarrasser de leurs horloges et de leurs pointeuses, voire renoncer aux contrôles de présence, ce qui constitue une révolution inconcevable aux yeux de la sociologie d’inspiration marxiste » (p. 209).
L’une des idées les plus intéressantes du livre est développée dans ce chapitre. Face à « la dissipation progressive de la représentation auparavant dominante d’un « temps suprême », d’un temps du salut qui seul, après la mort ou la fin du monde, constituerait l’accomplissement de toute la vie et de tous les temps, et auprès duquel tout temps terrestre (temps de la vie ou temps du monde) ne serait que transitoire et vain, un cycle finalement insignifiant d’événements récurrents », advient « une autre alternative qui s’est imposée et semble être devenue la réponse exclusive au problème de la mort dans la modernité avancée : la représentation selon laquelle profiter à un rythme accéléré des diverses opportunités du monde, en « vivant plus vite » permettrait de réduire le hiatus entre temps du monde et temps de la vie ». Dans cette optique, « la vie bonne […] consiste à concevoir la vie comme ultime occasion, c’est-à-dire à mettre à profit la durée de vie sur terre accordée à chaque individu de manière aussi intensive et aussi universelle que possible, avant que la mort ne lui mette un terme définitif. […] Il en résulte que la vie bonne serait une vie bien remplie, ce qui signifie une vie où l’on profite autant que possible de tout ce que le monde peut offrir, et où l’on exploite aussi largement que possible ses potentialités et ses propositions » (p. 223 ; thèse attribuée à M. Gronemeyer).
« Pour celui qui atteint une vitesse infinie, la mort, comme annihilation des options, n’est plus à craindre ; une infinité de « tâches vitales » le sépare de sa survenue » (p. 225). En gros, on accumule des expériences pour surmonter notre angoisse de mourir ; mais c’est voué à l’échec, « Car le taux d’augmentation (des options) excède inévitablement le taux d’accélération – les ressources temporelles déjà parcimonieuses se réduisent encore » (p. 226). On reporte sans cesse dans le futur des choses à faire, mais « lorsque ce futur sera devenu un présent, il se trouvera surchargé des choix décisifs et des options en surnombre que l’on avait ajournées dans le passé » (p. 229). L’auteur prend plaisamment pour exemple un universitaire qui rédige « mettons un livre sur la théorie de l’accélération sociale », et qui ne parvient pas à jongler avec ses différentes tâches d’enseignement et de recherche (p. 232).
Chapitre 9 : « Pouvoir, guerre et vitesse – l’État et l’armée comme facteurs institutionnels centraux de l’accélération. »
« L’unification progressive de la langue nationale, des devises, des fuseaux horaires, des systèmes d’éducation, de la législation, des systèmes administratifs, du régime fiscal, des infrastructures et des organes de direction centralisés apparut, en particulier grâce à la disparition des obstacles internationaux aux transactions et aux traductions, comme un gigantesque accélérateur du développement et de la circulation. Par la construction d’infrastructures, par l’amélioration de la sécurité juridique et commerciale, par la conquête du monopole de la force (et de l’impôt) à l’intérieur, comme par la garantie d’une relative sécurité vis-à-vis de l’extérieur, l’État-nation créa les conditions d’une planification fiable et sûre à long terme, indispensable au déploiement systématique de l’accélération scientifique et technique, économique et industrielle » (p. 242).
L’auteur reprend et cite Paul Virilio à propos de la notion de « fleet in being » (p. 244) et des missiles. J’ai relevé un excellent paragraphe sur le rôle de la caserne : « Par ailleurs, l’institution de la caserne, dans le cadre de l’armée moderne de masse composée d’appelés et du service militaire obligatoire, représente peut-être, parallèlement à l’école, la plus importante des institutions d’éducation de cette société disciplinaire que M. Foucault a mise au centre du processus de modernisation. La discipline temporelle moderne y est, plus ou moins violemment, « inscrite » dans le corps humain. La population masculine s’y voit soumise à un « bourrage de crâne » rigoureux, qui lui inculque cette nouvelle discipline, totalement détachée de tous les rythmes naturels et qui néglige toutes les différences individuelles et les « temps spécifiques » subjectifs, et lui enseigne la capacité à réprimer tout mouvement impulsif et affectif en la plaçant sous un régime de domination structuré par un temps formel et abstrait. Dans le même temps, la « mobilité » corporelle est accrue, par l’accélération du corps lui-même dans les marches forcées et les prises d’assaut, et dans cette « mise au pas » temporelle, une multiplicité de soldats (quand ils « marchent au pas », par exemple) sont agrégés dans une « machinerie militaire » au fonctionnement réglé » (p. 246). L’auteur démontre facilement que cette armée est devenue obsolète car (à l’époque de rédaction de la thèse) elle était de plus en plus vécue comme période de décélération : « À l’ère du capitalisme mondialisé, les carrières professionnelles fixées sur un développement à long terme perdent leur signification ; en dehors de l’armée, on ne les rencontre plus que dans la bureaucratie d’État, que l’on peut elle-même considérer comme anachronique » (p. 247). Je ne suis pas tout à fait d’accord sur ce point, car j’ajouterais à cette liste tous les métiers exigeant une maîtrise technique parfaite, et parfois une maîtrise du corps, du moins quand ils sont pratiqués à un haut niveau. Je pense à la danse, aux sports, aux arts, y compris la cuisine. Un sportif de haut niveau, un musicien, un danseur, un couturier, sacrifient en général leur vie, jusqu’à leur régime de nourriture et de sommeil, et leur métier devient une passion à laquelle ils consacrent leur vie entière, devenant entraîneurs ou enseignants s’ils ne pratiquent plus. La guerre moderne ayant atteint un point de non retour dans l’accélération, on doit faire face à des guerres d’autres types, des guérillas ou du terrorisme, ce qui oblige les armées traditionnelles à innover dans la décélération ou dans la précision. À l’origine Internet fut inventé pour ralentir une éventuelle offensive contre les systèmes d’information, en créant un réseau décentralisé (p. 250).
Partie IV. Conséquences. Chapitre 10 « Accélération, mondialisation, postmodernité »
« La crise de l’ensemble des institutions issues de la modernité classique apparaît dans la plupart des analyses actuelles comme le résultat d’évolutions couramment résumées sous le terme de « mondialisation » » (p. 259). Les conséquences sur l’homme en sont certaines pathologies comme la « « maladie de l’homme pressé » ou encore le « mal du siècle », la dépression » (p. 262). Une citation de Zygmunt Bauman attire mon attention : « Les liquides voyagent facilement, […] ils ressortent totalement intacts de leurs contacts avec les solides, tandis que ceux-ci, s’ils restent solides, en ressortent transformés : humides ou trempés, […] il y a des raisons de penser que la « fluidité » ou la « liquidité » sont des métaphores appropriées lorsque nous nous efforçons de saisir la nature de la phase actuelle, à de nombreux égards inédite, de l’histoire de la modernité » (cité p. 267). D’où aussi certains bouleversements : « tandis que, dans la « modernité classique », l’indépendance spatio-temporelle du nomadisme (des sans-domicile, des tziganes, des « gens du voyage ») vis-à-vis de la sédentarité, au sens de l’« adresse permanente » (et d’une discipline temporelle réglée sur le temps chronométrique) était un signe d’arriération et menait à l’exclusion sociale, c’est, à l’inverse, le fait d’être fixé à un lieu et l’absence de souveraineté sur le temps (le fait d’être captif des lieux et d’être enchaîné à ce qui dure) qui fait de nos jours apparaître les classes sociales les plus basses comme rétrogrades et « arriérées » et qui est une menace d’exclusion. Lorsque, comme c’est le cas dans le discours sur la mondialisation, on ne cesse de parler de la supériorité croissante du capital sur le travail, cela signifie que le capital peut se déplacer instantanément en tout point du globe, tandis que la mobilité des travailleurs et leur capacité à la flexibilité et à l’accélération restent très limitées » (p. 268). La métaphore de la fluidité est reprise : « Puisqu’il est dans la nature de ces flux, en particulier les flux de capitaux, de s’écouler dans une autre direction dès qu’ils rencontrent la moindre résistance politique ou économique […] » (p. 271).
Chapitre 11 « Identité situative : des flâneurs et des joueurs »
Une citation de La Nouvelle Héloïse (1961) de Rousseau donne une date au sentiment d’accélération du rythme de vie. Je restitue ici les deux paragraphes entiers qui sont découpés par l’auteur : « Cependant je commence à sentir l’ivresse où cette vie agitée et tumultueuse plonge ceux qui la mènent, et je tombe dans un étourdissement semblable à celui d’un homme aux yeux duquel on fait passer rapidement une multitude d’objets. Aucun de ceux qui me frappent n’attache mon cœur, mais tous ensemble en troublent et suspendent les affections, au point d’en oublier quelques instants ce que je suis et à qui je suis. Chaque jour en sortant de chez moi j’enferme mes sentiments sous la clef, pour en prendre d’autres qui se prêtent aux frivoles objets qui m’attendent. Insensiblement je juge et raisonne comme j’entends juger et raisonner tout le monde. Si quelquefois j’essaye de secouer les préjugés et de voir les choses comme elles sont, à l’instant je suis écrasé d’un certain verbiage qui ressemble beaucoup à du raisonnement. On me prouve avec évidence qu’il n’y a que le demi-philosophe qui regarde à la réalité des choses ; que le vrai sage ne les considère que par les apparences ; qu’il doit prendre les préjugés pour principes, les bienséances pour lois, et que la plus sublime sagesse consiste à vivre comme les fous.
Forcé de changer ainsi l’ordre de mes affections morales, forcé de donner un prix à des chimères, et d’imposer silence à la nature et à la raison, je vois ainsi défigurer ce divin modèle que je porte au dedans de moi, et qui servait à la fois d’objet à mes désirs et de règle à mes actions ; je flotte de caprice en caprice ; et mes goûts étant sans cesse asservis à l’opinion, je ne puis être sûr un seul jour de ce que j’aimerai le lendemain. » (Deuxième partie, lettre XVI à Julie, citée p. 276).
L’« individualisation » est un projet de vie propre à la « modernité classique » : « Lorsque la responsabilité de ce qu’il advient d’une vie, de la conduite de la vie et de la poursuite d’un projet d’identité échoit à l’individu lui-même, il est contraint de se préoccuper de son avenir et d’explorer d’autres futurs possibles » (p. 279). « Cette forme de stabilité générationnelle ne s’appliquait pas seulement aux registres centraux de l’existence (mariage, métier, orientation politique) mais aussi à des aspects plus périphériques, comme l’activité associative ou bénévole, jusqu’au choix d’une mutuelle, d’une banque, et même souvent d’une marque de voiture. La signification d’une telle constance ne devient évidente que lorsqu’on lui oppose, par contraste, l’instabilité des relations dans la modernité avancée » (p. 283). On passe donc d’une identité intergénérationnelle à « des séquences intragénérationnelles », et dans le domaine intime comme professionnel, d’une « monogamie pour une vie entière » à une « monogamie en série » (p. 285). Le « rythme collectif de la vie sociale » est flexibilisé grâce aux « nouvelles technologies mobiles, et leurs possibilités de coordination et de synchronisation des actions » (p. 288), et c’en est fini de la routine qui organisait la journée de façon prévisible. Pour Paul Virilio, « l’éphémère est devenu nécessaire, tandis que la substance est devenue un épiphénomène » (p. 297).
Chapitre 12 « Politique situative : des horizons temporels paradoxaux entre désynchronisation et désintégration »
Comme dans la sphère personnelle, le temps long s’amenuise en politique : « lorsque des décisions politiques ont des conséquences sérieuses et irréversibles à long terme, leur fondement est remis en cause au même titre que la légitimité des décisions se dissipe aux yeux de la minorité. En même temps, l’acceptation de la règle majoritaire suppose aussi que les représentants de l’opinion minoritaire considèrent que les conditions sociales et politiques sont suffisamment dynamiques pour ne pas perdre tout espoir de constituer eux-mêmes une majorité à l’occasion des élections suivantes » (p. 310). Dans la « modernité classique », les « progressistes » et les « conservateurs » « deviennent néanmoins structurellement asymétriques : même une politique conservatrice ne peut empêcher l’histoire d’avancer, elle ne peut que se préoccuper d’assurer des transitions prudentes et de conserver ce qui est digne de l’être. « Progressiste » et « conservateur » désignent ainsi fréquemment davantage des vitesses différentes que des directions réellement distinctes. En vertu de la compréhension qu’elle a d’elle-même, la politique progressiste poursuit une accélération de l’évolution historique qu’elle attend, tandis que la politique conservatrice s’efforce de la ralentir ou de la suspendre provisoirement » (p. 315). Dans la sphère industrielle, l’innovation et « les cycles de vie des produits » ont été tellement accélérés que même les revendeurs « sont désormais incapables d’identifier le produit le plus récent ». L’auteur applique aussi cette idée à l’industrie pharmaceutique, mais sur ce point il me semble au contraire que les règlements stricts imposent des temps de test (essai thérapeutique de phase I, jusqu’à phase IV) des nouvelles molécules qui justement ont été parfois contestés, d’où la notion de « protocole compassionnel », du moins en France.
Retour au domaine politique : « il y a de moins en moins de choses que l’on puisse régler une fois pour toutes, ou au moins pour la durée d’une ou plusieurs générations ; le futur prévisible se rapproche toujours plus du présent, de telle sorte que la politique doit se replier sur le mode du « bricolage », dominée par l’urgence des échéances, où les évolutions provisoires remplacent les grands projets d’organisation. Ce qui explique que les mêmes problèmes (comme par exemple les réformes des retraites ou du système de santé) réapparaissent constamment et à brefs intervalles sur les agendas politiques. La politique perd ainsi son rôle d’acteur de l’organisation, pour jouer désormais le rôle d’un participant principalement réactif » (p. 321). « C’est le paradoxe de l’évolution temporelle actuelle : la portée à long terme de nos décisions semble s’accroître au rythme où diminuent les ressources temporelles dont nous disposons pour les prendre ». Je dirais même plus que certains politiciens malheureusement populaires semblent prendre pour gouvernail de leur gouvernement le journal de 20 h de TF1, ce qui nous vaut depuis 20 ou trente ans cette surenchère permanente de lois contre la pédophilie, le voile islamique, ou contre les violences contre les femmes, etc. Cela a une conséquence sociale : « Le degré croissant de désintégration sociale qui accompagne ce phénomène peut être lui-même interprété dans une large mesure comme une conséquence de la désynchronisation sociale : la simultanéité du non-simultané de la modernité contemporaine affecte les différents groupes sociaux, qu’ils soient culturels, ethniques ou religieux, qui se développent ainsi de manière « désynchronisée » selon leurs propres lois, de sorte que peut naître une mosaïque de « ghettos temporels » (comme on peut l’observer en particulier aux États-Unis – mais à considérer la relation entre Allemands et Turcs, la situation semble évoluer dans le même sens en Allemagne). Ces « ghettos » peuvent se soustraire partiellement à la contrainte d’accélération (donc, en général, aux structures et aux horizons temporels de la modernité) et garantir ainsi leur pérennité (comme les Amish aux États-Unis » (p. 324).
« Le dilemme de la politique dans la modernité avancée entraîne manifestement un déplacement du processus décisionnel hors du domaine de la politique démocratique, vers d’autres arènes, plus rapides, de la société. Parallèlement au déplacement du pouvoir du législatif vers l’exécutif, on assiste désormais à une tendance à déléguer les questions politiques controversées à des experts juridiques (judiciarisation), à l’autorégulation de l’économie (dérégulation économique) ou à la responsabilité des individus (privatisation de l’éthique) » (p. 325). Nouvelle expression du paradoxe : « les processus d’accélération, dont l’essor était porté par des espoirs utopiques lorsqu’ils furent mis en œuvre politiquement, se sont aujourd’hui autonomisés au point qu’ils poursuivent aujourd’hui leur trajectoire au détriment de cette politique et des espoirs de progrès » (p. 328). Citant le musicologue B. Martin, l’auteur explique le rapport entre le rock progressif à la mode en 1968, « animé par l’idée que l’on pouvait créer un futur meilleur », alors que « la musique des années 1980 et 1990 se caractérise par des « vagues rétro » et la négation de tous les espoirs de progrès » (p. 332).
Chapitre 13 « Accélération et pétrification : une tentative de redéfinition de la modernité »
L’auteur reprend le paradoxe exposé par Paul Virilio selon lequel le progrès rend le corps humain immobile dans la vitesse, il « devient un « paquet » plus ou moins ficelé, acheminé passivement, c’est-à-dire, dans une large mesure un mobile immobile, installé dans un « projectile » et donc de plus en plus coupé de l’expérience sensible du mouvement » (p. 346).
Les idées principales sur le changement du rythme de vie sont réunies dans cet excellent tableau « De l’histoire « temporalisée » à l’« immobilité fulgurante » : dialectique de la temporalisation et de la détemporalisation (engendrée par l’accélération) dans la modernité » (Fig. 16, p. 352). Je me suis permis de rectifier, dans la case de la colonne 2, ligne 2, « rythme intragénérationnel », ce qui m’a semblé une coquille du tableau, en « rythme intergénérationnel ».
| - | Prémodernité et débuts de la modernité | Modernité « classique » | Modernité tardive |
| Rythme du changement social endogène | Le changement structurel et culturel reste inférieur au rythme de la succession des générations (rythme intergénérationnel) | Le changement structurel et culturel se rapproche d’un rythme « générationnel » | Le rythme du changement culturel et structurel est supérieur à celui de la succession des générations (rythme intragénérationnel) |
| Indice : les structures familiales et professionnelles | Les structures familiales et professionnelles (la famille étant comprise comme unité économique) restent stables à l’échelle intergénérationnelle | Structures familiales et métiers changent selon le rythme de la succession des générations : « fonder une famille » et « choisir un métier » comme actes individuels et fondateurs de l’identité ; les générations sont les vecteurs de l’innovation | Structures familiales et professionnelles changent à un rythme plus rapide que l’alternance des générations : une succession d’activités (jobs) remplace le métier ; une série de « compagnons d’une partie de la vie » remplace le conjoint pour une vie entière |
| Perspective temporelle | Coïncidence de l’espace d’expérience et de l’horizon d’attente (temps cyclique) | Disjonction des horizons temporels du passé et de l’avenir (temps linéaire) | Temps atemporel et « temporalisation du temps » : le rythme, la durée, la séquence et le moment précis des actions et des événements se décident pendant qu’ils ont lieu |
| Perspective historique | Perspective historique stable, le temps historique est le temps des « histoires » | Temporalisation de l’histoire : l’histoire devient un processus compréhensible, dirigé et organisable (idée du progrès) ; l’indice directionnel politique est temporel (progressistes / conservateurs) ; la politique dicte le rythme de l’histoire. | « Fin de l’histoire » comprise comme progrès et comme philosophie de l’histoire ; perte de l’index directionnel politique due au rythme élevé du changement (politique situative) : « détemporalisation de l’histoire » |
| Perspective de la vie | Perspective de vie « situative » et résolution des problèmes (à cause externe) du quotidien sur le fondement d’une « identité substantielle a priori » ; les fluctuations de la vie sont enracinées d’une part de manière exogène, d’autre part aux plans métaphysique et culturel | Temporalisation de la vie : Perspective d’un parcours de vie planifiable et défini narrativement comme histoire d’une évolution, sur la base d’une identité stable et auto-déterminée a posteriori et de sa garantie institutionnelle (régime du parcours de vie) | Désinstitutionnalisation du parcours de vie ; abandon de l’identité stable au profit d’un « projet de vie » ; identité et conduite de vie « situatives » : « détemporalisation de la vie » |
Citant deux auteurs, Rosa évoque un « nouveau fatalisme » et donc un « immobilisme » paradoxal d’une société vouée à une « modernité laissée à elle-même » (p. 357). « La contrainte de l’accélération condamne les sujets, les organisations et les gouvernements à une situativité réactive, au lieu d’une conduite organisatrice de la vie individuelle et collective. Selon P. Virilio, ils commencent donc à ressembler à un pilote de course automobile qui, en raison du degré d’automatisation des processus qu’il est censé diriger, « n’est plus que la vigie inquiète des probabilités catastrophiques de son mouvement » (p. 358).
Conclusion
L’auteur termine par quatre hypothèses répondant à la question de la fin de l’histoire de l’accélération : « Est-elle pourvue d’une sorte de « point gravitationnel » quasi « naturel » vers lequel elle progresse irrésistiblement, ou des formes d’équilibre alternatives entre le mouvement et la permanence sont-elles concevables ? » (p. 370). Je trouve ces hypothèses trop théoriques et peu pragmatiques, mais l’auteur conclut de façon optimiste : « Dans les deux cas, on a affaire à une fin extrêmement inquiétante. Mais c’est justement cette inquiétude qui pourrait inciter une théorie sociale contemporaine créative à imaginer une cinquième fin de l’histoire de l’accélération. Et de citer Pierre Bourdieu : « il fallait connaître la loi de la gravitation pour construire des avions qui puissent justement la combattre efficacement » (p. 374).
– Voir l’article de Denis Collin sur ce livre, qui lui aussi est frustré de l’absence de solutions proposées. Il est vrai que c’est au tour des politiques (ou des citoyens) de jouer !
– Parmi les innombrables exemples de détérioration de notre vie amenée par le « progrès », et les plus rares protestations citoyennes contre ces détériorations, en voici une récente : « Obligées de s’inscrire sur Internet, des assistantes maternelles en grève ».
Ce livre m’inspire une idée que je reprendrai peut-être prochainement, d’une sorte de recherche sociologique ou de sondage, sur les innovations que nous avons le plus appréciées, ou au contraire qui nous ont le plus pourri la vie depuis l’an 2000. De façon à esquisser un programme politique de décélération, ou de dépourrissement de la vie. « Dépourrir la vie », voilà quel serait mon slogan si je faisais de la politique !
Voir en ligne : Hartmut Rosa sur France Culture
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Cette information m’ayant étonné, j’ai vérifié, et effectivement, le premier quotidien français date de 1777, c’est le Journal de Paris.
 altersexualite.com
altersexualite.com