Accueil > Culture générale et expression en BTS > « De la musique avant toute chose ? » > La Naissance de la tragédie, de Friedrich Nietzsche
Êtes-vous plutôt dionysiaque ou apollinien ?
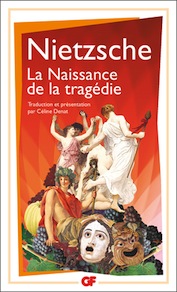 La Naissance de la tragédie, de Friedrich Nietzsche
La Naissance de la tragédie, de Friedrich Nietzsche
Gallimard, 1977 (1872), 156 p. sur un volume de 574.
samedi 3 octobre 2020, par
La Naissance de la tragédie (1872) de Friedrich Nietzsche (1844-1900) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « De la musique avant toute chose ? ». Je l’ai choisi parce que c’est un essai phare dont les thèses sont entrées dans le domaine courant, mais je ne l’avais jamais lu, alors c’était l’occasion de boire dans leur jus les notions d’apollinien et de dionysiaque, dont Wikipédia nous apprend qu’elles nous viennent de Plutarque et de Michelet. Je vais surtout prélever dans cet article des citations d’extraits utilisables en cours (dont plusieurs échappent au thème de la musique, bien entendu). L’édition que j’ai utilisée est le premier volume des Œuvres philosophiques complètes publiées par Gallimard, qui contient outre La Naissance de la tragédie des fragments posthumes contemporains ; c’est l’édition reprise en Pléiade et Folio. La traduction est de Philippe Lacoue-Labarthe pour ce texte. Le texte est parfois limpide, parce que pas trop jargonnant, mais parfois trop confus, faute de commencer par un exposé clair des forces en présence. L’auteur suppose que son lecteur a baigné dès le ventre de sa maman dans le théâtre athénien. Donc ne comptons pas que ce soit une lecture choisie par les étudiants, à part quelques-uns qui viennent de L ou de S et qui n’ont pas été traumatisés par la philo, dans certaines sections de BTS. Certains extraits seront cités dans la traduction de 1906 disponible sur Wikisource.
Essai d’autocritique
Le titre complet est La Naissance de la tragédie ou : hellénité et pessimisme ; le titre original de l’édition de 1872 était La Naissance de la tragédie, enfantée par l’esprit de la musique ; titre qui demeure pour la partie principale de l’essai, après l’« Essai d’autocritique ». L’apparat critique de cette édition Gallimard est à la fois savant, complexe, et discret : le lecteur non spécialiste peut glisser dessus sans que cela entrave sa lecture. Une « note des traducteurs » propose une liste des mots problématiques, qui sont traduits différemment selon le contexte. L’édition définitive commence par un « essai d’autocritique » qui présente l’ouvrage comme une œuvre de jeunesse imparfaite. Cela commence par une contextualisation :
« Quoi qu’il y ait au fond de ce livre problématique, il fallait que ce fût un problème de premier ordre et d’une grande séduction, et qui plus est un problème profondément personnel. À preuve l’époque où il est né, en dépit de laquelle il est né, l’époque fiévreuse de la guerre franco-allemande de 1870-1871. Pendant que déferlait sur l’Europe le tonnerre de la bataille de Woerth, quelque part dans un coin des Alpes, le songe-creux et l’amateur d’énigmes à qui est échue la paternité de ce livre était assis, tout à ses songeries et à ses énigmes, et donc à la fois très soucieux et très insouciant, à noter ses pensées sur les Grecs, – qui sont le noyau de ce livre étrange et difficile d’accès auquel cette préface (ou cette postface) tardive est consacrée » (p. 25). L’auteur n’est pas tendre avec lui-même : « une œuvre de jeunesse pleine d’ardeur juvénile et de juvénile mélancolie, indépendante, et même d’une autarcie arrogante là où elle paraît s’incliner devant quelque autorité ou quelque vénération particulière, – bref une œuvre de débutant, y compris au pire sens du mot, entachée, malgré son problème de vieillard, de tous les défauts de la jeunesse, avec par-dessus tout ses « beaucoup trop long » et son côté « Sturm und Drang » » (p. 27). Plus loin, il avoue « il m’est devenu étranger ». Il présente la thèse défendue par le livre : « La victoire de l’optimisme […] [est] un symptôme de force déclinante, de proche vieillesse, d’épuisement physiologique » (p. 30). Et le responsable est désigné : « Dès le début, le christianisme fut essentiellement et fondamentalement dégoût et lassitude de la vie envers la vie, simplement travestis, dissimulés, fardés sous la croyance en une « autre vie », une « vie meilleure ». La haine pour le « monde », la malédiction des affects, la peur de la beauté et de la sensualité, un au-delà inventé pour mieux calomnier l’en-deçà, au fond une aspiration au néant, à la fin, au repos, au « Sabbat des Sabbats » – tout cela, joint à l’inconditionnée volonté du christianisme de ne reconnaître que des valeurs morales, m’est toujours apparu comme la forme la plus dangereuse et la plus inquiétante entre toutes les formes possibles de la « volonté de périr », ou à tout le moins un signe de profonde maladie, de fatigue, de découragement, d’exténuation, d’appauvrissement de la vie. Car aux yeux de la morale (en particulier de la morale chrétienne, c’est-à-dire inconditionnée), il faut inévitablement que la vie ait toujours tort, parce que la vie est quelque chose d’essentiellement immoral, – il faut que la vie, réprimée sous le poids du mépris et de la négation éternelle, soit finalement ressentie comme indigne d’être désirée et dépourvue de valeur en soi » (p. 31). « C’est donc contre la morale que dans ce livre problématique s’était jadis tourné mon instinct, un instinct qui intercédait en faveur de la vie et s’inventa par principe une contre-doctrine et une contre-évaluation de la vie, purement artistique, anti-chrétienne. Mais comment la nommer ? En philologue, en homme du langage, je la baptisai non sans quelque liberté – mais qui saurait au juste le nom de l’antéchrist ? – du nom d’un dieu grec : je l’appelai dionysiaque. – » (p. 32). Cette « autocritique » se termine sur une citation de Ainsi parlait Zarathoustra : « Cette couronne du rieur, cette couronne de roses, à vous, mes frères, je lance cette couronne ! J’ai sanctifié le rire : ô vous, hommes supérieurs, apprenez donc – à rire ! » (p. 35).
La Naissance de la tragédie, enfantée par l’esprit de la musique
Après l’« Essai d’autocritique », on retombe donc sur le titre primitif, qui semble désormais celui d’une partie du livre, comme si l’auteur avait voulu infléchir le sens de son livre en le faisant précéder de son « autocritique ». Après une brève « dédicace à Richard Wagner », on entre dans le vif du sujet : « C’est à leurs deux divinités de l’art, Apollon et Dionysos, que se rattache la connaissance que nous pouvons avoir, dans le monde grec, d’une formidable opposition, quant à l’origine et quant au but, entre l’art plastique – l’art apollinien – et l’art non plastique qui est celui de Dionysos. Ces deux impulsions si différentes marchent de front, mais la plupart du temps en conflit ouvert, s’excitant mutuellement à des productions toujours nouvelles et de plus en plus vigoureuses afin de perpétuer en elles ce combat de contraires (entre lesquels le mot « art » qu’on leur attribue en commun ne fait qu’apparemment jeter un pont), jusqu’à ce qu’enfin, par un geste métaphysique miraculeux de la « volonté » hellénique, elles apparaissent accouplées l’une à l’autre et, dans cet accouplement, en viennent à engendrer l’œuvre d’art à la fois dionysiaque et apollinienne, la tragédie attique » (p. 42).
En lisant l’extrait suivant, écoutons l’« Hymne à la joie » de Beethoven dans l’interprétation de Daniel Barenboim et de son West-Eastern Divan Orchestra (à partir de 14’ pour le début du chœur proprement dit), interprété à Londres au Royal Albert Hall lors des Proms.
« Transformez en tableau l’« Hymne à la joie » de Beethoven et ne laissez pas votre imagination en reste lorsque les millions d’êtres se prosternent en frémissant dans la poussière : c’est ainsi qu’il est possible d’approcher le dionysiaque. Maintenant l’esclave est un homme libre, maintenant se brisent toutes les barrières hostiles et rigides que la nécessité, l’arbitraire ou la « mode insolente » [1] ont mises entre les hommes. Maintenant, dans cet évangile de l’harmonie universelle, non seulement chacun se sent uni, réconcilié, confondu avec son prochain, mais il fait un avec tous, comme si le voile de Maya s’était déchiré et qu’il n’en flottait plus que des lambeaux devant le mystère de l’Un originaire. Par le chant et la danse, l’homme manifeste son appartenance à une communauté supérieure : il a désappris de marcher et de parler et, dansant, il est sur le point de s’envoler dans les airs. Ses gestes disent son ensorcellement. De même que les animaux maintenant parlent et la terre donne lait et miel, de même résonne en lui quelque chose de surnaturel : il se sent dieu, il circule lui-même extasié, soulevé, ainsi qu’il a vu dans ses rêves marcher les dieux. L’homme n’est plus artiste, il est devenu œuvre d’art : ce qui se révèle ici dans le tressaillement de l’ivresse, c’est, en vue de la suprême volupté et de l’apaisement de l’Un originaire, la puissance artiste de la nature tout entière. Ce qui est pétri ou sculpté, c’est l’argile la plus noble, le marbre le plus précieux, l’homme lui-même, et sous les coups de ciseaux du démiurge dionysiaque retentit l’appel des Mystères d’Eleusis :
« Vous vous jetez à terre, millions d’êtres ? Ô monde, pressens-tu ton créateur ? »…
Jusqu’à présent nous avons considéré l’apollinien et son contraire, le dionysiaque, comme des forces artistiques qui jaillissent de la nature elle-même sans la médiation de l’artiste et par lesquelles la nature trouve à satisfaire primitivement et directement ses pulsions artistiques : c’est-à-dire, d’une part, comme le monde d’images du rêve, dont la perfection est sans aucun rapport avec le niveau intellectuel et la culture esthétique de l’individu, et, d’autre part, comme la réalité d’une ivresse qui, elle non plus, ne tient pas compte de l’individu, mais qui cherche au contraire à anéantir toute individualité pour la délivrer en un sentiment mystique d’unité. Au regard de ces dispositions artistiques immédiates de la nature, tout artiste est un « imitateur », à savoir : soit un artiste apollinien du rêve, soit un artiste dionysiaque de l’ivresse, soit enfin – comme dans la tragédie grecque par exemple – un artiste du rêve et l’ivresse à la fois, – ce dernier étant, si l’on veut, à penser comme celui qui, gagné par l’ivresse dionysiaque et le dessaisissement mystique de soi, s’effondre, seul, à l’écart des chœurs exaltés au moment même où, sous l’effet apollinien du rêve, son propre état (c’est-à-dire son unité avec le fond le plus intime du monde) se révèle à lui dans une image de rêve analogique » (p. 45-46).
« S’il apparaît que la musique était déjà connue, comme art apollinien, elle ne l’était néanmoins, à strictement parler, qu’en tant que ressac rythmique dont la force plastique, en se déployant, assurait la représentation d’états apolliniens. La musique d’Apollon était de l’architecture dorique en sons, mais en sons à peine indiqués, comme c’est le propre de la cithare. Avec prudence, on écartait justement comme non apollinien l’élément qui constitue le caractère de la musique dionysiaque, et par là-même de la musique en général, c’est-à-dire le pouvoir commotionnant du son, le flot homogène de la mélodie et le monde absolument incomparable de l’harmonie. Dans le dithyrambe dionysiaque, l’homme est porté au plus haut degré de toutes ses facultés symboliques » (p. 48).
Voici une analogie avec l’art pictural : « Raphaël, qui est lui-même l’un de ces immortels « naïfs », nous a représenté par une analogie picturale cette dépotentialisation de l’apparence en apparence qui est le procédé le plus fondamental de l’artiste naïf et, par là même, de la civilisation apollinienne. Dans sa Transfiguration, la partie inférieure du tableau nous montre, dans l’enfant possédé, les porteurs en proie au désespoir, les disciples désemparés et pris d’angoisse, l’image en miroir de l’éternelle douleur originaire, de l’unique fondement du monde : l’« apparence » est ici le reflet de l’éternel antagonisme qui est le père de toutes choses. Mais de cette apparence s’élève, comme un parfum d’ambroisie, un nouveau monde d’apparences semblable à une vision, mais dont ceux qui restent prisonniers de la premire apparence ne voient rien – vaste et radieux suspens de lumière dans la plus pure des félicités, dans cette contemplation libre de toute douleur que soutiennent des yeux grands ouverts. Là s’offrent à nous, dans le suprême symbolisme de l’art, à la fois le monde apollinien de la beauté et son arrière-fond, la terrifiante sagesse de Silène, et de telle manière que, par intuition, nous en saisissons la mutuelle nécessité » (p. 54). Voyons ce tableau de Raphaël :

La musique extatique des fêtes dionysiaques
Précision sur le dionysiaque et l’apollinien : « Mais c’est aussi bien dans ses effets que le dionysiaque apparaissait au Grec apollinien comme « titanesque » et « barbare » sans qu’il pût toutefois se dissimuler la profonde affinité qui l’attachait à ces Titans déchus et à ces héros. Bien plus, il était même obligé de sentir que son existence entière, avec toute sa beauté et sa mesure, reposait en fait sur un arrière-fond voilé de souffrance et de connaissance que le dionysiaque lui faisait redécouvrir. Et voici qu’Apollon ne pouvait vivre sans Dionysos ! Le « titanesque » et le « barbare » étaient en fin de compte aussi nécessaires que l’apollinien ! Représentons-nous dès lors, dans ce monde artificiellement endigué et bâti sur l’apparence et la mesure, la musique extatique des fêtes dionysiaques retentissant en accents magiques et ensorcelants, et laissant éclater à grand fracas, jusqu’à la stridence du cri, toute la démesure de la nature exultant dans la joie, la souffrance ou la connaissance ! Représentons-nous ce que pouvait signifier, face à ces chants populaires démoniaques, l’artiste apollinien psalmodiant au son évanescent de sa harpe ! Les Muses des arts de l’« apparence » pâlissaient devant un art qui, dans son ivresse, proclamait la vérité, et la sagesse de Silène criait : « Malheur ! Malheur ! » au front de la sérénité olympienne. L’individu – ses limites et sa mesure – sombrait dans cet oubli de soi qui est le propre des états dionysiaques et perdait toute mémoire des préceptes apolliniens. La démesure se dévoilait comme la vérité ; la contradiction, la volupté née de la douleur s’exprimaient d’elles-mêmes du plus profond de la nature. Et cela de telle façon que partout où pénétrait le dionysiaque, l’apollinien était aboli et détruit, encore qu’il ne soit pas moins sûr, cependant, que partout où le premier assaut était repoussé, le prestige et la majesté du dieu delphique se montraient plus rigides et menaçants que jamais » (p. 55).
L’artiste objectif
À l’opposition dionysiaque / apollinien se superpose l’opposition entre deux poètes de l’Antiquité : « Nous approchons désormais du but proprement dit de notre enquête, laquelle vise à la connaissance du génie dionysiaque-apollinien et de l’œuvre d’art qui en procède, ou cherche tout au moins à nous donner une idée de cette mystérieuse union. Pour l’instant toutefois, nous commencerons par nous demander où ce nouveau germe, antérieurement à son développement jusqu’à la tragédie et au dithyrambe dramatique, se laisse repérer pour la première fois dans le monde hellénique. Or sur ce point, c’est à l’antiquité elle-même que nous devons, de façon imagée, les éclaircissements nécessaires, elle qui place côte à côte sur des bas-reliefs, des gemmes, etc., Homère et Archiloque comme les ancêtres et les flambeaux de la poésie grecque, avec le sentiment tout à fait sûr que seuls ces deux poètes peuvent être considérés comme des natures pleinement originales d’où un torrent de feu se répand ensuite sur l’ensemble de la postérité grecque. Homère, le vieillard qui rêve tout absorbé en lui-même, le type de l’artiste naïf, apollinien, regarde, interdit, le visage passionné d’Archiloque, le belliqueux serviteur des Muses dont l’existence est toute de violence et de fureur. C’est à quoi l’esthétique moderne ne saurait guère ajouter ceci, en guise d’interprétation, qu’à l’artiste « objectif » on voit ici opposé le premier artiste « subjectif ». Ce qui en vérité nous avance assez peu, nous qui tenons l’artiste subjectif pour un mauvais artiste et qui exigeons dans l’art, en tout genre et à tous les niveaux, que d’abord et surtout l’on triomphe du subjectif, qu’on se délivre du « je » et que l’on impose silence à toutes les formes individuelles de la volonté et du désir, – oui, nous qui tenons que sans objectivité, sans contemplation pure et désintéressée, il ne nous sera jamais possible de croire à la moindre création artistique véritable C’est la raison pour laquelle, à nos yeux, l’esthétique a d’abord à résoudre ce problème : comment le « poète lyrique » est-il possible en tant qu’artiste, lui qui, d’après l’expérience de tous les temps, est celui qui dit toujours « je » et ne cesse de venir nous dévider toute la gamme chromatique de ses passions et de ses désirs ? Archiloque précisément, avec ses cris de haine et ses sarcasmes, ses explosions ivres de désir, nous effraie à côté d’Homère » (p. 57).
La chanson populaire
« Pour en revenir à Archiloque, la recherche érudite a découvert que c’est à lui qu’on doit l’introduction de la chanson populaire dans la littérature et que telle est la raison de la place unique que l’estime unanime des Grecs lui réservait à côté d’Homère. Mais qu’est-ce qui oppose la chanson populaire à l’époque pleinement apollinienne ? Rien d’autre que d’avoir constitué le perpetuum vestigium de l’union du dionysiaque et de l’apollinien. Son immense diffusion parmi tous les peuples, ce pouvoir, qui est en permanence le sien, de se renouveler et de s’enrichir sont pour nous les témoins de cette double impulsion artistique de la nature qui laisse sa trace dans la chanson populaire, comme, de manière analogue, les commotions orgiaques d’un peuple qui s’éternisent dans sa musique. Il est du reste certain qu’on pourrait démontrer historiquement que toute période riche et productive en matière de chanson populaire est également soumise aux plus fortes secousses de ces courants dionysiaques qu’il nous faut toujours considérer comme le soubassement et la condition préalable de la chanson populaire.
Mais pour ce qui nous intéresse ici, la chanson populaire est d’abord à prendre comme miroir musical du monde, mélodie originelle à la recherche d’une manifestation onirique qui lui soit parallèle et qu’elle exprime dans la poésie. La mélodie est donc l’élément premier et universel, qui pour cette raison, peut tolérer plusieurs objectivations et plusieurs textes. Elle est d’ailleurs, pour l’évaluation naïve du peuple, ce qu’il y a de plus important et de plus nécessaire. La mélodie enfante, et à vrai dire ne cesse d’enfanter la poésie : la forme strophique – ce phénomène qui m’a toujours étonné jusqu’à ce que je finisse par lui trouver cette explication – ne veut pas dire autre chose. […]
Dans la poésie des chansons populaires, nous voyons donc le langage tendre de toutes ses forces à imiter la musique. C’est la raison pour laquelle, avec Archiloque, commence un nouveau monde de la poésie, qui contredit de fond en comble le monde homérique. Mais cela posé, nous avons en fait défini la seule relation qui puisse exister entre musique et poésie, mot et son : le mot, l’image, le concept recherchent une expression analogue à la musique et, par là, en subissent la violence dominatrice » (pp. 62-63).
Trou normand : « Infinity » (« ∞ »), Aphrodite’s Child
Pour faire un break dans cette chronique, je vous propose d’écouter la performance unique d’Irène Papas sur la chanson « ∞ » des Aphrodite’s Child (Vangelis et Demis Roussos, album 666, 1971), qui à tort ou à raison me semble relever en droite ligne du dionysiaque (on est à cheval entre rock progressif, rock psychédélique et rock expérimental). À vous de voir ! Pour ceux qui auraient de la cire dans les oreilles, les uniques paroles de cette œuvre à scandale sont « I was, I am, I am to come, I was » (en anglais « je vais jouir ») très expressifs. Ces paroles sont l’inversion de celles de la représentation du Bien dans l’Apocalypse de Jean (I, 8) (« Il est, Il était et Il vient ») reprises en remplaçant la troisième personne par la première personne (passage du « il » au « je »). (Information puisée sur un post d’un certain Chritian Léon).
Retour à Nietzsche
Nietzsche prend un bon exemple pour illustrer son idée de musique analogique : « Une symphonie de Beethoven, on en fait l’expérience tous les jours, contraint chaque auditeur à un discours imagé, même si le rapprochement des différents mondes d’images suscités par un morceau de musique donne un résultat parfaitement bariolé et fantastique, voire contradictoire. […] même lorsqu’il lui est arrivé de désigner une symphonie comme pastorale et de baptiser tel mouvement « scène au bord d’un ruisseau » ou « joyeuse réunion de paysans », ce ne sont là que représentations analogiques nées de la musique – et non pas des objets imités par la musique —, représentations dont aucun aspect ne peut nous instruire sur le contenu dionysiaque de la musique et qui n’ont, au demeurant, aucune valeur exclusive par rapport à d’autres images. Ce processus par lequel la musique se décharge en images, il nous suffit du reste de le transférer et de l’imaginer agissant au sein d’un peuple neuf et jeune, créateur en matière de langage, pour avoir une idée de la manière dont prend naissance la chanson populaire à strophes et pressentir à quel point les capacités linguistiques peuvent être stimulées du moment où s’introduit le principe de l’imitation de la musique » (p. 64). Voici donc cette symphonie n°6 dite « pastorale » de Beethoven, interprétée ici par l’orchestre National de Radio France dirigé par Daniele Gatti en Décembre 2014 à l’auditorium de Radio France :
En relisant une page du roman d’André Gide La Symphonie pastorale et les propos de Berlioz dans son Beethoven, on pourrait imaginer de faire d’abord entendre un mouvement de cette symphonie sans aucune information, et de faire écrire leurs impressions aux élèves, puis de les comparer avec un montage de ces textes (Nietzsche, Berlioz, Gide). Je suggère le 5e mouvement, qui commence sur cette interprétation un peu avant la 35e minute sur 45. L’article de Wikipédia parle de « ranz des vaches », et cela pourrait poursuivre une séquence de cours, qui nous éloigne bien de ce livre… et nous renvoie à notre article sur le chœur. Mais le 1er mouvement conviendrait aussi bien.
Nietzsche discute longuement d’une affirmation d’Auguste Schlegel qui lui permet de préciser le rapport entre chœur et foule. Je choisis pour ces deux longues pages (§ 7 et 8) la traduction de 1906 sur Wikisource : « Beaucoup plus célèbre que cette définition politique du chœur est l’idée de A. W. Schlegel, qui veut nous faire considérer le chœur comme étant, jusqu’à un certain point, la substance et l’extrait de la foule des spectateurs, en un mot le « spectateur idéal ». En présence de cette tradition historique, qu’à l’origine la tragédie n’était que chœur, cette opinion est manifestement une allégation grossière, anti-scientifique et pourtant spécieuse dont le succès n’est dû qu’à la forme concise de l’expression, à la prévention toute germanique pour tout ce qui est qualifié d’« idéal », et aussi à notre surprise momentanée. Nous sommes en effet surpris dès que nous comparons à ce chœur le public de théâtre qui nous est bien connu, et que nous nous demandons s’il serait vraiment possible de tirer de ce public une idéalisation quelconque analogue au chœur antique. Nous dénions à part nous cette possibilité et nous restons alors émerveillés aussi bien de la hardiesse de l’allégation de Schlegel que de la nature si totalement différente du public grec. Nous avions en effet toujours pensé que le véritable spectateur, quel qu’il puisse être, devait avoir toujours pleinement conscience que c’est une œuvre d’art qui est devant lui, et non une réalité empirique ; tandis que le chœur tragique des Grecs est nécessairement obligé de reconnaître, dans les personnages qui sont en scène, des êtres existant matériellement. Le chœur des Océanides croit vraiment voir devant soi le titan Prométhée et se considère comme tout aussi réellement existant que le dieu qui est sur la scène. Et ce serait le modèle le plus noble et le plus achevé du spectateur, celui qui, comme les Océanides, tiendrait Prométhée pour matériellement présent et réel ? Ce serait la marque distinctive du spectateur idéal que de courir sur la scène et de délivrer le dieu de ses bourreaux ? Nous avions cru à un public esthétique, et nous tenions le spectateur individuel en estime d’autant plus grande qu’il se montrait plus apte à concevoir l’œuvre d’art en tant qu’art, c’est-à-dire esthétiquement ; et voici que l’interprétation de Schlegel nous dépeint le spectateur parfait, idéal, subissant l’influence de l’action scénique, non pas esthétiquement, mais d’une manière matériellement empirique. Oh ! ces Grecs ! soupirions-nous ; ils nous renversent notre esthétique ! Et, par la force de l’habitude, nous répétions la formule de Schlegel aussi souvent que le chœur prenait la parole.
Mais la tradition, si formelle, s’élève ici contre Schlegel : le chœur en soi, sans scène, c’est-à-dire la forme primitive de la tragédie, et ce chœur de spectateurs idéaux sont incompatibles. Que serait une espèce d’art dont l’origine remonterait à la notion du spectateur envisagée sous la forme spéciale du « spectateur en soi » ? Le spectateur sans spectacle est une conception absurde. Nous craignons que l’origine de la tragédie ne puisse être expliquée ni par une haute estimation de l’intelligence morale de la foule, ni par la conception du spectateur sans spectacle, et ce problème nous semble trop profond pour être seulement effleuré par des considérations aussi superficielles. »
Autre comparaison au bénéfice des Grecs : « Le satyre, comme le berger de notre moderne idylle, est né de la nostalgie de l’origine et de l’état de nature. Mais quelle poigne chez le Grec, et quelle intrépide vigueur à concevoir son homme des bois ! Et que de sensiblerie pudibonde dans le batifolage de nos modernes avec la complaisante image de leur pâtre à pipeau, mièvre et gracile ! – La nature intouchée par la connaissance, encore verrouillée aux intrusions de la civilisation, voilà ce que le Grec apercevait dans son satyre. Mais il ne l’assimilait pas pour autant au singe. Au contraire. C’était l’archétype même de l’homme, l’expression de ses émotions les plus hautes et les plus fortes. C’était un être inspiré, exalté, que la proximité du dieu transposait d’extase – un compagnon de souffrance, aussi, en qui se répétait la passion du dieu, le message d’une sagesse venue du plus profond de la nature elle-même et l’emblême de cette toute-puissance sexuelle de la nature que le Grec avait depuis toujours considérée avec stupeur et respect » (§ 7).
« Mais il faut toujours avoir présent à l’esprit que le public de la tragédie attique se retrouvait lui-même dans le chœur de l’orchestre, qu’il n’existait au fond aucun contraste, aucune opposition entre le public et le chœur : car tout cela n’est qu’un grand chœur sublime de satyres chantant et dansant, ou de ceux qui se sentaient représentés par ces satyres. Le mot de Schlegel doit être entendu ici dans un sens plus profond. Le chœur est le « spectateur idéal » pour autant qu’il est l’unique voyant, le voyant du monde de vision de la scène. Un public de spectateurs, tel que nous le connaissons, était inconnu aux Grecs : dans leurs théâtres, grâce aux gradins superposés en arcs concentriques, il était tout particulièrement facile à chacun de faire abstraction de l’ensemble du monde civilisé ambiant, et, en s’abandonnant à l’ivresse de la contemplation, de se figurer être soi-même un des personnages du chœur. D’après ce point de vue, nous pouvons nommer le chœur, sous sa forme primitive dans la tragédie originelle, l’image réfléchie de l’homme dionysien lui-même, et ce phénomène ne peut être plus nettement rendu sensible que par l’exemple de l’acteur qui, lorsqu’il est véritablement doué, voit flotter devant ses yeux l’image quasi matérielle du rôle qu’il interprète. Le chœur de satyres est, avant tout, une vision de la foule dionysienne comme, à son tour, le monde de la scène est une vision du chœur de satyres : la puissance de cette vision est assez forte pour éblouir le regard et le rendre insensible à l’impression de la « réalité », au spectacle des hommes civilisés rangés en cercle sur les gradins. La forme du théâtre grec rappelle celle d’une vallée solitaire : l’architecture de la scène apparaît comme un halo de nuées lumineuses que les Bacchantes, qui vont rêvant à travers les montagnes, aperçoivent des hauteurs, cadre glorieux au milieu duquel se révèle à leurs yeux l’image de Dionysos » (§ 8).
Précision sur le chœur du dithyrambe : « Mais le chœur dithyrambique, lui, est un chœur d’êtres métamorphosés qui ont complètement oublié leur passé de citoyen et leur position sociale et qui, se mettant à vivre en dehors de toute structure sociale, sont devenus les serviteurs intemporels de leur dieu. Toutes les autres formes du lyrisme choral ne sont, chez les Grecs, qu’une immense amplification de l’aède apollinien. Dans le dithyrambe nous avons affaire à une communauté d’acteurs inconscients, qui sont mutuellement témoins de leurs propres métamorphoses.
La possession est par conséquent la condition préalable de tout art dramatique : possédé, l’exalté de Dionysos se voit comme satyre – et comme satyre, alors, il voit le dieu. Ce qui revient à dire que, métamorphosé, il perçoit, extérieure à lui, une nouvelle vision qui est l’accomplissement apollinien de son état. C’est avec cette nouvelle vision que le drame achève de se constituer » (p. 74).
Voici un 2e long extrait de cet § 8, dans la traduction de Gallimard : « Mais c’est le chœur de la tragédie grecque, le symbole de la foule tout entière en proie à l’émotion dionysiaque qui trouve dans notre façon de voir sa pleine explication. Habitués comme nous l’étions jusqu’ici à la fonction réservée au chœur sur la scène moderne, en particulier dans l’opéra, nous ne pouvions absolument pas comprendre – ainsi qu’il ressort pourtant clairement de la tradition – comment le chœur tragique des Grecs pouvait être plus ancien, plus originaire, plus important même que l’« action » proprement dite.
Nous n’étions pas non plus capables d’accorder avec cette importance et cette originalité traditionnellement attestées le fait que le chœur n’était composé que d’êtres subalternes et serfs – et même, tout d’abord, que de satyres à l’aspect de boucs. Et la situation de l’orchestre, devant la scène, demeurait pour nous une énigme. Maintenant en revanche nous savons que la scène, action comprise, fut au fond simplement pensée, à l’origine, comme vision et que la seule « réalité », c’est justement le chœur qui fait naître hors de lui cette vision et qui en parle avec toutes les ressources symboliques de la danse, de la musique et du verbe. Dans sa vision, c’est Dionysos que le chœur aperçoit, son Seigneur et maître – et c’est pourquoi il reste toujours un chœur de serviteurs. Mais il le voit, ce dieu, souffrant et se magnifiant – et c’est pourquoi lui-même il n’agit pas. Et bien qu’il soit enfin dans cette position d’entière servitude à l’égard du dieu, il est néanmoins l’expression la plus haute de la nature, c’est-à-dire son expression dionysiaque – et c’est pourquoi, comme elle, il profère sous le coup de l’inspiration oracles et sentences. Parce qu’il est le compatissant, il est aussi le sage qui annonce cette vérité jaillissant du plus profond du monde. Car c’est ainsi que prend naissance cette figure fantastique et si choquante à première vue du satyre sage et inspiré qui est en même temps, par opposition au dieu, « l’humain stupide », – image de la nature et de ses pulsions les plus vigoureuses, mieux, symbole de la nature et messager de sa sagesse et de son art – musicien, poète, danseur et voyant en une seule personne » (p. 76).
Notons au passage une affirmation surprenante, mais qui ne concerne pas la musique : « Une très ancienne croyance populaire, surtout répandue en Perse, veut qu’un mage doué de sagesse ne puisse naître que d’un inceste. Qu’on l’applique au mythe, à l’épisode de la résolution de l’énigme et des épousailles avec la mère, – et l’interprétation suit aussitôt : là où des forces prophétiques et magiques ont aboli la frontière entre présent et futur, brisé la loi rigide de l’individuation et, de manière générale, rompu le charme propre de la nature, il faut en chercher la cause dans quelque monstrueuse transgression de la nature – comme ici l’inceste. Car comment pourrait-on contraindre la nature à livrer ses secrets, si ce n’est en lui opposant une résistance victorieuse, je veux dire par un acte contre nature » (p. 79).
Mythe / religion
« Les Grecs, sur ce chemin, n’étaient pas loin de faire passer, avec autant de sagacité que d’arbitraire, tout le rêve mythique de leur jeunesse sous l’estampille historico-pragmatique de simples annales de leur jeunesse. Telles, en effet, meurent ordinairement les religions, lorsque leurs supports mythiques en arrivent, sous l’œil sévère et sèchement rationnel d’un dogmatisme orthodoxe, à être systématisés en un ensemble clos d’événements historiques, et que l’on commence à justifier anxieusement la crédibilité des mythes, tout en s’opposant à leur survie et à leur prolifération naturelles ; lorsque, en un mot, le sentiment mythique dépérit pour laisser place à une religion qui prétend à des fondements historiques. C’est de ce mythe à l’agonie que s’empara le génie renaissant de la musique dionysiaque : alors, sous sa main, on le vit refleurir encore une fois, se parer de couleurs que jamais il n’avait montrées, exhaler un parfum qui éveillait le désir et le pressentiment d’un monde métaphysique. Mais passé ce dernier éclat, le mythe dépérit, ses feuilles se flétrissent, et c’est bientôt au tour des Lucien sarcastiques de l’antiquité de courir après des fleurs décolorées et fanées qui volent aux quatre vents. Grâce à la tragédie, le mythe accède à son contenu le plus profond, à sa forme la plus expressive. Comme un héros blessé, il se redresse une dernière fois, et dans son regard brille d’une ultime et puissante clarté tout l’excès de sa force, allié au calme lucide et résigné des mourants » (p. 86). Suit un blâme d’Euripide dont les discours des héros « ne sont que masque et simulation ». « Avec lui, c’est l’homme de tous les jours qui passa des gradins à la scène et le miroir, qui ne reflétait naguère que les traits de la grandeur et de l’intrépidité, accusa désormais cette fidélité exaspérante qui reproduit scrupuleusement jusqu’aux ratés de la nature. Ulysse, entre les mains de ces nouveaux poètes, le type même du Grec pour l’art ancien, fut ravalé à la figure du Graeculus, de l’esclave domestique, débonnaire et madré, désormais placé au centre de l’intérêt dramatique. Ce dont Euripide se fait un mérite dans Les Grenouilles d’Aristophane – d’avoir, grâce à ses remèdes de bonne femme, débarrassé l’art tragique de son embonpoint pompeux, – on en voit surtout le résultat sur les héros de ses tragédies. Et pour l’essentiel, ce que le spectateur voyait et entendait sur la scène euripidienne, c’était son propre double, qu’il se réjouissait d’entendre si bien parler » (p. 87). « Exclure de la tragédie cet élément dionysiaque originel et tout-puissant, afin de la reconstruire de fond en comble sur la base d’un art, d’une morale et d’une conception du monde exclusivement non-dionysiaques, telle est, se dévoilant désormais à nous en pleine lumière, la tendance d’Euripide » (p. 92). « Car Euripide aussi, d’une certaine manière, ne fut qu’un masque. Toutefois, la divinité qui parlait par sa bouche n’était pas Dionysos, ni non plus Apollon, mais un démon de naissance toute récente – qui avait nom Socrate. Tel est le nouvel antagonisme : socratisme contre dionysisme. La tragédie grecque en périt » (p. 93).
Contre Euripide
Voici encore un long passage de l’alinéa 12 dans la traduction de 1906 :
« Après avoir reconnu qu’Euripide ne put réussir à donner au drame une base exclusivement apollinienne, et que sa tendance anti-dionysienne s’est bien plutôt fourvoyée dans un naturalisme anti-artistique, nous pouvons examiner de plus près la nature du socratisme esthétique. Son dogme suprême est à peu près ceci : « Tout doit être conforme à la raison pour être beau », argument parallèle à l’axiome socratique : « Celui-là seul est vertueux, qui possède la connaissance. » Armé de cet étalon, Euripide mesura tous les éléments de la tragédie, la langue, les caractères, la construction dramaturgique, la musique du chœur, et il les corrigea d’après ce principe. Ce que nous avons si fréquemment considéré chez Euripide, en comparant son œuvre avec la tragédie de Sophocle, comme un signe de pauvreté et d’infériorité poétiques, est le plus souvent le résultat de l’intrusion de cet esprit critique et aveuglément rationnel. Le prologue d’Euripide nous servira d’exemple pour montrer les conséquences de cette méthode rationaliste. Il n’y a rien de plus opposé à notre conception de la technique dramaturgique que le prologue dans le drame d’Euripide. Qu’un seul personnage, au commencement de la pièce, s’avance et raconte qui il est, ce qui précède immédiatement l’action, ce qui s’est passé antérieurement et même ce qui doit arriver au cours du drame, c’est là un procédé qui paraîtrait impardonnable à un poète de théâtre moderne, et qui équivaudrait pour lui à renoncer de propos délibéré à toute surprise, à tout effet. Si l’on sait d’avance tout ce qui doit arriver, qui voudra attendre que cela arrive vraiment ? — puisqu’il ne s’agit d’ailleurs ici en aucune façon d’un rêve prophétique qui laisserait entiers l’intérêt et l’émotion de sa réalisation future [2]. Euripide pensait tout autrement. Dans son esprit, l’effet produit par la tragédie n’avait jamais pour cause l’anxiété épique, l’attrait de l’incertitude au sujet des péripéties éventuelles, mais bien ces grandes scènes, pleines d’un lyrisme rhétorique, où la passion et la dialectique du héros principal s’étalaient et se gonflaient comme la crue puissante d’un large fleuve. Tout devait préparer non pas à l’action, mais au pathétique, et ce qui ne préparait pas au pathétique était à rejeter. Le plus grand obstacle à un abandon entier, au plaisir sans mélange à de telles scènes, c’est l’absence d’un élément nécessaire au préalable à l’auditeur, une lacune dans la trame des évènements préliminaires. Aussi longtemps que le spectateur est obligé de supputer avec attention l’importance ou la qualité de tel ou tel personnage, les causes de tel ou tel conflit des sentiments ou des volontés, il ne peut pas être absorbé complètement par les actions et les malheurs des héros principaux, et il lui est impossible encore de compatir, haletant, à leurs souffrances et à leurs terreurs. La tragédie d’Eschyle et de Sophocle employait les moyens artistiques les plus ingénieux pour donner à l’auditeur, dès les premières scènes et comme par hasard, toutes les indications nécessaires à l’intelligence de l’intrigue : procédé par lequel s’affirme cette noble maîtrise artistique qui, tout à la fois, masque ce qui est matériellement indispensable et le révèle sous la forme d’incidents inopinés. Cependant Euripide croyait avoir remarqué que, pendant ces premières scènes, le spectateur semblait en proie à une inquiétude particulière, préoccupé qu’il était de résoudre le problème des événements antérieurs, de sorte que les beautés poétiques et le pathétique de l’exposition étaient perdus pour lui. C’est pourquoi, avant l’exposition, il plaça le prologue et le fit réciter par un personnage en qui on pouvait avoir confiance : un dieu devait souvent se porter, pour ainsi dire, garant devant le public des événements de la tragédie et lever tous les doutes sur la réalité du mythe ; procédé analogue à celui à l’aide duquel Descartes arrivait à prouver la réalité du monde empirique, en en appelant uniquement à la véracité de Dieu incapable de mentir. Cette véracité divine, Euripide l’emploie encore une fois à la fin de son drame, pour informer le public, en toute certitude, des destinées futures de ses héros ; ceci est le rôle du fameux deus ex machina. Entre la vision épique du passé et celle de l’avenir se trouve le présent dramatico-lyrique, le véritable « Drame » ».
« Dans Platon en effet, la pensée philosophique recouvre l’art telle une végétation proliférante et l’oblige à rester étroitement agrippé au tronc de la dialectique. La tendance apollinienne s’est momifiée en schématisme logique. Nous avions déjà perçu quelque chose d’analogue chez Euripide – avec, de surcroit, une transposition du dionysiaque en affects naturalistes. Et de fait Socrate, le héros dialectique du drame platonicien, n’est pas sans parenté de nature avec le héros d’Euripide qui doit justifier ses actes par raisons et contre-raisons, au risque, souvent, de perdre notre compassion tragique » (p. 102, traduction Gallimard).
« Dans cet art théâtral nouveau, socratique et optimiste, quelle est alors la situation du Chœur et en général de toute la substance dionyso-musicale de la tragédie ? Tout cela apparaît comme quelque chose de fortuit, comme une réminiscence inutile, voire superflue, des origines de la tragédie ; tandis que nous avons reconnu que le chœur ne peut être compris que comme cause première, principe générateur, de la tragédie et du tragique en général. Déjà, chez Sophocle, on constate cet embarras à l’égard du chœur, — indice important qui nous montre que, chez lui, la matière dionysienne de la tragédie commence à se désagréger. Il n’ose plus confier au chœur le rôle émotif principal, et restreint son action à un tel point, que ce chœur semble à présent assimilé aux acteurs, comme s’il eût été transporté de l’orchestre sur la scène ; et, en dépit de l’approbation d’Aristote, son caractère est définitivement altéré. Cette perturbation dans le rôle du chœur, mise en pratique par Sophocle, et même, d’après la tradition, recommandée par lui dans un de ses écrits, est la première étape de cette annihilation du chœur, dont les phases se succèdent avec une effrayante rapidité dans Euripide, Agathon et la comédie nouvelle. Armée du fouet de ses syllogismes, la dialectique optimiste chasse la musique de la tragédie : c’est-à-dire détruit l’essence même de la tragédie, essence qui ne peut être interprétée que comme une manifestation et une objectivation d’états dionysiens, comme une symbolisation visible de la musique, comme le monde de rêve d’une ivresse dionysiaque » (traduction 1906, Wikisource).
Éloge de Schopenhauer
« Cette formidable opposition qui s’ouvre, béante, entre l’art plastique (qui est l’art apollinien) et la musique (l’art dionysiaque), il n’est qu’un seul penseur, entre les plus grands, à qui elle se soit révélée, au point que, sans nul recours au symbolisme des dieux grecs, il a reconnu que la musique diffère par son caractère comme par son origine de tous les autres arts, parce qu’elle n’est pas, comme eux, une reproduction du phénomène, mais la reproduction immédiate de la volonté, et que par conséquent elle présente à tout ce qu’il y a de physique dans le monde, le métaphysique — à l’ensemble des phénomènes, la chose en soi (Schopenhauer) » (p. 110).
Nietzsche introduit ici une longue citation de Schopenhauer (Le Monde comme volonté et comme représentation, I) « Toutes les aspirations de la volonté, tout ce qui la stimule, toutes ses manifestations possibles, tout ce qui agite notre cœur, tout ce que la raison range sous le concept vaste et négatif de « sentiment », peut être exprimé par les innombrables mélodies possibles ; malgré tout, il n’y aura jamais là que la généralité de la forme pure, la matière en sera absente ; cette expression sera fournie toujours quant à la chose en soi, non quant au phénomène ; elle donnera en quelque sorte l’âme sans le corps. Ce rapport étroit entre la musique et l’être vrai des choses nous explique le fait suivant : si, en présence d’un spectacle quelconque, d’une action, d’un événement, de quelque circonstance, nous percevons les sons d’une musique appropriée, cette musique semble nous en révéler le sens le plus profond, nous en donner l’illustration la plus exacte et la plus claire. Ce même rapport explique également cet autre fait : pendant que nous sommes tout occupés à écouter l’exécution d’une symphonie, il nous semble voir défiler devant nous tous les événements possibles de la vie et du monde ; pourtant, si nous y réfléchissons, nous ne pouvons découvrir aucune analogie entre les airs exécutés et nos visions. Car, nous l’avons dit, ce qui distingue la musique des autres arts, c’est qu’elle n’est pas une reproduction du phénomène ou, pour mieux dire, de l’objectité adéquate de la volonté et que par conséquent elle présente à tout ce qu’il y a de physique dans le monde, le métaphysique, à l’ensemble des phénomènes, la chose en soi. En conséquence le monde pourrait être appelé une incarnation de la musique tout aussi bien qu’une incarnation de la volonté ; nous comprenons désormais comment il se fait que la musique donne directement à tout tableau, à toute scène de la vie ou du monde réel, un sens plus élevé ; elle le donne, il est vrai, d’autant plus sûrement que la mélodie elle-même est plus analogue au sens intime du phénomène présent. Voilà aussi pourquoi l’on peut adapter indifféremment à une composition musicale une poésie où l’on doit chanter, ou bien une scène visible telle qu’une pantomime, ou encore tous les deux ensemble, comme dans l’opéra. De pareilles scènes de la vie humaine, soumises à être exprimées par la langue universelle de la musique, ne sont jamais en connexion nécessaire ni même en correspondance absolue avec elle ; leur relation est celle d’un exemple arbitrairement choisi avec un concept général ; elles représentent avec la précision de la réalité ce que la musique énonce avec la généralité de la pure forme. Car, de même que les notions générales, les mélodies sont dans une certaine mesure une quintessence de la réalité. La réalité, c’est-à-dire le monde des choses particulières, fournit l’intuitif, l’individuel, le spécial, le cas isolé, tant pour la généralisation des concepts que pour celle des mélodies, bien que ces deux sortes de généralités soient, à certains égards, contraires l’une à l’autre ; les concepts, en effet, contiennent uniquement les formes extraites de l’intuition et en quelque sorte la première dépouille des choses ; ils sont donc des abstractions proprement dites, au lieu que la musique nous donne ce qui précède toute forme, le noyau intime, le cœur des choses. On pourrait fort bien caractériser ce rapport en faisant appel au langage des scolastiques : on dirait que les concepts abstraits sont les universalia post rem, que la musique révèle les universalia ante rem, et que la réalité fournit les universalia in re. S’il est vrai qu’en général il puisse exister un rapport quelconque entre une composition musicale et une représentation intuitive, cela vient, comme nous l’avons dit, de ce qu’elles ne sont l’une et l’autre que diverses expressions de l’être toujours identique du monde. Si, dans un cas donné, cette relation est réelle, c’est-à-dire si le compositeur a su rendre dans la langue universelle de la musique les mouvements de volonté qui constituent la substance d’un événement, la mélodie du Lied, la musique de l’opéra sont expressives. Mais il faut que l’analogie trouvée par le compositeur soit sortie d’une connaissance immédiate de la nature du monde, connaissance que la raison elle-même ne possède point ; cette analogie ne doit pas être une imitation, obtenue par l’intermédiaire de concepts abstraits ; autrement la musique n’exprimerait plus l’être intime, la volonté, elle ne ferait qu’imiter imparfaitement le phénomène de la volonté ; c’est, à vrai dire, le cas de toute musique imitative » (fin de la citation de Schopenhauer, pp. 112 / 113).
Nietzsche y ajoute sa propre pensée : « Il n’est absolument pas possible, honnêtement, de déduire le tragique de l’essence de l’art telle qu’elle est conçue d’ordinaire sous la seule catégorie de l’apparence et de la beauté : que de la joie puisse naître de l’anéantissement de l’individu, cela n’est compréhensible qu’à partir de l’esprit de la musique. Car ce que nous révèlent les exemples particuliers d’un tel anéantissement, c’est tout simplement le phénomène éternel de l’art dionysiaque qui exprime la toute-puissance de la volonté en quelque sorte derrière le principium individuationis, l’éternité de la vie par-delà tous les phénomènes et en dépit de tous les anéantissements. La joie métaphysique qui naît du tragique est la traduction, dans le langage de l’image, de l’instinctive et inconsciente sagesse dionysiaque : le héros, cette manifestation suprême de la volonté, est nié pour notre plaisir parce qu’il n’est que manifestation et que son anéantissement n’affecte en rien la vie éternelle de la volonté. « Nous croyons à la vie éternelle », voilà ce que proclame la tragédie, alors que la musique, elle, est l’idée immédiate de cette vie. L’art plastique vise un but tout différent : en lui, Apollon surmonte la souffrance de l’individu par cette gloire de lumière dont il auréole l’éternité du phénomène ; la beauté triomphe de la souffrance inhérente à la vie, et la douleur est en un certain sens mensongèrement effacée des traits de la nature. Dans l’art dionysiaque, au contraire, et dans son symbolisme tragique, c’est de sa voix non déguisée, de sa vraie voix que nous parle cette même nature : « Soyez tels que je suis ! Moi, la Mère originelle, qui crée éternellement sous l’incessante variation des phénomènes, qui contrains éternellement à l’existence et qui, éternellement, me réjouis de ces métamorphoses ! » (p. 115).
« L’art dionysiaque lui aussi veut nous persuader de ce plaisir de l’existence, à ceci près toutefois que ce plaisir, nous ne devons pas le chercher dans les phénomènes, mais derrière eux. Sans doute nous faut-il reconnaître que tout ce qui voit le jour doit nécessairement s’apprêter à décliner et périr dans la souffrance ; sans doute sommes-nous contraints de plonger notre regard dans les terreurs de l’existence individuelle – mais non pour en rester figés d’horreur : une consolation métaphysique nous arrache, momentanément, au tourbillon des formes changeantes. Pour de brefs instants, nous sommes véritablement l’être originel lui-même, nous ressentons son incoercible désir et son plaisir d’exister ; les luttes et les tourments, l’anéantissement des phénomènes, tout cela nous paraît soudain nécessaire étant donné la surabondance des innombrables formes d’existence qui se pressent et se précipitent vers la vie, la fécondité débordante du vouloir universel ; l’aiguillon furieux de ces tourments nous transperce dans le temps même où nous ne faisons pour ainsi dire plus qu’un avec l’incommensurable et originel plaisir d’exister et où, ravis par l’extase dionysiaque, nous pressentons l’indestructible éternité de ce plaisir ; – où, nobostant terreur et pitié, nous connaissons la félicité de vivre non pas comme individus, mais en tant que ce vivant unique qui engendre et procrée, et dans l’orgasme duquel nous nous confondons » (p. 115).
« Le sacrilège du nouveau dithyrambe, c’est de transformer la musique en une contrefaçon imitative du phénomène – par exemple d’une bataille, d’une tempête –, ce qui lui enlève bien entendu toute sa fécondité mythique. Car si elle ne vise à nous plaire qu’en nous contraignant à rechercher des analogies extérieures entre tel incident de la vie ou tel événement de la nature et certaines figures rythmiques ou certaines sonorités caractéristiques, si notre raison doit se satisfaire de la reconnaissance d’analogies de ce genre, nous sommes ramenés à une disposition telle que toute fécondation du mythe est impossible. Car le mythe veut être intuitivement ressenti comme un exemple unique, l’exemple d’une vérité et d’une généralité capables d’ouvrir sur l’infini. La musique véritablement dionysiaque nous parvient comme un tel miroir du vouloir universel : l’événement que nous appréhendons intuitivement se reflète en lui et aussitôt s’amplifie pour notre sentiment jusqu’à nous donner la reproduction d’une vérité éternelle. En revanche, soumis au pittoresque musical du nouveau dithyrambe, le même événement est immédiatement dépouillé de tout caractère mythique : la musique, ici, est devenue l’indigente reproduction du phénomène, laquelle, pour cette raison, est infiniment plus pauvre que le phénomène lui-même. Car cette pauvreté amoindrit encore à ce point le phénomène, pour notre sentiment, qu’une bataille, par exemple, soumise de la sorte à l’imitation musicale, finit par s’épuiser en bruits de marches, signaux de ralliement, etc., qui fixent notre imagination sur ces seuls traits superficiels. La musique descriptive est donc à tous égards le contraire de la créativité mythique de la vraie musique : elle appauvrit encore le phénomène, quand la musique dionysiaque l’enrichit et en élargit la singularité aux dimensions d’une image du monde. Ce fut une éclatante victoire de l’esprit non dionysiaque lorsque, dans le développement du nouveau dithyrambe, il rendit la musique étrangère à elle-même et l’abaissa au rang d’esclave aliénée du phénomène. C’est la raison pour laquelle Euripide, que l’on désignait, au sens élevé du mot, comme une nature foncièrement non musicienne, est un partisan passionné de la nouvelle musique dithyrambique dont il utilise avec une prodigalité de voleur toutes les manières et les recettes à effets » (p. 118).
« […] une civilisation fondée sur le principe de la science ne peut que sombrer, du moment où elle commence a devenir illogique, c’est-à-dire à reculer devant ses propres conséquences. Notre art trahit cette situation de désarroi général : c’est en vain que l’on cherche appui, en les imitant, sur toutes les grandes époques productives et tous les grands génies créateurs, c’est en vain qu’on rassemble autour de l’homme moderne, pour le consoler, toute la « littérature universelle » et qu’on l’installe au milieu des styles et des artistes de tous les temps pour qu’il leur donne un nom – comme Adam aux animaux : il reste l’éternel affamé, le « critique » sans vigueur et sans joie, l’Alexandrin au fond bibliothécaire et correcteur d’épreuves qui, dans la poussière des livres, s’use lamentablement les yeux aux fautes d’impression » (p. 125).
Dionysiaque et orgiasme
Nietzsche développe une attaque contre le récitatif dans l’opéra, que je cite dans la version de 1906 (2 extraits) : « Pour la satisfaction de l’auditeur qui veut percevoir avec netteté les paroles, le chanteur parle plus qu’il ne chante, et, par ce demi-chant, souligne plus fortement l’expression pathétique du discours. Grâce à ce renforcement du pathos, il facilite la compréhension de la parole et fait violence à l’élément qui constitue l’autre moitié de la musique. Le véritable danger qui le menace alors est qu’il accorde quelquefois mal à propos la prépondérance à la musique, par quoi disparaîtraient aussitôt fatalement le pathétique et la clarté du langage ; et pourtant, il se sent poussé par ailleurs à abandonner sa voix à l’entraînement musical et à la faire valoir avec virtuosité. Ici, le « poète » vient à son secours, en sachant lui ménager suffisamment les occasions d’accents lyriques, de répétitions de mots et de phrases, etc., qui permettent au chanteur de se reposer en ces endroits dans l’élément purement musical, sans prendre souci des paroles. Cette alternance de discours passionnés, expressifs, bien que chantés à moitié, et d’exclamations complètement chantées, qui est l’essence du stilo rappresentativo, les brusques fluctuations de cet effort qui s’évertue à agir, tantôt sur l’intelligence et l’imagination, tantôt sur le tréfonds musical de l’auditeur, tout cela est quelque chose de si absolument anti-naturel, de si profondément opposé aussi bien aux impulsions artistiques dionysiaques qu’à la tendance apollinienne, que l’on est obligé d’en conclure que le récitatif a trouvé son origine en dehors de tout instinct artistique. » […] « Un examen attentif montre que cette influence néfaste de l’opéra sur la musique coïncide exactement avec l’évolution tout entière de la musique moderne. L’optimisme latent, inhérent à la genèse de l’opéra et à l’esprit de la culture qu’il représente, a réussi, avec une rapidité inquiétante, à dépouiller la musique de son caractère d’expression dionysiaque du monde et à lui inculquer les qualités d’un art agréable, s’amusant aux arabesques des formes. Et l’on ne saurait peut-être comparer cette transformation qu’à la métamorphose qui fit de l’homme eschyléen, l’homme de la sérénité alexandrine. »
Encore une de ces fulgurance, avec allusion à une gravure de Dürer : « Que nul ne cherche à diminuer notre foi dans la renaissance prochaine de l’antiquité hellénique : car c’est en elle, et en elle seule, que réside tout l’espoir que nous avons d’un renouveau et d’une purification de l’esprit allemand par le jeu magique de la musique. Que pourrions-nous désigner, dans cette désolation et cet épuisement de la civilisation présente, qui puisse éveiller en nous l’attente d’une consolation pour l’avenir ? C’est en vain que nous cherchons une seule racine vigoureuse, un seul coin de terre fertile et sain : partout, poussière, sable, torpeur, dépérissement. Qui s’en écarterait, solitaire et désespéré, ne pourrait trouver meilleur symbole que le Chevalier escorté de la Mort et du Diable, tel que Dürer l’a gravé : chevalier cuirassé au regard d’airain, qui suit son chemin de terreur, indifférent à ses horribles compagnons et pourtant sans espoir, seul avec son cheval et son chien. Notre Schopenhauer fut ce chevalier de Dürer : tout espoir lui faisait défaut, mais il voulait la vérité. Il n’en existe aucun qu’on lui puisse comparer » […] « Oui, mes amis, croyez avec moi à la vie dionysiaque et à la renaissance de la tragédie. Le temps de l’homme socratique est passé : couronnez-vous de lierre, prenez le thyrse en main et ne vous étonnez pas si le tigre et la panthère viennent ramper à vos genoux. Osez maintenant être des hommes tragiques , car vous serez délivrés. Accompagnez le cortège de Dionysos depuis l’Inde jusqu’à la Grèce ! Armez-vous pour un dur combat mais croyez aux miracles de votre dieu » (p. 134).

– Voici l’illustration en question empruntée à Wikisource (Le Chevalier, la Mort et le Diable, 1513, Albrecht Dürer (1471-1528).
J’ai appris un nouveau mot, « orgiasme » (célébration des mystères, des orgies) : « La tragédie absorbe l’orgiasme musical à son plus haut degré, si bien que d’un seul coup, chez les Grecs comme chez nous, elle accomplit la musique. Mais elle y ajoute aussitôt le mythe (et le héros) tragique qui, tel un puissant Titan, prend sur ses épaules tout le poids du monde dionysiaque et nous en décharge, tandis que d’autre part – toujours par le truchement du mythe, mais cette fois dans la personne même du héros – elle sait nous délivrer de l’incoercible désir qui nous pousse vers cette existence, nous rappelant à la pensée d’un autre être et d’une forme plus élevée de plaisir, que le héros pressent tout au long du combat qu’il mène, mais à quoi il se prépare en fait par sa propre ruine et non par ses victoires. Entre la validité universelle de la musique et l’auditeur prédisposé à l’émoi dionysiaque, la tragédie installe donc un substitut analogique sublime – le mythe –, et de telle sorte qu’elle finit par donner l’impression que la musique n’est que le plus puissant parmi les moyens dont dispose la représentation pour insuffler vie au monde plastique du mythe » (p. 136).
voici un long paragraphe de l’§ 21 : « Par cette harmonie préétablie qui règne entre le drame parfait et sa musique, le drame atteint à un degré de perspicuïté [3] suprême, inaccessible par ailleurs au drame parlé. Alors que les figures animées de la scène se simplifient devant nous, dans les mouvements indépendants des lignes mélodiques, pour la plus grande netteté de la ligne prépondérante, le mélange combiné de ces lignes nous fait entendre une succession d’harmonies qui traduit, avec la plus délicate fidélité, les péripéties de l’action. Par cette polyphonie, les rapports des choses nous deviennent immédiatement perceptibles, et cela non pas d’une façon abstraite, mais d’une manière matériellement sensible, de même que nous reconnaissons aussi par elle que seulement dans ces rapports peut se manifester dans toute sa pureté la nature essentielle et intime d’un caractère et d’une ligne mélodique. Et pendant que la musique nous force ainsi à voir mieux et plus profondément, et à étendre devant nous le voile de l’action comme un fin tissu de gaze, le monde de la scène est, pour notre œil spiritualisé, pénétrant jusqu’au dedans des choses, aussi infiniment agrandi qu’illuminé par une flamme intérieure. Que pourrait nous offrir d’analogue le poète littéraire qui, à l’aide d’un mécanisme moins parfait de beaucoup, par une voie indirecte, en partant de la parole et de l’idée, s’épuise à atteindre à cet épanouissement en profondeur et à ce rayonnement interne du monde perceptible de la scène ? Et si, à la vérité, la tragédie musicale s’adjoint également la parole, elle peut en même temps aussi montrer juxtaposées la cause fondamentale occulte et l’occasion génératrice de la parole et, par le rayonnement d’une lumière intérieure, rendre pour nous intelligible l’apparition de la parole et son développement futur. »
Voici deux piques contre la catharsis, dont le nom ne figure pas dans l’essai, et contre les critiques : « Il est vrai que nos esthéticiens n’ont rien su nous dire de ce retour à la patrie originelle, de cette alliance fraternelle des deux divinités de l’art dans la tragédie ni, non plus, par conséquent, de l’émotion à la fois apollinienne et dionysiaque de l’auditeur – alors qu’ils ne se sont jamais lassés de chercher dans le combat du héros contre le destin ou dans le triomphe de l’ordre moral ou dans la purification des passions provoquées par la tragédie, le caractère propre du tragique (obstination qui m’induit d’ailleurs à penser qu’il s’agit là en somme de gens tout à fait incapables d’émotion esthétique et qui n’assistent probablement à la tragédie qu’en créatures purement morales) » (p. 144). « C’est ainsi que la renaissance de la Tragédie fait renaître aussi l’auditeur esthétique, auquel s’était substitué jusque-là, dans les salles de théâtre, un étrange quiproquo, aux prétentions mi-morales et mi-savantes, le « critique ». Dans la sphère où celui-ci avait vécu jusqu’alors, tout était artificiel et fardé seulement d’une apparence de vie. L’artiste exécutant ne savait vraiment plus, en effet, comment s’y prendre avec un semblable auditeur aux allures de critique, et il lui fallait épier anxieusement, en compagnie de son inspirateur le dramaturge ou le compositeur d’opéra, les derniers restes de vie dans cette entité prétentieuse, vide et incapable de sentir » (traduction de 1906). À ce critique s’oppose le spectateur contemplatif : « Certes, à l’aide de cette clarté intérieure même, due à la musique, l’image lumineuse apollinienne n’arrivait pas à produire l’effet caractéristique de manifestations moindres de l’art apollinien. Ce que peuvent l’épopée ou le marbre animé, — forcer le regard contemplatif à une quiétude extatique en face du monde de l’individuation, — il lui fut impossible de l’atteindre, en dépit d’une vie et d’une netteté supérieures. Nous pûmes contempler le drame et pénétrer d’un œil clairvoyant jusqu’au dedans du monde agité de ses motifs, — et cependant il nous semblait ne voir se dérouler devant nous qu’un tableau symbolique, dont nous croyions presque deviner le sens le plus profond, et que nous souhaitions écarter comme un rideau, pour apercevoir au delà l’image originelle, le spectacle primordial. L’absolue clarté du tableau ne nous suffisait pas ; car celui-ci paraissait aussi bien dissimuler que révéler quelque chose ; et tandis que, par sa révélation symbolique, il semblait provoquer à déchirer le voile, à démasquer l’au-delà mystérieux cette lumineuse et intégrale évidence retenait cependant le regard fasciné, et le protégeait d’une vision plus profonde. » (§ 24, traduction 1906).
Ça sent le soufre
Certains propos dans l’ensemble du livre sentent le souffre et justifient l’accusation d’avoir fourni des arguments aux futurs nazis : « D’avoir commencé, sur le fond de la dernière musique allemande, à fabuler sur « l’âme allemande » comme si celle-ci avait été à la veille de se découvrir et de se retrouver – et cela en un temps où l’esprit allemand, qui peu auparavant avait encore la volonté de dominer l’Europe et la force de la conduire, venait irrévocablement et définitivement d’abdiquer, et, sous le pompeux prétexte d’une fondation d’empire, opérait son passage à la médiocrisation, à la démocratie, aux « idées modernes » ! » (p. 33).
Au contraire, ce passage montre que Nietsche ne prônait pas le génocide : « Et de fait, qu’on imagine un instant que la somme incalculable de forces qui s’est dépensée au profit de cette tendance universelle ait été consacrée non pas au service de la connaissance mais à la réalisation des buts pratiques, c’est-à-dire égoïstes, des individus et des peuples : il est vraisemblable alors que des guerres d’extermination généralisée et de perpétuelles migrations de peuples auraient à ce point affaibli l’instinctif plaisir de vivre que l’individu aurait peut-être vu dans la coutume du suicide le dernier vestige du sentiment du devoir, après que, à l’instar de l’indigène des îles Fidji, il eut de ses propres mains de fils et d’ami étranglé parents et amis : pessimisme pratique, qui pourrait même engendrer une effroyable morale du génocide par compassion – et qui du reste existe et a existé partout dans le monde où l’art n’est pas apparu, sous l’une quelconque de ses formes (en particulier la religion et la science), comme un remède et une protection contre ce souffle pestilentiel » (p. 107). Mais quelques pages plus loin, ce sera le contraire : « Qu’on en prenne note : pour durer, la civilisation alexandrine a besoin de l’esclavage ; mais dans sa vision optimiste de l’existence, elle en dénie la nécessité et c’est la raison pour laquelle, le jour où l’effet de ses belles paroles enjôleuses et lénifiantes sur la « dignité de l’homme » et la « dignité du travail » se sera usé, elle s’acheminera progressivement au-devant d’un horrible anéantissement. Il n’y a rien de plus terrifiant qu’une classe servile et barbare qui a appris à considérer son existence comme une injustice et qui se prépare à en tirer vengeance, non seulement pour elle, mais pour toutes les générations » (p. 122).
Mais on ne sait que dire devant ces paragraphes prophétiques à la fin de l’ouvrage (§ 24) dont la lecture a dû faire frémir les nazis : « C’est de cet abîme que s’élève vers nous le Lied dionysiaque, afin de nous faire comprendre que le chevalier de l’Allemagne n’a pas cessé de rêver en visions graves et bienheureuses son mythe dionysiaque séculaire. Gardons-nous de croire que l’esprit allemand a perdu à jamais sa patrie mythique, quand il entend si clairement encore le chant d’oiseaux qui lui en parlent. Un jour il s’éveillera, dans toute la force matinale de ce formidable sommeil : alors il tuera les dragons, il anéantira les nains perfides et réveillera Brunehilde — et la lance même de Wotan ne pourra lui barrer la route !
O mes amis, vous qui croyez à la musique dionysiaque, vous savez aussi ce que signifie pour nous la tragédie. C’est en elle que nous possédons le mythe qui renaît de la musique – et c’est en lui que vous pouvez mettre tout votre espoir, il peut vous faire oublier les pires douleurs ! Mais la pire douleur, pour nous – c’est l’interminable avilissement où l’esprit allemand, devenu étranger à sa demeure et à sa terre natale, a vécu au service de nains perfides. Vous comprenez ces paroles – comme, pour finir, vous comprendrez mes espérances » (p. 155).
– Pour se faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler une tragédie grecque à la représentation, on peut visionner un téléfilm marquant de l’histoire de la télévision, Les Perses, adaptation télévisée par Jean Prat de la tragédie d’Eschyle.
– Voir aussi notre article « Chœur, orchestre, choral(e) ».
– Un extrait de ce livre figure dans ce corpus original pour une synthèse : musique populaire.
Voir en ligne : La Naissance de la tragédie sur Wikisource, dans une traduction de 1906
© altersexualite.com 2020
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Citation du texte de l’« Hymne à la joie » de Friedrich von Schiller.
[2] Remarque amusante quand on songe au succès de Jean Anouilh dans son Antigone !
[3] Qualité d’une pensée, du style, qui fait que l’esprit voit à travers, clarté, netteté.
 altersexualite.com
altersexualite.com