Accueil > Essais & Documentaires (adultes) > Les Lieux. Histoire des commodités, de Roger-Henri Guerrand
Un livre à mettre au cabinet, pour lycéens et adultes
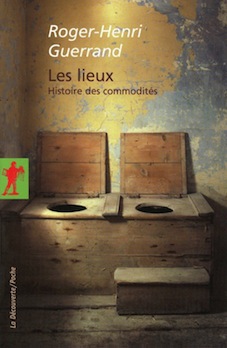 Les Lieux. Histoire des commodités, de Roger-Henri Guerrand
Les Lieux. Histoire des commodités, de Roger-Henri Guerrand
La Découverte, 1985, 212 p., 10,5 €.
samedi 8 juin 2019, par
L’amie Isabelle, à qui mon intérêt pour les lieux dans M&mnoux n’avait pas échappé, m’a offert une réédition de ce livre atypique de Roger-Henri Guerrand, qui fut son prof d’histoire à l’école d’architecture. J’ai goûté, effectivement, ce livre consacré à cette histoire modeste des détails négligés par les grands historiens, de même qu’en sociologie, Laud Humphreys s’intéressa au Commerce des pissotières, en attendant qu’un historien ou sociologue s’intéresse aux saunas et bars gays, monde éphémère en voie de disparition sous les coups de boutoirs des sites de rencontre. Je ne ferai pas de compte-rendu complet mais citerai quelques bonnes feuilles, si je puis me permettre. C’est un livre, comme dirait l’autre, à mettre au cabinet, pour l’édification de vos familiers.
L’ouvrage commence par une petite anthologie historique du caca poétique, dans laquelle nous retrouvons un vieil ami, Eustorg de Beaulieu, dont l’auteur oublie la référence à un fameux besoin du Roi Saül dans la Bible. L’une des idées défendues par Roger-Henri Guerrand est que la bourgeoisie a toujours réprimé le corps dans toutes ses expressions naturelles, tandis que l’aristocratie l’acceptait, à l’instar d’Eustorg, et ce jusqu’aux Lumières, en gros. Il cite une remarque de Montaigne qu’il faudrait inscrire en lettres d’or au fronton de nos écoles : « Qu’a fait l’action génitale aux hommes, si naturelle, si nécessaire et si juste, pour n’en oser parler sans vergogne et pour l’exclure des propos sérieux et réglés ? Nous prononçons hardiment tuer, dérober, trahir ; et cela, nous n’oserions qu’entre les dents ? » (Essais, III, 5). J’ai appris l’existence du mot « aniterge », façon cuistre de dire « torche-cul » : « le choix des aniterges, au XVIIe siècle, ne semble pas avoir été le même sujet de plaisanteries qu’à la Renaissance. D’après Liger, il dépend étroitement de la classe sociale. Le cardinal de Richelieu préférait le chanvre et Madame de Maintenon la laine mérinos. Avec les bourgeois, on descend à l’étoupe et, chez les pauvres, herbes et cailloux font l’affaire. Les intellectuels se servent de pages arrachées à des livres ou de leurs documents personnels » (p. 37). Au XVIe siècle, on place des « privés » ou « fosses d’aisance », soit au grenier, soit à la cave, en prenant soin de les éloigner « des puits, caves, citernes » (p. 40). Un certain Jean-Jacques Bouchard racontait que « L’usage des fosses de privés n’y étant point reçu, il faut aller faire ses affaires sur le toit des maisons, ce qui empuantit fort le logis et même toute la ville, principalement lorsqu’il pleut ». Ce même Bouchard racontait d’ailleurs « en caractères grecs, des scènes de masturbation collective avec ses camarades du collège de Calvy qui sont uniques dans la littérature française » (p. 40). Dans le même genre, Charles Sorel, en son Histoire comique de Francion (1623), n’avait pas peur de ce qui ferait pousser des cris de vierge effarouchée à la majorité de ceux parmi nos contemporains qui se croient libertins : « Enfin, m’étant couché sur le dos, une belle dame se vint agenouiller près de moi et, me mettant un entonnoir sur la bouche, et tenant un vase, me dit qu’elle me voulait faire boire d’une liqueur délicieuse. J’ouvrais déjà le gosier plus large que celui de ce chantre qui avala une souris en buvant, lorsque, s’étant un peu relevée, elle pissa plus d’une pinte d’urine, mesure de Saint-Denis, qu’elle me fit engorger » (cité p. 44).
De nombreux exemples sont donnés d’anecdotes dans le plus grand monde où l’on pisse ou chie sans lâcher la main d’une dame avec qui on se promène, « dans le manchon d’une dame occupée à danser », dans une loge au théâtre, etc. (p. 31).
Pour Guerrand, Sade, y compris dans son éloge de la coprophagie, « est tout aussi proche de ses contemporains qu’un Rabelais pouvait l’être. Il appartient à une tradition française que les bourgeois ne briseront vraiment qu’au XIXe siècle : ils devront payer cette tentative insensée par l’obligation de s’allonger sur les divans du Dr Freud et de ses successeurs » (p. 47). Notre ami Jonathan Swift est plus connu pour Gulliver que pour Le Grand mystère ou l’art de méditer sur la garde-robe, cité p. 52 (cf. ci-dessous). Fin XVIIIe, l’on chie toujours n’importe où, ce qui entraîne des plaintes : « Cette observation sera confirmée par le marquis de Villette, habitant du quai Voltaire : en 1793, il se plaindra que le devant de son logis soit devenu une immense latrine. « En ma qualité de témoin oculaire et nasiculaire, écrit-il, je demande à la commune de me débarrasser de ce voisinage pestilentiel. » (p. 61). Le XIXe siècle, malgré l’émergence de la pudibonderie, voit toujours la publication de réjouissants ouvrages, comme La Chézonomie ou l’art de ch… (cité p. 74) :
« Je veux toute ma vie être en honneur aux belles
Si les mâles étrons près des étrons femelles [joli chiasme !]
Ne semblent pas des nains à côté des géants
Tant les uns sont petits, les autres gros et grands »
ou encore Peteriana ou Manuel théorique et pratique de l’art de péter, vesser et roter, à l’usage des personnes constipées, graves, mélancoliques et triste.

L’installation de cabinets à la fin du XIXe ne va pas sans contraintes pour en imposer la nouveauté. D’abord, la France est en retard en Europe pour remplacer les « dispositifs à la Turque » (p. 129), puis les sièges ont aussi leurs défauts : « Mais les enfants contractent vite, à l’imitation des adultes, la mauvaise habitude de monter sur les sièges. Il faut maintenant les contraindre à s’asseoir. Pour ce faire, Perrin proposera diverses solutions : réduction intérieure du cabinet aux dimensions strictement nécessaires, de manière à obliger le déféquant à se placer forcément et directement au-dessus de la lunette du siège ; pose d’une planche sous forme de plan incliné s’élevant de l’arrière de la lunette et se dirigeant obliquement le long du dos, ce qui oblige à se pencher en avant et à s’asseoir directement au-dessus de l’orifice ; inclinaison du siège en avant à vingt-cinq degrés pour empêcher la station debout » (cité p. 131 ; je remarque d’ailleurs en cherchant les références sur Google livres, que Guerrand ne s’emmerde pas et qu’il réécrit ses citations). Les médecins de l’époque, sont soucieux du « danger de transmission d’écoulements vulvaires très tenaces et souvent graves : aussi la cinquième sous-commission a-t-elle fait expérimenter avec succès […] un dispositif qui interrompt le siège en bois dans sa partie antérieure » (E. Javal, Hygiène des écoles primaires, 1884 ; cité p. 132). Mais le plus grave danger bien sûr, dans les écoles, ce sont les « habitudes vicieuses » (p. 130), aussi préconise-t-on des solutions pratiques : « les lieux d’aisances, séparés pour chaque classe, sont placés au fond d’un couloir placé à l’air libre et séparé de la classe par une porte vitrée ; de sa chaire, le maître a vue sur les lieux d’aisances, qui sont fermés par des portes à mi-hauteur, laissant une ouverture à la partie inférieure, de sorte que du dehors le maître voit les pieds et la tête de l’élève lorsqu’il est assis, sans que celui-ci puisse être aperçu des autres élèves de la classe ». C’est là l’origine des toilettes étasuniennes, ce peuple qui vit toujours au XIXe siècle au niveau des mœurs.
J’ai eu la surprise de trouver mention de l’immeuble où j’ai l’honneur d’habiter : « L’exigence de Napias sera d’abord satisfaite dans les constructions des fondations à caractère philanthropique qui commencent à œuvrer sérieusement à la fin du XIXe siècle. En 1884, dans un immeuble à bon marché, rue Jean-Robert, édifié pour la Société civile coopérative de consommation du XVIIIe arrondissement, chaque logement dispose de ses W.-C. intérieurs. C’est la règle, à partir de 1886, dans les milliers d’appartements de la Société des logements économiques, fondée à Lyon par l’industriel Félix Mangini » (p. 137).
Des innovations curieuses et oubliées sont évoquées, comme ces « urinoirs à huile » « substitu[ant] au lavage en nappe la lubrification des dalles d’ardoises ou de ciment à l’aide d’un corps gras rendant impossible l’adhérence de l’urine et la formation d’incrustations. Ce système a été expérimenté avec succès à Berlin et à Vienne. Le poids du visiteur fait jouer un mécanisme qui provoque, avant et pendant la miction, une irrigation d’huile formant une pellicule infranchissable par l’urine. Des pissoirs fonctionnant de cette façon furent effectivement mis en service à Paris, et ils subsistèrent jusqu’au-delà de la Seconde Guerre mondiale » (p. 165). J’ignore si les urinoirs à huile de Berlin évoqués par l’auteur sont les mêmes que les Café Achteck dont j’ai pu admirer un des derniers exemplaires (ci-dessous).

Les premiers trains sont caractérisés par « La difficulté pour la classe bourgeoise française, au XIXe siècle, à tenir compte des exigences de la nature humaine », et l’auteur de citer Edmond de Goncourt, en route pour voir Flaubert à Croisset avec Daudet et Zola : « Le bonheur de Zola est troublé par une grande préoccupation, la préoccupation de savoir s’il pourra, en ce train rapide, pisser à Paris, à Mantes, à Vernon. Le nombre de fois que l’auteur de Nana pisse ou du moins tente de pisser est inimaginable » (cité p. 172). Je comprends enfin l’origine réelle de ma passion pour Zola : nous sommes atteints du même syndrome, la peur de ne pas pouvoir pisser, qui pousse à pisser dès qu’on en a l’occasion.
Les moralistes qu’étaient souvent les hygiénistes du début du XXe siècle, favorisèrent les édicules souterrains, le 1er du genre ouvrit « le 1er février 1905 » à la Madeleine à Paris, et nos amis socialistes ont eu sa peau (lire cet article). L’intérêt était de protéger les regards des dames, de favoriser la surveillance, et d’empêcher certaines pratiques perverses de pissotières, comme celle-ci évoquée p. 171, mais Guerrand ignore le mot « soupeur » : « Au dire des agents qui le connaissaient très bien, ce masochiste venait de retirer un pain qu’il avait soumis à une certaine macération ».
Guerrand entame sa conclusion avec une notion dont j’ignorais l’existence : « Du XIe au XIIIe siècle, les théologiens catholiques se sont violemment affrontés à propos d’une doctrine dont personne ne veut plus se souvenir aujourd’hui, sans doute à cause de son caractère touchant directement à la scatologie au sens philosophique du terme. Il s’agit en effet du « stercoranisme » : certains docteurs prétendaient nier que les espèces consacrées fussent vouées, après la communion, aux transformations de la digestion et à leurs suites ».
– Pour illustrer l’article, j’ai mis une photo d’une latrine à la turque de la vieille maison Skenduli à Gjirokastër en Albanie. Et ci-dessous, voici les seules toilettes – mais gratuites – que j’ai trouvées pendant une balade de déconfinement coronavirus de 10 km à Paris en mai 2020. Tous les bars étaient fermés, et la mairesse qui n’a jamais comme ses prédécesseurs appris que les électeurs eussent des tubes digestifs ni des prostates, avait fait fermer les rares sanisettes, de sorte que ces toilettes dénichées enfin sur les quais de la Seine (voie Georges Pompidou piétonnisée), vers Châtelet, furent comme un graal…

– Lire la chronique de Jean-Yves Alt.
Pour compléter cet article, voici quelques citations de Le Grand mystère ou l’art de méditer sur la garde-robe de Jonathan Swift, que ce livre m’a donné envie de découvrir. J’ai lu un recueil d’essais de Swift paru en 1995 aux éditions de Paris. Ces écrits grinçants m’ont plutôt ennuyé en général, car il y a tant d’allusions au contexte de l’époque qu’il faudrait plus de notes que de texte pour comprendre. L’essai sur la garde-robe est peut-être le plus compréhensible, et derrière l’ironie percent de légitimes préoccupations d’un esprit critique et progressiste. La traduction est celle de l’abbé Guyot-Desfontaines, le premier traducteur de Gulliver.
« Je ne trouverais donc pas inutile qu’on érigeât, sous la direction de personnes polies et bien nées, des académies, où les jeunes gens apprendraient à faire en cavaliers ce que personne ne saurait faire pour eux, et où on montrerait aux moindres demoiselles à chier comme des grandes dames. On enseignerait aux uns et aux autres comment ils doivent entrer de bon air dans les retraites, lever leurs jupes ou baisser leurs hauts-de-chausses de bonne grâce, et s’asseoir sur le siège d’une manière plaisante pour les spectateurs. On enseignerait aussi aux élèves à donner aux traits de leur visage une forme agréable et à ne prononcer que des interjections harmonieuses et significatives. Enfin, on leur y enseignerait l’art de s’essuyer proprement selon les doctes leçons que Rabelais a données » (p. 116).
« Et comme il y aura beaucoup de personnes studieuses qui n’ont de loisir pour lire que dans les latrines, et qui font un double usage des livres qu’elles lisent en sacrifiant au soulagement de leurs intestins, ces productions de la cervelle des savants, il y aura dans chaque latrine une bibliothèque, d’où on tirera pour ceux qui le voudront, au lieu du papier blanc, deux feuilles de livres convenables pour ces besoins. Pour les personnes de qualité, et pour celles qui poussent la délicatesse un peu loin, on aura dans chaque collège cacatoire un office garni de papier doré, de papier des Indes, de velours, de satin, d’écarlate, de peaux de lapins ou autres fourrures, et de belle toile de Hollande, que l’on vendra au prix fixé par les directeurs » (p. 121).
– J’ajoute encore cet extrait de L’Espèce humaine (1947) de Robert Antelme (p. 113) : « Aux chiottes, deux Polonais fument un mégot ; deux Français sont assis sur la barre au bord de la fosse. J’ai enlevé les ficelles qui retiennent mon pantalon, et je l’ai ouvert ainsi que mon caleçon déchiré. Je ne vois guère mes cuisses qu’aux chiottes : elles sont mauves, leur peau est ridée ; celles d’un Français qui est assis sur la barre sont plus blanches. On s’habitue à se regarder chier, mais il reste toujours un peu de curiosité. Les plus silencieux se livrent ici, les plus redoutables aussi. Le gros kapo Ernst, qui cogne, essaye lui aussi de rigoler avec nous quand il chie. Ici, il ne peut pas garder sa dignité (c’est pour cela d’ailleurs qu’à l’usine, des cabinets sont réservés aux civils), et il essaye de faire comme s’il choisissait pour un moment l’humilité de sa situation, en parlant amicalement avec ceux qui sont là. Quelquefois, il se trouve que ce soit avec celui sur lequel il vient de cogner. Mais Ernst ne peut rien faire pour ne pas nous paraître indécent : ses caleçons sont blancs, ses cuisses énormes. Il est fort même en chiant. Il ne peut pas devenir un type à cuisses grises ou mauves, à genoux proéminents. Il est plus criant que jamais qu’il bouffe au moins ses trois rations de pain par jour, une série de gamelles, etc. »
– Voir d’autres extraits du même livre ici, là et encore là.
– Lire la chronique de Jean-Yves Alt sur Culture et débats.
– Si vous aimez les lieux, alors vous adorez les pets, ou je m’abuse ? En ce cas, humez la conférence de Bernard Joubert sur le pet en Bande Dessineé, et sa primesautière chanson « Le peintre des cabinets ». Tiens, ça me rappelle la bucolique chanson « Délicacas » de Claude Astier (mort en 2017), un chanteur interdit à la radio et à la télé, donc un chanteur de talent, dont il reste si peu de traces sur Internet, ici chanté par Dominique Mac’Avoy.
– En août 2023, bref hommage à Annie Dingo, la Madone des toilettes publiques, qu’aurait adorée Zola.
Voir en ligne : Numéro spécial « Et merde ! » de la revue S !lence
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com