Accueil > Essais & Documentaires (adultes) > Soumission à l’autorité, de Stanley Milgram
Expérience phare de la psychologie sociale
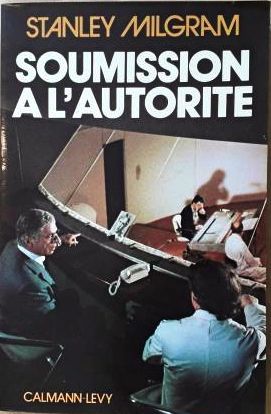 Soumission à l’autorité, de Stanley Milgram
Soumission à l’autorité, de Stanley Milgram
Calmann-Lévy, 1974, 272 p., 22,4 €
samedi 2 mai 2020, par
C’est après avoir lu Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens, de Robert-Vincent Joule & Jean-Léon Beauvois, que j’avais voulu lire cette bible de la psychologie sociale, mais aussi revoir I… comme Icare, le film de Henri Verneuil (1979) avec Yves Montand, qui m’avait profondément marqué dans mon adolescence. Ces œuvres peuvent avoir une vertu pédagogique à une époque de coronavirus où l’autorité se dissout tellement qu’on ne sait plus même qu’on lui obéit aveuglément. Les journalistes & politiciens qui suivent le troupeau panurgesque des contempteurs du Docteur Raoult aux ordres de l’État, et qui ne défendent pas la liberté de prescrire des médecins généralistes, sont-ils conscients qu’ils se sont peut-être faits complices de l’assassinat de milliers de petits vieux qu’on a laissé crever dans les Ehpad, en les envoyant au lit avec un doliprane et une camomille sans leur prescrire un traitement compassionnel qui aurait pu les sauver ?
Soumission à l’autorité, de Stanley Milgram
Voici un extrait de l’introduction de cet essai fameux de Stanley Milgram (1933-1984). L’expérience de Milgram est sans doute la plus célèbre des expériences de psychologie sociale du XXe siècle. Il est étonnant que son inventeur n’ait publié en français qu’un seul livre. En mai 2013 est paru un autre livre chez Zones, qui est constitué d’articles sur la même expérience, mais tout est déjà là, de façon très circonstanciée. Voici cet extrait utilisable en classe, qui explique l’ensemble de la méthode et de ses conclusions.
« L’extermination des Juifs européens par les nazis reste l’exemple extrême d’actions abominables accomplies par des milliers d’individus au nom de l’obéissance. Cependant, à un degré moindre, le même type de phénomène se reproduit constamment : des citoyens ordinaires reçoivent l’ordre de tuer leurs semblables et ils l’exécutent puisqu’ils estiment que c’est leur devoir. Ainsi, l’obéissance à l’autorité, longtemps prônée comme une vertu, revêt un aspect différent quand elle est au service d’une cause néfaste ; la vertu se mue alors en vice odieux. Que faut-il en penser ?
Le problème moral que pose l’obéissance dans les cas où il y a conflit entre l’ordre donné et la conscience a été traité par Platon, mis en scène dans Antigone et analysé sur le plan philosophique à chaque époque de l’histoire. Pour les philosophes conservateurs, toute rébellion met en péril les fondements de l’édifice social ; même si la décision prise en haut lieu est mauvaise, mieux vaut s’y soumettre qu’ébranler la structure de l’autorité. Hobbes devait par la suite affirmer que la responsabilité d’un acte accompli dans ces conditions incombe non pas à l’exécutant, mais uniquement à l’instigateur. Inversement, les humanistes mettent l’accent sur la suprématie de la conscience individuelle en pareil cas et soutiennent que l’éthique personnelle doit primer l’autorité quand il y a conflit entre elles.

L’aspect légal et l’aspect philosophique de l’obéissance sont d’un intérêt considérable. Mais pour l’homme de science de formation empirique vient toujours le moment où il souhaite passer de la discussion abstraite à l’observation rigoureuse d’exemples concrets. Afin d’analyser avec précision l’acte d’obéissance, j’ai réalisé à l’Université de Yale une expérience simple. Elle devait par la suite entraîner la participation de plus d’un millier de sujets et être reprise dans diverses universités, mais au départ, la conception en était élémentaire. Une personne vient dans un laboratoire de psychologie où on la prie d’exécuter une série d’actions qui vont entrer progressivement en conflit avec sa conscience. La question est de savoir jusqu’à quel point précis elle suivra les instructions de l’expérimentateur avant de se refuser à exécuter les actions prescrites.
Il est toutefois nécessaire que le lecteur ait plus de détails sur l’expérience. Deux personnes viennent dans un laboratoire de psychologie qui organise une enquête sur la mémoire et l’apprentissage. L’une d’elles sera le « moniteur », l’autre, « l’élève ». L’expérimentateur leur explique qu’il s’agit d’étudier les effets de la punition sur le processus d’apprentissage. Il emmène l’élève dans une pièce, l’installe sur une chaise munie de sangles qui permettent de lui immobiliser les bras pour empêcher tout mouvement désordonné et lui fixe une électrode au poignet. Il lui dit alors qu’il va avoir à apprendre une liste de couples de mots ; toutes les erreurs qu’il commettra seront sanctionnées par des décharges électriques d’intensité croissante.
Le véritable sujet de l’expérience, c’est le moniteur. Après avoir assisté à l’installation de l’élève, il est introduit dans la salle principale du laboratoire où il prend place devant un impressionnant simulateur de chocs. Celui-ci comporte une rangée horizontale de trente manettes qui s’échelonnent de quinze à quatre cent cinquante volts par tranches d’augmentation de quinze volts et sont assorties de mentions allant de CHOC LÉGER à ATTENTION : CHOC DANGEREUX. On invite alors le moniteur à faire passer le test d’apprentissage à l’élève qui se trouve dans l’autre pièce. Quand celui-ci répondra correctement, le moniteur passera au couple de mots suivant. Dans le cas contraire, il devra lui administrer une décharge électrique en commençant par le voltage le plus faible (quinze volts) et en augmentant progressivement d’un niveau à chaque erreur (trente volts, quarante-cinq volts, ainsi de suite).

Le moniteur est un sujet absolument « naïf », venu au laboratoire pour participer à une expérience. Par contre, l’élève, ou victime, est un acteur qui ne reçoit en réalité aucune décharge électrique. L’expérience a pour objet de découvrir jusqu’à quel point un individu peut pousser la docilité dans une situation concrète et mesurable où il reçoit l’ordre d’infliger un châtiment de plus en plus sévère à une victime qui proteste énergiquement. À quel instant précis le sujet refusera-t-il d’obéir à l’expérimentateur ?
Le conflit surgit quand l’élève commence à donner des signes de malaise. À soixante-quinze volts, il gémit. À cent vingt volts, il formule des plaintes en phrases distinctes. À cent cinquante volts, il supplie qu’on le libère. À mesure que croît l’intensité des décharges électriques, ses protestations deviennent plus véhémentes et pathétiques. À deux cent quatre-vingt-cinq volts, sa seule réaction est un véritable cri d’agonie.
Tous les témoins s’accordent à dire qu’il est impossible de restituer par l’écriture le caractère poignant de la situation. Pour le sujet, l’expérience n’est pas un jeu, mais un conflit intense et bien réel. D’un côté, la souffrance manifeste de l’élève l’incite à s’arrêter ; de l’autre, l’expérimentateur, autorité légitime vis-à-vis de laquelle il se sent engagé, lui enjoint de continuer. Chaque fois qu’il hésite à administrer une décharge, il reçoit l’ordre de poursuivre. Pour se tirer d’une situation insoutenable, il doit donc rompre avec l’autorité. Le but de notre investigation était de découvrir quand et comment se produirait cette rupture en dépit d’un impératif moral clairement défini.
Il y a naturellement des différences énormes entre le fait d’obéir aux ordres d’un officier en temps de guerre et celui d’obéir aux ordres d’un expérimentateur. Cependant, il existe entre les deux cas une relation fondamentale puisqu’on peut se poser à leur sujet la même question générale : comment un individu se comporte-t-il quand une autorité légitime lui demande d’agir contre un tiers ? À tout le moins, on peut s’attendre à ce que l’ascendant de l’expérimentateur soit moindre que celui du chef militaire puisqu’il ne dispose d’aucun moyen de coercition pour renforcer les injonctions et qu’en outre, la participation à une expérience de psychologie ne peut guère prétendre avoir le caractère de nécessité impérieuse et d’engagement total qu’implique la participation à la guerre. En dépit de ces différences d’ordre de grandeur, j’ai estimé qu’il valait la peine d’entreprendre une observation rigoureuse du phénomène d’obéissance, même dans une situation aussi limitée que celle du laboratoire. J’espérais qu’elle nous permettrait de mieux saisir tous les aspects de ce phénomène et nous fournirait des propositions générales applicables à toute une série de cas particuliers.
La première réaction du lecteur sera peut-être de s’étonner qu’un individu en possession de toutes ses facultés consente à administrer un choc électrique, si léger soit-il, à un tiers. N’aura-t-il pas immédiatement le réflexe de refuser et de s’en aller ? Or, le fait est qu’aucun des participants ne l’a eu. Le sujet est venu au laboratoire pour aider l’expérimentateur, il se montre donc très désireux de commencer l’expérience. Rien de très extraordinaire dans cette attitude, d’autant plus qu’au départ, l’élève semble tout disposé à coopérer, en dépit de quelque appréhension. Ce qui se révèle surprenant, c’est de constater jusqu’où peut aller la soumission d’un individu ordinaire aux injonctions de l’expérimentateur. À vrai dire, les résultats de l’expérience sont à la fois inattendus et inquiétants. Même si l’on tient compte du fait que beaucoup de sujets éprouvent un stress considérable et que certains protestent auprès de l’expérimentateur, il n’en demeure pas moins qu’une proportion importante d’entre eux continue jusqu’au niveau de choc le plus élevé du stimulateur.
Nombreux sont ceux qui obéissent, quelles que soient la véhémence des plaintes de la victime, sa souffrance manifeste, ses supplications pour qu’on la libère. Un tel comportement a été constaté à maintes reprises au cours de notre enquête ainsi que dans plusieurs universités où l’expérience a été reproduite. C’est cette propension extrême des adultes à la soumission quasi inconditionnelle aux ordres de l’autorité qui constitue la découverte majeure de notre étude. Il y a là un phénomène qui exige une explication.
La plus courante consiste à prendre ceux qui ont administré toute la gamme des décharges pour des monstres constituant la tranche sadique de la société. Toutefois, si l’on considère que près des deux tiers des participants sont entrés dans la catégorie des sujets « obéissants » et qu’ils représentaient des gens ordinaires, ouvriers, chefs d’entreprise et cadres supérieurs, l’argument devient bien fragile. En vérité, il rappelle singulièrement les réactions déclenchées en 1963 par le livre de Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem. L’auteur soutenait que les efforts de l’accusation pour dépeindre le coupable comme un monstre sadique partaient d’un point de vue totalement faux, qu’Eichmann était bien davantage un rond-de-cuir sans initiative qui se contentait de s’asseoir derrière son bureau et de s’acquitter de sa tâche. Pour avoir exprimé de telles opinions, Hannah Arendt s’attira un mépris immense allant même jusqu’à la calomnie. Obscurément, chacun estimait que les abominations perpétrées par Eichmann ne pouvaient qu’être le fait d’une personnalité bestiale, pervertie et sadique, l’incarnation même du mal. Après avoir constaté au cours de mes propres expériences la soumission inconditionnelle de centaines d’individus ordinaires, force m’est de conclure que la conception de la banalité du mal formulée par Hannah Arendt est plus proche de la vérité que nous n’aurions jamais osé l’imaginer. Ceux qui ont administré des chocs électriques à la victime l’ont fait non pour assouvir des tendances particulièrement agressives, mais parce que l’idée qu’ils avaient de leurs obligations en tant que sujets les y contraignait moralement.
C’est peut-être là l’enseignement essentiel de notre étude : des gens ordinaires, dépourvus de toute hostilité, peuvent, en s’acquittant simplement de leur tâche, devenir des agents d’un atroce processus de destruction. En outre, même lorsqu’il ne leur est plus possible d’ignorer les effets funestes de leur activité professionnelle, si l’autorité leur demande d’agir à l’encontre des normes fondamentales de la morale, rares sont ceux qui possèdent les ressources intérieures nécessaires pour lui résister. Toute une gamme d’inhibitions s’oppose à une éventuelle révolte et parvient à maintenir chacun au poste qui lui a été assigné ». [fin de l’extrait de la préface, pp. 18 à 22.]
En dehors de cet extrait, j’ai relevé d’autres citations fort intéressantes. Par exemple, toujours dans la préface : « C’est pourquoi l’image de l’individu solitaire confronté à une autorité — image que mon expérience crée pour les besoins de mes investigations — est une distorsion illusoire de la façon dont les choses fonctionnent dans le monde réel. Car, à moins que l’individu puisse intégrer ses actions dans une communauté élargie qui lui fournira un support, il y a de fortes chances pour qu’il demeure un velléitaire d’une totale inefficacité » (p. 10). Cela me semble être un parfait portrait de notre Lorenzaccio. Un détail de l’expérience nous titille aujourd’hui, c’est quand parmi les nombreuses variantes, Milgram a enfin l’idée de faire réaliser l’expérience par… des femmes ! Ce qui nous fait comprendre que toutes les autres l’étaient uniquement avec des hommes ! (p. 85). Milgram cite à plusieurs reprises Le Cheval dans la locomotive, essai d’Arthur Koestler : « les impulsions égoïstes de l’homme constituent un danger historique bien moindre que ses tendances d’intégration » (p. 183 ; citation tirée du livre de Koestler signalé, à la p. 230 de l’édition Calmann-Lévy). Cette citation me fait penser à des propos prêtés à Hannah Arendt dans le film éponyme de Margarethe von Trotta sorti en 2013. Je ne suis pas tout à fait d’accord quand Milgram explique que les soldats ne tuent que pour obéir. À mon avis il faut distinguer le soldat de conscription et celui de métier, qui dans certains cas, comme disait Maxime le Forestier sur un disque aujourd’hui introuvable paru en 1975 à propos des militaires obéissant à Pinochet au Chili de 1973 : « Il obéit aux ordres parce que les ordres lui plaisent » (citation de mémoire). Et certains témoignages sur le camp de Guantánamo vont dans ce sens. On trouve une longue interview édifiante publiée le 25 novembre 1969 par le New York Times d’un soldat ayant participé au massacre de My Lai en mars 1968, qui plaide aussi pour l’obéissance aveugle (pp. 226 à 229). En gros, il a massacré des civils, femmes, enfants, bébés y compris, parce qu’on le lui a ordonné. Au contraire, Chuck Yeager, qui fut en 1947 le premier aviateur à passer le mur du son – protagoniste du livre et du film L’Étoffe des héros – raconte dans son autobiographie quels étaient ses scrupules à exécuter les ordres de bombardements de civils en Allemagne : Il se rappelle que lors d’un briefing, il murmura à son voisin : « Si nous faisons des choses pareilles, nous devrons vraiment nous efforcer d’être dans le camp des vainqueurs. »
Tout cela fait écho à mon engagement de jeune homme comme objecteur de conscience, même si je dois reconnaître avoir mis beaucoup de ruisseaux, des océans d’eau dans mon vin depuis… À l’époque, j’avais des idées du style : un vrai ministère de la défense devrait consacrer de l’énergie à la défense passive. Par exemple, si un occupant ordonne que les juifs doivent porter une étoile jaune, immédiatement, TOUS les citoyens — parce qu’on les a formés à ça — arborent une étoile jaune. Du style « nous sommes tous des juifs allemands » (d’après Hannah Arendt, c’est ce qui se passa au Danemark, seul pays européen s’étant opposé aux nazis de cette façon). Actualisation : si une jeune fille montre ses seins pour protester contre le sexisme, et qu’elle est emprisonnée pour cela, tous les citoyens — filles ou garçons — montrent leur solidarité en en faisant autant, de façon à ce que les prisons soient saturées, et que l’application de la loi devienne impossible. Tss… comment ai-je pu avoir ce genre d’idée ? Pour conclure sur Hannah Arendt et sur Milgram, je crois que c’est surtout la polémique engendrée par son livre, qui a permis de théoriser la « banalité du mal », que le livre lui-même, qui est un ouvrage journalistique plus que philosophique. Le livre de Milgram semble la théorisation nécessaire à la réflexion de la philosophe, qui manquait dans cet ouvrage. Cela dit c’est un livre essentiel pour comprendre comment le génocide a eu lieu, et la participation, ou même la collaboration des dirigeants juifs européens à ce génocide, que dénonce Arendt (ou plutôt qu’elle expose), et qui lui a valu un déferlement de critiques haineuses du monde juif, est à mon avis le point de départ de l’expérience de Milgram.
I… comme Icare, d’Henri Verneuil
J’ai pour ma part été profondément marqué dans mon adolescence par cette expérience de Milgram, dont j’avais eu connaissance par le film I… comme Icare (1979) d’Henri Verneuil (1920-2002), et je crois que de là date une certaine incapacité personnelle à assumer l’autorité sans réplique qui devrait être l’apanage de tout prof. J’appelle cela « angélisme de gauche » faute de mieux. Funny Games de Michael Haneke peut être considéré comme une variation sur ce thème. Il se trouve que j’ai revu ce film en 2020, parce qu’il me semblait intéressant dans le cadre du thème de BTS « Seuls avec tous ». J’ai donc décidé de ne pas l’infliger à mes étudiants en entier, parce que ce 2e visionnement m’a révélé un film au scénario cousu de fil blanc sur un thème rebattu (le complot politique), loin du niveau de films précédents de Verneuil comme Le Président (1961) ou Le Clan des Siciliens (1969), avec un Yves Montand qui cabotine un max et n’a pas de répondant dans la distribution, aucun rôle féminin qui ne soit un faire-valoir, bref, un film qu’on pourrait oublier (malgré la partition d’Ennio Morricone) si n’était la scène-clé de l’expérience de Milgram, qui m’avait à ce point marqué qu’à 30 ans de distance, j’avais l’impression de l’avoir vue la veille. Cette scène dure 19’30 explications comprises, de 1h11 à 1h30, sur un film de 2h02 (qui aurait pu largement tenir en 1h30). L’expérience y est fidèlement reproduite, avec Marcel Maréchal dans le rôle de l’élève qui simule les chocs électriques et Roger Planchon dans le rôle du Pr David Naggara, c’est-à-dire Milgram ! Y a-t-il de l’ironie à choisir deux grands hommes de théâtre dans ces rôles ? Le « moniteur » est incarné par Jacques Denis. La séquence est mise en ligne sur Odysée en 2021, à l’occasion du covidisme, qui est une expérience de Milgram à l’échelle planétaire.

Ce photogramme montre Planchon en gros plan devant Maréchal, alors qu’en hors-champ, Montand incarne le procureur Henri Volney qui, selon le mot malicieux du Pr Naggara, a attendu 185 volts pour réagir. Ce choix d’acteurs nous met sur la piste d’une mise en abyme, qui pousse à nous interroger sur la limite entre réalité et fiction du scénario. En effet, ce scénario cousu de fil blanc brode sur le thème de l’assassinat de John F. Kennedy, qui déjà en 1979 avait connu pas mal d’adaptations. On dirait que le réalisateur nous dit : « Eh les gars, c’est pas du théâtre : ça a vraiment eu lieu, et on cherche toujours le coupable ! » La scène en elle-même est une pièce rapportée et pourrait être retirée du film sans problème ; il s’agit juste de prouver que la chèvre (le faux tueur) Daslow a pu accepter cette « mission » par simple obéissance à une autorité qu’il reconnaît, tandis que le vrai tueur n’a agi que pour l’argent. Or le scénario abat tout cet échafaudage lorsqu’on finit par abattre aussi le vrai tueur, après avoir abattu 9 témoins gênants pour le protéger, en vain. Bref, rien de plausible, sauf à aboutir, comme c’est la règle dans ce genre de films, à montrer que le vrai caïd reste toujours en place. Mais on a vu dix fois mieux dans le genre, comme par exemple, sorti la même année, l’excellent Qui a tué le président ? De William Richert. Donc ne retenons du film que cette séquence isolée, à intégrer peut-être à une séquence sur le pouvoir. Vous trouverez un autre photogramme du film dans cet article et là aussi.
– Voir aussi mon article sur Paranoid Park, de Gus Van Sant, qui contient à mon avis une illustration de ladite expérience. Dans Journaux de guerre d’Ernst Jünger (tome 1, 1914-1918), on trouve une réflexion sur la responsabilité du soldat, indépendamment de celle qui est endossée par l’État, ce qui est intéressant vu que l’auteur est loin d’être un antimilitariste. Georges Bernanos a également développé ce type de réflexion dans La France contre les robots.
– Dans cet article du Parisien sont évoquées des pratiques de management à France Telecom qui semblent redoubler l’expérience de Milgram : « En juin 2009 son supérieur hiérarchique lui demande d’aller superviser des plateaux d’appels téléphoniques au SNC (Service national des consommateurs), un service qui traite des réclamations de clients. Une mission très éloignée de sa fonction d’origine. Il devra désormais vérifier le temps que les salariés prennent pour manger, pour « aller aux toilettes ». Mais aussi s’assurer que les communications téléphoniques ne soient pas trop longues. Un « garde-chiourme » déclare-t-il. « Vous êtes en pleine ascension et, du jour au lendemain, on vous fusille ». Ici l’expérimentateur n’est pas consentant, et c’est pour l’humilier lui qu’on le force à humilier autrui.
Voir en ligne : L’expérience de Milgram, sur Wikipédia
© altersexualite.com 2020
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com