Accueil > Zola pour les nuls > Nana, d’Émile Zola
« Nom de Dieu, quelles couilles vous avez ! » pour lycéens et adultes
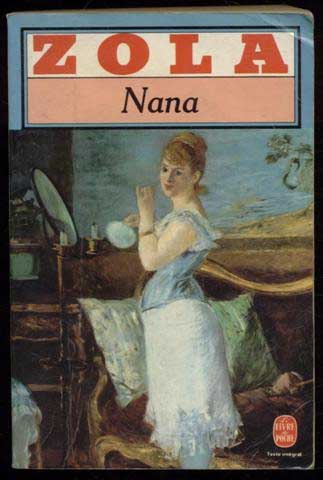 Nana, d’Émile Zola
Nana, d’Émile Zola
GF Flammarion, 1880 (éd. 2000).
mardi 1er mars 2016
J’ai utilisé une édition de 2000, revue en 2013, par Marie-Ange Fougère, disponible en GF Flammarion (510 p., 4 €). Après la parenthèse popote de Une page d’amour, on renoue avec le terreau proprement zolien laissé en plan après le scandale de L’Assommoir. Nana, alias Anna Coupeau, est la fille de Gervaise et de Coupeau, qu’on avait vu grandir notamment au chapitre XII de L’Assommoir, mais elle n’évolue pas dans les mêmes sphères. La seule mention de ce chapitre au succès de Nana en prostituée de luxe, quand elle est aperçue par le chapelier : « Oui, elle était en voiture, et une toilette d’un chic !… Je ne la reconnaissais pas, tant elle ressemblait à une dame de la haute, les quenottes blanches dans sa frimousse fraîche comme une fleur. C’est elle qui m’a envoyé une risette avec son gant… Elle a fait un vicomte, je crois. Oh ! très lancée ! Elle peut se ficher de nous tous, elle a du bonheur par-dessus la tête, cette gueuse !… », n’est pas reprise dans Nana, où Gervaise et Coupeau ne sont évoqués que morts depuis longtemps. Selon Marie-Ange Fougère, loin de chercher à émoustiller le lecteur, le moraliste Zola cherche avant tout à « désacraliser le mythe romantique du rachat de la courtisane » ; autant dire qu’il écrit l’anti Splendeurs et Misères des courtisanes, d’Honoré de Balzac. Son point de vue sur la prostitution et sur la femme est digne de certains fanatiques islamistes actuels, si l’on en croit cette critique d’un spectacle d’Offenbach rédigée en 1868, citée dans la préface de l’édition GF : « Le jour où une femme aura l’idée sublime de se mettre à quatre pattes sur la scène et de jouer au naturel le rôle d’une chienne errante, ce jour-là Paris se rendra malade d’enthousiasme. Nous n’en sommes qu’aux coups de hanche et aux jeux de poitrine. Mais patience, la pente est fatale : nous roulerons jusqu’au ruisseau. À moins que l’écœurement ne vienne et que, pris de nausées, nous ne chassions les cascadeuses de nos théâtres. » Il faut cependant remettre les choses dans leur contexte : par cette diatribe, Zola s’en prenait sans doute surtout à la façon dont les hommes riches traitaient les femmes. Détail amusant, Ludovic Halévy, librettiste d’Offenbach est un des amis de Zola, qu’il consulte pour sa documentation ! Mieux vaut s’adresser au diable qu’à ses diablotins ! L’édition GF est d’un bon usage, même si les notes de bas de page sont agaçantes. On a en effet un mélange de notes pour les ignares (ex : « persiennes » a droit à une note indiquant : « volets », p. 83), plus des renvois incessants à une note d’une page précédente dès que le mot en question a déjà été employé, alors qu’en ce cas un glossaire aurait suffi, et parfois au contraire, on a des notes d’apparat critique très utiles, de sorte qu’on se croit obligé d’interrompre sa lecture à toutes ces notes pour ne pas rater les 5 % de notes utiles. Je relève même une note contestable au mot « œuvre cyclopéenne », indiquant « gigantesque », ce qui est un raccourci audacieux !
Genèse
Nana fait partie des dix romans pour lesquels Zola avait envoyé à son éditeur Lacroix en 1869 un bref scénario, avec les noms de personnages qu’il avait choisis à l’époque : « Un roman qui a pour cadre le monde galant et pour héroïne Louise Duval, la fille du ménage d’ouvriers. De même que le produit des Goiraud, gens enfoncés dans la jouissance, est un avorton social, de même le produit des Bergasse, gens gangrenés par les vices et la misère, est une créature pourrie et nuisible à la société. Outre les effets héréditaires, il y a, dans les deux cas, une influence fatale du milieu contemporain. Louise est ce qu’on appelle une « biche de haute volée ». Peinture du monde où vivent ces filles. Drame poignant d’une existence de femme, perdue par l’appétit du luxe et des jouissances faciles. » Le dossier de l’œuvre expose crument le propos : « Le sujet philosophique est celui-ci : toute une société se ruant sur le cul. Une meute derrière une chienne qui n’est pas en chaleur et qui se moque des chiens qui la suivent. Le poème des désirs du mâle, le grand levier qui remue le monde. Il n’y a que le cul et la religion. » On lira avec profit un article de fond de Sophie Ménard (référence en fin d’article), qui étudie ces ébauches, dans lesquelles elle retrouve la trace de la fameuse mise en abyme que constitue l’article de Fauchery intitulé « La Mouche d’or » (chapitre VII) : « [Nana] devenant une force de la nature, un ferment de destruction, mais cela sans le vouloir, par son sexe seul et par sa puissante odeur de femme, détruisant tout ce qu’elle approche, faisant tourner la société comme les femmes qui ont leurs règles font tourner le lait. Le cul dans toute sa puissance ; le cul sur un autel et tous sacrifiant devant. Il faut que le livre soit le poème du cul, et la moralité sera le cul faisant tout tourner. » Le livre a été publié en feuilleton dans Le Voltaire du 16 octobre 1879 au 5 février 1880, puis en volume chez Charpentier, le 14 février 1880. Fait remarquable, Zola termine son livre le 7 janvier 1880 au matin, alors que la publication des premiers chapitres a déjà entraîné une féroce bataille à laquelle il a dû répondre par un article dans le même Voltaire !
Dossier
L’édition GF propose un dossier utile pour les lycéens, avec de nombreux documents sur la théorie naturaliste, contemporains de la rédaction de Nana, Le Roman expérimental datant justement de Nana, qui s’écarte pourtant tellement de l’orthodoxie naturaliste ! Quand Zola se défend de l’accusation d’obscénité, on s’amuse un peu de sa pose de père la morale pourfendant ses prédécesseurs justement sur le plan de la moralité. Il leur reproche leurs « idéalisations continuelles de la débauche qui la montrent provocante, toute puissante dans une apothéose de jouissance et de luxe. Encore un coup, voilà les seuls spéculateurs de l’obscénité moderne. Ils vivent du vice enguirlandé, ils battent monnaie avec l’hypocrisie de notre âge. […] il suffit qu’ils aient menti, qu’ils aient voilé l’alcôve d’un rideau rose, qu’ils aient chanté le vice en idéalistes au lieu de le marquer d’un fer rouge en naturalistes, pour que leur besogne soit empoisonnée et tombe quand même à une immoralité finale ». On agrée cependant quand il remarque dans sa conclusion : « Rien ne pousse moins à la gaudriole que nos livres » ! Pour sa documentation, on apprend que Zola a utilisé un chapitre sur la prostitution de l’ouvrage de Maxime Du Camp, Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il aurait aussi fréquenté l’hôtel particulier de Valtesse de La Bigne, dont l’histoire ressemble à celle de Nana, et lui a emprunté le motif du lit d’apparat de Nana. L’article du Voltaire mentionné ci-dessus est cité, avec cette conclusion amusante de mauvaise foi : « j’ai eu l’ambition, sans doute trop grande, de vouloir planter debout une fille, la première venue, comme il y en a plusieurs milliers à Paris, et cela pour protester contre les Marion Delorme, les Dame aux camélias, les Marco, les Musettes, toute cette sentimentalité, tout cet enguirlandage du vice que je trouve dangereux pour les mœurs et d’une influence désastreuse sur l’imagination de nos filles pauvres ». « Comme il y en a plusieurs milliers à Paris » est fort de café, quand il fait de cette jeunette inculte la reine de Paris ! Mais sans doute était-il de bonne guerre de retourner l’attaque sur d’autres ouvrages. Les articles, parfois publiés au cours de la parution en feuilleton, sont virulents, mais ils tapent parfois juste, à l’instar de Georges Ohnet : « sa « Nana » est une caricature. Le romancier a fait injure aux courtisanes contemporaines, il les a calomniées. Elles sont scélérates, elles ne sont point stupides ». Cela rejoint le jugement porté par Valtesse de La Bigne sur le personnage qu’elle a informé en partie : « Nana est une vulgaire catin, sotte, grossière ! » Jules Lemaître me semble voir juste quand il pose que Zola est plus poète que naturaliste : « Lorsque M. Zola parvient à revêtir cette idée d’une forme concrète, comme dans le grand tableau des courses, où Paris, hurlant autour de Nana, semble saluer en elle la reine de l’impudicité et ne sait plus trop s’il acclame la fille ou la jument, c’est bien vraiment de l’art idéaliste et de la pure poésie. » Quant à Flaubert, Nana est le dernier Zola qu’il aura l’occasion de lire, et il lui écrit une de ses dernières lettres le 15 février 1880, quelques semaines avant sa mort (mais ils se verront encore d’ici là), pour lui tresser ces lauriers : « J’ai passé hier toute la journée jusqu’à 11 heures et demie du soir à lire Nana. Je n’en ai pas dormi cette nuit et « j’en demeure stupide ». Nom de Dieu, quelles couilles vous avez ! quelles boules ! S’il fallait noter tout ce qui s’y trouve de rare et de fort, je ferais un commentaire à toutes les pages ! Les caractères sont merveilleux de vérité. Les mots nature foisonnent ; à la fin, la mort de Nana est Michelangelesque ! Un livre énorme, mon bon ! […] Maintenant, que vous ayez pu économiser les mots grossiers, c’est possible ; que la table d’hôte des tribades « révolte toute pudeur », je le crois ! Eh bien, après ? Merde pour les imbéciles ! C’est nouveau en tout cas et crânement fait. Le mot de Mignon « quel outil » et tout le caractère de Mignon, du reste, me ravit. Nana tourne au mythe, sans cesser d’être réelle. Cette création est babylonienne. » C’est dit ! J’ajouterais que, quelques années avant que Zola, à l’âge sans doute de son Muffat, tombe amoureux d’une jeune fille de l’âge de Nana, Jeanne Rozerot, on doute qu’il n’y ait que de l’entomologie dans sa façon d’ausculter cette sexualité adultère et compulsive.
Chapitre I
Nana nous est présentée comme si nous étions un spectateur du théâtre des Variétés entendant le public masculin impatient de découvrir cette « étoile nouvelle, qui doit jouer Vénus », dont le journaliste Fauchery, qui est parfois comme le double du narrateur sinon de Zola, nous avertit malicieusement, et l’on comprend qu’il parle à la fois de la fille et du nouvel opus de Zola qui porte le nom de ladite fille en couverture : « Allons, bon ! ça va recommencer ! cria Fauchery en jetant les bras en l’air. Depuis ce matin, on m’assomme avec Nana. J’ai rencontré plus de vingt personnes, et Nana par-ci, et Nana par-là ! Est-ce que je sais, moi ! est-ce que je connais toutes les filles de Paris ! Nana… est une invention de Bordenave. Ça doit être du propre ! » Selon la chronologie du dossier, la scène initiale aurait lieu le 12 avril 1867. La chute du Second Empire aurait d’ailleurs obligé Zola à précipiter les actions, raccourcir les biographies de ses protagonistes : « Mes personnages se sont cassé le nez contre 1870, je le reconnais bien volontiers. De même je concède que j’ai dû tricher et que Nana, par exemple, fait en trois ou quatre ans ce qu’elle devrait faire en dix ans. La raison en est que je n’ai pas voulu déborder du second Empire » (lettre à Fernand Xau, 1880). En effet, si l’on en croit la chronologie interne, Nana, née le 30 avril 1852, n’aurait pas encore 15 ans quand débute le roman ! Et si nous lui en donnons trois de plus, cela lui fait 21 ans à sa mort en 1870… Mais dans le dossier du roman, folio 194, on lit très distinctement ceci : « née en 51. En 67 (fin d’année, décembre) elle a dix-sept ans (en fait 16 !). Mais elle est très forte, on lui donnerait au moins vingt ans ». Donc pour Zola elle aurait bien 19 ans à sa mort le 15 juillet 1870 ! Est-il vraisemblable qu’un chambellan de l’Empire se ruine pour une fille de cet âge au vu et au su de tout Paris, et surtout que tout Paris se rue aux genoux d’une telle gamine, inculte de surcroît, quand il y en aurait « plusieurs milliers à Paris » ?
Fauchery, jeune journaliste, est comme bizuté par Bordenave, qui le reprend quand il parle de « théâtre » : « Dites mon bordel. ». Selon lui, Nana est « une vraie seringue ! », voire « Un paquet ! », mais il ne s’inquiète pas du succès. Cette scène au théâtre est l’occasion de présenter les personnages du drame. Il y a Daguenet, « le greluchon de Nana » ; le petit Georges Hugon, qui nous est d’abord présenté en éphèbe : « un tout jeune homme, de dix-sept ans au plus, quelque échappé de collège, ouvrait très grands ses beaux yeux de chérubin. » [donc il est plus âgé qu’elle !] Le succès est étonnant pour une prestation artistiquement nulle, et le narrateur n’est pas tendre avec le public : « Elle continuait à se balancer, ne sachant faire que ça. Et on ne trouvait plus ça vilain du tout, au contraire ; les hommes braquaient leurs jumelles. Comme elle terminait le couplet, la voix lui manqua complètement, elle comprit quelle n’irait jamais au bout. Alors, sans s’inquiéter, elle donna un coup de hanche qui dessina une rondeur sous la mince tunique, tandis que, la taille pliée, la gorge renversée, elle tendait les bras. Des applaudissements éclatèrent. » Mignon, maquereau de sa femme, résume l’idée que veut faire passer Zola : « C’est dégoûtant que le public accueille comme ça la première salope venue. Il n’y aura bientôt plus d’honnêtes femmes au théâtre » Mais il faut en rajouter pour bien morigéner ce public au goût douteux : « Dès lors, la pièce était sauvée, un grand succès se dessina. Ce carnaval des dieux, l’Olympe traîné dans la boue, toute une religion, toute une poésie bafouée, semblèrent un régal exquis. La fièvre de l’irrévérence gagnait le monde lettré des premières représentations ; on piétinait sur la légende, on cassait les antiques images. Jupiter avait une bonne tête, Mars était tapé. La royauté devenait une farce, et l’armée, une rigolade. Quand Jupiter, tout d’un coup amoureux d’une petite blanchisseuse, se mit à pincer un cancan échevelé, Simonne, qui jouait la blanchisseuse, lança le pied au nez du maître des dieux, en l’appelant si drôlement « Mon gros père ! » qu’un rire fou secoua la salle. […] Depuis longtemps, au théâtre, le public ne s’était vautré dans de la bêtise plus irrespectueuse. Cela le reposait. » C’est sévère, et pourtant, La fièvre de l’irrévérence gagnait le monde lettré, cela sonnerait comme un éloge de Zola ; sans doute espère-t-il le monopole du scandale. Au café, la bande rencontre Satin, qui semble modelée sur La Prune (1878) d’Édouard Manet : « À l’autre bout de la salle, la nuque appuyée contre le cadre d’une glace, une fille de dix-huit ans au plus se tenait immobile devant un verre vide, comme engourdie par une longue et vaine attente. Sous les frisures naturelles de ses beaux cheveux cendrés, elle avait une figure de vierge aux yeux de velours, doux et candides ; et elle portait une robe de soie verte déteinte, avec un chapeau rond que des gifles avaient défoncé. La fraîcheur de la nuit la rendait toute blanche. »
Satin racole dans le « passage des Panoramas », lieu où déambulent aussi les riches messieurs entichés d’actrices, comme le comte Muffat au chapitre VII. Cela confirme le rôle de lieu de drague tous azimuts des passages parisiens, qu’on retrouve dans Les Chemins de la Liberté de Sartre, ou dans Zazie dans le métro, de Queneau. Le spectacle reprend, et c’est le grand portrait de Nana nue : « Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue avec une tranquille audace, certaine de la toute puissance de sa chair. Une simple gaze l’enveloppait ; ses épaules rondes, sa gorge d’amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides comme des lances, ses larges hanches qui roulaient dans un balancement voluptueux, ses cuisses de blonde grasse, tout son corps se devinait, se voyait sous le tissu léger, d’une blancheur d’écume. C’était Vénus naissant des flots, n’ayant pour voile que ses cheveux. Et, lorsque Nana levait les bras, on apercevait, aux feux de la rampe, les poils d’or de ses aisselles. Il n’y eut pas d’applaudissements. Personne ne riait plus, les faces des hommes, sérieuses, se tendaient, avec le nez aminci, la bouche irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, chargé d’une sourde menace. Tout d’un coup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le coup de folie de son sexe, ouvrant l’inconnu du désir. Nana souriait toujours, mais d’un sourire aigu de mangeuse d’hommes. »
Chapitre II
Nous voilà boulevard Haussmann, où Nana s’occupe à « essuyer les plâtres […] d’une grande maison neuve » louée pour elle par « un riche marchand de Moscou ». Elle est préoccupée par « son petit Louis, un enfant quelle avait eu à seize ans », et qu’elle va confier à « sa tante Mme Lerat » (la sœur de Coupeau). Elle ne sait pas encore que des grappes d’hommes vont la couvrir de fleurs, de cartes et de visites, et l’assaut d’hommages la ravit, mais l’irrite en même temps. Elle s’amuse à les lorgner : « Ils devaient avoir une bonne tête, tous la langue pendante, comme des toutous assis en rond sur leur derrière. C’était son succès de la veille qui continuait, cette meute d’hommes l’avait suivie à la trace. » Elle accepte un bouquet de Georges Hugon, qu’elle prend pour un bébé alors qu’elle-même a plus ou moins le même âge, et lui permet de revenir. Enfin elle se sauve de chez elle avec son coiffeur, Francis, qui ne semble pas menaçant pour la gent féminine : « Francis lui-même, malgré le flegme anglais qu’il affectait, se mit à rire, tout en rangeant les peignes. Nana […] le poussait dans la cuisine. Et elle se sauva, délivrée des hommes enfin, heureuse, sachant qu’on pouvait l’avoir seul avec soi, n’importe où, sans craindre des bêtises ». Elle veut « dormir toute une nuit, toute une nuit à moi », ce qui est le comble du plaisir pour cette jeune femme dégoûtée des hommes.
Chapitre III
Nous voilà sans transition dans le grand monde, en l’occurrence le salon de la comtesse Sabine, la femme du comte Muffat, où l’on retrouve tous les hommes qui se frottaient le bassin aux mollets de Nana aux chapitres précédents ! Madame Hugon présente son fils Georges à la comtesse, qu’elle a vu naître, étant une vieille amie de sa mère : « Le jeune homme, avec ses yeux clairs et ses frisures blondes de fille déguisée en garçon, saluait la comtesse sans embarras ». Les hommes manigancent en tâchant de ne pas se faire entendre des femmes, pour se retrouver à minuit au dîner qui doit lancer Nana, et c’est à qui amènera le plus de filles : « Alors, ils ricanèrent, les yeux luisants, se donnant des détails sur la table d’hôte de la rue des Martyrs, où la grosse Laure Piédefer, pour trois francs, faisait manger les petites femmes dans l’embarras. Un joli trou ! Toutes les petites femmes baisaient Laure sur la bouche. » Monsieur de Vandeuvres se vante : « Je vais encore en racoler… Ces jeunes gens doivent connaître des petites filles. » Fauchery le journaliste, s’écarte de son rôle de double de Zola, car il a deux préoccupations lors de cette première invitation chez la comtesse : inviter le comte chez Nana, et savoir si « la comtesse ne couche avec personne ». Elle a 34 ans et n’a pas mauvaise réputation. Mais cette première invitation le laisse dubitatif : « Décidément, il devait s’être trompé, il n’y avait point de fêlure. C’était dommage. » Quant au père de la comtesse, le vieux marquis de Chouard, les noceurs ne se trompent guère sur son compte : « Dites donc, où avez-vous passé ? Votre coude est plein de toiles d’araignée et de plâtre. » Ce serait aujourd’hui, on reniflerait le poppers sur ses frusques !
Chapitre IV
C’est la nuit d’agapes chez Nana. Toutes les filles sont de la partie, ce qui permet une typologie de la prostituée. La naïveté de Tatan Néné fournit un gag récurrent : « Seule, Tatan Néné, à qui l’on avait raconté en chemin que six nègres, absolument nus, serviraient le souper de Nana, s’inquiétait, demandant à les voir. » Rose Mignon est la rivale et ennemie de Nana. Elle constitue avec son mari et maquereau un couple pittoresque : « Mignon triomphait, flatté dans son orgueil de père. Il adorait les petits, une seule préoccupation le tenait, grossir leur fortune en administrant, avec une rigidité d’intendant fidèle, l’argent que gagnait Rose au théâtre et ailleurs. […] C’était réglé entre eux : elle, travaillait le plus qu’elle pouvait, de tout son talent et de toute sa beauté ; lui, avait lâché son violon pour mieux veiller sur ses succès d’artiste et de femme. On n’aurait pas trouvé un ménage plus bourgeois ni plus uni. » Quant à « Caroline Héquet, née à Bordeaux, d’un petit employé mort de honte, [elle] avait la bonne chance de posséder pour mère une femme de tête, qui, après l’avoir maudite, s’était remise avec elle, au bout d’un an de réflexion, voulant au moins lui sauver une fortune ; la fille, âgée de vingt-cinq ans, très froide, passait pour une des plus belles femmes qu’on pût avoir, à un prix qui ne variait pas ; la mère, pleine d’ordre, tenait les livres, une comptabilité sévère des recettes et des dépenses, menait toute la maison de l’étroit logement qu’elle habitait deux étages plus haut ». Les michetons aussi sont pittoresques ; il y a Steiner, le juif à la Balzac : « On connaissait le banquier pour ses coups de cœur ; ce terrible juif allemand, ce brasseur d’affaires dont les mains fondaient les millions, devenait imbécile, lorsqu’il se toquait d’une femme ; et il les voulait toutes, il n’en pouvait paraître une au théâtre, sans qu’il l’achetât, si chère quelle fût. On citait des sommes. À deux reprises, son furieux appétit des filles l’avait ruiné. Comme disait Vandeuvres, les filles vengeaient la morale, en nettoyant sa caisse. » L’assemblée est nombreuse dans l’appartement de Nana, les invités arrivent par grappes et l’on pousse les murs pour accueillir tout le monde. Un vieillard anonyme est présent, celui qui paie la note, et on s’amuse de peu : « Foucarmont, en veine d’esprit, […] avait trouvé une plaisanterie qui consistait à appeler Labordette « madame » ; elle devait l’amuser beaucoup, il la répétait […]. La table s’égayait, le trouvant très spirituel ; mais ce n’était pas une raison pour gâter la nuit. Vandeuvres, dont le fin visage se cuivrait, exigea qu’il rendît son sexe à Labordette. » Nana, déçue de ne pas avoir pu ferrer le comte Muffat, se résigne au meilleur parti présent : « autant le banquier qu’un autre », sans abandonner Daguenet, son « amant de cœur ».
Chapitre V
C’est le triomphe de Nana au théâtre. En passant, Zola nous livre le beau portrait d’une vieille fille qui ne servira plus dans la suite du récit : « Madame Jules n’avait plus d’âge, le visage parcheminé, avec ces traits immobiles des vieilles filles que personne n’a connues jeunes. Celle-là s’était desséchée dans l’air embrasé des loges, au milieu des cuisses et des gorges les plus célèbres de Paris. Elle portait une éternelle robe noire déteinte, et sur son corsage plat et sans sexe, une forêt d’épingles étaient piquées, à la place du cœur. » Un prince d’Écosse s’entiche de Nana, et demande à la voir dans sa loge à l’entracte. On s’amuse en bons enfants quand arrive le comédien Fontan, qui trouve un bon mot : « Le roi Dagobert est dans le corridor, qui demande à trinquer avec Son Altesse Royale […]. Le comte Muffat et le marquis de Chouard l’avaient imité. On ne plaisantait plus, on était à la cour. Ce monde du théâtre prolongeait le monde réel. » Mais la grande affaire, c’est que le prince amène dans son sillage le comte Muffat, pris au piège : « Un jour, en passant, il avait aperçu, par une porte entrebâillée, une servante qui se débarbouillait ; et c’était l’unique souvenir qui l’eût troublé, de la puberté à son mariage. Puis, il avait trouvé chez sa femme une stricte obéissance aux devoirs conjugaux ; lui-même éprouvait une sorte de répugnance dévote. Il grandissait, il vieillissait, ignorant de la chair, plié à de rigides pratiques religieuses, ayant réglé sa vie sur des préceptes et des lois. Et, brusquement, on le jetait dans cette loge d’actrice, devant cette fille nue. Lui qui n’avait jamais vu la comtesse Muffat mettre ses jarretières, il assistait aux détails intimes d’une toilette de femme […]. Tout son être se révoltait, la lente possession dont Nana l’envahissait depuis quelque temps l’effrayait, en lui rappelant ses lectures de piété, les possessions diaboliques qui avaient bercé son enfance. Il croyait au diable. Nana, confusément, était le diable, avec ses rires, avec sa gorge et sa croupe, gonflées de vices […]. Lorsqu’elle ferma l’œil droit et qu’elle passa le pinceau, il comprit qu’il lui appartenait. » Devant l’altesse, en coulisse, se déroule un gag : une altercation entre Mignon et Fauchery au sujet de leur femme : « Mais Rose resta stupéfaite, en voyant à ses pieds son mari et son amant qui se vautraient, s’étranglant, ruant, les cheveux arrachés, la redingote blanche de poussière. » Muffat ose enfin embrasser Nana par surprise ; celle-ci l’invite dans sa maison de campagne que lui offre Steiner : « Vous savez, je suis propriétaire… Oui, j’achète une maison de campagne, près d’Orléans, dans un pays où vous allez quelquefois. Bébé m’a dit ça, le petit Georges Hugon, vous le connaissez ?… Venez donc me voir, là-bas. » Muffat est sacrément allumé : « C’était sa jeunesse qui s’éveillait enfin, une puberté goulue d’adolescent, brûlant tout à coup dans sa froideur de catholique et dans sa dignité d’homme mûr. »
Chapitre VI
Tous ces messieurs éprouvent une envie soudaine de visiter leur vieille amie Madame Hugon à la campagne, comme par hasard le jour-même où Nana emménage. Cela fait un beau chapitre de comédie : « Ah ! çà, s’écria-t-elle, c’est donc un rendez-vous, ce matin ? Vous vous êtes donné le mot. Que se passe-t-il ? Voilà des années que je n’ai pu vous réunir, et vous tombez tous à la fois… Oh ! je ne me plains pas ». La brave dame appelle son petit Georges « Zizi » [1], sans se douter que Zizi s’évade la nuit pour retrouver Nana, brûlant la politesse à toute la mâle compagnie. Il prend l’averse, et Nana lui prête ses vêtements : « Oh ! le mignon, qu’il est gentil en petite femme ! […] il semblait une fille, avec ses deux bras nus de jeune blond, avec ses cheveux fauves encore mouillés, qui roulaient dans son cou. » Le petit galopin fait à la rouée Nana le coup du rossignol, ou plutôt du rouge-gorge : « Mais un oiseau chanta, puis se tut. C’était un rouge-gorge, dans un sureau, sous la fenêtre. — Attends, murmura Georges, la lampe lui fait peur, je vais l’éteindre. […] Alors, en écoutant le rouge-gorge, tandis que le petit se serrait contre elle, Nana se souvint. Oui, c’était dans des romances qu’elle avait vu tout ça. Autrefois, elle eût donné son cœur, pour avoir la lune ainsi, et des rouges-gorges, et un petit homme plein d’amour. […] Et elle tomba en vierge dans les bras de cet enfant, en face de la belle nuit. » Voir la belle scène du rossignol dans « Une partie de campagne » que Maupassant nous servira un an plus tard, dans son recueil La Maison Tellier, sans doute influencé par Nana. Nana ne se gêne pas pour se taper son « bébé » Georges (qui n’a qu’un an de moins qu’elle si l’on suit l’improbable chronologie des Rougon-Macquart) à la barbe de Steiner qui vient de lui offrir la maison, et de Muffat qui vient cueillir le fruit qu’on lui a promis, ce qui n’empêche pas ce petit con d’être jaloux des barbons qui entretiennent Nana pour son plaisir ! Nana neutralise Muffat et Steiner en les mettant l’un en face de l’autre : « Enfin, les deux vieux étaient emballés ! » et se donne à Zizi : « La nuit, à plus de dix reprises, elle lâchait Zizi pour voir si Louiset avait une bonne respiration ; mais, quand elle revenait, elle reprenait son Zizi avec un restant de ses caresses maternelles, elle faisait la maman ; tandis que lui, vicieux, aimant bien être petit aux bras de cette grande fille, se laissait bercer comme un bébé qu’on endort. » La petite bande de Nana, Georges compris, fait une virée dans des voitures, et croise la bande de madame Hugon, qui se promène à pied, belle scène zolienne : « Les cinq voitures, qui conduisaient Nana et sa société aux ruines de Chamont, s’engageaient sur le petit pont de bois. Fauchery, Daguenet, les dames Muffat durent reculer, pendant que madame Hugon et les autres s’arrêtaient également, échelonnés le long du chemin. Ce fut un défilé superbe. Les rires avaient cessé dans les voitures ; des figures se tournaient, curieusement. On se dévisagea, au milieu d’un silence que coupait seul le trot cadencé des chevaux. Dans la première voiture, Maria Blond et Tatan Néné, renversées comme des duchesses, les jupes bouffant par-dessus les roues, avaient des regards dédaigneux pour ces femmes honnêtes qui allaient à pied. » Georges est reconnu par sa maman, mais la société poursuit sa sortie, et au lieu des ruines promises, c’est sur une ruine humaine qu’on tombe par hasard : « une ancienne du temps de Napoléon… Oh ! […] une noceuse comme il n’y en a plus. Maintenant, elle est dans les curés […]. Ça ne m’étonne pas, si elle a un château. Elle vous nettoyait un homme, rien qu’à souffler dessus… Ah ! Irma d’Anglars vit encore ! […] elle doit aller dans les quatre-vingt-dix ans ». Nana est impressionnée par cette « vision d’une Nana très riche et très saluée », et du coup, lui viennent « des scrupules, à cause du jeune âge de Zizi. […] elle rentrait dans le bon chemin, elle prenait un vieux […]. Et elle coucha avec Muffat, mais sans plaisir. »
Chapitre VII
De retour à Paris, Nana se partage entre Steiner et Muffat, lequel est avare par ignorance, mais bien pincé : « C’était, dans l’éveil tardif de sa chair, une gloutonnerie d’enfant qui ne laissait pas de place à la vanité ni à la jalousie. Une seule sensation précise pouvait le frapper : Nana devenait moins gentille, elle ne le baisait plus sur la barbe. Cela l’inquiétait, il se demandait ce qu’elle avait à lui reprocher, en homme qui ignore les femmes. » Avec tous ces grigous, la pauvre a bien du mal à gérer son budget : « À cette heure, pourtant, les créanciers la tourmentaient plus qu’autrefois, lorsqu’elle n’avait pas le sou ; chose qui lui causait une continuelle surprise, car elle se citait comme un modèle d’économie. Depuis un mois, ce voleur de Steiner trouvait mille francs à grand-peine, les jours où elle menaçait de le flanquer dehors, s’il ne les apportait pas. Quant à Muffat, il était idiot, il ignorait ce qu’on donnait, et elle ne pouvait lui en vouloir de son avarice. » Le chapitre consiste d’abord en une longue déambulation de Muffat puis de Nana et Muffat passage des Panoramas, devant le théâtre. Nana rencontre son ex-amant de cœur Daguenet, qui « épouserait une grosse dot et finirait préfet, comme son père ». Elle apprend, stupéfaite, que la comtesse Sabine trompe son mari : « Si c’est possible, une femme honnête tromper son mari, et avec cette roulure de Fauchery ! » De retour chez elle avec Muffat, Nana se contemple : « Un des plaisirs de Nana était de se déshabiller en face de son armoire à glace, où elle se voyait en pied. Elle faisait tomber jusqu’à sa chemise ; puis, toute nue, elle s’oubliait, elle se regardait longuement. C’était une passion de son corps, un ravissement du satin de sa peau et de la ligne souple de sa taille, qui la tenait sérieuse, attentive, absorbée dans un amour d’elle-même ». Ce genre de scène est à mettre en relation avec le célèbre tableau d’Édouard Manet intitulé Nana, bien qu’il eût été peint en 1877. Il représente l’actrice Henriette Hauser devant son miroir.
Ce chapitre central contient la mise en abyme de l’article très zolien de Fauchery sur Nana : « La chronique de Fauchery, intitulée « La mouche d’or », était l’histoire d’une fille, née de quatre ou cinq générations d’ivrognes, le sang gâté par une longue hérédité de misère et de boisson, qui se transformait chez elle en un détraquement nerveux de son sexe de femme. Elle avait poussé dans un faubourg, sur le pavé parisien ; et, grande, belle, de chair superbe ainsi qu’une plante de plein fumier, elle vengeait les gueux et les abandonnés dont elle était le produit. Avec elle, la pourriture qu’on laissait fermenter dans le peuple remontait et pourrissait l’aristocratie. Elle devenait une force de la nature, un ferment de destruction, sans le vouloir elle-même, corrompant et désorganisant Paris entre ses cuisses de neige, le faisant tourner comme des femmes, chaque mois, font tourner le lait. Et c’était à la fin de l’article que se trouvait la comparaison de la mouche, une mouche couleur de soleil, envolée de l’ordure, une mouche qui prenait la mort sur les charognes tolérées le long des chemins, et qui, bourdonnante, dansante, jetant un éclat de pierreries, empoisonnait les hommes rien qu’à se poser sur eux, dans les palais où elle entrait par les fenêtres. » Mise en abyme aussi de l’effet de la littérature sur le lecteur : « Le journal était tombé de ses mains. Dans cette minute de vision nette, il se méprisait. C’était cela : en trois mois, elle avait corrompu sa vie, il se sentait déjà gâté jusqu’aux moelles par des ordures qu’il n’aurait pas soupçonnées. Tout allait pourrir en lui, à cette heure. Il eut un instant conscience des accidents du mal, il vit la désorganisation apportée par ce ferment, lui empoisonné, sa famille détruite, un coin de société qui craquait et s’effondrait. Et, ne pouvant détourner les yeux, il la regardait fixement, il tâchait de s’emplir du dégoût de sa nudité. » Nana s’amuse à questionner Muffat sur sa sexualité disons rudimentaire : « Imagine-toi, [Fauchery] jure que tu l’avais encore, lorsque tu as épousé ta femme… Hein ? tu l’avais encore ?… Hein ? est-ce vrai ? » Elle lui fait raconter sa nuit de noces. Mais comme elle veut absolument qu’il débarrasse le plancher pour accueillir un autre amant, elle se résout à lui annoncer l’adultère de sa femme, et lui donne l’adresse de Fauchery. Le pauvre homme passe ainsi le reste de la nuit planté devant la fenêtre du journaliste, n’osant faire un scandale pour s’assurer si l’ombre qu’il y voit s’agiter est celle de sa femme. Il revient la queue entre les jambes chez Nana, où il retrouve Steiner venu apporter mille francs qu’il avait promis à Nana. Elle les fiche dehors sans ménagement, car elle s’est toquée du comique Fontan.
Chapitre VIII
Ce chapitre constitue une première plongée dans l’abyme, un sorte de rappel du lent engloutissement de la mère de Nana, Gervaise. Nana vend tous ses meubles et quitte sans prévenir son appartement du boulevard Haussmann, pour loger rue Véron, avec Fontan. Celui-ci se révèle un profiteur sans vergogne qui ne tarde pas à la battre. Nana retrouve son amie Satin qui habite le quartier, et elles s’acoquinent : « Puis, venaient les jours où Nana pleurait, en déclarant que ça ne pouvait pas continuer. Satin l’accompagnait jusqu’à sa porte, restait une heure dans la rue, pour voir s’il ne l’assassinait pas. Et, le lendemain, les deux femmes jouissaient toute l’après-midi de la réconciliation, préférant pourtant, sans le dire, les jours où il y avait des raclées dans l’air, parce que ça les passionnait davantage. » La lesbianisation de Nana débute par petites touches dans une belle scène de bouge saphique. Satin mène son amie déjeuner chez « Laure Piedefer […] une dame de cinquante ans, aux formes débordantes, sanglée dans des ceintures et des corsets. Des femmes arrivaient à la file, se haussaient par-dessus les soucoupes, et baisaient Laure sur la bouche, avec une familiarité tendre ; pendant que ce monstre, les yeux mouillés, tâchait, en se partageant, de ne pas faire de jalouses. » Là, Nana rencontre certaines de ses amies, et découvre le monde lesbien. Satin se fait débaucher sous ses yeux par une « madame Robert », ce qui vexe Nana. Voici une belle page (une des premières de la littérature française consacrée aux amours lesbiennes) :
« Un instant, elle fut intéressée par un jeune homme, aux cheveux courts et bouclés, le visage insolent, tenant sans haleine, pendue à ses moindres caprices, toute une table de filles, qui crevaient de graisse. Mais, comme le jeune homme riait, sa poitrine se gonfla. — Tiens, c’est une femme ! laissa-t-elle échapper dans un léger cri. Satin, qui se bourrait de poule, leva la tête en murmurant : — Ah ! oui, je la connais… Très chic ! on se l’arrache.
Nana fit une moue dégoûtée. Elle ne comprenait pas encore ça. Pourtant, elle disait, de sa voix raisonnable, que des goûts et des couleurs il ne fallait pas disputer, car on ne savait jamais ce qu’on pourrait aimer un jour. Aussi mangeait-elle sa crème d’un air de philosophie, en s’apercevant parfaitement que Satin révolutionnait les tables voisines, avec ses grands yeux bleus de vierge. Il y avait surtout près d’elle une forte personne blonde très aimable ; elle flambait, elle se poussait, si bien que Nana était sur le point d’intervenir.
Mais, à ce moment, une femme qui entrait lui causa une surprise. Elle avait reconnu madame Robert. Celle-ci, avec sa jolie mine de souris brune, adressa un signe de tête familier à la grande bonne maigre, puis vint s’appuyer au comptoir de Laure. Et toutes deux se baisèrent, longuement. Nana trouva cette caresse-là très drôle de la part d’une femme si distinguée ; d’autant plus que madame Robert n’avait pas du tout son air modeste, au contraire. Elle jetait des coups d’œil dans le salon, causant à voix basse. Laure venait de se rasseoir, tassée de nouveau, avec la majesté d’une vieille idole du vice, à la face usée et vernie par les baisers des fidèles ; et, au-dessus des assiettes pleines, elle régnait sur sa clientèle bouffie de grosses femmes, monstrueuse auprès des plus fortes, trônant dans cette fortune de maîtresse d’hôtel qui récompensait quarante années d’exercice.
Mais madame Robert avait aperçu Satin. Elle lâcha Laure, accourut, se montra charmante, disant combien elle regrettait de ne s’être pas trouvée chez elle, la veille ; et comme Satin, séduite, voulait absolument lui faire une petite place, elle jurait qu’elle avait dîné. Elle était montée simplement pour voir. Tout en parlant, debout derrière sa nouvelle amie, elle s’appuyait à ses épaules, souriante et câline, répétant : — Voyons, quand vous verrai-je ? Si vous étiez libre…
Nana, malheureusement, ne put en entendre davantage. Cette conversation la vexait, elle brûlait de dire ses quatre vérités à cette femme honnête. Mais la vue d’une bande qui arrivait la paralysa. C’étaient des femmes chic, en grande toilette, avec leurs diamants. Elles venaient en partie chez Laure, qu’elles tutoyaient toutes, reprises d’un goût pervers, promenant des cent mille francs de pierreries sur leur peau, pour dîner là, à trois francs par tête, dans l’étonnement jaloux des pauvres filles crottées. Lorsqu’elles étaient entrées, la voix haute, le rire clair, apportant du dehors comme un coup de soleil, Nana avait vivement tourné la tête, très ennuyée de reconnaître parmi elles Lucy Stewart et Maria Blond. Pendant près de cinq minutes, tout le temps que ces dames causèrent avec Laure, avant de passer dans le salon voisin, elle tint le nez baissé, ayant l’air très occupée à rouler des miettes de pain sur la nappe. Puis, quand elle put enfin se retourner, elle demeura stupéfaite : la chaise près d’elle était vide. Satin avait disparu. — Eh bien ! où est-elle donc ? laissa-t-elle échapper tout haut.
La forte personne blonde, qui avait comblé Satin d’attentions, eut un rire, dans sa mauvaise humeur ; et comme Nana, irritée de ce rire, la regardait d’un œil menaçant, elle dit mollement, la voix traînante : — Ce n’est pas moi, bien sûr, c’est l’autre qui vous l’a faite. »
Fontan non seulement bat de plus en plus Nana, mais il s’approprie leur argent et l’appartement : « D’un bout de la semaine à l’autre, il y avait un bruit de gifles, un vrai tic-tac d’horloge, qui semblait régler leur existence. Nana, à force d’être battue, prenait une souplesse de linge fin ; et ça la rendait délicate de peau, rose et blanche de teint, si douce au toucher, si claire à l’œil, qu’elle avait encore embelli. » Nana reprend du service chez la Tricon, en fille de bas étage. Elle retrouve Satin, et lui pardonne son lâchage pour madame Robert : « Mais Satin se contentait de répondre que lorsqu’on n’aimait pas une chose, ce n’était pas une raison pour vouloir en dégoûter les autres. Et Nana, d’esprit large, cédant à cette idée philosophique qu’on ne sait jamais par où l’on finira, avait pardonné. Même, la curiosité mise en éveil, elle la questionnait sur des coins de vice, stupéfiée d’en apprendre encore à son âge [faut-il rappeler qu’elle n’est pas censée avoir vingt ans ?], après tout ce qu’elle savait ; et elle riait, elle s’exclamait, trouvant ça drôle, un peu répugnée cependant, car au fond elle était bourgeoise pour ce qui n’entrait pas dans ses habitudes. […] Pourtant, elle n’en était toujours pas, comme elle disait. » C’est alors quelques pages de la vie des prostituées en carte, une parenthèse dans la vie de Nana, qui sort avec Satin le soir quand Fontan joue au théâtre : « Sur les trottoirs de la rue Notre-Dame-de-Lorette, deux files de femmes rasant les boutiques, les jupons troussés, le nez à terre, se hâtaient vers les boulevards d’un air affairé, sans un coup d’œil aux étalages. C’était la descente affamée du quartier Bréda, dans les premières flammes du gaz. Nana et Satin longeaient l’église, prenaient toujours par la rue Le Peletier. Puis, à cent mètres du café Riche, comme elles arrivaient sur le champ de manœuvres, elles rabattaient la queue de leur robe, relevée jusque-là d’une main soigneuse ; et dès lors, risquant la poussière, balayant les trottoirs et roulant la taille, elles s’en allaient à petits pas, elles ralentissaient encore leur marche, lorsqu’elles traversaient le coup de lumière crue d’un grand café. Rengorgées, le rire haut, avec des regards en arrière sur les hommes qui se retournaient, elles étaient chez elles. » Nana « complète son éducation » par cette expérience : « Elle avait bien un peu peur, car les plus comme il faut étaient les plus sales. Tout le vernis craquait, la bête se montrait, exigeante dans ses goûts monstrueux, raffinant sa perversion. » Nana découvre le vieux marquis de Chouard sortant de chez Satin, dont elle lui apprend les goûts particuliers pour la crasse et les sneakers avant la lettre : « il reniflait dans tous les endroits pas propres, jusque dans ses pantoufles. » Bizarrement, Zola passe très rapidement sur le monde de la prostitution de bas étage, celui des filles en carte. Satin apprend à Nana à se sauver des rafles, et lui raconte ce qui arrive à celles qui sont prises, ce qui horrifie Nana ; mais dans tout le roman, la syphilis ne sera évoquée fort discrètement que par cette allusion : « elle se voyait toujours bousculée, traînée, jetée le lendemain à la visite ; et ce fauteuil de la visite l’emplissait d’angoisse et de honte, elle qui avait lancé vingt fois sa chemise par-dessus les moulins. » On n’aura pas droit à ce pittoresque dont le peintre Toulouse Lautrec rendra compte de façon très naturaliste par exemple avec Inspection médicale rue des Moulins (1894).
Par chance, Nana se fait jeter dehors par Fontan, qui la remplace par une autre, et la scène est fort amusante ; on dirait une parodie de la pratique de répudiation dans l’islam, car au lieu de répéter « je te répudie » trois fois, c’est le mot « Merde ! » que trisse Fontan. Nana passe la nuit dans un hôtel de passe avec Satin, elle-même mise à la porte de chez elle, qui la réconforte de son mieux : « Alors, peu à peu, dans cette étreinte si douce, Nana essuya ses larmes. Elle était touchée, elle rendait à Satin ses caresses. Lorsque deux heures sonnèrent, la bougie brûlait encore ; toutes deux avaient de légers rires étouffés, avec des paroles d’amour. » Mais c’est une descente de police : « Pendant près d’une heure, ce fut un bruit de gros souliers sur les marches, des portes ébranlées à coups de poing, des querelles aiguës s’étouffant dans des sanglots, des glissements de jupes frôlant les murs, tout le réveil brusque et le départ effaré d’un troupeau de femmes, brutalement emballées par trois agents, sous la conduite d’un petit commissaire blond, très poli. » Satin est embarquée, mais Nana, terrorisée, s’est réfugiée sur le toit ; le lendemain, elle retrouve sa tante et son fils. Ce long chapitre aura constitué comme un roman de la prostituée dans le roman de la courtisane.
Chapitre IX
Nana repique au théâtre, ou du moins elle fait une tentative. C’est l’occasion de raconter une pièce écrite par Fauchery, mise en abyme de Nana : « Après un premier acte, où l’auteur posait comme quoi le duc de Beaurivage trompait sa femme avec la blonde Géraldine, une étoile d’opérettes, on voyait, au second acte, la duchesse Hélène venir chez l’actrice, un soir de bal masqué, pour apprendre par quel magique pouvoir ces dames conquéraient et retenaient leurs maris. C’était un cousin, le bel Oscar de Saint-Firmin, qui l’introduisait, espérant la débaucher. Et, comme première leçon, à sa grande surprise, elle entendait Géraldine faire une querelle de charretier au duc, très souple, l’air enchanté ; ce qui lui arrachait ce cri : « Ah bien ! si c’est ainsi qu’il faut parler aux hommes ! » Nana se fait amener Muffat au théâtre même, et lui fait cracher toute sa fortune pour l’avoir, et plus encore, elle le force à quémander pour elle à Fauchery, l’amant de sa femme, le rôle de la « femme honnête », que devait jouer Rose Mignon : « Et cette fois, je te jure, ce ne sera pas comme la première, puisque maintenant tu comprends ce qu’il faut à une femme. Tu donnes tout, n’est-ce pas ? alors je n’ai besoin de personne… ». La première est un désastre en tant qu’actrice pour Nana, et elle abandonne le rôle, mais elle s’en fiche bien car la voilà devenue une courtisane de premier plan.
Chapitre X
Nana règne désormais en son hôtel, avenue de Villiers. La description qui nous en est faite est d’un moraliste dont on peut jauger la neutralité à l’aune de cette phrase : « La pièce gardait le ton du vieil or, fondu de vert et de rouge, sans que rien marquât trop la fille, en dehors de la volupté des sièges ; seules, deux statuettes de biscuit, une femme en chemise cherchant ses puces, et une autre absolument nue, marchant sur les mains, les jambes en l’air, suffisaient à salir le salon d’une tache de bêtise originelle ». Malgré ses protestations de fidélité, elle s’empresse de prendre un deuxième client, un autre aristocrate qui se suicide aux filles, filles dont la fierté est précisément le nombre d’amants qu’elles ruinent : « le comte Xavier de Vandeuvres […] Elle lui tirerait bien huit à dix mille francs par mois ; ce serait là de l’argent de poche très utile. […] il avait comme une hâte de tout balayer, jusqu’aux décombres de la vieille tour bâtie par un Vandeuvres sous Philippe Auguste, enragé d’un appétit de ruines, trouvant beau de laisser les derniers besants d’or de son blason aux mains de cette fille, que Paris désirait ». Elle se tape parfois le petit Georges, par ennui : « elle cédait souvent encore, le gardait dans ses armoires, lui laissait continuellement ramasser les miettes de sa beauté ». Mais le petit se fait sermonner par son grand frère diligenté par maman ; qu’à cela ne tienne, Nana vous retourne le frérot comme un gant, et oblige Muffat à accepter cette compagnie : « Dès lors, les fils Hugon, Vandeuvres et Muffat furent ouvertement de la maison, où ils se serraient la main en intimes. » Elle s’ennuie à mourir entre deux hommes ; « Ne sortant qu’en voiture, elle perdait l’usage de ses jambes ». Elle ramasse Satin reconnue dans la rue, misérable et crottée, et s’en amourache : « Satin fut son vice. Installée dans l’hôtel de l’avenue de Villiers, débarbouillée, nippée, pendant trois jours elle raconta Saint-Lazare, et les embêtements avec les sœurs, et ces salauds de la police qui l’avaient mise en carte. » Comme le chapitre VIII, on s’étonne que Zola, qui veut traiter de la prostitution et ausculter en naturaliste la vie moderne, ne développe pas le récit de Satin. En tout cas, Nana devient ouvertement lesbienne : « Puis, un beau soir, ça devint sérieux. Nana, si dégoûtée chez Laure, comprenait maintenant. Elle en fut bouleversée, enragée ». L’édition GF signale en note une formule du dossier préparatoire, que l’on peut visionner avec émotion sur Gallica (dossier 10303, folio 103, tout en haut de la page) : « Le ravage du g. toutes le sont. La plaie. Clarisse. Simonne ». Nana devient enragée, et dispute Satin à madame Robert : « À vingt reprises, tragique dans ses fureurs de femme trompée, Nana courut à la poursuite de cette gueuse, qui s’envolait par toquade, ennuyée du bien-être de l’hôtel. Elle parlait de souffleter madame Robert ; un jour même, elle rêva de duel ; il y en avait une de trop. Maintenant, quand elle dînait chez Laure, elle mettait ses diamants, emmenant parfois Louise Violaine, Maria Blond, Tatan Néné, toutes resplendissantes ; et, dans le graillon des trois salles, sous le gaz jaunissant, ces dames encanaillaient leur luxe, heureuses d’épater les petites filles du quartier, qu’elles levaient au sortir de table. […] Satin pourtant, au milieu de ces histoires, gardait son calme, avec ses yeux bleus et son pur visage de vierge ; mordue, battue, tiraillée entre les deux femmes, elle disait simplement que c’était drôle, qu’elles auraient bien mieux fait de s’entendre. Ça n’avançait à rien de la gifler ; elle ne pouvait se couper en deux, malgré sa bonne volonté d’être gentille pour tout le monde. À la fin, ce fut Nana qui l’emporta, tellement elle combla Satin de tendresses et de cadeaux ; et, pour se venger, madame Robert écrivit aux amants de sa rivale des lettres anonymes abominables. » Quand arrive une de ces lettres, Nana défend son nouveau genre face à Muffat : « — Ça, mon loup, c’est une chose qui ne te regarde pas… Qu’est-ce que ça peut te faire ? Elle ne niait point. […] D’où sortait-il ? Ça se faisait partout, et elle nomma ses amies, elle jura que les dames du monde en étaient. Enfin, à l’entendre, il n’y avait rien de plus commun ni de plus naturel. […] à quoi bon lui mentir sur une chose sans conséquence ? » Au cours d’un dîner, entre poire et truffes, Satin évoque les bons vieux souvenirs de l’Assommoir : « Et je vois encore votre boutique… Ta mère était une grosse. Un soir que nous jouions, ton père est rentré pochard, mais pochard ! » ; mais c’est à peu près tout l’effort de Zola pour lier ses deux romans, à part le personnage de Mme Lerat. Sans doute veut-il faire de Nana et de Louiset des fins de race. Nana et Satin exhibent leur passion : « Mais Satin, qui avait pelé une poire, était venue la manger derrière sa chérie, appuyée à ses épaules, lui disant dans le cou des choses, dont elles riaient très fort ; puis, elle voulut partager son dernier morceau de poire, elle le lui présenta entre les dents ; et toutes deux se mordillaient les lèvres, achevaient le fruit dans un baiser. Alors, ce fut une protestation comique de la part de ces messieurs. Philippe leur cria de ne pas se gêner. Vandeuvres demanda s’il fallait sortir. […] — Êtes-vous bêtes ! dit Nana, vous la faites rougir, cette pauvre mignonne… Va, ma fille, laisse-les blaguer. Ce sont nos petites affaires. […] Muffat n’avait plus une protestation. Au milieu de ces messieurs, de ces grands noms, de ces vieilles honnêtetés, les deux femmes, face à face, échangeant un regard tendre, s’imposaient et régnaient, avec le tranquille abus de leur sexe et leur mépris avoué de l’homme. Ils applaudirent. » Il arrive à Nana de lire des romans, ce qui permet à Zola de mettre en abyme sa conception de la littérature : « Elle avait lu dans la journée un roman qui faisait grand bruit, l’histoire d’une fille ; et elle se révoltait, elle disait que tout cela était faux, témoignant d’ailleurs une répugnance indignée contre cette littérature immonde, dont la prétention était de rendre la nature ; comme si l’on pouvait tout montrer ! Comme si un roman ne devait pas être écrit pour passer une heure agréable ! En matière de livres et de drames, Nana avait des opinions très arrêtées : elle voulait des œuvres tendres et nobles, des choses pour la faire rêver et lui grandir l’âme. » Voir plus haut l’opinion de Valtesse de La Bigne sur Nana…
Chapitre XI
La scène du Grand Prix de Paris au bois de Boulogne occupe ce chapitre. Tous les personnages s’y retrouvent, et c’est l’apothéose de Nana, qu’elle partage un peu avec un personnage secondaire, la Tricon : « Arrivée dans un fiacre, d’où elle ne voyait rien, la Tricon était tranquillement montée sur le siège du cocher. Et, là-haut, redressant sa grande taille, avec sa figure noble aux longues anglaises, elle dominait la foule, elle semblait régner sur son peuple de femmes. Toutes lui souriaient, discrètement. Elle, supérieure, affectait de ne pas les connaître. » Le marquis de Chouard est censé avoir terriblement vieilli, alors que l’action s’étale sur 3 ans : « il venait d’acheter à Gaga sa fille Amélie, trente mille francs, disait-on. » L’épreuve est remportée par l’un des deux chevaux de Vandeuvres, qu’il a subtilement appelé « Nana » et fait passer pour une rosse, de façon à truquer la course contre son autre cheval censé être le favori. Cela donne nombre de plaisanteries sur le jockey qui « monte » Nana, mais à la fin, la foule s’enflamme pour cette cavale allégorique : « Nana ! Nana ! Nana ! Le cri roulait, grandissait, avec une violence de tempête, emplissant peu à peu l’horizon, des profondeurs du Bois au mont Valérien, des prairies de Longchamp à la plaine de Boulogne. Sur la pelouse, un enthousiasme fou s’était déclaré. Vive Nana ! vive la France ! à bas l’Angleterre ! » Malheureusement le trucage de Vandeuvres est éventé ; et celui-ci, « exclu des champs de courses, exécuté le soir même au Cercle Impérial, s’était le lendemain fait flamber dans son écurie, avec ses chevaux. »
Chapitre XII
Nana fait « une fausse couche », ce qui occasionne un beau paragraphe sur sa conception de la conception : « Nana était enceinte de trois mois. Longtemps elle avait cru à une indisposition […] ça faisait donc des enfants, même lorsqu’on ne voulait plus et qu’on employait ça à d’autres affaires ? La nature l’exaspérait, cette maternité grave qui se levait dans son plaisir, cette vie donnée au milieu de toutes les morts qu’elle semait autour d’elle. Est-ce qu’on n’aurait pas dû disposer de soi à sa fantaisie, sans tant d’histoires ? Ainsi, d’où tombait-il, ce mioche ? Elle ne pouvait seulement le dire. Ah ! Dieu ! celui qui l’avait fait aurait eu une riche idée en le gardant pour lui, car personne ne le réclamait, il gênait tout le monde, et il n’aurait bien sûr pas beaucoup de bonheur dans l’existence ! » Muffat « avait reçu la lettre écrite par Sabine à son amant ». Comme il veut « tuer sa femme » ou « souffleter cet homme », Nana lui conseille de « [s]e remettre avec [s]a femme », ce qui arrangerait bien ses propres affaires. Fut dit fut fait, et en prime, Nana manigance pour que Daguenet avec qui elle est réconciliée, épouse la fille de Muffat, ce qui se fait en petit comité, juste 500 invités. La Faloise s’amuse à faire croire à Steiner que Nana est venue en personne chez les Muffat pour faire la leçon à son protégé : « Vous savez, Nana vient d’arriver… Oh ! une entrée, mes enfants ! quelque chose de pharamineux !… D’abord, elle a embrassé la comtesse. Ensuite, quand les enfants se sont approchés, elle les a bénis en disant à Daguenet : « Ecoute, Paul, si tu lui fais des queues, c’est à moi que tu auras à faire… ». Faire des queues, c’est-à-dire être infidèle. Zola de son côté s’amuse à faire prendre des poses au vieux marquis de Chouard : « Scandalisé par la conduite du comte Muffat, il venait de rompre publiquement, il affectait de ne plus mettre les pieds dans l’hôtel. S’il avait consenti à y paraître, ce soir-là, c’était sur les instances de sa petite-fille, dont il désapprouvait d’ailleurs le mariage, avec des paroles indignées contre la désorganisation des classes dirigeantes par les honteux compromis de la débauche moderne. » Le comte retrouve le chemin du devoir conjugal : « Ce fut le soir du mariage à l’église que le comte Muffat se présenta dans la chambre de sa femme, où il n’était pas entré depuis deux ans. La comtesse, très surprise, recula d’abord. […] D’ailleurs, ni l’un ni l’autre ne risquèrent une explication nette. C’était la religion qui voulait ce pardon mutuel ; et il fut convenu entre eux, par un accord tacite, qu’ils garderaient leur liberté. Avant de se mettre au lit, comme la comtesse paraissait hésiter encore, ils causèrent affaires. Le premier, il parla de vendre les Bordes. Elle, tout de suite, consentit. Ils avaient de grands besoins, ils partageraient. Cela acheva la réconciliation. Muffat en ressentit un véritable soulagement dans ses remords. » Daguenet tient une promesse que Nana avait oubliée, et vient coucher avec elle avant de dépuceler sa nouvelle épouse : « Voyons, ton courtage… Je t’apporte l’étrenne de mon innocence. »
Chapitre XIII
C’est la dégringolade du comte. Nana abuse de sa passion, et grignote pied à pied le pacte. C’est d’abord par hasard qu’il la surprend se tapant son petit Georges. Il ouvre les yeux, mais ne peut se résoudre à sévir : « il ne restait dans le tourment de sa possession que par un besoin lâche, par une épouvante de la vie, à l’idée de vivre sans elle. » Nana mène la grande vie et ne trouve plus de bornes à ses envies. Pour satisfaire ses désirs, elle trait tous les mâles que son rut attire. Philippe Hugon vole et va en prison pour elle, la demande en mariage, et elle s’amuse à casser d’un coup le bibelot ruineux qu’il lui a offert avec tous les autres : « elle zézaya d’une voix de gamine : — Fini ! n’a plus ! n’a plus ! » Du coup, Georges demande des comptes, et Nana lui fait remarquer qu’il ne paie pas, et qu’elle couche avec son frère si elle veut : « Tu n’espérais pas, peut-être, m’avoir pour maman jusqu’à la mort. J’ai mieux à faire que d’élever des mioches. » (Il n’a qu’un an ou deux de moins qu’elle). Le pauvre se suicide avec des ciseaux de couture, qui ne le tuent pas aussitôt, mais laissent une tache de sang dont le narrateur use avec mauvais goût (on ne parvient pas à la nettoyer et elle demeure comme un symbole, et blablabla). Quant elle ne trouve pas d’argent sous la queue de ses hommes, Nana « se rendait chez la Tricon, avec l’aisance de l’habitude, comme les pauvres gens vont au mont-de-piété ». Quand Muffat la surprend à nouveau avec un homme, elle monte le ton : « Mets bien dans ta caboche que j’entends être libre. Quand un homme me plaît, je couche avec. » Ce qui se passe chez le comte n’est pas à son avantage : « Son rapprochement avec sa femme lui avait rendu son intérieur insupportable. La comtesse, lâchée par Fauchery, qui retombait sous l’empire de Rose, s’étourdissait à d’autres amours, dans le coup de fièvre inquiet de la quarantaine, toujours nerveuse, emplissant l’hôtel du tourbillon exaspérant de sa vie. Estelle, depuis son mariage, ne voyait plus son père ; chez cette fille, plate et insignifiante, une femme d’une volonté de fer avait brusquement paru, si absolue, que Daguenet tremblait devant elle ; maintenant, il l’accompagnait à la messe, converti, furieux contre son beau-père qui les ruinait avec une créature. » Nana ne se gêne plus avec Muffat : « Est-ce que tu t’imagines que je t’aime pour tes formes ? Quand on a une gueule comme la tienne, on paie les femmes qui veulent bien vous tolérer… Nom de Dieu ! si tu ne m’apportes pas les dix mille francs ce soir, tu n’auras pas même à sucer le bout de mon petit doigt… Vrai ! je te renvoie à ta femme ! » Elle se fait putain libre : « À cette heure, elle ne se gênait plus, elle avait reconquis une liberté entière. Tous les jours, elle faisait son tour du lac, ébauchant là des connaissances, qui se dénouaient ailleurs. C’était la grande retape, le persil ! au clair soleil, le raccrochage des catins illustres, étalées dans le sourire de tolérance et dans le luxe éclatant de Paris. » Elle couche même avec ses domestiques, avec le « premier venu », ce qui accélère sa chute : « ce fut le commencement d’une débâcle parmi les domestiques. […] Zoé seule restait, avec son air propre et son unique souci d’organiser ce désordre, tant qu’elle n’aurait pas de quoi s’établir pour son compte, un plan dont elle mûrissait l’idée depuis longtemps. Les aventures féminines ne sont pas négligées : « Dans l’angoisse de sa jalousie, le malheureux en arrivait à être tranquille, lorsqu’il laissait Nana et Satin ensemble. Il l’aurait poussée à ce vice, pour écarter les hommes. Mais, de ce côté encore, tout se gâtait. Nana trompait Satin comme elle trompait le comte, s’enrageant dans des toquades monstrueuses, ramassant des filles au coin des bornes. Quand elle rentrait en voiture, elle s’amourachait parfois d’un souillon aperçu sur le pavé, les sens pris, l’imagination lâchée ; et elle faisait monter le souillon, le payait et le renvoyait. Puis, sous un déguisement d’homme, c’étaient des parties dans des maisons infâmes, des spectacles de débauche dont elle amusait son ennui. » La prochaine victime est Steiner, ce qui permet une critique neuve de la prostituée : « Elle le traitait de sale juif, elle semblait assouvir une haine ancienne, dont elle ne se rendait pas bien compte. Il était gros, il était bête, et elle le bousculait, avalant les morceaux doubles, voulant en finir plus vite avec ce Prussien. […] Il s’était associé avec un maître de forges, en Alsace ; il y avait là-bas, dans un coin de province, des ouvriers noirs de charbon, trempés de sueur, qui, nuit et jour, raidissaient leurs muscles et entendaient craquer leurs os, pour suffire aux plaisirs de Nana. Elle dévorait tout comme un grand feu, les vols de l’agio, les gains du travail. » Après Steiner, vient « La Faloise. Il postulait depuis longtemps l’honneur d’être ruiné par elle, afin d’être parfaitement chic. » Muffat subit Nana en chrétien : « La femme le possédait avec le despotisme jaloux d’un Dieu de colère, le terrifiant, lui donnant des secondes de joie aiguës comme des spasmes, pour des heures d’affreux tourments, des visions d’enfer et d’éternels supplices. C’étaient les mêmes balbutiements, les mêmes prières et les mêmes désespoirs, surtout les mêmes humilités d’une créature maudite, écrasée sous la boue de son origine. » Nana en profite pour corser leurs jeux, lui faire faire le cheval ou le chien : « D’autres fois, il était un chien. Elle lui jetait son mouchoir parfumé au bout de la pièce, et il devait courir le ramasser avec les dents, en se traînant sur les mains et les genoux. — Rapporte, César !… Attends, je vais te régaler, si tu flânes !… Très bien, César ! obéissant ! gentil !… Fais le beau ! Et lui aimait sa bassesse, goûtait la jouissance d’être une brute. Il aspirait encore à descendre, il criait : — Tape plus fort… Hou ! hou ! je suis enragé, tape donc ! » La goutte d’eau qui fait déborder le vase est que le comte tombe sur son beau père, le vieux marquis de Chouard, « comme une loque humaine, gâtée et dissoute par soixante ans de débauche, […] retomb[é] en enfance […] ne trouvant plus les mots, à moitié paralysé, bégayant, grelottant ». C’est à cette « ordure » que Nana réserve l’inauguration de son lit d’apparat qui a achevé de ruiner ses hommes. Au sortir de cette scène, Muffat apprend que « la comtesse Sabine, dans un détraquement suprême, venait de s’enfuir avec un chef de rayon d’un grand magasin de nouveautés, scandale affreux dont tout Paris causait déjà ». À côté de ce ménage malheureux, Zola s’amuse à glisser un ménage à trois heureux, nouvel avatar de ce motif connu (Gervaise / Coupeau / Lantier) : « Mignon […] s’accoutumait à Fauchery, il finissait par trouver mille avantages dans la présence d’un mari chez sa femme, lui laissait les petits soins du ménage, se reposait sur lui pour une surveillance active, employait aux dépenses quotidiennes de la maison l’argent de ses succès dramatiques […] ; et comme, d’autre part, Fauchery se montrait raisonnable, […] les deux hommes s’entendaient de mieux en mieux, heureux de leur association fertile en bonheurs de toutes sortes, faisant chacun son trou côte à côte, dans un ménage où ils ne se gênaient plus. C’était réglé, ça marchait très bien, ils rivalisaient l’un l’autre pour la félicité commune. » Du côté de Nana, ça ne va pas fort, Zoé prend son congé : « Zoé prenait l’établissement de la Tricon, un vieux projet longtemps couvé, une ambition de fortune où allaient passer ses économies ; elle était pleine d’idées larges, elle rêvait d’agrandir la chose, de louer un hôtel et d’y réunir tous les agréments » Mignon donne un point de vue amusant sur notre héroïne : « Cette sacrée Nana le stupéfiait […]. Au milieu de la débâcle de la maison, dans le coulage, dans le galop de massacre des domestiques, il y avait un entassement de richesses bouchant quand même les trous et débordant par-dessus les ruines. […] Nana l’exaltait davantage ; et il retrouvait, devant son travail, cette sensation de respect éprouvée par lui un soir de fête, dans le château qu’un raffineur s’était fait construire, un palais dont une matière unique, le sucre, avait payé la splendeur royale. Elle, c’était avec autre chose, une petite bêtise dont on riait, un peu de sa nudité délicate, c’était avec ce rien honteux et si puissant, dont la force soulevait le monde, que toute seule, sans ouvriers, sans machines inventées par des ingénieurs, elle venait d’ébranler Paris et de bâtir cette fortune où dormaient des cadavres. — Ah ! nom de Dieu ! quel outil ! laissa échapper Mignon » Nana semble d’accord avec ce jugement, si l’on en croit ce passage grandiloquent dont on se demande s’il est en discours indirect libre ou s’il est à mettre au compte du narrateur : « Son œuvre de ruine et de mort était faite, la mouche envolée de l’ordure des faubourgs, apportant le ferment des pourritures sociales, avait empoisonné ces hommes, rien qu’à se poser sur eux. C’était bien, c’était juste, elle avait vengé son monde, les gueux et les abandonnés. Et tandis que, dans une gloire, son sexe montait et rayonnait sur ses victimes étendues, pareil à un soleil levant qui éclaire un champ de carnage, elle gardait son inconscience de bête superbe, ignorante de sa besogne, bonne fille toujours. Elle restait grosse, elle restait grasse, d’une belle santé, d’une belle gaieté. »
Chapitre XIV
La chute de Nana et du roman est brusque, comme si notre naturaliste avait besoin d’une fin morale où la méchante bête serait châtiée. Nana vend tout et parcourt le monde sur une toquade ; les rumeurs les plus folles courent sur elle : « elle s’était ruinée avec un grand nègre, une sale passion qui la laissait sans une chemise, dans la débauche crapuleuse du Caire » ; et elle revient à Paris en reine, mais le récit s’accélère, et la narration est déléguée à Lucy Stewart, une fille d’âge mûr (que Zola aurait aussi bien pu choisir pour héroïne) : « Nana débarque de Russie, je ne sais plus pourquoi, un attrapage avec son prince… Elle laisse ses bagages à la gare, elle descend chez sa tante, tu te rappelles, cette vieille… Bon elle tombe sur son bébé qui avait la petite vérole ; le bébé meurt le lendemain ». Bref, toute la société se retrouve à nouveau, après le théâtre, après la maison de campagne de Mme Hugon et le champ de course, au spectacle de la mort de Nana, sexes séparés comme dans les églises, les femmes en haut auprès du cadavre de Nana (quand Lucy arrive, elle a déjà passé), et les hommes, moins courageux, dans la rue, craignant la contamination. Tout cela sur fond d’une manifestation manigancée par le régime avec des « blouses blanches », qui entraînent le peuple à crier « À Berlin ! À Berlin ! À Berlin ! », le 15 juillet 1870, jour du vote des crédits de la guerre avec la Prusse (motif repris au premier chapitre de La Débâcle). Nana ne meurt donc pas de la syphilis ni phtisique, et ne meurt pas ruinée, facilité que Zola a sans doute écartée parce qu’elle a été utilisée dans des œuvres traitant de courtisanes : « ajoutez qu’elle avait des sous avec ça, quelque chose comme un million. Lucy demanda qui héritait. Des parents éloignés, la tante sans doute. » On cause de la guerre devant le cadavre de Nana : « Lucy prit la défense de l’empire. Elle avait couché avec un prince de la maison impériale, c’était pour elle affaire de famille ». Le roman se clôt sur un portrait répugnant du visage de Nana, pour lequel Zola s’est renseigné comme il a pu : « Vénus se décomposait. Il semblait que le virus pris par elle dans les ruisseaux, sur les charognes tolérées, ce ferment dont elle avait empoisonné un peuple, venait de lui remonter au visage et l’avait pourri. »
Quelques réflexions en guise d’épilogue
J’avais à peine terminé cet article que je partais en vacances à Prague. Et le hasard m’y a fait assister à une représentation de La Traviata, l’opéra de Verdi inspiré de La Dame aux Camélias, d’Alexandre Dumas fils. Or si vous lisez l’article de Jo la Frite en lien ci-dessus, vous saurez que l’inspiration de ce roman qui donne une idée si fausse selon notre ami Zola de la prostitution, est autobiographique, l’auteur ayant eu une liaison avec la courtisane Marie Duplessis. Jo la Frite qualifie même le roman de « féministe ». De même Verdi, s’il adapta le roman de Dumas, c’est qu’il avait assisté à une représentation de la pièce tirée du roman, en compagnie de Giuseppina Strepponi, sa compagne et future épouse, qui était elle-même considérée comme une « traviata » en raison de sa vie quelque peu altersexuelle, bien qu’elle n’eût point été courtisane. Lire cet article de Jean-Louis Foucart. On s’étonne donc du moralisme de Zola, trop outré pour n’être pas suspect. Et c’est à ce moralisme que l’on doit ce chef-d’œuvre qui est aussi naturaliste que je suis hôtesse de l’air, avec ce personnage aussi peu crédible de courtisane adolescente.

À Prague également, dans la galerie de peinture du château, j’ai pu admirer un tableau de Lucas Cranach l’Ancien (1472-1553) intitulé Le Vieux fou, qui représente une jeune femme embrassant un vieil homme de sa main gauche tandis que sa dextre plonge dans la bourse du vieux fou. Or Cranach a peint toute une série de ce même motif sous des titres variés : « Couple mal assorti », quatre versions (1517, 1522, 1530) ; « Paysan et prostituée » (1525) ; « Courtisane et vieillard » (1530). L’un de ces tableaux mériterait une séance d’histoire de l’art dans le cadre d’une étude de Nana en classe de Première, ce qui rappellerait que le naturalisme n’est pas une émanation du seul XIXe siècle.
– Lire « Faire tourner Paris : ethnogénétique et logogénétique de Nana de Zola » article de Sophie Ménard. Notice sur le personnage de Nana dans Les Personnages des Rougon-Macquart, de F. C. Ramond (1901), sur un site extraordinairement fourni de Michael Lastinger, professeur de français à la West Virginia University. Voir un sujet de bac sur le roman incluant un extrait de Nana.
– Lire l’article sur La Maison Tellier de Guy de Maupassant, premier recueil de nouvelles qu’il publie en 1881, dans lequel il se démarque de son mentor sur la question de la prostitution autant que sur celle du lesbianisme. Par curiosité, voyez cet article sur À la feuille de rose, maison turque, première pièce du jeune Maupassant, jouée en huis clos et en travesti, paraît-il en présence de Flaubert et Zola !
– Pour le cinéma, Nana est un des romans de Zola qui a été le plus souvent adapté. On trouvera la liste des 9 adaptations sur le site TheEmileZolaSociety, en complétant avec l’article de Wikipédia. Mais je vous propose aussi l’inénarrable scène centrale de My Fair Lady (1964) de George Cukor, lorsque Eliza est « sortie » pour la 1re fois aux courses d’Ascot, et stupéfie l’aristocratie en retrouvant spontanément son langage ordurier lorsqu’elle se prend au jeu des courses. J’ai vu en 2018 la version de Jean Renoir, cinéma muet de 1926, en ciné-concert à la Cinémathèque. C’est le 2e film de Renoir, et autant prévenir que ce n’est pas un chef-d’œuvre. Film interminable qui censure tous les aspects gênants, l’extrême jeunesse de l’héroïne, le lesbianisme, la prostitution de bas étage. Par manque de budget sans doute, les scènes les plus attendues manquent, comme celle de la rencontre à la campagne de Nana avec la mère de son petit Hugon, le trouple de Fauchery / Mignon, etc.
Voir en ligne : Nana sur Wikisource
© altersexualite.com, 2016
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] De même dans La Machine infernale de Cocteau, Jocaste surnomme Zizi le devin Tirésias.
 altersexualite.com
altersexualite.com

