Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > Du Contrat social, de Jean-Jacques Rousseau
Nul n’est prophète en son pays, pour étudiants et adultes
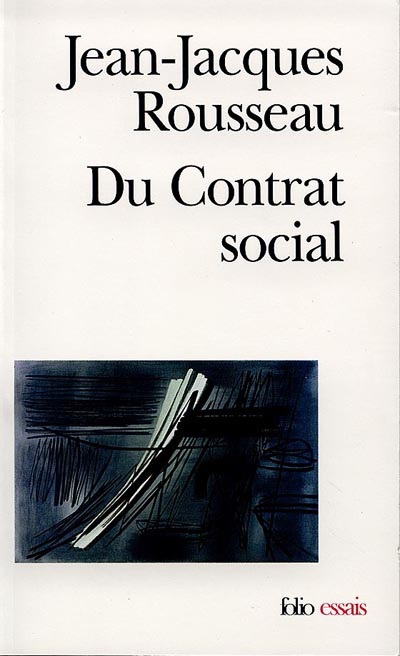 Du Contrat social, de Jean-Jacques Rousseau
Du Contrat social, de Jean-Jacques Rousseau
Folio, 1964 (1762), 542 p., 11,4 €.
samedi 4 mai 2019
Du Contrat social (1762), de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « Seuls avec tous ». Familier des écrits de Rousseau (cf. mon article sur Les Confessions), le Contrat social était son seul livre fameux que je n’avais pas encore lu. J’ai choisi l’édition Folio, qui est en fait extraite du volume III des œuvres complètes de la Pléiade, avec le paratexte de Robert Derathé. Le livre est épais car le Contrat social en lui-même assez bref, est précédé ici du « Discours sur l’économie politique », et de la 1re version du Contrat, et suivi de « Fragments politiques ». C’est un choix que je regrette et que je ne conseille pas aux étudiants. En effet, l’édition est universitaire, et s’attache fort peu à expliciter la pensée parfois complexe de Rousseau. Par exemple, la plupart des citations latines ne sont pas toujours traduites, car en 1964 sans doute trouvait-on naturel qu’un lecteur de cette édition fût latiniste. On trouve par contre la traduction d’une citation italienne (p. 194). Le texte lui-même est publié dans son jus, avec l’orthographe du XVIIIe siècle (« loix » pour « lois », « avoient » pour « avaient », et « Contract » pour « Contrat », sauf dans le titre !), exception faite de l’esperluette, transformée en « et ». Dans les citations ci-dessous, je moderniserai l’orthographe, mais je rétablirai l’esperluette, pour une raison que vous trouverez dans cet article.
Publié en même temps que le traité l’Émile ou De l’éducation, le Contrat devait faire partie d’un vaste ensemble intitulé Les Institutions politiques que Rousseau méditait mais qu’il renonça à accomplir. Il craignait d’ailleurs que la publication simultanée étouffât le Contrat (cf. p. 49). Si la pensée est novatrice sous l’ancien régime – et Rousseau n’y va pas de main morte – la lettre est parfois confuse, chez un auteur dont on admire pourtant l’art de la période. Il y a cependant, ne vous inquiétez pas, de quoi nous fournir de nombreux extraits brillants autant qu’utiles auprès de nos étudiants, et toujours éclairants sur notre démocratie du XXIe siècle. Les idées de Rousseau trouvent leur origine dans son expérience à l’ambassade de Venise en 1743, mais aussi dans son admiration feinte ou réelle pour sa république natale de Genève, qui pourtant foutra son livre au feu, tandis qu’il était interdit en France.
Introduction de Robert Derathé
Voici une sorte d’abstract de l’œuvre : « Dans les deux versions les intentions de Rousseau sont les mêmes : il se propose d’exposer ce qui rend légitime l’autorité politique, sans rechercher comment elle s’est établie en fait et maintenue au cours de l’histoire où la force tient le plus souvent lieu du droit » (p. 25).
« Mais le Contrat social n’est pas une nostalgique évocation des institutions antiques, uniquement destinée à faire sentir aux hommes modernes leur petitesse et leur dépravation. Rousseau y expose ses principes de législation avec l’espoir qu’ils pourront, au contraire, préserver les peuples modernes de la dépravation » (p. 36). Dans une page des Dialogues Rousseau précise en ces termes quelles furent ses intentions en écrivant le Contrat social : « Son objet ne pouvait être de ramener les peuples nombreux ni les grands États à leur première simplicité, mais seulement d’arrêter, s’il était possible, le progrès de ceux dont la petitesse & la situation les ont préservés d’une marche aussi rapide vers la perfection de la société & vers la détérioration de l’espèce… Mais les grandes nations ont pris pour elles ce qui n’avait pour objet que les petites républiques, & l’on s’est obstiné à voir un promoteur de bouleversements & de troubles dans l’homme du monde qui porte un plus vrai respect aux lois, aux constitutions nationales, & qui a le plus d’aversion pour les révolutions & pour les ligueurs de toute espèce, qui la lui rendent bien ». Malgré ces déclarations, ce qui compte pour Rousseau, c’est peut-être moins la grandeur des États que la mentalité des peuples. Comme il le constate lui-même, la Pologne est « un grand État ». Il consentira à écrire pour elle un projet de réforme parce que les Polonais ont su conserver des « âmes patriotiques » et un grand amour de la liberté » (p. 37).
« Si L’Émile et le Contrat social forment ensemble un seul tout, c’est donc parce qu’ils nous présentent chacun un des deux objectifs visés par l’auteur, une des deux options qu’il nous propose et qu’il faut lire le tout pour avoir un exposé complet de sa pensée. L’Émile s’adresse aux hommes des sociétés corrompues pour qu’ils se préservent eux-mêmes de la corruption, tandis que le Contrat social est destiné aux peuples qui ont su conserver leur liberté » (p. 38).
C’est dans Les Confessions que l’on trouve trace de la genèse de l’œuvre, 18 ans avant la parution du Contrat social : « J’étais assez magnifique en projets. […] Des divers ouvrages que j’avais sur le chantier, celui que je méditais depuis longtemps, dont je m’occupais avec plus de goût, auquel je voulais travailler toute ma vie, et qui devait selon moi, mettre le sceau à ma réputation, était mes Institutions politiques. Il y avait treize à quatorze ans que j’en avais conçu la première idée, lorsqu’étant à Venise j’avais eu quelque occasion de remarquer les défauts de ce gouvernement si vanté. Depuis lors, mes vues s’étaient beaucoup étendues par l’étude historique de la morale. J’avais vu que tout tenait radicalement à la politique, et que, de quelque façon qu’on s’y prît, aucun peuple ne serait jamais que ce que la nature de son gouvernement le ferait être » (cité p. 39).
Le livre est interdit en France par Malesherbes (Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes), chef de la censure royale : « Les deux ballots d’exemplaires du Contrat social expédiés d’Amsterdam vers la mi-avril furent saisis à Rouen, mais ils ne furent pas confisqués et Rey put finalement les récupérer » (p. 50). Des livres passés en fraude sont saisis lors de perquisitions chez des particuliers. Diffusé à 200 exemplaires à Genève début juin, « Ce fut seulement le 19 juin qu’un arrêt du Petit Conseil condamna ensemble l’Émile et le Contrat social à être brûlés « comme téméraires, scandaleux, impies, tendant à détruire la religion chrétienne et tous les gouvernements » » (p. 52).
« Discours sur l’économie politique »
Cet article de l’Encyclopédie contient d’excellents passages, tel que le suivant, farci de questions rhétoriques, que je cite avec toutes ses esperluettes, signe typographique si révélateur de l’esprit des Lumières à mon sens :
« Par quel art inconcevable a-t-on pu trouver le moyen d’assujettir les hommes pour les rendre libres ? d’employer au service de l’état les biens, les bras, & la vie même de tous ses membres, sans les contraindre & sans les consulter ? d’enchaîner leur volonté de leur propre aveu ? de faire valoir leur consentement contre leur refus, & de les forcer à se punir eux-mêmes, quand ils font ce qu’ils n’ont pas voulu ? Comment se peut-il faire qu’ils obéissent & que personne ne commande, qu’ils servent & n’aient point de maître ; d’autant plus libres en effet que sous une apparente sujétion, nul ne perd de sa liberté que ce qui peut nuire à celle d’un autre ? Ces prodiges sont l’ouvrage de la loi. C’est à la loi seule que les hommes doivent la justice & la liberté. C’est cet organe salutaire de la volonté de tous, qui rétablit dans le droit l’égalité naturelle entre les hommes. C’est cette voix céleste qui dicte à chaque citoyen les préceptes de la raison publique, & lui apprend à agir selon les maximes de son propre jugement, & à n’être pas en contradiction avec lui-même. C’est elle seule aussi que les chefs doivent faire parler quand ils commandent ; car sitôt qu’indépendamment des lois, un homme en prétend soumettre un autre à sa volonté privée, il sort à l’instant de l’état civil, & se met vis-à-vis de lui dans le pur état de nature où l’obéissance n’est jamais prescrite que par la nécessité » (p. 70).
En voici un autre, contre l’abus de lois : « Plus vous multipliez les lois, plus vous les rendez méprisables ; & tous les surveillants que vous instituez ne sont que de nouveaux infracteurs destinés à partager avec les anciens, ou à faire leur pillage à part. Bientôt le prix de la vertu devient celui du brigandage : les hommes les plus vils sont les plus accrédités ; plus ils sont grands, plus ils sont méprisables ; leur infamie éclate dans leurs dignités, & ils sont déshonorés par leurs honneurs. S’ils achètent les suffrages des chefs ou la protection des femmes, c’est pour vendre à leur tour la justice, le devoir & l’État ; & le peuple qui ne voit pas que ses vices sont la première cause de ses malheurs, murmure & s’écrie en gémissant : « Tous mes maux ne viennent que de ceux que je paye pour m’en garantir » » (p. 75).
Sur la répartition des richesses : « C’est sur la médiocrité seule que s’exerce toute la force des lois [1] ; elles sont également impuissantes contre les trésors du riche & contre la misère du pauvre ; le premier les élude, le second leur échappe ; l’un brise la toile, & l’autre passe au travers.
C’est donc une des plus importantes affaires du gouvernement, de prévenir l’extrême inégalité des fortunes, non en enlevant les trésors à leurs possesseurs, mais en ôtant à tous les moyens d’en accumuler, ni en bâtissant des hôpitaux pour les pauvres, mais en garantissant les citoyens de le devenir » (p. 80 ; idée reprise dans le Contrat II, XI, cf. infra).
1re mention du « pacte social » : « Il faut se ressouvenir ici que le fondement du pacte social est la propriété ; & sa première condition, que chacun soit maintenu dans la paisible jouissance de ce qui lui appartient » (p. 91).
Sur les tranches d’imposition : « Premièrement on doit considérer le rapport des quantités, selon lequel, toutes choses égales, celui qui a dix fois plus de bien qu’un autre, doit payer dix fois plus que lui. Secondement, le rapport des usages, c’est-à-dire la distinction du nécessaire & du superflu. Celui qui n’a que le simple nécessaire, ne doit rien payer du tout ; la taxe de celui qui a du superflu, peut aller au besoin jusqu’à la concurrence de tout ce qui excède son nécessaire. À cela il dira qu’eu égard à son rang, ce qui serait superflu pour un homme inférieur, est nécessaire pour lui ; mais c’est un mensonge : car un Grand a deux jambes, ainsi qu’un bouvier, & n’a qu’un ventre non plus que lui. De plus, ce prétendu nécessaire est si peu nécessaire à son rang, que s’il savait y renoncer pour un sujet louable, il n’en serait que plus respecté. Le peuple se prosternerait devant un ministre qui irait au conseil à pied, pour avoir vendu ses carrosses dans un pressant besoin de l’état. Enfin la loi ne prescrit la magnificence à personne, & la bienséance n’est jamais une raison contre le droit » (p. 93).
Phrase ironique (citée par Karl Marx dans Le Capital) : « Résumons en quatre mots le pacte social des deux états. Vous avez besoin de moi, car je suis riche & vous êtes pauvre ; faisons donc un accord entre nous : je permettrai que vous ayez l’honneur de me servir, à condition que vous me donnerez le peu qui vous reste, pour la peine que je prendrai de vous commander » (p. 95).
Du Contrat social
Livre I « Premières notions du corps social »
Le chapitre I du livre I pose brièvement le « sujet de ce livre » : « L’homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres qui ne laisse pas d’être plus esclave qu’eux. Comment ce changement s’est-il fait ? Je l’ignore. Qu’est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question.
Si je ne considérais que la force, et l’effet qui en dérive, je dirais : « Tant qu’un peuple est contraint d’obéir et qu’il obéit, il fait bien ; sitôt qu’il peut secouer le joug, et qu’il le secoue, il fait encore mieux ; car, recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l’était point à la lui ôter. » Mais l’ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant ce droit ne vient point de la nature ; il est donc fondé sur des conventions. Il s’agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d’en venir là, je dois établir ce que je viens d’avancer » (p. 173).
Le chapitre II « Des premières Sociétés » commence ainsi :
« La plus ancienne de toutes les sociétés & la seule naturelle est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu’aussi longtemps qu’ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exempts de l’obéissance qu’ils devaient au père, le père exempt des soins qu’il devait aux enfants, rentrent tous également dans l’indépendance. S’ils continuent de rester unis ce n’est plus naturellement c’est volontairement, & la famille elle-même ne se maintient que par convention.
Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l’homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation, ses premiers soins sont ceux qu’il se doit à lui-même, &, sitôt qu’il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à se conserver devient par là son propre maître.
La famille est donc si l’on veut le premier modèle des sociétés politiques ; le chef est l’image du père, le peuple est l’image des enfants, & tous étant nés égaux & libres n’aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que dans la famille l’amour du père pour ses enfants le paye des soins qu’il leur rend, & que dans l’État [2] le plaisir de commander supplée à cet amour que le chef n’a pas pour ses peuples » (p. 174).
Le même chapitre se clôt sur cette ironie : « Je n’ai rien dit du roi Adam, ni de l’empereur Noé père de trois grands monarques qui se partagèrent l’univers, comme firent les enfants de Saturne, qu’on a cru reconnaître en eux. J’espère qu’on me saura gré de cette modération ; car, descendant directement de l’un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que sais-je si par la vérification des titres je ne me trouverais point le légitime roi du genre humain ? Quoi qu’il en soit, on ne peut disconvenir qu’Adam n’ait été souverain du monde comme Robinson de son île, tant qu’il en fut le seul habitant ; et ce qu’il y avait de commode dans cet empire était que le monarque assuré sur son trône n’avait à craindre ni rébellions, ni guerres, ni conspirateurs » (p. 176).
Le chapitre III « Du droit du plus fort » doit être cité en entier :
« Le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître, s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir. De là le droit du plus fort ; droit pris ironiquement en apparence, et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique ; je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté ; c’est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-ce être un devoir ?
Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu’il n’en résulte qu’un galimatias inexplicable. Car sitôt que c’est la force qui fait le droit, l’effet change avec la cause ; toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu’on peut désobéir impunément on le peut légitimement, et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s’agit que de faire en sorte qu’on soit le plus fort. Or qu’est-ce qu’un droit qui périt quand la force cesse ? S’il faut obéir par force, on n’a pas besoin d’obéir par devoir, et si l’on n’est plus forcé d’obéir, on n’y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n’ajoute rien à la force ; il ne signifie ici rien du tout.
Obéissez aux puissances. Si cela veut dire : cédez à la force, le précepte est bon, mais superflu, je réponds qu’il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l’avoue ; mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu’il soit défendu d’appeler le médecin ? Qu’un brigand me surprenne au coin d’un bois : non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la soustraire suis-je en conscience obligé de la donner ? car enfin le pistolet qu’il tient est aussi une puissance.
Convenons donc que force ne fait pas droit, et qu’on n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes. Ainsi ma question primitive revient toujours » (p. 177).
Le chapitre IV « De l’esclavage » se termine sur ce paragraphe :
« Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit d’esclave est nul, non seulement parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il est absurde & ne signifie rien. Ces mots, esclavage & droit, sont contradictoires ; ils s’excluent mutuellement. Soit d’un homme à un homme, soit d’un homme à un peuple, ce discours sera toujours également insensé : Je fais avec toi une convention toute à ta charge & toute à mon profit, que j’observerai tant qu’il me plaira, & que tu observeras tant qu’il me plaira » (p. 180).
Le chapitre V « Qu’il faut toujours remonter à une première convention » doit également être cité en entier :
« Quand j’accorderais tout ce que j’ai réfuté jusqu’ici, les fauteurs du despotisme n’en seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude & régir une société. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu’ils puissent être, je ne vois là qu’un maître & des esclaves, je n’y vois point un peuple & son chef ; c’est si l’on veut une agrégation, mais non pas une association ; il n’y a là ni bien public ni corps politique. Cet homme, eût-il asservi la moitié du monde, n’est toujours qu’un particulier ; son intérêt, séparé de celui des autres, n’est toujours qu’un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, son empire après lui reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres, après que le feu l’a consumé.
Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un roi. Selon Grotius un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil, il suppose une délibération publique. Avant donc que d’examiner l’acte par lequel un peuple élit un roi, il serait bon d’examiner l’acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte étant nécessairement antérieur à l’autre est le vrai fondement de la société.
En effet, s’il n’y avait point de convention antérieure, où serait, à moins que l’élection ne fût unanime, l’obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand ? et d’où cent qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour dix qui n’en veulent point ? La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention, et suppose au moins une fois l’unanimité » (p. 181).
Le chapitre VI « Du pacte social » pose une problématique :
« « Trouver une forme d’association qui défende & protège de toute la force commune la personne & les biens de chaque associé, & par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même & reste aussi libre qu’auparavant. » Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution » (p. 182). La solution en est donnée à la fin du chapitre, avec en prime ces définitions utiles : « Si donc on écarte du pacte social ce qui n’est pas de son essence, on trouvera qu’il se réduit aux termes suivants : Chacun de nous met en commun sa personne & toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; & nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.
À l’instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral & collectif composé d’autant de membres que l’assemblée a de voix, lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie & sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l’union de toutes les autres prenait autrefois le nom de Cité, & prend maintenant celui de République ou de corps politique, lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant à ses semblables. À l’égard des associés ils prennent collectivement le nom de Peuple, & s’appellent en particulier Citoyens comme participants à l’autorité souveraine, & Sujets comme soumis aux lois de l’État. Mais ces termes se confondent souvent & se prennent l’un pour l’autre ; il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision » (p. 183).
Le chapitre VIII « De l’état civil » établit une balance comptable du contrat :
« Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle & un droit illimité à tout ce qui le tente & qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile & la propriété de tout ce qu’il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale, & la possession qui n’est que l’effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif » (p. 186).
Le chapitre IX « Du domaine réel » fournit un contrepoids au célébrissime extrait du début de la seconde partie du Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (« Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile »). Lisez plutôt : « Je terminerai ce chapitre & ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social ; c’est qu’au lieu de détruire l’égalité naturelle, le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d’inégalité physique entre les hommes, & que, pouvant être inégaux en force ou en génie, ils deviennent tous égaux par convention et de droit ». Suit une note de bas de page : « Sous les mauvais gouvernements cette égalité n’est qu’apparente et illusoire ; elle ne sert qu’à maintenir le pauvre dans sa misère & le riche dans son usurpation. Dans le fait les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent & nuisibles à ceux qui n’ont rien : D’où il suit que l’état social n’est avantageux aux hommes qu’autant qu’ils ont tous quelque chose & qu’aucun d’eux n’a rien de trop » (p. 189). À regrouper avec les passages du Manifeste du parti communiste concernant la propriété.
Livre II
Contrairement au livre I, le livre II n’a pas de titre, mais il est consacré à la souveraineté.
Le chapitre II « Que la souveraineté est indivisible » taille des croupières à Grotius, nous donnant une leçon de recherche de la vérité qui nous rappelle l’article « Agnus scythicus » de l’Encyclopédie : « Chacun peut voir dans les chapitres III & IV du premier livre de Grotius comment ce savant homme & son traducteur Barbeyrac s’enchevêtrent, s’embarrassent dans leurs sophismes, crainte d’en dire trop ou de n’en dire pas assez selon leurs vues, & de choquer les intérêts qu’ils avaient à concilier. Grotius, réfugié en France, mécontent de sa patrie, & voulant faire sa cour à Louis XIII à qui son livre est dédié, n’épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits & pour en revêtir les rois avec tout l’art possible. »
Le chapitre III « Si la volonté générale peut errer » définit la volonté générale par la règle du juste milieu, mais aussi par une réflexion sur les partis que nous pouvons vérifier chaque jour dans notre démocratie : « Il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous & la volonté générale ; celle-ci ne regarde qu’à l’intérêt commun ; l’autre regarde à l’intérêt privé, & n’est qu’une somme de volontés particulières : mais ôtez de ces mêmes volontés les plus & les moins qui s’entre-détruisent, reste pour somme des différences la volonté générale.
Si, quand le peuple suffisamment informé délibère, les citoyens n’avaient aucune communication entre eux, du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale, & la délibération serait toujours bonne. Mais quand il se fait des brigues, des associations partielles aux dépens de la grande, la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres, & particulière par rapport à l’État : on peut dire alors qu’il n’y a plus autant de votants que d’hommes, mais seulement autant que d’associations. Les différences deviennent moins nombreuses & donnent un résultat moins général.
Enfin quand une de ces associations est si grande qu’elle l’emporte sur toutes les autres, vous n’avez plus pour résultat une somme de petites différences, mais une différence unique ; alors il n’y a plus de volonté générale, & l’avis qui l’emporte n’est qu’un avis particulier » (p. 193).
Le chapitre IV « Des bornes du pouvoir souverain » établit le distinguo entre tous et chacun : « Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu’ils sont mutuels ; & leur nature est telle qu’en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi. Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite, & pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d’eux, si ce n’est parce qu’il n’y a personne qui ne s’approprie ce mot, chacun, et qui ne songe à lui-même en votant pour tous ? Ce qui prouve que l’égalité de droit et la notion de justice qu’elle produit dérivent de la préférence que chacun se donne, et par conséquent de la nature de l’homme ; que la volonté générale, pour être vraiment telle, doit l’être dans son objet ainsi que dans son essence ; qu’elle doit partir de tous pour s’appliquer à tous ; et qu’elle perd sa rectitude naturelle lorsqu’elle tend à quelque objet individuel et déterminé, parce qu’alors, jugeant de ce qui nous est étranger, nous n’avons aucun vrai principe d’équité qui nous guide » (p. 195).
Il en découle que chacun doit se battre pour tous, selon un raisonnement implacable : « Leur vie même, qu’ils ont dévouée à l’État, en est continuellement protégée ; & lorsqu’ils l’exposent pour sa défense, que font-ils alors que lui rendre ce qu’ils ont reçu de lui ? Que font-ils qu’ils ne fissent plus fréquemment & avec plus de danger dans l’état de nature, lorsque, livrant des combats inévitables, ils défendraient au péril de leur vie ce qui leur sert à la conserver ? Tous ont à combattre, au besoin, pour la patrie, il est vrai ; mais aussi nul n’a jamais à combattre pour soi. Ne gagne-t-on pas encore à courir, pour ce qui fait notre sûreté, une partie des risques qu’il faudrait courir pour nous-mêmes sitôt qu’elle nous serait ôtée ? » (p. 197).
Le chapitre V « Du droit de vie et de mort » plaide pour la peine de mort : « Le traité social a pour fin la conservation des contractants. Qui veut la fin veut aussi les moyens, & ces moyens sont inséparables de quelques risques, même de quelques pertes. Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut. Or, le citoyen n’est plus juge du péril auquel la loi veut qu’il s’expose ; & quand le prince lui a dit : « Il est expédient à l’État que tu meures », il doit mourir, puisque ce n’est qu’à cette condition qu’il a vécu en sûreté jusqu’alors, & que sa vie n’est plus seulement un bienfait de la nature, mais un don conditionnel de l’État. Vous retrouverez cet extrait dans une séance de réflexion sur un tableau de David, Le Serment des Horaces dans le cadre du cours sur le thème « Seuls avec tous ».
La peine de mort infligée aux criminels peut être envisagée à peu près sous le même point de vue : c’est pour n’être pas la victime d’un assassin que l’on consent à mourir si on le devient. Dans ce traité, loin de disposer de sa propre vie, on ne songe qu’à la garantir, & il n’est pas à présumer qu’aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre » (p. 198). Mais ce plaidoyer est tempéré par la fin du chapitre : « Au reste, la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement. Il n’y a point de méchant qu’on ne pût rendre bon à quelque chose. On n’a droit de faire mourir, même pour l’exemple, que celui qu’on ne peut conserver sans danger.
À l’égard du droit de faire grâce ou d’exempter un coupable de la peine portée par la loi & prononcée par le juge, il n’appartient qu’à celui qui est au-dessus du juge et de la loi, c’est-à-dire au souverain ; encore son droit en ceci n’est-il pas bien net, et les cas d’en user sont-ils très rares. Dans un État bien gouverné, il y a peu de punitions, non parce qu’on fait beaucoup de grâces, mais parce qu’il y a peu de criminels : la multitude des crimes en assure l’impunité lorsque l’État dépérit. […] Les fréquentes grâces annoncent que, bientôt les forfaits n’en auront plus besoin, et chacun voit où cela mène. Mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume : laissons discuter ces questions à l’homme juste qui n’a point failli, et qui jamais n’eut lui-même besoin de grâce » (p. 199).
Le chapitre VI « De la loi » comme son titre l’indique, définit la loi : « Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même ; & s’il se forme alors un rapport, c’est de l’objet entier sous un point de vue à I’objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C’est cet acte que j’appelle une loi » (p. 201).
Le chapitre VII « Du législateur » est-il une sorte d’auto-glorification du « législateur » que serait Rousseau ? : « Mais s’il est vrai qu’un grand prince est un homme rare, que sera-ce d’un grand législateur ? Le premier n’a qu’à suivre le modèle que l’autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n’est que l’ouvrier qui la monte et la fait marcher. « Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l’institution et c’est ensuite l’institution qui forme les chefs des républiques » (p. 203). Et de broder sur ce thème de l’œuf et de la poule : « Pour qu’un peuple naissant pût goûter les saines maximes de la politique & suivre les règles fondamentales de la raison d’État, il faudrait que l’effet pût devenir la cause ; que l’esprit social, qui doit être l’ouvrage de l’institution, présidât à l’institution même ; & que les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles. Ainsi donc le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c’est une nécessité qu’il recoure à une autorité d’un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence & persuader sans convaincre » (p. 205). Et voici la religion, qui assure cette « autorité d’un autre ordre » : « La loi judaïque, toujours subsistante, celle de l’enfant d’Ismaël, qui depuis dix siècles régit la moitié du monde, annoncent encore aujourd’hui les grands hommes qui les ont dictées ; & tandis que l’orgueilleuse philosophie ou l’aveugle esprit de parti ne voit en eux que d’heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand & puissant génie qui préside aux établissements durables.
Il ne faut pas, de tout ceci, conclure avec Warburton, que la politique & la religion aient parmi nous un objet commun, mais que, dans l’origine des nations, l’une sert d’instrument à l’autre » (p. 206).
Le chapitre VIII « Du peuple » rejoint les propos de Gustave Le Bon dans Psychologie des foules : « Ce n’est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des hommes et leur ôtent le souvenir du passé, il ne se trouve quelquefois dans la durée des États des époques violentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l’horreur du passé tient lieu d’oubli, et où l’État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre, et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort ». Mais Rousseau de nous prévenir aussitôt : « Mais ces événements sont rares ; ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l’État excepté. Elles ne sauraient même avoir lieu deux fois pour le même peuple : car il peut se rendre libre tant qu’il n’est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé.
Alors les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir ; &, sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars & n’existe plus : il lui faut désormais un maître & non pas un libérateur. Peuples libres, souvenez-vous de cette maxime : « On peut acquérir la liberté, mais on ne la recouvre jamais. » » (p. 207).
Le chapitre IX sobrement intitulé « Suite » commence par un éloge des petits États : « Comme la nature a donné des termes à la stature d’un homme bien conformé, passé lesquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d’un État, des bornes à l’étendue qu’il peut avoir, afin qu’il ne soit ni trop grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a, dans tout corps politique, un maximum de force qu’il ne saurait passer, & duquel souvent il s’éloigne à force de s’agrandir. Plus le lien social s’étend, plus il se relâche ; & en général un petit État est proportionnellement plus fort qu’un grand ».
Le chapitre XI « Des divers systèmes de législation » contient cette note : « Voulez-vous donc donner à l’État de la consistance ? rapprochez les degrés extrêmes autant qu’il est possible : ne souffrez ni des gens opulents ni des gueux. Ces deux états, naturellement inséparables, sont également funestes au bien commun ; de l’un sortent les fauteurs de la tyrannie & de l’autre les tyrans ; c’est toujours entre eux que se fait le trafic de la liberté publique ; l’un l’achète & l’autre la vend » (p. 214 ; idée présente dans le « Discours sur l’économie politique », cf. supra).
Livre III
Le livre III n’a pas de titre, mais une phrase d’accroche : « Avant de parler des diverses formes de gouvernement, tâchons de fixer le sens précis de ce mot qui n’a pas encore été fort bien expliqué »
Le chapitre III « Division des gouvernements » définit les formes de pouvoir, et les déclare poreuses entre elles. Voici le chapitre entier : « On a vu dans le chapitre précédent pourquoi l’on distingue les diverses espèces ou formes de gouvernements par le nombre des membres qui les composent ; il reste à voir dans celui-ci comment se fait cette division.
Le souverain peut, en premier lieu, commettre le dépôt du Gouvernement à tout le peuple ou à la plus grande partie du peuple, en sorte qu’il y ait plus de citoyens magistrats que de citoyens simples particuliers. On donne à cette forme de gouvernement le nom de Démocratie.
Ou bien il peut resserrer le Gouvernement entre les mains d’un petit nombre, en sorte qu’il y ait plus de simples citoyens que de magistrats ; & cette forme porte le nom d’Aristocratie.
Enfin il peut concentrer tout le Gouvernement dans les mains d’un magistrat unique dont tous les autres tiennent leur pouvoir. Cette troisième forme est la plus commune, & s’appelle Monarchie, ou gouvernement royal.
On doit remarquer que toutes ces formes, ou du moins les deux premières, sont susceptibles de plus ou de moins, & ont même une assez grande latitude ; car la Démocratie peut embrasser tout le peuple, ou se resserrer jusqu’à la moitié. L’Aristocratie, à son tour, peut, de la moitié du peuple, se resserrer jusqu’au plus petit nombre indéterminément. La royauté même est susceptible de quelque partage. Sparte eut constamment deux rois par sa constitution ; & l’on a vu dans l’empire romain jusqu’à huit empereurs à la fois sans qu’on pût dire que l’empire fût divisé. Ainsi il y a un point où chaque forme de gouvernement se confond avec la suivante, & l’on voit que, sous trois seules dénominations, le Gouvernement est réellement susceptible d’autant de formes diverses que l’État a de Citoyens.
Il y a plus : ce même Gouvernement pouvant, à certains égards, se subdiviser en d’autres parties, l’une administrée d’une manière & l’autre d’une autre, il peut résulter de ces trois formes combinées une multitude de formes mixtes, dont chacune est multipliable par toutes les formes simples.
On a, de tout temps, beaucoup disputé sur la meilleure forme de Gouvernement, sans considérer que chacune d’elles est la meilleure en certains cas, & la pire en d’autres.
Si, dans les différents États, le nombre des magistrats suprêmes doit être en raison inverse de celui des citoyens, il s’ensuit qu’en général le gouvernement démocratique convient aux petits États, l’aristocratique aux médiocres, & le monarchique aux grands. Cette règle se tire immédiatement du principe. Mais comment compter la multitude de circonstances qui peuvent fournir des exceptions ? » (p. 226).
Le chapitre VI « De la monarchie » fait un constat peu favorable aux rois : « Les Rois veulent être absolus, & de loin on leur crie que le meilleur moyen de l’être est de se faire aimer de leurs peuples. Cette maxime est très belle, & même très vraie à certains égards : malheureusement, on s’en moquera toujours dans les Cours. La puissance qui vient de l’amour des peuples est sans doute la plus grande ; mais elle est précaire & conditionnelle ; jamais les Princes ne s’en contenteront. Les meilleurs Rois veulent pouvoir être méchants s’il leur plaît, sans cesser d’être les maîtres. Un sermonneur politique aura beau leur dire que, la force du peuple étant la leur, leur plus grand intérêt est que le peuple soit florissant, nombreux, redoutable ; ils savent très bien que cela n’est pas vrai. Leur intérêt personnel est premièrement que le peuple soit faible, misérable, & qu’il ne puisse jamais leur résister. J’avoue que, supposant les sujets toujours parfaitement soumis, l’intérêt du Prince serait alors que le peuple fût puissant, afin que cette puissance étant sienne le rendît redoutable à ses voisins ; mais, comme cet intérêt n’est que secondaire & subordonné, & que les deux suppositions sont incompatibles, il est naturel que les princes donnent la préférence à la maxime qui leur est le plus immédiatement utile. C’est ce que Samuel représentait fortement aux Hébreux : c’est ce que Machiavel a fait voir avec évidence. En feignant de donner des leçons aux Rois, il en a donné de grandes aux peuples. Le Prince de Machiavel est le livre des républicains » (p. 231).
Le chapitre X « De l’abus du gouvernement & de sa pente à dégénérer » établit des distinctions lexicales : « Quand l’État se dissout, l’abus du Gouvernement quel qu’il soit, prend le nom commun d’anarchie. En distinguant, la Démocratie dégénère en Ochlocratie, l’Aristocratie en Oligarchie : j’ajouterais que la Royauté dégénère en Tyrannie, mais ce dernier mot est équivoque et demande explication.
Dans le sens vulgaire, un Tyran est un Roi qui gouverne avec violence & sans égard à la justice & aux lois. Dans le sens précis, un Tyran est un particulier qui s’arroge l’autorité royale sans y avoir droit. C’est ainsi que les Grecs entendaient ce mot de Tyran ; ils le donnaient indifféremment aux bons & aux mauvais Princes dont l’autorité n’était pas légitime. Ainsi Tyran & usurpateur sont deux mots parfaitement synonymes.
Pour donner différents noms à différentes choses, j’appelle Tyran l’usurpateur de l’autorité royale, & Despote l’usurpateur du pouvoir Souverain. Le Tyran est celui qui s’ingère contre les lois à gouverner selon les lois ; le Despote est celui qui se met au-dessus des lois mêmes. Ainsi le Tyran peut n’être pas Despote, mais le Despote est toujours Tyran » (p. 245).
Le chapitre XI « De la mort du corps politique » pose une question toujours actuelle : « Pourquoi donc porte-t-on tant de respect aux anciennes lois ? C’est pour cela même. On doit croire qu’il n’y a que l’excellence des volontés antiques qui les ait pu conserver si longtemps ; si le Souverain ne les eût reconnues constamment salutaires, il les eût mille fois révoquées. Voilà pourquoi, loin de s’affaiblir, les lois acquièrent sans cesse une force nouvelle dans tout État bien constitué ; le préjugé de l’antiquité les rend chaque jour plus vénérables : au lieu que partout où les lois s’affaiblissent en vieillissant, cela prouve qu’il n’y a plus de pouvoir législatif, & que l’État ne vit plus » (p. 247).
Le chapitre XII « Comment se maintient l’autorité souveraine » contient une phrase adventice qui se passe de commentaire : « Le dernier cens donna dans Rome quatre cent mille Citoyens portant armes, & le dernier dénombrement de l’empire plus de quatre millions de Citoyens, sans compter les sujets, les étrangers, les femmes, les enfants, les esclaves » (p. 247).
Le chapitre XV « Des députés ou représentants » nous met en garde : « Sitôt que le service public cesse d’être la principale affaire des Citoyens, & qu’ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l’État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? ils payent des troupes & restent chez eux ; faut-il aller au Conseil ? ils nomment des députés & restent chez eux. À force de paresse & d’argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie, & des représentants pour la vendre.
C’est le tracas du commerce & des arts, c’est l’avide intérêt du gain, c’est la mollesse & l’amour des commodités, qui changent les services personnels en argent. On cède une partie de son profit pour l’augmenter à son aise. Donnez de l’argent, & bientôt vous aurez des fers. Ce mot de finance est un mot d’esclave, il est inconnu dans la Cité. Dans un État vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras, & rien avec de l’argent ; loin de payer pour s’exempter de leurs devoirs, ils payeraient pour les remplir eux-mêmes. Je suis bien loin des idées communes ; je crois les corvées moins contraires à la liberté que les taxes » […] « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, & la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi. Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort ; il ne l’est que durant l’élection des membres du parlement : sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l’usage qu’il en fait mérite bien qu’il la perde.
L’idée des représentants est moderne : elle nous vient du gouvernement féodal, de cet inique & absurde gouvernement dans lequel l’espèce humaine est dégradée, & où le nom d’homme est en déshonneur. Dans les anciennes républiques, & même dans les monarchies, jamais le peuple n’eut des représentants ; on ne connaissait pas ce mot-là » (p. 252).
« Quoi ! la liberté ne se maintient qu’à l’appui de la servitude ? Peut-être. Les deux excès se touchent. Tout ce qui n’est point dans la nature a ses inconvénients, & la société civile plus que tout le reste. Il y a telles positions malheureuses où l’on ne peut conserver sa liberté qu’aux dépens de celle d’autrui, & où le citoyen ne peut être parfaitement libre que l’esclave ne soit extrêmement esclave. Telle était la position de Sparte. Pour vous, peuples modernes, vous n’avez point d’esclaves, mais vous l’êtes ; vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j’y trouve plus de lâcheté que d’humanité.
Je n’entends point par tout cela qu’il faille avoir des esclaves, ni que le droit d’esclavage soit légitime, puisque j’ai prouvé le contraire : je dis seulement les raisons pourquoi les peuples modernes qui se croient libres ont des représentants, & pourquoi les peuples anciens n’en avaient pas. Quoi qu’il en soit, à l’instant qu’un peuple se donne des représentants, il n’est plus libre ; il n’est plus » (p. 253).
Le chapitre XVIII « Moyens de prévenir les usurpations du gouvernement » porte bien son nom : « Les assemblées périodiques, dont j’ai parlé ci-devant, sont propres à prévenir ou différer ce malheur, surtout quand elles n’ont pas besoin de convocation formelle ; car alors le Prince ne saurait les empêcher sans se déclarer ouvertement infracteur des lois & ennemi de l’État.
« L’ouverture de ces assemblées, qui n’ont pour objet que le maintien du traité social, doit toujours se faire par deux propositions qu’on ne puisse jamais supprimer, & qui passent séparément par les suffrages.
La première : « S’il plaît au Souverain de conserver la présente forme de Gouvernement. »
La seconde : « S’il plaît au Peuple d’en laisser l’administration à ceux qui en sont actuellement chargés. » Robert Derathé précise en note que « C’est surtout ce passage qui a fait condamner le Contrat social à Genève et accuser Rousseau de vouloir détruire tous les gouvernements ».
Livre IV
Le livre IV n’a pas de titre ; il traite de l’organisation de l’État.
Le chapitre II « Des suffrages » traite une question grave : « Il n’y a qu’une seule loi qui, par sa nature, exige un consentement unanime ; c’est le pacte social : car l’association civile est l’acte du monde le plus volontaire ; tout homme étant né libre & maître de lui-même, nul ne peut, sous quelque prétexte que ce puisse être, l’assujettir sans son aveu. Décider que le fils d’une esclave naît esclave, c’est décider qu’il ne naît pas homme.
Si donc, lors du pacte social, il s’y trouve des opposants, leur opposition n’invalide pas le contrat, elle empêche seulement qu’ils n’y soient compris : ce sont des étrangers parmi les Citoyens. Quand l’État est institué, le consentement est dans la résidence ; habiter le territoire, c’est se soumettre à la souveraineté.
Hors ce contrat primitif, la voix du plus grand nombre oblige toujours tous les autres ; c’est une suite du contrat même. Mais on demande comment un homme peut être libre & forcé de se conformer à des volontés qui ne sont pas les siennes. Comment les opposants sont-ils libres & soumis à des lois auxquelles ils n’ont pas consenti ?
Je réponds que la question est mal posée. Le Citoyen consent à toutes les lois, même à celles qu’on passe malgré lui, & même à celles qui le punissent quand il ose en violer quelqu’une. La volonté constante de tous les membres de l’État est la volonté générale : c’est par elle qu’ils sont citoyens & libres. Quand on propose une loi dans l’assemblée du peuple, ce qu’on leur demande n’est pas précisément s’ils approuvent la proposition ou s’ils la rejettent, mais si elle est conforme ou non à la volonté générale, qui est la leur : chacun en donnant son suffrage dit son avis là-dessus ; & du calcul des voix se tire la déclaration de la volonté générale. Quand donc l’avis contraire au mien l’emporte, cela ne prouve autre chose sinon que je m’étais trompé, & que ce que j’estimais être la volonté générale ne l’était pas. Si mon avis particulier l’eût emporté, j’aurais fait autre chose que ce que j’avais voulu ; c’est alors que je n’aurais pas été libre » (p. 262). C’est limpide, hormis la dernière phrase, à laquelle il me semble manquer un mot. J’ai trouvé une note explicative dans l’édition Beauvallon de 1903 disponible sur Wikisource : « Car je voulais (par définition) faire ce qui me semblait conforme à l’intérêt général. Or le peuple consulté a émis un avis différent. C’est donc que je me trompais, car la volonté générale est infaillible. Je n’aurais donc pas eu la liberté morale, puisque mon intelligence était aveuglée par des préjugés et dirigeait mal ma conduite ». Un article de Pierre Joxe : « La loi est-elle “l’expression de la volonté générale” ? » explicite ce texte mais pas cette phrase, que je persiste à trouver confuse.
Le chapitre III « Des élections » prend pour exemple la république de Venise : « À l’égard des élections du Prince & des Magistrats, qui sont, comme je l’ai dit, des actes complexes, il y a deux voies pour y procéder, savoir, le choix & le sort. L’une, & l’autre ont été employées en diverses républiques, & l’on voit encore actuellement un mélange très compliqué des deux dans l’élection du doge de Venise. » […]
« L’exemple de l’élection du doge de Venise confirme cette distinction, loin de la détruire : cette forme mêlée convient dans un gouvernement mixte. Car c’est une erreur de prendre le gouvernement de Venise pour une véritable aristocratie. Si le Peuple n’y a nulle part au Gouvernement, la noblesse y est peuple elle-même. Une multitude de pauvres Barnabotes [3] n’approcha jamais d’aucune magistrature, & n’a de sa noblesse que le vain titre d’Excellence & le droit d’assister au grand Conseil. Ce grand Conseil étant aussi nombreux que notre Conseil général à Genève, ses illustres membres n’ont pas plus de privilèges que nos simples Citoyens. […] » Vous retrouverez cet extrait avec le tableau ci-dessous dans une séance de réflexion sur le palais des Doges dans le cadre du cours sur le thème « Seuls avec tous ».

Les élections par le sort auraient peu d’inconvénients dans une véritable Démocratie où, tout étant égal aussi bien par les mœurs & par les talents que par les maximes & par la fortune, le choix deviendrait presque indifférent. Mais j’ai déjà dit qu’il n’y avait point de véritable démocratie.
Quand le choix & le sort se trouvent mêlés, le premier doit remplir les places qui demandent des talents propres, telles que les emplois militaires : l’autre convient à celles où suffisent le bon sens, la justice, l’intégrité, telles que les charges de judicature, parce que, dans un État bien constitué, ces qualités sont communes à tous les Citoyens » (p. 265). Là, on a envie de rétorquer à notre bon Jean-Jacques : « Et si ma tante en avait… ».
Le chapitre IV « Des comices romains » est un des plus longs. J’en extrais ce paragraphe sur le vote secret : « Quant à la manière de recueillir les suffrages, elle était chez les premiers Romains aussi simple que leurs mœurs, quoique moins simple encore qu’à Sparte. Chacun donnait son suffrage à haute voix, un Greffier les écrivait à mesure : pluralité de voix dans chaque Tribu déterminait le suffrage de la Tribu ; pluralité des voix entre les Tribus déterminait le suffrage du peuple ; & ainsi des Curies & des Centuries. Cet usage était bon tant que l’honnêteté régnait entre les Citoyens, & que chacun avait honte de donner publiquement son suffrage à un avis injuste ou à un sujet indigne ; mais, quand le peuple se corrompit & qu’on acheta les voix, il convint qu’elles se donnassent en secret pour contenir les acheteurs par la défiance, & fournir aux fripons le moyen de n’être pas des traîtres » […] « On distribua donc aux citoyens des tablettes par lesquelles chacun pouvait voter sans qu’on sût quel était son avis : on établit aussi de nouvelles formalités pour le recueillement des tablettes, le compte des voix, la comparaison des nombres, etc. ; ce qui n’empêcha pas que la fidélité des officiers chargés de ces fonctions ne fût souvent suspectée. On fit enfin, pour empêcher la brigue & le trafic des suffrages, des édits dont la multitude montre l’inutilité » (p. 274). Ne pourrait-on répliquer que le suffrage secret empêche au contraire l’effet moutonnier et la crainte d’assumer une opinion non consensuelle ? Par exemple, quand nous comprenons que la raison est d’arrêter une grève ou une guerre, mais que cela coûte à notre taux de testostérone de l’admettre en public ? Vous retrouverez également cet extrait dans la séance de réflexion sur le palais des Doges dans le cours sur « Seuls avec tous ».
Le chapitre VIII « De la religion civile » prône sagement la séparation de la religion et de l’État : « Bien plus ; loin d’attacher les cœurs des Citoyens à l’État, elle les en détache comme de toutes les choses de la terre. Je ne connais rien de plus contraire à l’esprit social. […]
Le Christianisme est une religion toute spirituelle, occupée uniquement des choses du Ciel ; la patrie du Chrétien n’est pas de ce monde. Il fait son devoir, il est vrai, mais il le fait avec une profonde indifférence sur le bon ou mauvais succès de ses soins. Pourvu qu’il n’ait rien à se reprocher, peu lui importe que tout aille bien ou mal ici-bas. Si l’État est florissant, à peine ose-t-il jouir de la félicité publique ; il craint de s’enorgueillir de la gloire de son pays : si l’État dépérit, il bénit la main de Dieu qui s’appesantit sur son peuple » (p. 288).
« Les dogmes de la religion civile doivent être simples, en petit nombre, énoncés avec précision, sans explications ni commentaires. L’existence de là Divinité puissante, intelligente, bienfaisante, prévoyante & pourvoyante, la vie à venir, le bonheur des justes, le châtiment des méchants, la sainteté du Contrat social & des Lois : voilà les dogmes positifs. Quant aux dogmes négatifs, je les borne à un seul, c’est l’intolérance : elle rentre dans les cultes que nous avons exclus.
Ceux qui distinguent l’intolérance civile & l’intolérance théologique se trompent, à mon avis. Ces deux intolérances sont inséparables. Il est impossible de vivre en paix avec des gens qu’on croit damnés ; les aimer serait haïr Dieu qui les punit ; il faut absolument qu’on les ramène ou qu’on les tourmente. Partout où l’intolérance théologique est admise, il est impossible qu’elle n’ait pas quelque effet civil ; & sitôt qu’elle en a, le Souverain n’est plus Souverain, même au temporel : dès lors les Prêtres sont les vrais maîtres, les Rois ne sont que leurs officiers.
Maintenant qu’il n’y a plus & qu’il ne peut plus y avoir de religion nationale exclusive, on doit tolérer toutes celles qui tolèrent les autres, autant que leurs dogmes n’ont rien de contraire aux devoirs du citoyen. Mais quiconque ose dire : hors de l’Église point de Salut, doit être chassé de l’État, à moins que l’État ne soit l’Église, & que le Prince ne soit le Pontife. Un tel dogme n’est bon que dans un Gouvernement Théocratique ; dans tout autre il est pernicieux » (p. 291).
Et voilà tout ce que j’ai sélectionné du Contrat social. L’édition Folio est complétée par 90 pages de « Fragments politiques », dont j’extrais seulement ces deux fragments : « Ce doit être une des premières lois de l’État qu’une même personne ne puisse occuper à la fois plusieurs charges, soit pour qu’un plus grand nombre de citoyens ait part au gouvernement, soit pour ne laisser à aucun d’eux plus de pouvoir que n’a voulu le législateur » (p. 310). « La seule étude qui convienne à un bon peuple est celle de ses Lois. Il faut qu’il les médite sans cesse pour les aimer, pour les observer, pour les corriger même avec les précautions que demande un sujet de cette importance, quand le besoin en est bien pressant & bien avéré. Tout État où il y a plus de Lois que la mémoire de chaque Citoyen n’en peut contenir est un État mal constitué, & tout homme qui ne sait pas par cœur les Lois de son pays est un mauvais Citoyen ; aussi Lycurgue ne voulut-il écrire que dans les cœurs des Spartiates » (p. 314).
Voir en ligne : Article de Wikipédia sur le Contrat social
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Je dirais : « les citoyens solvables & qui n’ont pas de compte off-shore ».
[2] À noter que dans Le Contrat social, contrairement à l’article de l’Encyclopédie qui le précède dans l’édition Folio, le mot État désignant l’entité de gouvernement a bien sa majuscule, de même que certains mots importants, comme « Loi », « Citoyen », « Cité », « Roi », « Peuple », « Tyran », etc. Je tâcherai de les mettre à chaque fois, mais il m’arrivera forcément d’en oublier.
[3] Barnabotes ou Barnabotti : habitants pauvres du quartier Saint-Barnabé dans la République de Venise.
 altersexualite.com
altersexualite.com