Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > Seuls ensemble, de Sherry Turkle
De plus en plus de technologies, de moins en moins de relations humaines, pour étudiants et adultes
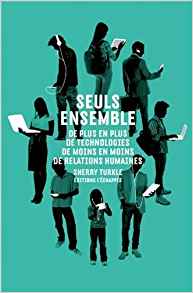 Seuls ensemble, de Sherry Turkle
Seuls ensemble, de Sherry Turkle
L’échappée, Pour en finir avec, 2011, 526 p., 22 €.
samedi 16 mars 2019
Seuls ensemble (avec son long sous-titre « De plus en plus de technologies, de moins en moins de relations humaines » est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « Seuls avec tous ». J’entreprends avec ce livre ce que j’ai fait avec le thème précédent « Corps naturel, corps artificiel », rédiger sept fiches de lecture sur les 7 ouvrages extraits de la liste que j’ai sélectionnés pour mes étudiants. Une seule auteure, six auteurs. Je commence par elle car c’est le plus épais mais aussi le plus actuel, et encore le plus facile à lire, celui qui parlera d’eux à nos étudiants nés à l’époque du narcissisme exacerbé. Le mot « narcissisme » ne figure pas sur la liste des mots clés du thème, alors qu’il figurait parmi ceux du thème précédent, le corps. Pourtant le narcissisme a à voir aussi dans la relation entre l’individu et le groupe. Le livre de Sherry Turkle est passionnant parce qu’elle base sa réflexion sur une multitude d’observations qu’elle a faites lors de sa carrière d’anthropologue au Massachusetts Institute of Technology. C’est loin d’être une gauchiste, et lorsqu’elle parvient à critiquer l’usage des nouvelles technologies, on cherche en vain la moindre critique économique sur les GAFA qui tirent les ficelles. Mais c’est à nous de prolonger la lecture. L’écriture est elle-même influencée par ce narcissisme qu’elle étudie inconsciemment, car elle écrit à la première personne et intègre les expériences de sa propre vie, ses relations avec ses amis ou sa fille entre les expériences scientifiques, comme si son œuvre était une page Facebook. Le livre est divisé en deux parties, l’une consacrée aux robots, l’autre aux technologies de la communication. Nos étudiants rebutés par le format du pavé pourraient choisir de ne lire que l’une des deux parties, et peut-être qu’ils finiraient par avoir envie de lire l’autre. Le livre nous fournit de nombreux passages dignes d’intérêt et de figurer dans des corpus d’entraînement à l’épreuve. J’en citerai de longs extraits, dont je n’ai trouvé qu’un seul sur Internet. C’est dire si ce livre n’a pas été encore assez lu.
Introduction
L’auteure est un peu juge et partie, puisqu’elle a réalisé sa carrière au sein d’une des universités les plus prestigieuses du monde, qui a fourni une bonne partie des technologies qu’elle étudie. Elle reconnaît que depuis les années 1970 où elle a commencé son travail jusqu’en 2012, son opinion optimiste s’est infléchie vers le bas, comme nous l’apprend ce paragraphe de l’intro, argument qui sera souvent repris : « Alors que des parents font la queue pour acheter à leurs enfants des Zhu Zhu Pets – des hamsters robotisés interactifs qui, d’après les publicités, « vivent pour ressentir l’amour » –, le site en ligne Chatroulette connecte aléatoirement ses utilisateurs les uns avec les autres dans le monde entier Ceux-ci peuvent se voir en direct par vidéo, parler ou écrire des messages. Et la plupart d’entre eux appuient sur le bouton « suivant » environ toutes les deux secondes pour faire apparaître un nouvel utilisateur sur leur écran. Les Zhu Zhu Pets et Chatroulette semblent être deux « objets » appropriés pour conclure cette enquête : d’un côté, les Zhu Zhu Pets sont conçus pour provoquer l’amour, de l’autre, les gens sont réifiés et hâtivement rejetés dans Chatroulette. Mon histoire s’interrompt sur cette dérangeante symétrie : nous semblons déterminés à doter des objets de qualités humaines, tout en étant heureux de traiter nos semblables comme des objets » (p. 17). Un ancien joueur d’échecs, David Levy, connu pour avoir gagné un pari risqué contre l’Intelligence artificielle dans le domaine des échecs, a écrit un essai où il suggère « qu’épouser un robot aurait de nombreux avantages » (p. 25).
Un paragraphe me rappelle le dilemme du hérisson d’Arthur Schopenhauer : « Une jeune fille de treize ans m’explique qu’elle « déteste le téléphone et n’écoute jamais les messages sur sa boîte vocale ». Les textos lui offrent juste assez d’accès et de contrôle. Elle est comme Boucle d’Or : pour elle, les textos maintiennent les gens ni trop près ni trop loin, juste à bonne distance. Le monde est aujourd’hui plein de Boucles d’Or modernes, de gens qui sont rassurés d’avoir beaucoup de contacts qu’ils peuvent en même temps tenir à distance. Un étudiant de vingt et un ans réfléchit à ce nouvel équilibre : « Je n’utilise plus mon téléphone pour passer des coups de fil. Je n’ai pas le temps de papoter pendant des heures. Je préfère les textos, Twitter, le mur Facebook d’un ami. J’y trouve tout ce que j’ai besoin de savoir » (p. 41). Un avocat se plaint dans le § suivant, que sa sœur ait annoncé ses fiançailles et sa date de mariage par un e-mail adressé à plusieurs personnes, plutôt que par un coup de fil. Ces thèmes de la bonne distance et de l’humanisation des robots corrélative à la déshumanisation des humains constituent plus ou moins la thèse du livre, résumée par le sous-titre.
Première partie : Le moment robotique : nouvelles solitudes, nouvelles intimités.
Sherry Turkle évoque un certain nombre de robots, qu’ils soient ou non anthropomorphes, dont beaucoup sont des créations expérimentales du MIT qu’elle a été amenée à évaluer. Elle évoque ainsi les fameux « Tamagotchi », qui réveillent effectivement de lointains souvenirs d’enseignant : « Sally, huit ans, a déjà eu trois Tamagotchi. Ils sont tous morts et elle les a « enterrés » cérémonieusement dans le tiroir du haut de sa commode. À chaque fois, elle a refusé de réinitialiser son Tamagotchi et a convaincu sa mère de lui acheter un œuf de remplacement. Sally me raconte : « Ma mère dit que le mien marche toujours, mais je lui réponds qu’un Tamagotchi ne coûte pas cher et que je ne lui demanderai rien d’autre, et du coup elle me l’achète. Je ne vais pas refaire marcher mon vieux Tamagotchi. Il est mort. Il a besoin de repos » (p. 67).
Une photo extraite d’un article de The Albion pleiad : « Students Gather to Mourn Death of Tamagotchi » (janvier 2019) où des étudiants parodient une cérémonie funéraire pour la mort d’un de ces gadgets âgé de deux jours nous fournit un recul critique… Pourquoi ne pas l’insérer dans un sujet de BTS ?

Un passage me fait songer à l’expérience de Milgram : « Le marketing présentait ainsi My Real Baby comme en tous points « réel » – sauf si on lui « faisait du mal », auquel cas il s’éteignait. Et de fait, quand les enfants jouent avec lui, ils ne manquent pas d’avoir différents comportements agressifs. Ils lui donnent la fessée ; le robot s’éteint. Ils le secouent, le tournent la tête en bas, le frappent sur les oreilles ; il s’éteint également.
Le choix de Hasbro d’offrir un réalisme maximum, mais aucun mécanisme de réponse à la douleur, suscite des réactions contrastées, notamment chez les parents. Un groupe de parents estime que le plus important c’est d’éviter toute réponse agressive de la part de l’enfant. Certains pensent que si les publicités présentent le robot comme réaliste mais qu’il ne réagit pas à la douleur, cela encourage les enfants à lui faire du mal puisqu’ils ont l’impression que cela n’entraîne aucune conséquence. Pour d’autres, si un robot simule la douleur, cela encourage au contraire les enfants à le maltraiter.
Pour un autre groupe de parents, il est regrettable que My Real Baby ne réagisse pas à la douleur. Ils appliquent le même raisonnement que lorsqu’ils laissent leurs enfants jouer à des jeux vidéo violents. Ils considèrent ces expériences comme « cathartiques ». Pour eux, les enfants (et les adultes) devraient exprimer leur agressivité (ou sadisme, ou curiosité) dans des situations qui semblent « réalistes » mais où aucune victime « vivante » n’est blessée. Mais même ces parents-là sont parfois soulagés que My Real Baby « nie » la douleur, au mépris du réalisme. Ils n’ont aucune envie de voir leurs enfants tourmenter un bébé en train de hurler.
Quelle que soit notre position vis-à-vis de cette question, il faut souligner que les robots sociaux nous ont appris que nous ne redoutions pas de faire du mal à des simulations réalistes du vivant. C’est ainsi que nous entraînons les gens à faire la guerre. Nous apprenons d’abord à abattre le virtuel. Une fois rendus insensibles, nous pouvons ensuite nous attaquer au réel, sans états d’âme. L’étude de ces questions soulève de graves problèmes. Freedom Baird demandait aux gens de tenir un Furby la tête en bas malgré ses protestations et les mettait ainsi profondément mal à l’aise. Voulons-nous encourager les mauvais traitements de poupées robotiques de plus en plus réalistes ? » (pp. 88-89).
On est étonné par les confidences de l’auteure sur elle et sur ses collègues chercheurs du MIT. Ils se laissent parfois prendre au jeu quand ils expérimentent un robot ou un logiciel. Une précision déontologique manque, c’est la mention du financement des études relatées dans l’ouvrage. Sont-elles totalement indépendantes des sociétés qui fabriquent ces robots ? (pour ceux qui ne sont pas des prototypes conçus par les laboratoires du MIT, dont on se doute qu’il a financé aussi leur évaluation). On a parfois l’impression que malgré les critiques mitigées, certaines pages relèvent quand même du publireportage. Mais nous sentons encore trop le gauchisme rentré… Je relève une rare ligne d’autocritique amusante quand l’auteure avoue : « j’ai souvent remarqué que si les personnes âgées continuaient de prendre part à nos sessions avec les robots, c’était surtout pour pouvoir passer du temps avec mes assistants de recherche, charmants, intelligents et attirants pour la plupart. L’un d’entre eux en particulier faisait l’objet d’une attention bien plus soutenue que le Paro qu’il essayait de faire découvrir […]. L’administration eut vent de leurs commentaires, qui prenaient parfois un tour grivois » (p. 174).
Belle réflexion sur l’amitié : « Les roboticiens rétorqueront qu’il n’y a pas de mal à ce que les gens engagent des conversations avec des robots, conversations qui pourraient être intéressantes, drôles, éducatives, voire réconfortantes. Mais je ne trouve en rien cette idée réconfortante. Quand on promeut une machine au rang d’ami, on dévalue inévitablement le sens de l’amitié. Ceux que nous aimons et ceux qui nous aiment sont à l’origine de qui nous sommes. Lorsque Madison se dit pleinement heureuse de l’« affection » que lui témoigne Kismet, je suis incapable de me réjouir. Face à cette scène, j’ai le sentiment d’assister à une expérience scientifique dont les sujets ne sont autres que les êtres humains » (p. 169).

La situation étudiée est surtout la situation non seulement étasunienne, mais de la côte Est, et particulièrement des alentours d’une des universités les plus en avance sur l’Intelligence artificielle. On a parfois l’impression que ce livre parlera moins non seulement à des Français, mais que pour des Éthiopiens ou des Malgaches, il passera pour de la science-fiction. Il est parfois question du Japon, guère pour des expériences, mais parce que l’auteure a souvent participé à des conférences et connaît le terrain : « Il y a vingt-cinq ans, les Japonais ont calculé que l’évolution démographique de leur pays jouait en leur défaveur : les générations futures ne seraient plus assez nombreuses pour prendre soin de la population vieillissante. Plutôt que de confier cette tâche à des étrangers, ils décidèrent de construire des robots pour s’en charger » (p. 175).
Quand elle se fait critique – quasiment gauchiste – ce qui est rare, Sherry Turkle a des arguments souvent touchants. Elle établit la liste grandissante des personnes que, faute de personnel, nous serions prêts à confier à des robots plutôt qu’à des humains : « aux patients d’hôpital, aux personnes âgées, aux handicapés mentaux, aux autistes » et s’inquiète : « tous autant que nous sommes, nous rencontrons des difficultés au cours de nos vies et luttons contre des « problèmes » qui surviennent au quotidien. Faudra-t-il bientôt être riche et « bien dans sa peau » pour avoir le privilège de vivre avec son espèce ? » (p. 179).
Un long extrait ferait un texte de corpus fort intéressant :
« Quand l’équipe arrive chez elle en milieu de matinée, la vieille dame se consacre entièrement à son arrière-petite-fille. Elle la prend dans ses bras, lui parle, lui donne des friandises. Comme elle a raté l’anniversaire de la fillette, elle lui offre aussi un cadeau. Au bout d’une demi-heure, nous confions le robot à Edna ; il accapare alors son attention. Elle essaie diverses approches et son visage s’illumine quand elle le voit sourire. Dès lors, elle s’adresse directement à lui : « Bonjour, comment vas-tu ? Est-ce que tu es une petite fille bien sage ? » Elle le prend dans ses bras. Quand le robot se met à pleurer, elle trouve son biberon, sourit et annonce qu’elle va lui donner à manger. Amy essaie d’attirer l’attention de son arrière-grand-mère, mais celle-ci l’ignore. Edna explique en berçant doucement le robot contre sa poitrine qu’il va faire une sieste après manger et qu’elle va l’emmener en haut dans la chambre, où « [elle] va le mettre dans son berceau avec son doudou ». Elle se tourne vers les chercheurs pour expliquer qu’un de ses enfants appelait ainsi ses couvertures, mais elle a oublié lequel. Elle continue à parler au robot : « Ma chérie […] tu es ma petite puce chérie ! Oh oui, oui, oui,oui. »
Edna passe le plus clair de l’heure suivante à parler avec lui. Elle s’inquiète de ne pas comprendre ce qu’il raconte et, craignant de lui « faire mal », dit qu’elle veut « bien faire ». De temps en temps, Amy s’approche de son arrière-grand-mère pour lui amener quelque chose, un cookie ou un mouchoir, ou pour solliciter directement son attention. Les demandes de la petite fille varient entre douceur et irritation, mais restent sans effet. L’attention d’Edna demeure rivée sur le robot. L’atmosphère est silencieuse, pour ne pas dire surréaliste : une arrière-grand-mère complètement fascinée par un bébé robot, un bambin de deux ans négligé, une mère choquée et des chercheurs mal à l’aise qui toussotent nerveusement.
Devant des personnes âgées apparemment ravies de se perdre dans les mondes de leurs Paro et de leurs My Real Baby, on peut être tenté de dire : « Et alors ? Où est le mal ? Ces vieilles personnes sont heureuses. Cela ne fait de mal à personne, n’est-ce pas ? L’histoire d’Edna offre une possible réponse à cette question. Car une fois mise en relation avec le robot, celle-ci semble vouloir être seule – « ensemble » seulement avec le robot » (p. 192-3).
Autres paragraphes inquiets : « à long terme, voulons-nous vraiment créer un monde où les enfants pourront se détacher de leurs parents plus facilement ? Le « moment agréable » offert par le robot ne risque-t-il pas de leurrer les gens en leur faisant croire que leurs visites sont désormais moins nécessaires ? Ne risque-t-il pas de tromper les personnes âgées qui se sentent moins seules en parlant avec le robot de choses dont elles auraient auparavant parlé à leurs enfants ? Si l’on partage « ses sentiments » avec des « créatures » robotiques, on finit par s’habituer à la gamme « émotionnelle » limitée des machines. En apprenant à tirer « le plus possible » des robots, nous pourrions finir par attendre moins des relations en général, y compris des relations humaines. Et c’est alors nous-mêmes que nous trahirions » (p. 205).
Voici un entretien avec Aaron Edsinger, concepteur de Domo, robot plus élaboré que Kismet (cf. photo ci-dessus) : « nous puisons déjà du réconfort dans la présence de personnes dont les véritables motivations nous restent inconnues. Nous confions nos soins à des individus qui ne se soucient peut-être pas du tout de nous. Ainsi que se passe-t-il lorsqu’une infirmière vous prend la main lors d’une hospitalisation ? Quelle est l’importance de ce geste ? Et si c’était un geste mécanique, pas si différent d’un geste programmé ? Est-ce si important que cette infirmière programmée soit une personne humaine ? » Le chercheur avoue lui-même qu’« il y a peut-être une part de [lui]-même qui cherche à [s’]en convaincre ». L’auteure en conclut que « l’un des « usagers » des robots les plus informés du monde ne peut résister à l’idée que si un robot lui serre la main, cela veut dire qu’il s’intéresse à lui » […] « Dans nos interactions avec eux, nous pouvons donc à la fois tout savoir de leurs limites et trouver en même temps du réconfort dans ce qu’il convient d’appeler un amour à sens unique » (p. 214).
Ces réflexions me rappellent les deux deuils les plus marquants auxquels j’ai eu à faire face en 2018, celui de Roland Longpré et celui de Catherine. Je crois que le chercheur n’a pas fait le distinguo entre d’une part des robots qui peuvent être des jouets de [ré-]confort, par exemple pour des personnes en état léthargique recevant peu de visites, ou même des outils de rééducation ou de motricité adjuvants de traitements de kinésithérapie, orthophonie, etc., et d’autre part des hospitalisations lourdes pour lesquelles la présence d’infirmiers est indispensable. En ce qui concerne Catherine, son état de fragilité était tel qu’un robot aurait sans doute été plutôt nocif. Par exemple lorsqu’elle voulait à tout moment quitter le lit, il fallait la présence d’un infirmier pour refuser tout en la rassurant. Et puis quel robot aurait pu lui accorder ces quelques secondes de « danse » qu’elle lui demandait par plaisanterie, parce que cet infirmier antillais avait fait remonter des souvenirs précis ?
– De nombreuses notes reléguées en fin de volume devraient figurer dans le texte (en dehors de celles qui précisent la référence d’un article). Par exemple celle-ci dont l’amalgame a de quoi amuser : « Au Japon, les robots baby-sitters donnent des cours, proposent des jeux et assurent la surveillance des enfants lorsque leur mère est occupée à des tâches ménagères. Les androïdes commercialisés sous des traits de femmes charmantes remplissent les fonctions de réceptionnistes et de guides. Certains modèles en cours de développement remplaceront les hôtesses d’accueil et les professeurs des écoles. En parallèle, toujours au Japon, il est possible de trouver dans le commerce une poupée plus vraie que nature, dotée d’une anatomie conforme à la réalité et pourvue de muscles du sphincter. Ses concepteurs insistent sur le fait qu’elle constitue un bon moyen pour les personnes isolées de prendre du plaisir et, plus généralement, de contrôler la propagation des maladies sexuellement transmissibles » (note 124 p. 497). On pourrait préconiser que ces professeurs des écoles « sous des traits de femmes charmantes » soient aussi muni(e)s de sphincters pour que devienne réalité ce que leur souhaitent souvent leurs élèves à mi-voix quand ils sont mécontents de leurs services…
Deuxième partie : En réseau : Dans l’intimité, de nouvelles solitudes.
Le titre est retourné pour la 2e partie du livre, étude sur les nouveaux moyens de communication, téléphone mobile, smartphone, courriels et réseaux sociaux. Les réflexions seront fort intéressantes pour nos étudiants, nés sous cette nouvelle ère, alors que la plupart de leurs enseignants datent du Pléistocène.
« De nos jours, le fait d’être connecté ne dépend pas de la distance qui nous sépare des autres, mais des technologies de communication qui sont à notre portée. Or nous les transportons avec nous presque tout le temps, à tel point que le fait d’être seul peut finir aujourd’hui par apparaître comme la condition sine qua none (sic) de l’être ensemble. Il apparaît en effet plus aisé de communiquer avec les autres si on peut rester concentré sur son écran sans interruption. Dans ce nouveau régime, une gare – ou un aéroport, un café, un parc – n’est plus un espace commun, mais un endroit où les gens sont rassemblés mais s’ignorent. Chacun est relié à un appareil mobile, ainsi qu’aux contacts et aux lieux auxquels il donne accès. J’ai grandi à Brooklyn, où les trottoirs avaient quelque chose de particulier : quelle que soit la saison (même en hiver, quand ils avaient été déneigés), on pouvait y trouver des marelles dessinées à la craie. […] Les marelles ont disparu. Les enfants sont toujours dehors – mais sur leurs téléphones » (p. 245).

« On peut aussi envisager la situation dans le sens inverse : ne sont-ce pas ceux qui téléphonent qui se signalent d’eux-mêmes comme absents ? Parfois, les gens indiquent qu’ils sont « sur le départ » en sortant leur téléphone de leur poche et en le portant à l’oreille. Toutefois, le plus souvent, ces signes sont de nature plus subtile : un bref regard jeté sur un téléphone pendant un dîner ou un rendez-vous suffit. Au sens traditionnel du terme, un « lieu » renvoie à un espace physique et aux gens qui s’y trouvent. Mais que devient le « lieu » si ceux qui s’y trouvent ne prêtent attention qu’à des personnes absentes, et non plus à celles qui les entourent ? Dans un bar près de chez moi, presque tous les clients sont assis devant un ordinateur ou regardent leur téléphone portable pendant qu’ils boivent leur café. Ces gens ne sont pas mes amis. Pourtant, leur présence me manque » (p. 247).
De longs développements sont consacrés au site Second Life (dont il est d’ailleurs question au début du film d’Agnès Varda Les Plages d’Agnès (2008), car Chris Marker, qu’elle filme, joue à ce jeu). Extrait : « Pete, un homme de quarante-six ans, essaie d’oublier son mariage décevant. […] Il s’occupe de ses deux enfants, âgés de quatre et six ans, et de son téléphone […]. Dans le jeu, Pete s’est créé un avatar nommé Rolo, un beau jeune homme musclé. Il a fait la cour à un avatar féminin nommé Jade, un petit brin de fille, un lutin blond aux cheveux courts et hérissés. Il l’a ensuite « épousée », lors d’une cérémonie élaborée qui s’est tenue en ligne l’année précédente et à laquelle assistaient leurs meilleurs amis virtuels. Pete n’a jamais rencontré la femme qui se cache derrière l’avatar nommé Jade, et il n’en éprouve pas le besoin (la personne présente derrière cet avatar pourrait aussi bien être un homme. Pete en a conscience, mais dit : « Je ne veux pas y penser »). Il dit de Jade qu’elle est intelligente, passionnée et qu’il est facile de lui parler. […]
Lui et Jade discutent (par l’intermédiaire de leurs claviers), puis entament une relation érotique entre leurs avatars, ce qu’ils peuvent faire grâce à des animations spéciales. Les frontières entre monde réel et monde virtuel sont parfois poreuses. En ligne, ils parlent de sexe, et échangent des ragots qu’ils ont entendus dans le jeu, mais ils évoquent aussi le sujet de l’argent, de la récession, de leur travail ou de leurs problèmes de santé. Pete suit un traitement pour faire baisser son taux de cholestérol, qui n’est pas pleinement efficace. Il m’explique qu’il lui est difficile de partager ses inquiétudes avec sa « vraie » femme, Alison : « Ça l’inquiète trop, l’idée que je meure et que je la laisse seule. » En revanche, il sait qu’il peut se confier à Jade. « Second Life me permet d’avoir une meilleure situation que dans la vie réelle. C’est là que je me sens le plus moi-même. Jade m’accepte comme je suis. C’est grâce à ma relation avec elle que j’arrive à rester avec ma femme, avec mes enfants », dit-il. L’ironie de la situation est évidente : la personne qui accepte Pete comme il est vraiment est un avatar que ne l’a jamais vu, ne lui a jamais parlé en personne, et à qui il exhibe un corps très différent du sien.
L’homme profite de ce dimanche passé au parc : il est avec ses enfants et avec Jade. « Mes enfants ont l’air content. […] J’ai l’impression d’être avec eux. […] Je suis là pour eux, mais à l’arrière-plan. » Je regarde le parc autour de moi. Beaucoup d’adultes partagent leur attention entre leurs enfants et leurs appareils mobiles. Parcourent-ils les emails et les textos de leur famille, de leurs amis, de leurs collègues ? Regardent-ils leurs photos ? Se trouvent-ils eux aussi dans des mondes parallèles, avec des amants virtuels ? » (p. 252-3).
« Aujourd’hui, un enfant qui fait ses devoirs partage son attention entre (liste non-exhaustive) Facebook, des sites d’achat en ligne, de la musique, des jeux en réseau, des textos, des vidéos, des appels et des messages instantanés. Seuls les emails manquent à l’appel : la plupart des adolescents de moins de vingt-cinq ans les trouvent obsolètes : ils sont incontournables seulement quand il faut candidater à une université ou envoyer un CV.
Le multitâche a ainsi changé progressivement d’image : de négatif, il en est venu à désigner quelque chose de positif et de vertueux. Le débat sur ses bienfaits est lui aussi devenu complètement extravagant, portant aux nues les adolescents capables de faire plusieurs choses à la fois. Des experts ont été jusqu’à déclarer que le multitâche était non seulement une compétence, mais aussi et surtout la compétence essentielle pour travailler et apprendre dans le monde numérique. Certains s’inquiétaient même de la situation à venir : les professeurs de la vieille école n’allaient-ils pas freiner la progression des élèves, eux qui ne pouvaient faire qu’une chose à la fois ? Il est temps de nous demander pourquoi nous nous sommes tant laissés emballer par ce phénomène ? Car les études des psychologues sur le multitâche sont loin de mettre en évidence de nouvelles formes d’efficacité. Au contraire : elles soulignent que lorsque l’on fait plusieurs choses à la fois, on les fait toutes moins bien. Il est vrai que l’on ressent un certain plaisir quand on s’adonne au multitâche ; la raison en est que le corps nous « récompense » en produisant des substances neurochimiques qui créent un sentiment d’euphorie. Mais celui-ci est trompeur, dans la mesure où il conduit de nombreux adeptes du multitâche à se croire particulièrement productifs. Pour perpétuer l’euphorie, ils cherchent alors à faire encore plus de choses en même temps. Dans les prochaines années, il sera nécessaire de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie. Nous sommes tombés en adoration devant ce que la technologie rend facile et accessible. Et nos corps ont eux aussi succombé à ses charmes » (p. 258-9).
« Les adolescents d’aujourd’hui n’ont pas moins besoin que leurs aînés d’apprendre à éprouver de l’empathie, de réfléchir à leur identité et à leurs valeurs, de gérer et d’exprimer leurs émotions. Ils ont besoin de temps pour réfléchir, pour découvrir qui ils sont. Mais la technologie, mise au service d’une communication continue et toujours plus rapide, a changé les règles du jeu. Quand trouvent-ils du temps pour faire une pause, pour rester immobiles ? Il serait inexact de dire que le règne des réponses instantanées – où les textos occupent une place de choix – a rendu toute introspection impossible, mais il ne fait rien pour l’encourager. Lorsque les échanges sont reformatés pour le petit écran et que leur versant émotionnel se réduit à des émoticônes, une simplification s’opère nécessairement. Sans même parler du besoin qu’ont les adolescents d’avoir des secrets, de délimiter un espace qui leur appartient en propre » (p. 272).
Comme d’autres enfants qui racontent des histoires du même acabit, Audrey se plaint que sa mère ne fasse pas attention à elle quand elle vient la chercher à l’école ou après le sport. Dans ces moments-là, dit la jeune fille, sa mère est souvent concentrée sur son téléphone, occupée à parler à ses amis ou à leur écrire des textos. Audrey décrit la scène : elle sort du gymnase épuisée, chargée de son équipement qui pèse plusieurs kilos. Sa mère est assise dans leur vieille Jeep, entièrement absorbée par son téléphone, et ne lève même pas les yeux quand sa fille ouvre la porte de la voiture. Il lui arrive de croiser son regard, mais elle démarre et commence à conduire, sans lâcher son téléphone. Audrey commente : « Ça s’interpose entre nous deux, mais ça ne change rien. Elle ne va pas lâcher son téléphone. Même si ça fait quatre jours que je ne lui ai pas parlé, je m’assois dans la voiture et j’attends sans rien dire qu’elle ait fini. » Elle rêve que sa mère l’attende avec impatience dans la voiture, et sans téléphone. Mais elle s’est résignée à ce que ce rêve ne se réalise jamais. Elle pense aussi qu’elle ne devrait pas être trop dure envers sa mère, parce qu’elle-même envoie continuellement des textos, même quand elle est avec ses copines » (p. 299). D’autres passages évoquent le ressentiment d’ados contre des parents accaparés par leurs smartphones, y compris à table. Je les comprends parfois, mais moi qui suis tout sauf accro au portable (je le considère comme un téléphone fixe et le laisse 90 % du temps à la maison) il m’arrive de me sentir seul.
Une anecdote amusante est mentionnée en note (p. 505), traduction d’un article de presse de caniveau : deux filles de 10 à 12 ans en danger dans un collecteur d’eau pluviale, au lieu d’appeler les secours avec leur téléphone, se connectent à leur compte Facebook. Ce sont des amis connectés qui auront ce réflexe à leur place ! La veille de ma lecture de cette page, un collègue m’avait raconté une anecdote du même acabit : son TGV s’arrête, et on annonce que suite à une chute de caténaire, etc. Il entend des djeunes se demander céquoi un kTner, mais au lieu de poser la question à un être humain autour d’eux, voire à Wikipédia, ils se connectent sur Facebook. Le collègue et les autres vieux cons alentour les laissent faire, et un quart d’heure après ils cherchaient toujours la réponse… Cette anecdote m’incite à soulever une question sans doute trop tendancieuse pour Sherry Turkle : celle du temps de cerveau disponible. Nous enseignants constatons tous que beaucoup de nos élèves travaillent de moins en moins, mais est-ce que ce n’est pas le but ? Pourquoi même France Culture incite ses auditeurs à blablater avec les producteurs sur ces réseaux sociaux ? Je n’ai pas fait de prépa, mais on m’a toujours dit que les étudiants de prépa étaient essorés, qu’ils bossaient comme des malades. Et dans les grandes facs étasuniennes il doit en être de même, alors quid du temps siphonné par les réseaux sociaux ? Est-il pris sur le sommeil ? C’est un aspect qui n’est pas abordé dans les 500 pages, malheureusement. Il nous faudrait des études spécifiques de l’impact sur la réussite scolaire et sociale du temps passé après ces gadgets futiles.
La plupart des gens ont quasiment abandonné le téléphone pour parler, souvent parce qu’ils craignent soit de ne pas pouvoir se livrer à d’autres tâches, soit parce que la conversation risque d’autant plus de s’éterniser qu’elle est exceptionnelle : « Hugh raconte que depuis peu, quand il obtient ce genre de moments téléphoniques privés, il finit souvent par le regretter. En demandant aux gens de s’asseoir, de ne rien faire d’autre pendant qu’ils parlent avec lui, il crée des attentes trop élevées : « Ils sont déçus si je ne leur raconte pas que je fais une dépression, que je pense à divorcer ou que je me suis fait virer. » Il éclate de rire : « Si tu demandes du temps téléphonique en privé, t’as vraiment intérêt à avoir du matos derrière » (p. 321). Pire, nous n’écoutons même plus les messages vocaux, car cela prend trop de temps. Il existe des logiciels pour transcrire ces messages, et on peut les faire défiler plus rapidement. « Nous travaillons très dur pour créer des voix expressives pour nos robots – et nous ne nous plaignons pas de ne plus avoir recours aux nôtres » (p. 326).
Sherry Turkle évoque aussi les dangers parfois mortels que prennent les gens avec leur smartphone (et font prendre aux autres) quand ils conduisent ou marchent en regardant leur écran. Le jour où j’écris ces lignes, je bute sur une femme plantureuse qui s’était immobilisée avec son gadget magique en haut d’un escalier étroit du métro, juste après un coude, d’où déboulaient des cohortes de gens en retard, qui plus est en plein milieu de la marche ! Mais les médias, qui appartiennent en gros aux mêmes compagnies qui possèdent les 4 opérateurs téléphoniques, sont bizarrement taiseux sur les accidents de la route dus aux smartphones. Seule la vitesse, qu’on se le dise, est cause d’accidents ! (c’est ce genre de remarques qui manque à ce livre : on est entre gens de bonne compagnie !)
Les enseignants seront ravis d’apprendre ceci : « Je suis mal à l’aise au téléphone. Je trouve que c’est plus facile d’envoyer un texto. » Pour cette raison, elle ne quitte jamais son portable. Si elle reçoit un texto pendant un cours, elle demande à aller aux toilettes pour pouvoir le lire. Elle reçoit des messages toute la journée et son téléphone vibre au minimum toutes les cinq minutes. Dès qu’elle sait qu’elle a un message, elle devient « nerveuse », elle s’inquiète. Il faut qu’elle le lise. Elle me confie que lorsqu’elle va aux toilettes pour ouvrir ses messages, ce sont souvent des copains qui lui disent juste bonjour. « Je me sens stupide d’avoir eu si peur » (p. 380). On est un peu dubitatif quand on rapproche deux informations de ces lignes : « Si elle reçoit un texto pendant un cours, elle demande à aller aux toilettes » / « son téléphone vibre au minimum toutes les cinq minutes » ! C’est absurde, surtout si vous multipliez ça par le nombre d’étudiants qui en font de même. Cela m’est arrivé récemment avec des étudiants de BTS 1re année, et j’ai demandé à la CPE d’intervenir. J’hésite à leur demander de laisser leur téléphone en échange de l’autorisation d’aller aux toilettes, car forcément ils apporteront leur vieux ou celui du voisin, et vérifier prendrait trop de temps et serait inquisitoire.
Dans la rubrique du délire collectif, on apprend que selon l’auteure la plupart des gens, notamment les adolescents, sont super contents que Google et l’État (pardon pour le pléonasme) enregistrent toutes leurs données. Il exista même un projet du Pentagone nommé LifeLog qui fut abandonné en 2004, pour enregistrer absolument « toute l’existence d’une personne » (note 88 p. 505). On est effaré du cynisme des responsables de ces grandes sociétés totalitaires : « Certains entrepreneurs sur Internet ont soutenu qu’il n’y avait, en effet, pas grand-chose d’autre à faire. Dès 1999, Scott Mc Nealy, co-fondateur de Sun Microsystems, déclarait : « De toute façon, vous n’avez aucune vie privée, acceptez-le une fois pour toutes. » Dix ans plus tard, Eric Schmidt, alors PDG de Google, ajoutait à cela : « Si vous faites quelque chose que vous voulez cacher à tout le monde, vous feriez sûrement mieux de commencer par vous en abstenir. » Et il a récemment déclaré que, dans un futur proche, les jeunes gens auraient automatiquement le droit de demander à changer de nom pour échapper à leur passé archivé en ligne » (p. 196). Là encore, cette annonce oublie de préciser qu’avec la reconnaissance des visages, changer de nom a fort peu de sens ! En fait pour ces géants du Net, il est normal que seules les organisations terroristes et mafieuses et toutes les grandes sociétés puissent se payer les technologies de l’ombre, et les simples citoyens peuvent crever, à moins d’être des as de l’informatique (ce qui a de bonnes chances de leur permettre de trouver de l’emploi dans les catégories précédentes).
Ce qui m’amuse c’est le contraste abyssal entre le mépris total des gouvernements pour les sites et blogs comme celui sur lequel vous lisez ce texte, qui disparaissent dès que leur auteur meurt. Aucun politicien en France à ma connaissance n’a jamais songé à proposer un système de dépôt légal pour les blogs et sites les plus consultés. Ces politiciens sont tellement heureux de se masturber l’esprit avec le nombre de « retweets » qu’une de leurs « petites phrases » peut obtenir qu’ils oublient de songer à l’intérêt commun. Chaque année je suis obligé de rayer des sites référencés d’altersexualite.com plusieurs sites, de profs par exemple, qui contenaient des articles extrêmement intéressants pour la communauté. C’est le moment de vous refiler ma citation favorite de Pierre Bourdieu : « si l’on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c’est que ces choses si futiles sont en fait très importantes dans la mesure où elles cachent des choses précieuses » (Sur la télévision, p.17). Consacrer des articles à des sites Facebook de gamines de 15 ans ou à des tweets antisémites de n’importe quel connard, cela prend le temps que les médias pourraient consacrer par exemple à mon livre M&mnoux (6 ans de travail, 550 pages, 0 émission de radio, 0 émission de télé, 0 article dans la presse nationale). Dix ans après ma mort, mes livres serviront de pitance aux mites, altersexualite.com sera comme n’ayant jamais existé, mais les ressources de la planète brûleront pour conserver la trace des quelques heures que j’aurai passées sur des sites de cul ! Le pire c’est qu’on serait plutôt d’accord avec les gilets jaunes, mais que leur révolte s’exerce grâce à ce système totalitaire qu’elle favorise sans en être consciente. Mais je m’écarte encore du livre et du ton policé de l’auteure !
Quant aux « amis » Facebook de l’enfance : « C’est la première fois que les gens restent tes amis. Ça devient plus difficile de laisser sa vie derrière soi et d’avancer. » Sanjay, seize ans, se demande à son tour s’il écrira toujours sur les murs de ses amis quand il sera adulte. Cela résume bien ses appréhensions : C’est la première fois que les gens peuvent rester en contact toute leur vie. Pourtant, c’était une bonne chose qu’ils puissent oublier leurs amis de lycée et passer à autre chose » (p. 402). Il faudrait mitiger cette opinion, car elle émane sans doute d’un lycéen d’une métropole. Si l’on a fréquenté le lycée unique d’une ville moyenne et qu’on vit toujours dans le secteur, il y a des chances qu’on reste au moins en relation avec beaucoup de camarades…
« Pendant une discussion sur la vie en ligne entre élèves de terminale à Fillmore, Brendan dit qu’il se sent seul. Il essaie de faire de l’humour et décrit une journée type où il se sent « entre deux eaux » : « Toute ma vie se résume à : « Je t’écris un petit message, tu me réponds dans quinze minutes, une heure, n’importe quoi. Et je te réponds quand je peux. » Soudain, il n’a plus envie de rire. Les textos le dépriment. La raison en est qu’il n’a pas l’impression que ces textos le « rapprochent » des gens, au contraire, il est certain qu’ils l’éloignent de certaines choses qui, elles, l’en rapprocheraient. Il veut voir ses amis en personne, ou avoir avec eux des relations téléphoniques qui ne finissent pas abruptement parce qu’ils ont autre chose à faire. Ici encore, la nostalgie pointe derrière les questions d’attention, d’investissement et d’engagement, et les avantages de ne faire qu’une seule chose à la fois. Truman, l’un des camarades de Brendan, trouve que son ami est trop exigeant. « Brendam […] m’appelle de temps en temps, et c’est vraiment cool, j’aime vraiment beaucoup ça, mais c’est un truc que je ne peux pas m’imaginer faire. […] Ben, ça me semble bizarre comme truc, d’appeler quelqu’un juste pour parler. » Sa remarque mérite d’être décortiquée. Il dit qu’il aime bien le téléphone, mais pas vraiment. Il ajoute que la conversation c’est vraiment cool, mais c’est surtout stressant. Pour lui, tout ce qui n’est pas un « appel déjà prévu, ou un appel pour prévoir quelque chose, ou pour se fixer un lieu de rendez-vous » sous-entend que la personne qu’on appelle a du temps à nous consacrer. Il n’est jamais sûr que ce soit le cas, ce qui le pousse à se demander si ce genre d’appel n’est pas trop intrusif. Ces appels rendent trop vulnérables. Il y a des risques de se blesser.
Quand les jeunes gens doutent d’eux-mêmes, ils inventent des tests pour mesurer l’amour qu’on leur porte, une sorte de métrique personnelle pour se rassurer. Aujourd’hui, j’entends les adolescents mesurer l’affection à l’aune des types de communication qu’ils utilisent. Un message sur le chat ? Vous n’êtes qu’une fenêtre parmi d’autres. Une lettre ou un long appel téléphonique, ces choses rares et difficiles à obtenir, prouvent au contraire qu’on vous donne une attention totale. Brad, le garçon en terminale à Hadley qui a quitté Facebook pour faire une petite pause, explique de façon détaillée :
« Ce qui est si particulier, quand on reçoit une lettre, c’est qu’elle n’est destinée qu’à toi. […] C’est tellement flatteur, surtout à l’heure où les gens font de plus en plus de choses à la fois, que quelqu’un se donne du mal et se concentre entièrement sur quelque chose qui t’est destiné pendant cinq ou dix minutes. Ce qui est flatteur, c’est qu’ils prennent ce temps, […] qu’ils donnent un peu de leur temps pour toi » (p. 417).
Les jeunes ne sont pas dupes de l’artificialité de Facebook : « D’autres, enfin, estiment que le site les incite à juger les autres et eux-mêmes de façon trop superficielle. Ils se demandent pendant des heures quelles photos poster. Ils les retouchent numériquement pour avoir l’air plus séduisant. Et après tout ce travail, tout le temps passé à rédiger des profils et à retoucher des photos, la fiction de la page Facebook se prolonge à travers la mise en ligne des informations avec une sorte de nonchalance aristocratique. Luis commente : « C’est comme une fille trop maquillée, qui fait trop d’efforts. Ta page doit donner l’impression que tu l’as faite comme ça, sans te poser trop de questions. Mais personne n’y croit, à ce mythe du : « Oh, j’ai juste balancé deux ou trois trucs sur ma page. […] Je suis tellement cool. J’ai beaucoup d’autres choses à faire. » Mais tu vois bien qu’ils sont sur leur Facebook toute la journée. Qui croit à leur mytho ? » Il se fait nostalgique : « Ça devait être bien, quand on pouvait faire la connaissance de quelqu’un juste en lui parlant. » Ainsi, pour toutes ces raisons, quitter la vie en ligne leur apparaît un peu comme un soulagement » (p. 423).

Conclusion : des débats nécessaires
« Désormais, nous savons que dès que les ordinateurs nous lient les uns aux autres, dès que nous nous enchaînons au réseau, nous n’avons plus besoin de chercher comment les maintenir occupés. Le fait est que ce sont eux qui nous maintiennent occupés. C’est comme si nous étions devenus leurs applications. Comme l’a dit avec esprit l’un de mes amis : « Nous ne traitons pas nos emails. Nos emails nous traitent. » Nous parlons des « heures perdues » sur nos boîtes de réception, mais nous sommes perdus dans le même mouvement » (p. 430).
« Une étude comparant des données recueillies entre 1985 et 2004 a permis d’établir que le nombre moyen de personnes avec qui les Américains peuvent parler de choses importantes a baissé de près d’un tiers, passant de 2,94 personnes en 1985 à 2,08 en 2004. Les chercheurs ont également révélé que le nombre d’individus affirmant n’avoir personne à qui se confier a plus que doublé en l’espace de deux décennies, ce qui représente près de 25 % des personnes interrogées au total. On y apprend enfin que les confidents appartenant ou non au cercle familial sont eux aussi moins nombreux, la baisse la plus marquée étant au sein même du cercle familial » (note 2, p. 514).
Même en conclusion, on a droit à des histoires hallucinantes : Un ancien collègue de l’auteur devenu « lourdement handicapé » donne son avis : « L’idée que des robots puissent offrir une assistance pratique et tenir compagnie à des gens dans sa situation l’intéresse, mais provoque aussi chez lui une réaction mitigée. Il commence par dire : « Montre-moi quelqu’un dans ma situation qui veut un robot et je te montrerai quelqu’un qui cherche un être humain mais ne le trouve pas. » Il se lance ensuite dans un plaidoyer pour des auxiliaires de santé robotiques, quand il évoque le sujet de la cruauté humaine : « Dans le centre de rééducation, il y a des infirmières et des auxiliaires qui te font mal par maladresse, d’autres qui le font délibérément. J’ai eu affaire aux deux. Il y en avait une qui me tirait les cheveux. Une autre qui me tirait dans les couloirs par les sondes. Un robot ne ferait jamais ça. » Et d’ajouter : « Mais tu sais, en fin de compte, cette personne qui me tirait par les sondes, elle avait une histoire personnelle. J’aurais pu la découvrir. […]
Être avec une personne, même désagréable ou sadique, donne à Richard le sentiment d’être toujours vivant. Cela signifie que son mode d’être au monde conserve une certaine dignité, alors même que son champ d’activité est drastiquement limité. Pour lui, la dignité requiert une forme d’authenticité, le sentiment que l’on appartient encore au grand récit de l’humanité. Il en a profondément besoin. Ainsi, même s’il ne veut pas courir de risque mortel, il préfère le sadique plutôt que le robot » (p. 433).
Pour information, on apprend l’existence (mais sans précision) d’une « déclaration des droits des robots » pour éviter qu’ils ne soient maltraités, et l’auteure s’étonne qu’elle se « retrouve à débattre contre ceux qui affirment, comme David Lévy, que [s]a fille pourrait vouloir en épouser un » (p. 442 + note 20 de cette page).
Sherry Turkle se fait presque gauchiste quand elle s’exclame : « Un bon point de départ serait d’augmenter le salaire moyen des professionnels du soin aux personnes âgées, pour l’instant souvent fixé au salaire minimum et dépourvu d’avantages sociaux. Le dilemme « des robots ou rien » évacue le choix social et politique, alors qu’il devrait être au centre. »
Un dernier long extrait pour la route, qui est comme la conclusion de la conclusion : « Pourquoi voudrions-nous donner à nos enfants des robots en guise de compagnons ? On l’a vu, les enfant entretiennent avec les robots sociaux des relations très différentes d’avec leurs poupées. Ils n’essaient pas de modeler leurs expressions sur celles de leurs poupées : au contraire, ils projettent sur elles des expressions humaines. Mais les robots baby-sitters (déjà à l’étude) pourraient ressembler suffisamment à des êtres humains pour que les enfants les prennent comme modèles. Ceci soulève de graves problèmes. Les êtres humains sont capables d’une combinaison infinie d’inflexions de voix et d’expressions faciales. Nous apprenons des autres comment écouter et nous pencher vers nos interlocuteurs. Notre regard « s’éclaire » quand nous sommes intéressés, ou « s’assombrit » sous le coup des émotions fortes ou de l’angoisse. Nous reconnaissons ceux qui ont le même comportement et c’est avec eux que nous sommes le plus à l’aise. De la même façon, nous reconnaissons ceux pour qui ce n’est pas le cas (qui souffrent d’autisme ou du syndrome d’Asperger) et sommes moins à l’aise avec eux. Si les enfants se calquent sur des robots, qui sait quelles conséquences cela pourrait avoir sur leur développement ? Quelque chose me dit qu’elles pourraient être désastreuses. Les êtres humains ont besoin d’être touchés par d’autres humains, de voir leurs visages, d’entendre leurs voix. En somme, ils ont besoin d’être entourés d’autres êtres humains.
Quand je fais valoir cet argument, on me rétorque parfois que, même si j’ai raison, les robots pourraient se charger des tâches les « plus simples », comme donner à manger aux enfants ou changer leurs couches. Mais un enfant qui a appris à manger ses légumes avec un robot n’associera pas le temps du repas avec la compagnie humaine, la discussion, le calme. Pour le dire autrement, il n’associera pas le fait d’être nourri par quelqu’un à une forme d’affection. De même un enfant dont un robot a changé la couche ne sentira pas que son corps est malgré tout chéri par d’autres êtres humains. Pourquoi sommes-nous prêts à courir de tels risques ? » (p. 450).
– Sur ce dernier point, l’affaire des orphelins de Ceaucescu en Roumanie nous fournit une réponse à propos d’enfants privés d’un entourage humain, qui deviennent arriérés (cf. Les Cancres n’existent pas, Anny Cordié, Points Seuil, 1993, p. 127.
– La photographe Catherine Balet est l’auteure d’une série intitulée Strangers in the light dont a été tirée une photo pour la session du BTS de 2014 (thème « Paroles, échanges, conversations et révolution numérique »). Cette photo illustre parfaitement cet article.
– Écouter une émission de 2015 sur France Culture, « Du grain à moudre » : « Faut-il écrire la déclaration des droits (et des devoirs) des robots ? ».
Voir en ligne : Le site de l’auteure (en anglais)
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com