Accueil > Zola pour les nuls > Une Page d’amour, d’Émile Zola
Zola fleur bleue, pour midinets & midinettes
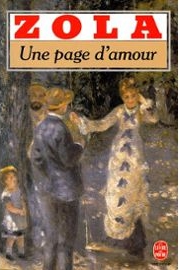 Une Page d’amour, d’Émile Zola
Une Page d’amour, d’Émile Zola
GF Flammarion, 1878 (éd. 1973).
vendredi 1er janvier 2016
J’ai utilisé une édition de 1973 par Colette Becker, toujours disponible en GF Flammarion. « C’est un peu popote, c’est un peu jeanjean, mais cela se boira agréablement, je crois. Je veux étonner les lecteurs de L’Assommoir par un livre bonhomme. », écrivait Zola à Huysmans (p. 16), et tout est dit : Ayant enfin obtenu le succès de scandale hénaurme dont il rêvait, le polémiste acerbe des premiers tomes peut prendre ses détracteurs à rebrousse-poil et leur offrir du mièvre. Mièvre extra-conjugal quand même ; on ne se refait pas… Le titre est à prendre de façon ironique, du moins c’est mon avis. En effet, d’amour, pour une fois, il n’y aura pas, ni au sens moral, ni au sens physique, sauf peut-être amour filial, et le détracteur de Zola émoustillé par le titre, qui se tape le roman pour y débusquer de quoi pourfendre à nouveau le pornographe, en sera pour ses frais, et attendra avec impatience le retour des cochonneries zoliennes dans le volume suivant ! Le roman parut en feuilleton entre décembre 77 et avril 78, et pour la première fois (voir infra), le volume sera édulcoré par rapport au feuilleton ! La conception et la rédaction furent très rapides, et le dossier est un des plus minces des Rougon-Macquart, et pour cause : toute l’action se passe à Paris dans un milieu bourgeois dont l’auteur était familier. Ce livre sur une passion amoureuse vouée à l’échec n’était pas prévu dans la liste de dix romans de 1868. Comme plus tard Le Rêve, puis Pot-Bouille, ce tome est selon la préfacière une œuvre de diversion entre deux romans majeurs. Zola le présente comme un roman sur Paris, mais après les pages magistrales déjà sorties de sa plume sur le sujet dans La Curée, Le Ventre de Paris et Son Excellence Eugène Rougon, cela ennuie un peu. Dois-je avouer que c’est le premier des huit tomes qui m’ait fait bâiller ? Certes les cinq grandes – lisez « longues » – descriptions de Paris rivalisent avec les tableaux impressionnistes dont Zola appréciait la nouveauté, et il faut y lire en filigrane l’évolution des sentiments de l’héroïne (et de sa fille pour la 4e description), mais que ne torche-t-on en une phrase lesdits sentiments ! Flaubert, nonobstant, est grisé : « je n’en conseillerais pas la lecture à ma fille, si j’étais mère !!! Malgré mon grand âge, le roman m’a troublé et excité. On a envie d’Hélène de façon démesurée et on comprend très bien votre docteur. […] Vous êtes un mâle. Mais ce n’est pas d’hier que je le sais. » [1] Mais ce que ne dit pas Flaubert (ou entre les lignes) c’est que plus que lui-même, Zola est parvenu avec Une Page d’amour, à écrire le livre sur rien qu’ambitionnait Flaubert en rédigeant Bovary. La courte note liminaire est l’occasion de prendre date (elle est d’ailleurs signée du 2 avril 1878, anniversaire de ses 38 ans, à l’apogée du succès), et de donner rendez-vous pour le dernier volume : « La publication de ce document sera ma réponse à ceux qui m’ont accusé de courir après l’actualité et le scandale. Depuis 1868, je remplis le cadre que je me suis imposé, l’arbre généalogique en marque pour moi les grandes lignes, sans me permettre d’aller ni à droite ni à gauche. Je dois le suivre strictement, il est en même temps ma force et mon régulateur. Les conclusions sont toutes prêtes. Voilà ce que j’ai voulu et voilà ce que j’accomplis. ». En ce qui concerne les descriptions, Zola s’explique dans une préface à une réédition de 1884 : « Aux jours misérables de ma jeunesse, j’ai habité des greniers de faubourg, d’où l’on découvrait Paris entier. Ce grand Paris, immobile et indifférent, qui était toujours là, dans le cadre de ma fenêtre, me semblait comme le confident tragique de mes joies et de mes tristesses. J’ai eu faim et j’ai pleuré devant lui ; et devant lui, j’ai aimé, j’ai eu mes plus grands bonheurs. Eh bien ! dès ma vingtième année, j’avais rêvé d’écrire un roman dont Paris, avec l’océan de ses toitures, serait un personnage, quelque chose comme le chœur antique. Il me fallait un drame intime, trois ou quatre créatures dans une petite chambre, puis l’immense ville à l’horizon, toujours présente, regardant avec ses yeux de pierre rire et pleurer ces créatures. C’est cette vieille idée que j’ai tenté de réaliser dans Une Page d’amour. » On comprend pourquoi l’héroïne ne copule guère avec son docteur, et pourtant on se demande bien pourquoi cette pauvre femme qui ne croit guère en dieu et ne pratique pas, ne profite pas de son veuvage pour pimenter sa vie. C’est que l’amour, en fait, ne dit rien à cette créature si peu zolienne, ou alors si proche d’Eugène Rougon que les circonstances également empêchent de jouir d’une femme, et qui en épouse une autre qui lui convient fort bien. Le thème de la mort de l’enfant est peut être influencé par le fait qu’à cette époque, les recherches entamées par les Zola sur l’enfant abandonnée d’Alexandrine à l’époque de sa vie de misère viennent d’aboutir : ils ont appris que cette fillette est morte peu après son abandon. Cf. Madame Zola d’Évelyne Bloch-Dano (Grasset, 1997, p. 117).
– aller à la fin de l’article
Première partie
Le livre est composée de 5 parties de 5 chapitres chacune. La première partie commence in medias res par l’inquiétude d’Hélène Rambaud, l’héroïne, pour sa fille Jeanne. Elle la croit morte et sort en pleine nuit chercher un médecin. Elle sonne au hasard dans les environs et tombe sans y songer sur son voisin et propriétaire de son appartement, dont elle avait oublié qu’il était médecin, M. Deberle : « Elle n’eût pas amené Dieu chez elle d’une façon plus dévote ». Le médecin constate des convulsions, et Hélène doit rappeler l’hérédité de Jeanne, qui intéresse les lecteurs fidèles des Rougon-Macquart : « Elle hésitait, prise d’une honte, ne voulant pas avouer une aïeule enfermée dans une maison d’aliénés. Toute son ascendance était tragique. » Il s’agit évidemment de tante Dide, dont Hélène est la petite-fille, par Ursule Macquart. Le trait de caractère principal de la fillette est donné d’emblée à ce médecin qui semble comme un fondé de pouvoir du romancier naturaliste : « Elle m’aime avec une passion, une jalousie qui la font sangloter, lorsque je caresse un autre enfant. » Le docteur n’a pas les yeux dans sa poche, et continue de se comporter en romancier auquel rien n’échappe : « Cependant, il ne la quittait pas du regard. Jamais il n’avait vu une beauté plus correcte. Grande, magnifique, elle était une Junon châtaine, d’un châtain doré à reflets blonds. Quand elle tournait lentement la tête, son profil prenait une pureté grave de statue. Ses yeux gris et ses dents blanches lui éclairaient toute la face. Elle avait un menton rond, un peu fort, qui lui donnait un air raisonnable et ferme. Mais ce qui étonnait le docteur, c’était la nudité superbe de cette mère. Le châle avait encore glissé, la gorge se découvrait, les bras restaient nus. Une grosse natte, couleur d’or bruni, coulait sur l’épaule et se perdait entre les seins. Et, dans son jupon mal attaché, échevelée et en désordre, elle gardait une majesté, une hauteur d’honnêteté et de pudeur qui la laissait chaste sous ce regard d’homme, où montait un grand trouble. » Le coup de foudre est partagé par l’épouse du médecin, qui voit la belle Hélène ainsi : « Jamais elle n’avait vu une femme d’un air plus royal, dans ces vêtements noirs qui drapaient la haute et sévère figure de la veuve. » En conclusion de cette première entrevue, elle déclare : « Vous êtes si belle qu’il faut bien vous aimer ! » Mme Deberle obtient pour le lecteur les informations utiles sur le mariage d’Hélène à 17 ans avec un homme de six ans plus âgé : « le grand amour que son mari avait conçu pour elle, lorsqu’elle habitait avec son père, le chapelier Mouret, la rue des Petites-Maries, à Marseille ; l’opposition entêtée de la famille Grandjean, une riche famille de raffineurs, que la pauvreté de la jeune fille exaspérait ; et des noces tristes et furtives, après les sommations légales, et leur vie précaire, jusqu’au jour où un oncle, en mourant, leur avait légué dix mille francs de rente environ. C’était alors que Grandjean, qui nourrissait une haine contre Marseille, avait décidé qu’ils viendraient s’installer à Paris. » Elle ne fréquente plus que deux connaissances de Marseille, l’abbé Jouve et son demi-frère M. Rambaud. Dans le salon de Mme Deberle, on cause vaudeville, et Malignon, un jeune homme fat, déclare à propos d’un spectacle : « c’est répugnant de réalisme » ; mais cela plaît à ces dames. Hélène rencontre le docteur au chevet de la mère Fétu, une dame pauvre et fort intéressée qu’ils assistent tous deux : « — Ah ! on peut bien dire que vous faites la paire… », remarque celle-ci, qui n’est pas née de la dernière pluie. Zola en fera un personnage récurrent et prophétique digne de l’aveugle de Madame Bovary. Les enfants Lucien (fils du docteur) et Jeanne (fille d’Hélène) sont l’occasion de réunir les adultes, car Jeanne profite du beau jardin des Deberle. Mais Zola prend plaisir à observer les enfants, motif rare dans le roman de l’époque. Sans doute souffre-t-il déjà de la stérilité de son couple qui le prive des enfants dont il rêve et qu’il obtiendra dix ans plus tard de Jeanne Rozerot. Pauline, la jeune sœur de Mme Deberle, est l’objet d’un gag : comme il est question d’amour dans la discussion (et pourtant de façon fort vague), on l’oblige à deux reprises à s’éloigner un instant, le temps de donner les informations jugées lestes. Ce gag est un clin d’œil roublard de Zola à son lecteur : non, décidément, contrairement à ce que prétend Flaubert, il n’y a dans ce Zola-ci pas de quoi effaroucher les jeunes filles ! Il est question d’une dame que Malignon fréquenterait, et auprès de la quelle il se serait moqué de la « japonerie », c’est-à-dire le salon japonais de Mme Deberle. La pruderie n’a guère de limite, et quand Hélène se laisse aller au plaisir de la balançoire, c’est édifiant : « Surtout, elle n’avait point de pruderie. En riant, elle dit qu’elle ne voulait pas montrer ses jambes, et elle demanda une ficelle, avec laquelle elle noua ses jupes au-dessus de ses chevilles ». Voilà qui met en perspective la fameuse scène de la balançoire de Partie de Campagne de Jean Renoir, adapté de « Une partie de campagne » de Maupassant. Hélène saute de la balançoire à l’arrivée du docteur et, troublée, refuse qu’il l’ausculte : « lorsqu’il avança les mains, elle se souleva d’un effort, elle serra ses jupes autour de ses pieds ». Hélène lit Ivanhoé de Walter Scott, et bovaryse : « évoquée par les pages du roman, sa propre existence se dressa. Elle se vit jeune fille, à Marseille, chez son père, le chapelier Mouret. […] Un matin, comme elle revenait du marché avec sa mère, elle avait heurté le fils Grandjean de son panier plein de légumes. Charles s’était retourné et les avait suivies. Tout le roman de ses amours tenait là. […] Mon Dieu ! était-ce tout ? et que disait donc ce livre, lorsqu’il parlait de ces grandes amours qui éclairent toute une existence ? » On songe à cette maxime de La Rochefoucauld : « Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour. » La première partie se referme sur une description de Paris censée évoquer l’état d’esprit de la jeune femme. C’est là que Zola s’autorise des anachronismes qu’il revendique dans sa « lettre aux éditeurs » : « plus loin, derrière la toiture écrasée de la Madeleine, semblable à une pierre tombale, se dressait la masse énorme de l’Opéra ». Opéra qui ne fut inauguré qu’en 1875, alors que l’action se déroule en 1853-54. L’église Saint-Augustin est également évoquée au ch V de la 3e partie. Hélène et sa fille, de toute façon, ne voient rien de ce que peint le narrateur : « Elles ne savaient rien de Paris, en effet. Depuis dix-huit mois qu’elles l’avaient sous les yeux à toute heure, elles n’en connaissaient pas une pierre. » Cela nous rappelle Thérèse Raquin, où Thérèse et sa mère vivent recluses dans leur boutique sans connaître Paris.
Deuxième partie
La bonne Rosalie demande l’autorisation à Madame de recevoir son fiancé Zéphyrin le dimanche. Hélène autorise, mais ment à sa fille, qui veut savoir si le garçon est le frère de Rosalie : « Maman, c’est le frère de Rosalie ? demanda Jeanne. […] Non, c’est son cousin. » N’est-il pas amusant que pour préserver la pudeur par respect pour la religion, on n’hésite pas à mentir, ce qui est contraire à un autre précepte religieux ? Rosalie semble « plus délurée » que Zéphyrin à Paris : « elle s’y déniaisait, bien qu’elle ne connût que trois rues, la rue de Passy, la rue Franklin et la rue Vineuse. Lui, au régiment, restait godiche. » Ce sera aussi le cas de Denise dans Au Bonheur des Dames. L’abbé son ami parle mariage à Hélène, ce qui l’offusque : « Tout son cœur se soulevait, elle était effrayée elle-même de la violence de son refus. La proposition du prêtre venait de remuer en elle ce coin obscur, où elle évitait de lire ; et, à la douleur qu’elle éprouvait, elle comprenait enfin la gravité de son mal, elle avait l’effarement de pudeur d’une femme qui sent glisser son dernier vêtement. » C’est que M. Rambaud est sur les rangs. Hélène refuse le plus poliment qu’elle peut, et celui-ci a cette repartie édifiante : « — Écoutez, murmura-t-il, vous savez maintenant que je suis là, n’est-ce pas ? Eh bien ! dites-vous que j’y serai toujours, quoi qu’il arrive. C’est tout ce que l’abbé aurait dû vous expliquer… Dans dix ans, si vous voulez, vous n’aurez qu’à faire un signe. Je vous obéirai. » Le roman prend son temps : « Des rapports de plus en plus étroits se nouaient entre elle et les Deberle. » Hélène développe un amour chaste : « Entre elle et lui, elle s’avouait maintenant qu’il y avait un sentiment caché, quelque chose de très doux, d’autant plus doux que personne au monde ne le partageait avec eux. Mais elle portait son secret paisiblement, sans un trouble d’honnêteté, car rien de mauvais ne l’agitait. Comme il était bon avec sa femme et son enfant ! Elle l’aimait davantage, quand il faisait sauter Lucien et baisait Juliette sur la joue. Depuis qu’elle le voyait dans son ménage, leur amitié avait grandi. » La jalousie de la petite Jeanne pour sa mère occupe à nouveau un long temps du livre. C’est d’ailleurs elle qui révèle involontairement au docteur la proposition de mariage de M. Rambaud. Le docteur se dévoile lorsqu’il apprend cette nouvelle : « Il eut un geste violent. Il s’écria : — Mais c’est impossible ! » Vient le récit exhaustif du dispendieux dîner d’enfants annuel donné par Mme Deberle : « On eût dit un de ces goûters gigantesques comme les enfants doivent en imaginer en rêve, un goûter servi avec la gravité d’un dîner de grandes personnes, l’évocation féerique de la table des parents, sur laquelle on aurait renversé la corne d’abondance des pâtissiers et des marchands de joujoux. » C’est au cours de ce dîner qu’Henri se déclare : « Alors, elle comprit qu’il allait parler ; mais elle n’avait plus la force d’échapper à son aveu. Il s’approcha, il dit très bas, dans sa chevelure : — Je vous aime ! Oh ! je vous aime ! Ce fut comme une haleine embrasée qui la brûla de la tête aux pieds. Mon Dieu ! il avait parlé, elle ne pourrait plus feindre la paix si douce de l’ignorance. » Hélène gamberge, et Zola nous introduit en connaisseur dans l’esprit d’une femme : « Sa brutalité d’homme venait de gâter leur tendresse. Et elle évoquait les heures où il l’aimait sans avoir la cruauté de le dire, ces heures passées au fond du jardin, dans la sérénité du printemps naissant. Mon Dieu ! il avait parlé ! Cette pensée s’entêtait, devenait si grosse et si lourde, qu’un coup de foudre détruisant Paris devant elle ne lui aurait pas paru d’une égale importance. C’était, dans son cœur, un sentiment de protestation indignée, d’orgueilleuse colère, mêlé à une sourde et invincible volupté qui lui montait des entrailles et la grisait. Il avait parlé et il parlait toujours, il surgissait obstinément, avec ces paroles brûlantes : « Je vous aime… Je vous aime… », qui emportaient toute sa vie passée d’épouse et de mère. » Et une nouvelle description maritime de Paris noyée dans une sorte de tempête sous un crâne clôt cette 2e partie : « Au nord, sur Montmartre, il y avait un réseau d’une finesse extrême, comme un filet de soie pâle tendu là, dans un coin du ciel, pour quelque pêche de cette mer calme. » On nous ressert « la masse énorme de l’Opéra » (anachronique) dans une autre sauce. Nous plongeons à nouveau dans ce crâne féminin : « Dire qu’elle s’était crue heureuse d’aller ainsi trente années devant elle, le cœur muet, n’ayant, pour combler le vide de son être, que son orgueil de femme honnête ! Ah ! quelle duperie, cette rigidité, ce scrupule du juste qui l’enfermaient dans les jouissances stériles des dévotes ! Non, non, c’était assez, elle voulait vivre ! […] Elle avait nié la chute, elle avait eu l’imbécile vanterie de croire qu’elle marcherait ainsi jusqu’au bout, sans que son pied heurtât seulement une pierre. Eh bien ! aujourd’hui, elle réclamait la chute, elle l’aurait souhaitée immédiate et profonde. Toute sa révolte aboutissait à ce désir impérieux. Oh ! disparaître dans une étreinte, vivre en une minute tout ce qu’elle n’avait pas vécu ! » Quand Jeanne la tire de sa rêverie, Hélène a ce geste osé d’embrasser sa fille pour aimer son amant : « C’était là, elle le voyait bien, qu’Henri avait baisé l’enfant. »
Troisième partie
Hélène s’adonne avec Mme Deberle à des bondieuseries mondaines pour le mois de Marie, ce qui lui inspire des désirs chastes : « Elle goûterait la joie d’être aimée, elle n’avouerait jamais son amour, car elle sentait bien que la paix était à ce prix. Et comme elle aimerait profondément, sans le dire, se contentant d’une parole d’Henri, d’un regard, échangé de loin en loin, lorsqu’un hasard les rapprocherait ! C’était un rêve qui l’emplissait d’une pensée d’éternité. » Et cet amour platonique se réalise : « Pour Hélène, c’était comme si Henri n’avait jamais cédé à une minute de folie ; elle avait rêvé cela ; ils s’aimaient, mais ils ne se le diraient plus, ils se contenteraient de le savoir. Heures délicieuses, pendant lesquelles, sans parler de leur tendresse, ils s’en entretenaient continuellement, par un geste, par une inflexion de voix, par un silence même. Tout les ramenait à cet amour, tout les baignait dans une passion qu’ils emportaient avec eux, autour d’eux, comme le seul air où ils pussent vivre. Et ils avaient l’excuse de leur loyauté, ils jouaient en toute conscience cette comédie de leur cœur, car ils ne se permettaient pas un serrement de main, ce qui donnait une volupté sans pareille au simple bonjour dont ils s’accueillaient. » C’est alors que Jeanne tombe gravement malade, et va à nouveau rapprocher les amants à son corps défendant. En effet, le docteur inquiet de ne pas voir Hélène, sonne chez elle un soir, et elle lui demande de soigner sa fille en précisant : « — Je vous défends de recommencer ici… Jamais, jamais ! » L’état de la fillette se dégrade, et le docteur en désespoir de cause fait « une tentative désespérée, qui pouvait sauver ou tuer son enfant ». Il se trouve que ça marche, et la mère de se laisser aller : « Et, d’un mouvement violent, elle se leva, elle se jeta au cou d’Henri. « — Ah ! je t’aime ! » s’écria-t-elle. Elle le baisait, elle l’étreignait. C’était son aveu, cet aveu si longtemps retardé, qui lui échappait enfin, dans cette crise de son cœur. La mère et l’amante se confondaient, à ce moment délicieux ; elle offrait son amour tout brûlant de sa reconnaissance. » Paradoxalement, une variante du texte publiée dans le dossier de l’édition GF, montre que dans la version publiée en feuilleton, la scène était plus osée : « Vers deux heures, lorsque le docteur s’en alla, Hélène l’accompagna jusqu’à l’antichambre. Là, sans parler, elle lui tendit les bras, et il l’attira, il l’embrassa, dans une étreinte muette ». C’est bien la première fois qu’un Rougon-Macquart se trouve édulcoré dans sa version en volume ! Mais on se rend mieux compte de la nature du projet de Zola, qui a renoncé aux effets faciles du roman d’amour, et a définitivement donné à son titre un sens ironique. Un Maupassant n’aurait pas hésité, dès la petite sauvée, à culbuter le docteur sur la mère ! Quoi qu’il en soit, c’est alors une terrible crise de jalousie de la petite convalescente : « À partir de ce jour, la jalousie de Jeanne s’éveilla pour une parole, pour un regard. Tant qu’elle s’était trouvée en danger, un instinct lui avait fait accepter cet amour qu’elle sentait si tendre autour d’elle et qui la sauvait. Mais, à présent, elle redevenait forte, elle ne voulait plus partager sa mère. Alors, elle se prit d’une rancune pour le docteur, d’une rancune qui grandissait sourdement et tournait à la haine, à mesure qu’elle se portait mieux. » Cette jalousie de la fille s’exerce d’autant plus que l’oisiveté dans laquelle son statut de rentière relègue Hélène la place sous les feux croisés des yeux de sa fille. Bizarrement, Zola qui n’aura pas de mots assez durs pour dénoncer les ravages des différences sociales dans d’autres volumes, n’a pas un mot pour fouiller un peu en moraliste les ravages de l’oisiveté des nantis. En revanche, il réunit les deux médecins pour conclure à la maladie nerveuse et à l’hérédité : « ils interrogèrent longuement Hélène, en se sentant devant une de ces névroses qui ont une histoire dans les familles et qui déconcertent la science. Alors, elle leur dit ce qu’ils savaient déjà en partie, son aïeule enfermée dans la maison d’aliénés des Tulettes ». Tout cela s’est passé lors d’une longue absence de Mme Deberle, partie aux bains. À son retour, la petite Jeanne surprend le docteur embrassant sa femme, et sa jalousie maladive change d’objet : « Elle ne pouvait plus voir le docteur s’approcher de sa femme sans changer de visage, frémissante, le poursuivant du regard enflammé d’une maîtresse trahie. » Elle semble pardonner par contre à M. Rambaud, et les soirées reprennent. L’abbé Jouve en profite pour arracher des confidences à Hélène : « Ces femmes, qui semblent chercher Dieu si ardemment, ne sont que de pauvres cœurs troublés par la passion. C’est un homme qu’elles adorent dans nos églises… » Il parvient habilement à lui faire avouer qu’elle aime, et qui elle aime, à lui faire promettre, si ça se passe mal, d’utiliser M. Rambaud comme alternative ; et c’est le tableau final habituel sur Paris, cette fois moins maritime et plus volcanique : « Cependant, sur Paris allumé, une nuée lumineuse montait. On eût dit l’haleine rouge d’un brasier. […] comme un de ces nuages de foudre et d’incendie qui couronnent la bouche des volcans ».
Quatrième partie
Lors d’une réception chez les Deberle, Hélène surprend un échange furtif entre la femme du médecin et Malignon : « Comment cette femme si heureuse, d’un visage si calme, aux joues blanches et reposées, pouvait-elle trahir son mari ? » Elle observe alors le jeu des couples : « Dans ce monde digne, parmi cette bourgeoisie d’apparence si honnête, il n’y avait donc que des femmes coupables ? Son rigorisme provincial s’étonnait des promiscuités tolérées de la vie parisienne. Et, amèrement, elle se raillait d’avoir tant souffert, lorsque Juliette mettait sa main dans la sienne. Vraiment ! elle était bien sotte de garder de si beaux scrupules ! L’adultère s’embourgeoisait là d’une béate façon, aiguisé d’une pointe de raffinement coquet. » Du coup, elle perd ses scrupules et, cette digue rompue, elle se donne enfin à Henri en quittant la réception la dernière : « Lui, cessa de sourire ; sa figure changeait, ardente et gonflée. Il la serra follement, il la baisa au cou. Et elle plia la tête en arrière pour lui rendre son baiser. » C’est alors que soucieux de ses effets, Zola envoie Mme Fétu chez Hélène faire une confidence hypocrite : elle fait le ménage chez un Monsieur qui a loué un appartement dans son immeuble « pour son travail » et l’a fait arranger en quinze jours : « — Attendez donc ! vous devez le connaître, mon monsieur… Il voit une de vos amies. » Il s’agit évidemment de la garçonnière où Malignon entend approfondir ses liens avec Mme Deberle. Mme Fétu réussit à enflammer la curiosité d’Hélène avec cette brindille. Elle se rend sur place et apprend que la dame doit venir le lendemain. Hélène, désorientée, rédige un billet anonyme demandant à M. Deberle de se rendre à l’adresse en question au moment où l’adultère doit se consommer ; mais elle regrette aussitôt cette « infamie », et tente de prévenir Mme Deberle. Elle tombe sur une répétition mondaine du Caprice de Musset, que Juliette met en scène avec ses amies. Il s’agit d’une pièce qui vaudra à Musset un tardif et inattendu succès sur les planches. Zola s’amuse de cette « comédie imbécile » qui permet à une femme de se donner en spectacle avec son amant. Une citation de Musset constitue une mise en abyme de la situation d’adultère : « Adieu. Vous m’en voudrez peut-être aujourd’hui, mais vous aurez demain quelque amitié pour moi, et, croyez-moi, cela vaut mieux qu’un caprice. » Il se trouve que l’adultère n’était pas encore consommé, et qu’Hélène en sera le témoin pour notre plus grand plaisir. Mme Deberle, que Malignon a tort de ne pas circonscrire dès son entrée dans sa garçonnière, a des scrupules et se met à faire des commentaires sur le style du gandin : « Un commis de nouveautés n’aurait pas voulu de ce rose-là. Vous avez donc fait le rêve de séduire votre blanchisseuse ? » Zola nous livre de belles pages d’analyse psychologique de l’adultère mondaine : « C’était aux bains de mer, à Trouville, que Malignon, ennuyé par la vue de l’Océan, avait eu la belle idée de tomber amoureux. Depuis trois années déjà, ils vivaient dans une familiarité querelleuse. Un soir, il lui prit la main. Elle ne se fâcha pas, plaisanta d’abord. Puis, la tête vide, le cœur libre, elle s’imagina qu’elle l’aimait. Jusqu’à ce jour, elle avait à peu près fait tout ce que faisaient ses amies, autour d’elle ; mais une passion lui manquait, la curiosité et le besoin d’être comme les autres la poussèrent. Dans les commencements, si le jeune homme s’était montré brutal, elle aurait infailliblement succombé. Il eut la fatuité de vouloir vaincre par son esprit, il la laissa s’habituer au jeu de coquette qu’elle jouait. Aussi, dès sa première violence, une nuit qu’ils regardaient la mer ensemble, comme des amants d’opéra-comique, l’avait-elle chassé, étonnée, irritée de ce qu’il dérangeait ce roman dont elle s’amusait. » Cependant, au moment même où Mme Deberle est prête à succomber à la violence du désir de Malignon, Hélène intervient pour leur annoncer l’arrivée du mari. Ils se sauvent, et voilà un délicieux quiproquo préparé de main de maître par un romancier tout sauf naturaliste : M. Deberle croit que la lettre était faite par Hélène pour l’attirer lui ! « Elle ne pouvait pourtant pas livrer Juliette après l’avoir sauvée. » Et le tour est joué, voilà Hélène obligée de se livrer à l’adultère pour sauver la femme de son amant ! « Les lèvres sur les lèvres, ils s’étaient baisés. Elle avait tout oublié, elle cédait à une force supérieure. Cela lui semblait maintenant naturel et nécessaire. » La scène est couverte par une ellipse pudibonde, de sorte que l’on ignore s’il y a ou non coït, mais se clôt sur une désillusion : « elle pensait que jamais ils ne s’étaient moins aimés que ce jour-là. » La transition est sans pitié vers la jalousie de Jeanne. Zola développe un portrait tragique de fillette littéralement abandonnique : « Son abandon lui apparaissait noir, sans bornes, d’une injustice et d’une méchanceté qui l’enrageaient. […] Toujours les autres cessaient de l’aimer les premiers. Ils s’abîmaient, ils partaient ; enfin, il y avait de leur faute. Pourquoi donc ? Elle ne changeait pas, elle. Quand elle aimait les gens, ça durait toute la vie. Elle ne comprenait pas l’abandon. La 4e partie se clôt sur une description de Paris du point de vue de Jeanne, qui prend froid en contemplant la ville de la fenêtre ouverte, et la pluie torrentielle est censée correspondre à l’état d’esprit de la fillette ; on retrouve « la masse énorme et sombrée (sic) de l’Opéra » et tout le barnum anachronique. Mais l’édition GF fournit dans son dossier une éluc… pardon, une analyse extraite de Zola et les mythes ou de la Nausée du salut, de Jean Borie (Seuil, 1971) : « Une Page d’amour prouve abondamment que la forme profonde de Paris est celle d’une vallée, d’une terre, fendue d’un coup d’épée, au creux de laquelle un liquide coule, s’échappe. Nous devinons alors que ce spectacle si longuement, si nostalgiquement, contemplé par la petite Jeanne (et par l’auteur tout aussi bien), c’est le corps largement étalé de sa mère, tel que son imagination puérile l’a, il y a beau temps, rêvé ». Bigre ! Et les quatre autres descriptions de Paris par les yeux de la mère, alors ? Et Londres, Prague, Berlin, Lyon, Rome, Moscou, bref, la moitié des capitales, fondées sur un fleuve : toutes des vulves ?
Cinquième partie
« Elle n’avait ni remords ni joie » : ainsi s’ouvre la dernière partie. Hélène rentre à la maison et découvre sa fille endormie à la fenêtre. Elle a pris froid, mais ne veut pas le dire et fait semblant d’avoir de l’appétit. Hélène bouleversée par ce qui vient de lui arriver n’est guère attentive. Une fois sa fille couchée, elle cherche la compagnie de sa bonne et de Zéphyrin, et cela nous vaut 4 pages de remplissage, à moins qu’il ne s’agisse de suggérer de façon prémonitoire pour la biographie de l’auteur, que la seule vraie « page d’amour » ne peut être qu’ancillaire. Mais cette vision réveille la sensualité d’Hélène qui trouve un plaisir rétrospectif dans ce qu’elle vient de vivre : « Elle frissonnait de la volupté qu’elle n’avait point éprouvée. Des souvenirs lui revenaient, ses sens s’éveillaient trop tard, avec un immense désir inassouvi. Droite au milieu de la pièce, elle eut un étirement de tout son corps, les mains levées et tordues, faisant craquer ses membres énervés. Oh ! elle l’aimait, elle le voulait, elle se donnerait comme ça, la fois prochaine. » Au matin, elle se précipite chez Mme Deberle, et improvise des mensonges éhontés qui la ravissent : « elle n’éprouvait aucun des scrupules de loyauté dont elle avait souffert autrefois. » Mais elle n’est pas pressée de remettre le couvert : « Elle semblait mettre un raffinement à retarder l’heure du second rendez-vous. » Le docteur Bodin, sans rien dire, comprend que la petite est atteinte de phtisie, et conseille un voyage en Italie sans préciser le mal. Hélène rechigne au début, mais quand se profile l’arrangement d’un voyage commun avec les Deberle, elle accepte, hélas trop tard. Au moment même où elle accorde un rendez-vous au Dr Deberle, Jeanne se met à cracher le sang. Les scènes précédentes se rejouent : Hélène, tout à sa fille, refuse l’entrée de sa maison au docteur ci-devant son amant, qui est rejeté par la fillette : « Vous voyez bien que nous l’avons tuée », dit-elle à celui qui la lui avait sauvée jadis.

La lente agonie nous est narrée par le menu, et se termine sur une sorte de Cri de Munch : « Hélène, la face tendue, serra son front entre ses poings, comme si elle sentait son crâne s’ouvrir. Elle ne pleurait pas, elle promenait devant elle des regards fous. » Mme Deberle se propose pour faire un bel enterrement-entertainment, avec jolis enfants tout de blanc vêtus et de fleurs porteurs. Quand Hélène, à moitié folle, tente de suivre l’enterrement, Mme Deberle s’exclame : « Comment ! elle est venue ! Mais ça ne se fait pas, c’est de très mauvais goût ! » La conclusion de l’enterrement reprend le titre : « Elle restait seule, il lui semblait qu’une page de sa vie était arrachée. »
Deux ans passent, et l’épilogue nous présente une Hélène devenue « Madame Rambaud » : « Un matin de décembre […] Madame Rambaud priait encore, à genoux devant le tombeau de Jeanne, sur la neige. Son mari venait de se relever, silencieux. Ils s’étaient épousés en novembre, à Marseille. » Mme Fétu, rencontrée par hasard quêtant au cimetière, donne des informations sur les Deberle : « Il était un peu coureur, personne ne disait le contraire. Des dames de Passy le connaissaient bien. Mais ça ne l’empêchait pas d’adorer sa femme, une femme si gentille, qui aurait pu se mal conduire et qui n’y songeait seulement plus. […] la dame était accouchée, l’autre hiver, d’un deuxième enfant ». Hélène se les imagine comme « des époux qui redeviennent des amants. ». Mais elle n’y songe plus guère. Elle s’est mariée comme une chose naturelle, sans amour :« Puisqu’il voulait encore cette chose, elle ne trouvait pas de raison pour refuser. […] Ils s’étaient mariés en noir. » Elle ne comprend guère, rétrospectivement, ce qui lui est arrivé : « Quel coup d’étrange folie, quel mal abominable, aveugle comme la foudre ! » Et c’est sur des cannes à pêche [2] que se clôt cette Page d’amour…
Voir en ligne : Une Page d’amour sur Wikisource
© altersexualite.com, 2016
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Lire cette lettre sur le site de l’université de Rouen, avril 1878.
[2] On songe bien sûr à l’ironie de Maupassant dans « Une partie de campagne » : « L’espérance de prendre du goujon, cet idéal des boutiquiers… ».
 altersexualite.com
altersexualite.com