Accueil > Zola pour les nuls > Son Excellence Eugène Rougon, d’Émile Zola
Éros & pouvoir, pour lycéens
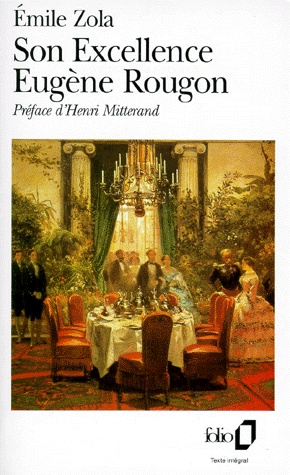 Son Excellence Eugène Rougon, d’Émile Zola
Son Excellence Eugène Rougon, d’Émile Zola
Folio classique, 1876 (éd. 1982).
dimanche 1er novembre 2015
Son Excellence Eugène Rougon est un objet rare, un roman entièrement consacré à la politique, sans intrigue amoureuse de premier plan et sans tragédie. C’est évidemment moins glamour, et cet opus est le dernier de la liste des best-sellers sur les vingt Rougon-Macquart, avec La Conquête de Plassans. Après la rocade que constitue La Faute de l’abbé Mouret, Zola reprend son plan initial et poursuit son « programme d’analyse politique » du régime impérial (selon les mots d’Henri Mitterand, auteur du dossier ainsi que de la préface de l’édition Folio), dont il avait étudié successivement le coup d’État, la spéculation, la petite bourgeoisie commerçante, la manipulation des opinions en province. Ce qu’envisage Zola, c’est une « mise en question globale et radicale du phénomène bonapartiste », au-delà de la défaite de Sedan, qui a escamoté, plus que détruit, les rouages du pouvoir. La tendance politique de Zola penche vers « une sorte d’anarchisme », en tout cas il se méfie de tout pouvoir, refuse de « servir, par la parole ou par le vote, quelque leader que ce soit », et cela le mènera, 22 ans plus tard, à « J’accuse… ! ». La comédie de mœurs est excellente ; on est parfois dans du Labiche, et en dépit de quelques longueurs dans les transitions, on se demande comment Son Excellence Eugène Rougon peut être un des 8 romans du cycle qui n’ait jamais été adapté au cinéma. Comment la politique culturelle est-elle menée en France pour que le cycle entier n’ait jamais fait l’objet d’une adaptation télévisuelle ou cinématographique ? Encore trop subversif ? Quel romancier actuel serait capable de raconter aussi crument les amours adultères de François Mitterrand ou de Jacques Chirac avec une ministre sous les yeux de son mari, ou avec une comédienne italienne ? La censure a beaucoup progressé depuis l’époque de Zola. On ne crache plus sur les livres de Zola de nos jours ; mais on sature les médias de prétendues vedettes de la littérature qui occupent la place avec leurs œuvrettes cachectiques.
Le dossier
Pour cet opus, le dossier est fort mince. Le roman fait partie des dix pour lesquels Zola a envoyé à son éditeur Lacroix en 1869 un bref scénario : « un roman qui aura pour cadre le monde officiel et pour héros Alfred Goiraud, l’homme qui a aidé au coup d’État. Je puis en faire soit un ministre, soit un grand fonctionnaire. L’ambition d’Alfred est plus haute que celle des autres membres de sa famille. Il a moins soif d’argent que de puissance. Mais le sens de la justice lui manque, il est un digne soutien de l’Empire. D’ailleurs c’est un homme de talent. Un Morny au petit pied. Il épousera la fille d’un comte quelconque, rallié à l’Empire, ce qui introduira dans l’œuvre des types affaiblis de notre noblesse agonisante ». Zola s’est servi de ses souvenirs de journaliste, collaborateur de La Tribune de 1868 à 70, chroniqueur du Rappel, journaliste et chroniqueur parlementaire à La Cloche, il suit presque quotidiennement les séances de l’Assemblée nationale à Versailles en 1871-72. Le modèle principal de son personnage éponyme est Eugène Rouher, dont il écrivait en mai 1872 : « On était allé là, en partie fine, et l’on attendait, au dessert, l’agonie de M. Rouher » (Le Sémaphore de Marseille). Mais il mélange avec des traits empruntés à tous les hommes forts du régime. Clorinde Balbi est inspirée de la comtesse Virginie de Castiglione, qui eut une liaison avec l’empereur. Zola utilise des livres d’histoire récente sur le Second Empire, d’Ernest Hamel et de Taxile Delord, plus une enquête auprès d’amis, jusqu’à interroger Flaubert sur un repas auquel il fut invité à Compiègne ; entrevue rapportée par le journal des frères Goncourt à la date du 7 mars 1875 :
« Zola en entrant chez Flaubert se laisse tomber dans un fauteuil, et murmure d’une voix désespérée :
— Que ça me donne du mal, ce Compiègne… que ça me donne du mal !
Alors Zola demande à Flaubert, combien il y avait de lustres éclairant la table du dîner… Si la causerie faisait beaucoup de bruit… et de quoi on causait… et qu’est-ce que disait l’Empereur…..
Et Flaubert, moitié pitié de son ignorance de l’intérieur impérial, moitié satisfaction d’apprendre à deux ou trois visiteurs, qu’il a passé quinze jours à Compiègne, joue à Zola dans sa robe de chambre, un Empereur classique au pas traînant, une main derrière son dos ployé en deux, tortillant sa moustache, avec des phrases idiotes de son cru :
— Oui, fait-il, après qu’il a vu que Zola a pris son croquis, cet homme était la bêtise, la bêtise toute pure !
— Certainement, lui dis-je, je suis de votre avis… mais la bêtise est en général bavarde, et la sienne a été muette : ça (sic) été sa force, elle a permis de tout supposer. »
Zola utilise aussi un livre de Paul Dhormoys intitulé La Cour à Compiègne. Confidences d’un valet de chambre. La publication prendra du retard à cause de quelques scènes « un peu vives » qui avaient du mal à passer dans les journaux, bien que Zola fût prêt à les retrancher pour la prépublication. Du coup, cette prépublication fut achevée un mois seulement (11 mars) avant le début de celle de L’Assommoir (13 avril), dont le scandale effaça complètement Son Excellence Eugène Rougon. À noter que si Le Siècle retarda la parution du roman de Zola, c’est aussi pour publier un roman d’André Léo, romancière injustement oubliée. La critique est plus favorable que d’habitude, comme l’indique le ton de Maxime Gaucher : « La réalité peinte actuellement par Zola est moins plate et moins triviale que celle où précédemment il se complaisait. Nous ne sommes plus, grâce à Dieu, dans les miasmes de la Halle et les émanations de la charcuterie ». Enfin, l’éditeur nous apprend que Zola ne rectifia que sur quelques points mineurs la première édition Charpentier, chose fascinante pour le 6e roman de la série.
Chapitre I. Après le triptyque de l’opus précédent, on revient à une structure en 14 chapitres. Le premier est une séance publique à l’Assemblée législative en mai 1856, au cours de laquelle Eugène Rougon démissionne de son poste de président du Conseil d’État, tandis que l’assemblée vote à l’unanimité « un crédit de quatre cent mille francs, pour les dépenses de la cérémonie et des fêtes du baptême du Prince Impérial », avec lecture intégrale du rapport sous les acclamations des députés. Cela fera contraste avec le dernier chapitre, où l’ambiance aura bien changé, quatre ans plus tard. Dans une caricature féroce mais réaliste digne de Daumier (« La femme avait un châle jaune extravagant ; le mari portait une de ces redingotes de province, qui semblent taillées à coups de hache ; et tous deux, larges, rouges, écrasés, appuyaient presque le menton sur le velours de la rampe, pour mieux suivre la séance, à laquelle leurs yeux écarquillés ne paraissaient rien comprendre »), sont présentés les députés et, parmi eux et parmi le public, la meute de Rougon, qui attend avec angoisse l’annonce de sa démission. Sont présentés d’abord M. Kahn : « Sa figure aux traits forts, dont le grand nez bien fait trahissait une origine juive » , puis M. La Rouquette, une vraie folle comme les aime Zola : « C’était un député tout jeune, vingt-huit ans au plus, blond et adorable, qui étouffait dans ses mains blanches une gaieté de jolie femme » […] « Sa figure poupine, égayée de quelques poils blonds, se rengorgeait sur sa cravate, avec un léger balancement. Il parut goûter un instant les deux dernières phrases d’orateur qu’il avait trouvées. Puis, brusquement, il partit d’un éclat de rire ». Puis c’est Clorinde et sa fille : « ces deux Italiennes, la mère et la fille, moitié aventurières et moitié grandes dames, qu’on rencontrait partout, au milieu de toutes les cohues : chez les ministres, dans les avant-scènes des petits théâtres, sur les plages à la mode, au fond des auberges perdues. La mère, assurait-on, sortait d’un lit royal ; la fille, avec une ignorance de nos conventions françaises qui faisait d’elle “une grande diablesse” originale et fort mal élevée, crevait des chevaux à la course, montrait ses bas sales et ses bottines éculées sur les trottoirs les jours de pluie, cherchait un mari avec des sourires hardis de femme faite. » Les autres membres de la meute sont aussi croqués en acte.

Rougon est d’abord présenté comme « chaste », suite à cette anecdote : « On a envoyé, paraît-il, une dame pour fléchir Rougon. Vous ne savez pas ce qu’il a fait, Rougon ? Il a mis la dame à la porte ; notez qu’elle était délicieuse. », puis on a son portrait en action : « Il crevait de ses larges épaules son uniforme de drap vert, chargé d’or au collet et aux manches. La face tournée vers la salle, avec sa grosse chevelure grisonnante plantée sur son front carré, il éteignait ses yeux sous d’épaisses paupières toujours à demi baissées ; et son grand nez, ses lèvres taillées en pleine chair, ses joues longues où ses quarante-six ans ne mettaient pas une ride, avaient une vulgarité rude, que transfigurait par éclairs la beauté de la force. Il resta adossé, tranquillement, le menton dans le collet de son habit, sans paraître voir personne, l’air indifférent et un peu las. ».
Chapitre II. Rougon prépare son déménagement et brûle les documents compromettants, aidé par son ami Delestang : « Ce “bon ami” était le seul avec lequel il pût à l’aise laver le linge sale de ses cinq années de présidence. Il l’avait connu à l’Assemblée législative, où ils siégeaient tous les deux sur le même banc, côte à côte. C’était là qu’il avait éprouvé un véritable penchant pour ce bel homme, en le trouvant adorablement sot, creux et superbe. Il disait d’ordinaire, d’un air convaincu, “que ce diable de Delestang irait loin”. Et il le poussait, se l’attachait par la reconnaissance, l’utilisait comme un meuble dans lequel il enfermait tout ce qu’il ne pouvait garder sur lui. […] En 1851, il avait même failli compromettre son avenir politique ; il adorait alors la femme d’un député socialiste, et le plus souvent, pour plaire au mari, il votait avec l’opposition, contre l’Élysée. Aussi, au 2 Décembre, reçut-il un véritable coup de massue. Il s’enferma pendant deux jours, perdu, fini, anéanti, tremblant qu’on ne vînt l’arrêter d’une minute à l’autre. Rougon avait dû le tirer de ce mauvais pas, en le décidant à ne point se présenter aux élections, et en le menant à l’Élysée, où il pêcha pour lui une place de conseiller d’État. » Bien qu’il ait donné ordre à son huissier de n’être là pour personne, un gag à répétition fait que tous les membres de la petite bande parviennent à s’introduire les uns après les autres, ce qui montre bien leur relation d’interdépendance. Du Poizat, le premier à arriver, est un « ami de trente ans » comme on dirait maintenant, de l’époque de Mme Correur dont il est compatriote de Coulonges. Comme pour le précédent, Zola utilise le verbe « utiliser » : « Dès les premiers temps de la propagande bonapartiste, Rougon utilisa ce garçon maigre qui mangeait rageusement ses cent francs par mois, avec des sourires inquiétants ; et ils trempèrent ensemble dans les besognes les plus délicates. Plus tard lorsque Rougon voulut entrer à l’Assemblée législative, ce fut Du Poizat qui alla emporter son élection de haute lutte dans les Deux-Sèvres. Puis, après le coup d’État, Rougon à son tour travailla pour Du Poizat, en le faisant nommer sous-préfet à Bressuire. » Kahn arrive ensuite, et d’expliquer son désappointement que la chute de son ami fasse capoter son projet de ligne de chemin de fer faisant un détour pour passer devant son usine de Bressuire. Devant ces fidèles, Rougon dicte la version officielle de sa démission, qu’il faut répandre dans Paris : « Mais, je le répète, continua Rougon d’une voix particulière, je me retire de mon plein gré. Si l’on vous interroge, vous qui êtes de mes amis, affirmez qu’hier soir encore j’étais libre de reprendre ma démission… » Arrivent ensuite d’autres familiers qui se croient un droit particulier à entrer dans le bureau de Rougon, accompagnés d’épouses, voire de fils : « Allons, bon ! des femmes, maintenant ! » Chacun se lamente sur sa petite prébende qu’il espère encore obtenir, et Rougon de sortir cette litote : « Je crains, je vous l’avoue, que mes amis ne reçoivent le contrecoup de ma disgrâce. » Le Colonel Jobelin est l’un des plus acharnés, il a apporté son fils : « Vous savez qu’il faudra me caser cette vermine-là, un de ces jours. Je compte sur vous. J’hésite encore entre la magistrature et l’administration… Donne une poignée de main, Auguste, pour que ton bon ami se souvienne de toi. » De même qu’il y a la bande des Deux-Sèvres, il y a la bande de Plassans : « La famille d’Escorailles était une des plus anciennes familles de Plassans, où elle jouissait de la vénération publique. Aussi Rougon, qui autrefois avait traîné des souliers éculés devant l’hôtel du vieux marquis, père de Jules, mettait-il son orgueil à protéger le jeune homme. » Les Charbonnel, qui ne sont pas des familiers, parviennent également à s’introduire, et la scène devient digne de Labiche : « Les Charbonnel, anciens marchands d’huile de Plassans, étaient les protégés de Mme Félicité, comme on nommait dans sa petite ville la mère de Rougon. Elle les lui avait adressés à l’occasion d’une requête qu’ils présentaient au conseil d’État. » Avec Mme Correur, on descend aux affaires sordides : « ”où en est l’affaire de Mme Leturc, la veuve du capitaine, qui demande un bureau de tabac. Je lui ai promis un résultat pour la semaine prochaine… Et l’affaire de cette demoiselle, vous savez, Herminie Billecoq, une ancienne élève de Saint-Denis, que son séducteur, un officier, consent à épouser, si quelque âme honnête veut bien avancer la dot réglementaire. Nous avions pensé à l’impératrice… Et toutes ces dames, Mme Chardon, Mme Testanière, Mme Jalaguier, qui attendent depuis des mois ?” Rougon, paisiblement, donnait des réponses, expliquant les retards, descendait dans les détails les plus minutieux. Il fit pourtant comprendre à Mme Correur qu’elle devait à présent compter beaucoup moins sur lui. » Mme Correur a son réseau de soutien du bas étage, mais très utile : « Mme Correur promit de parler à Gilquin, un de ses anciens locataires, du temps où Rougon logeait à l’hôtel Vaneau, garçon précieux à l’occasion, mais d’un débraillé très compromettant. » Une fois débarrassé de ces importuns, Rougon termine son rangement, et lance à Delestang un dernier avertissement : « Méfiez-vous des femmes », alors que justement, « une dame à cheval demande monsieur… Elle a dit en riant qu’elle monterait bien avec le cheval, si l’escalier était assez large… C’est seulement pour serrer la main à monsieur. » Il s’agit de Clorinde Balbi…
Chapitre III. Nous sautons sans transition dans le boudoir de la fille Balbi. Désœuvré, Rougon se laisse embobiner par ces dames, mère et fille indifféremment : « Pendant près de trois mois, Rougon, avec sa brutalité d’homme chaste, avait fort mal répondu aux avances de ces dames, qui s’étaient fait présenter à lui, dans un bal, au ministère des Affaires étrangères. Il les rencontrait partout, souriant l’une et l’autre du même sourire engageant, la mère toujours muette, la fille parlant haut, lui plantant son regard droit dans les yeux. » Il n’est pas parvenu à percer leurs secrets malgré ses investigations au ministère, qui révèlent un passé aventureux mais parsemé de vraies relations : « On lui avait conté bien des anecdotes abominables, une première faiblesse pour un cocher, et plus tard un marché passé avec un banquier, qui aurait payé la fausse virginité de la demoiselle du petit hôtel des Champs-Élysées. » Conclusion : « Il avait vécu jusque-là dans le dédain des femmes, et la première sur laquelle il tombait, était certes la machine la plus compliquée qu’on pût imaginer. » La scène est d’un débauché très chic : « Au milieu de la pièce, le député La Rouquette valsait avec une chaise, dont il serrait amoureusement le dossier entre ses bras, si emporté par son élan, qu’il avait jonché le parquet des sièges culbutés. Et, dans la lumière crue d’une des baies, en face d’un jeune homme qui la dessinait au fusain sur une toile blanche Clorinde, debout au milieu d’une table, posait en Diane chasseresse, les cuisses nues, les bras nus, la gorge nue, toute nue, l’air tranquille. Sur un canapé, trois messieurs très sérieux fumaient de gros cigares en la regardant, les jambes croisées, sans rien dire. » Rougon « affectait même, à chaque visite, d’être venu pour la mère, ce qui lui semblait plus convenable », mais la Comtesse assiste distraitement à la scène. Clorinde finit par faire sortir les intrus, sauf le peintre, et parvient à confesser Rougon comme un enfant de chœur (à la façon dont l’abbé Faujas s’y prenait avec François Mouret dans La Conquête de Plassans), ce dont il se rend compte, sans que cela l’empêche de persister à se laisser prendre : « Et il s’injuriait. À vingt ans, il n’aurait pas été plus bête. Elle venait de le confesser comme un enfant, lui qui depuis deux mois cherchait à la faire parler, sans tirer d’elle autre chose que de beaux rires. » Cela permet à Zola de nous fourguer ce bel autoportrait de Rougon : « C’est mon histoire que vous voulez ? dit-il. Rien de plus facile à conter. Mon grand-père vendait des légumes. Moi, jusqu’à trente-huit ans, j’ai traîné mes savates de petit avocat au fond de ma province. J’étais un inconnu hier. Je n’ai pas comme notre ami Kahn usé mes épaules à soutenir les gouvernements. Je ne sors pas comme Béjuin de l’École polytechnique. Je ne porte ni le beau nom du petit Escorailles ni la belle figure de ce pauvre Combelot. Je ne suis pas aussi bien apparenté que La Rouquette qui doit son siège de député à sa sœur, la veuve du général de Llorentz, aujourd’hui dame du palais. Mon père ne m’a pas laissé comme à Delestang cinq millions de fortune, gagnés dans les vins. Je ne suis pas né sur les marches d’un trône, ainsi que le comte de Marsy, et je n’ai pas grandi pendu à la jupe d’une femme savante, sous les caresses de Talleyrand. Non, je suis un homme nouveau, je n’ai que mes poings… » Arrive alors « le vieux M. de Plouguern […] soixante-dix ans », député légitimiste sous Louis-Philippe, rallié à l’Empire. Il a une vieille liaison avec la Comtesse : « Une histoire voulait que Clorinde fût sa fille ; mais ni lui ni la comtesse n’en savaient réellement rien ». Le vieux député et Rougon s’exclament d’admiration à propos du portrait de Clorinde, que le narrateur a malicieusement classé comme « une Diane à mettre sur une boîte de pastilles » ; cela donne un excellent dialogue sur la peinture où les deux rivalisent de ringardise : « Il en vint à déclarer que la couleur le laissait assez froid ; un beau dessin le satisfaisait pleinement, un dessin qui fût capable d’élever et d’inspirer de grandes pensées. Quant à M. de Plouguern, il n’aimait que les anciens ; il avait visité tous les musées de l’Europe, il ne comprenait pas qu’on eût assez de hardiesse pour oser peindre encore ». Puis comme le vieux député écrase par mégarde un chapelet offert par le pape à Clorinde et que celle-ci se met à pleurer, Rougon, qui « était d’une irréligion déplorable », vitupère la religion, ce qui exaspère le vieux légitimiste : « comme le grand homme continuait à lancer des phrases toutes faites sur l’influence détestable du clergé, sur l’éducation déplorable des femmes catholiques, sur l’abaissement de l’Italie livrée aux prêtres, il déclara de sa voix sèche : “La religion fait la grandeur des États“. » […] “Ne me parlez pas de votre empire ! finit-il par crier. C’est un fils bâtard de la révolution… Oh ! nous le savons, votre empire rêve l’humiliation de l’Église. Mais nous sommes là, nous ne nous laisserons pas égorger comme des moutons…“ ».
Chapitre IV. Il s’agit de la scène du baptême du Prince impérial, que Zola utilise pour continuer à présenter la bande. Gilquin cornaque les Charbonnel en se faisant abondamment rincer la glotte et emplir la panse. Il termine ivre et fait un scandale, interpelle Rougon qu’il voit passer, le plus indiscrètement possible (« “Ah ! le lâcheur, c’est parce qu’il a de l’or sur son paletot, maintenant ! Ça n’empêche pas, mon gros, que tu aies emprunté plus d’une fois les bottes de Théodore !” »), mais Rougon interviendra quand même discrètement pour empêcher son interpellation. Gilquin semble très informé, ce qui nous permet d’en apprendre de belles, qui montrent que les tares de la politique actuelle ne sont pas nouvelles : « Le Corps législatif avait voté quatre cent mille francs ; mais c’était une misère, car un palefrenier des Tuileries lui avait affirmé, la veille, que le cortège seul coûterait près de deux cent mille francs ». La sortie de la messe est utilisée pour chercher à caser Rougon avec une femme à qui il fait des amabilités : « “Tenez, dit le colonel en baissant la voix, voilà la femme qu’il faudrait à Rougon. — Parfaitement, approuva M.Bouchard. Fortune convenable, bonne famille, femme d’ordre et d’expérience. Il ne trouvera pas mieux.” Mais Du Poizat se récria. La demoiselle était mûre comme une nèfle qu’on a oubliée sur de la paille. Elle avait au moins trente-six ans et elle en paraissait bien quarante. Un joli manche à balai à mettre dans un lit ! »
Chapitre V. Rougon s’ennuie dans l’inaction, et Clorinde en profite pour le circonvenir de ses charmes. Belle scène décisive où la belle Italienne visite le vieux garçon en son hôtel de la rue Marbeuf : « Quand l’empereur lui avait fait cadeau de cet hôtel, il devait épouser une dame veuve, choisie par Sa Majesté elle-même. Mais la dame était morte. Maintenant, il resterait garçon ». Rougon est prêt à tout pour sauter sur l’occasion et sur Clorinde : « Vous savez bien que je suis le plus soumis de vos esclaves… » Rougon explique lucidement son tempérament à Clorinde : « Quand le sang lui montait à la tête, parbleu ! il était comme tous les hommes, il aurait crevé une cloison d’un coup d’épaule, pour entrer dans une alcôve. Il n’aimait pas à s’attarder aux bagatelles de la porte. Puis, lorsque c’était fini, il redevenait bien tranquille ». C’est un véritable « duel » d’orgueil, résumé dans cet alexandrin : « Leur orgueil se battait plus encore que leurs sens ». On cause littérature, et Zola glisse une allusion à Madame Bovary : « Rougon, à son tour, tonnait contre les livres. Il venait de paraître un roman, surtout, qui l’indignait : une œuvre de l’imagination la plus dépravée, affectant un souci de la vérité exacte, traînant le lecteur dans les débordements d’une femme hystérique » […] « “les romanciers de nos jours ont adopté un style lubrique, une façon de dire les choses qui les font vivre devant vous. Ils appellent ça de l’art. C’est de l’inconvenance, voilà tout.” Rougon défie Clorinde de se rendre à l’écurie, où il tente de la prendre à la hussarde (comme plus tard ce sera la coutume populaire dans Germinal ou La Terre, mais on ne s’y attendrait pas dans la haute !), mais la belle se défend avec sa cravache, dans une scène que Marc Dorcel n’aurait pas reniée, une des plus belles scènes érotiques du roman français :
« Rougon, affolé, effrayant, la face pourpre, se ruait avec un souffle haletant de taureau échappé. Elle-même, heureuse de taper sur cet homme, avait dans les yeux une lueur de cruauté qui s’allumait. Muette à son tour, elle quitta le mur, elle s’avança superbement au milieu de l’écurie ; et elle tournait sur elle-même, multipliant les coups, le tenant à distance, l’atteignant aux jambes, aux bras, au ventre, aux épaules ; tandis que, stupide, énorme, il dansait, pareil à une bête sous le fouet d’un dompteur. Elle tapait de haut, comme grandie, fière, les joues pâles, gardant aux lèvres un sourire nerveux. Pourtant, sans qu’elle le remarquât, il la poussait au fond, vers une porte ouverte qui donnait sur une seconde pièce, où l’on serrait une provision de paille et de foin. Puis, comme elle défendait sa cravache, dont il faisait mine de vouloir s’emparer, il la saisit aux hanches, malgré les coups, et l’envoya rouler sur la paille, à travers la porte, d’un tel élan, qu’il y vint tomber à côté d’elle. Elle ne jeta pas un cri. À toute volée, de toutes ses forces, elle lui cravacha la figure, d’une oreille à l’autre.
“Garce !” cria-t-il.
Et il lâcha des mots orduriers, jurant, toussant, étranglant. Il la tutoya, il lui dit qu’elle avait couché avec tout le monde, avec le cocher, avec le banquier, avec Pozzo. Puis, il demanda :
“Pourquoi ne voulez-vous pas avec moi ?”
Elle ne daigna pas répondre. Elle était debout, immobile, la face toute blanche, dans une tranquillité hautaine de statue.
“Pourquoi ne voulez-vous pas ? répéta-t-il. Vous m’avez bien laissé prendre vos bras nus… Dites-moi seulement pourquoi vous ne voulez pas.”
Elle restait grave, supérieure à l’injure, les yeux ailleurs.
“Parce que”, dit-elle enfin.
Et, le regardant, elle reprit, au bout d’un silence :
“Épousez-moi… Après, tout ce que vous voudrez.” Il eut un rire contraint, un rire bête et blessant, qu’il accompagna d’un refus de la tête.
“Alors, jamais ! s’écria-t-elle, entendez-vous, jamais, jamais !” ».
Il faut quelques jours à Rougon pour se calmer, mais conformément à son autoportrait, sa fureur est partie, et à la grande surprise de Clorinde, il vient lui proposer Delestang en mariage. Dépitée, elle finit par accepter (sans aucun délai de réflexion), mais formule des menaces voilées : « Elle n’avait pas la vengeance puérile, elle rêvait déjà de l’écraser par quelque triomphe d’apothéose. En rentrant dans le cabinet, elle se surprit à dire, à demi-voix : “Ah ! tant pis ! tous les chemins mènent à Rome.” » Rougon n’a guère de mal à convaincre son ami d’épouser Clorinde, et souffre à peine quand il comprend qu’elle s’est donnée à « cet imbécile » avant même le mariage. Du coup Rougon décide de se marier avec le « manche à balai », avec des motivations très romantiques : « Depuis trois mois, on le persécutait, on lui prouvait qu’un homme dans sa position devait être marié. Il riait, il ajoutait que, lorsqu’il recevait ses intimes, le soir, il n’y avait seulement pas une femme chez lui, pour verser le thé »
Chapitre VI. Rougon reçoit désormais en homme marié : « Sa femme le ravissait. Depuis longtemps, il avait l’envie d’un intérieur bourgeois, qui fût comme une preuve matérielle de sa probité ». Le portrait du héros à ce moment du récit constitue une excellente lecture analytique sur le thème du personnage de roman en classe de première :
Pendant les premiers mois, Rougon s’enferma, se recueillant, se préparant aux luttes qu’il rêvait. C’était, chez lui, un amour du pouvoir pour le pouvoir, dégagé des appétits de vanité, de richesses, d’honneurs. D’une ignorance crasse, d’une grande médiocrité dans toutes les choses étrangères au maniement des hommes, il ne devenait véritablement supérieur que par ses besoins de domination. Là, il aimait son effort, il idolâtrait son intelligence. Être au-dessus de la foule où il ne voyait que des imbéciles et des coquins, mener le monde à coups de trique, cela développait dans l’épaisseur de sa chair un esprit adroit, d’une extraordinaire énergie. Il ne croyait qu’en lui, avait des convictions comme on a des arguments, subordonnait tout à l’élargissement continu de sa personnalité. Sans vice aucun, il faisait en secret des orgies de toute-puissance. S’il tenait de son père la carrure lourde des épaules, l’empâtement du masque, il avait reçu de sa mère, cette terrible Félicité qui gouvernait Plassans, une flamme de volonté, une passion de la force, dédaigneuse des petits moyens et des petites joies ; et il était certainement le plus grand des Rougon.
Quand il se trouva ainsi seul, inoccupé, après des années de vie active, il éprouva d’abord un sentiment délicieux de sommeil. Depuis les chaudes journées de 1851, il lui semblait qu’il n’avait pas dormi. Il acceptait sa disgrâce comme un congé mérité par de longs services. Il pensait rester six mois à l’écart, le temps de choisir un meilleur terrain, puis rentrer à son gré dans la grande bataille. Mais, au bout de quelques semaines, il était déjà las de repos. Jamais il n’avait eu une conscience si nette de sa force ; maintenant qu’il ne les employait plus, sa tête et ses membres le gênaient ; et il passait ses journées à se promener, au fond de son étroit jardin, avec des bâillements formidables, pareil à un de ces lions mis en cage, qui étirent puissamment leurs membres engourdis. Alors, commença pour lui une odieuse existence, dont il cacha avec soin l’ennui écrasant ; il était bonhomme, il se disait bien content d’être en dehors du “gâchis” ; seules ses lourdes paupières se soulevaient parfois, guettant les événements, retombant sur la flamme de ses yeux, dès qu’on le regardait. Ce qui le tint debout, ce fut l’impopularité dans laquelle il se sentait marcher. Sa chute avait comblé de joie bien du monde. Il ne se passait pas un jour, sans que quelque journal l’attaquât ; on personnifiait en lui le coup d’État, les proscriptions, toutes ces violences dont on parlait à mots couverts ; on allait jusqu’à féliciter l’empereur de s’être séparé d’un serviteur qui le compromettait. Aux Tuileries, l’hostilité était plus grande encore ; Marsy triomphant le criblait de bons mots, que les dames colportaient dans les salons. Cette haine le réconfortait, l’enfonçait dans son mépris du troupeau humain. On ne l’oubliait pas, on le détestait, et cela lui semblait bon. Lui seul contre tous, c’était un rêve qu’il caressait ; lui seul, avec un fouet, tenant les mâchoires à distance. Il se grisa des injures, il devint plus grand, dans l’orgueil de sa solitude ».
Les fidèles remâchent leurs déceptions. Kahn s’est vu retirer sa candidature aux élections. Du Poizat, emporté par sa colère, se prétend républicain : « C’est une honte d’avoir une presse comme la nôtre, bâillonnée, menacée d’être étranglée au premier cri. Un de mes amis, qui publie un roman, a été appelé au ministère, où un chef de bureau l’a prié de changer la couleur du gilet de son héros, parce que cette couleur déplaisait au ministre. Je n’invente rien.” » La cacophonie règne : « ils établissaient des nuances énormes, se cantonnaient chacun dans des opinions particulières, difficiles à définir ; si bien qu’au bout de dix minutes toute la société était passée à l’opposition », ce qui n’empêche pas les petites intrigues, comme les cornes qu’on plante dans le dos de M. Bouchard : « Mme Bouchard semblait dormir, assoupie par la chaleur. M. d’Escorailles était venu la retrouver. Puis, comme personne ne les regardait, il eut la tranquille audace de poser un long baiser silencieux sur ses lèvres à demi closes ». Ou la jalousie à retardement de Rougon : « Ce frisson persistant de jalousie était tout ce qui restait dans sa chair de son ancienne passion. Il poussait les choses jusqu’à la faire surveiller, dans les salons où elle se rendait. S’il s’était aperçu de la moindre intrigue, il eût peut-être averti le mari. D’ailleurs, quand il voyait celui-ci en particulier, il le mettait en garde, lui parlait de l’extraordinaire beauté de sa femme. Mais Delestang riait d’un air de confiance et de fatuité ; si bien que, dans le ménage, c’était Rougon qui avait tous les tourments de l’homme trompé ». C’est qu’il faut quand même cadrer Clorinde : « Rougon pourtant obtint de Clorinde qu’elle s’habillât à peu près comme tout le monde. Elle était très fine, d’ailleurs, de cette finesse des fous lucides qui se font raisonnables en présence des étrangers », et leurs liens se resserrent : « Et lui, souvent, oubliait à qui il parlait, exposait son système de gouvernement, s’engageait dans les aveux les plus nets. Peu à peu, ces conversations devinrent une habitude ; il la prit pour confidente ». Rougon semble abandonner l’idée d’un retour au pouvoir, et se lance dans un projet utopique de fondation d’une ville dans les Landes. C’est à ce moment qu’il reçoit une invitation à Compiègne.
Chapitre VII. Voici le chapitre pour lequel Zola a dû consulter Flaubert qui avait eu l’occasion d’observer les fastes de la cour. On remarque l’importance de la répartition égale des sexes pour l’étiquette : « Les hommes se penchaient, disaient un mot, puis se redressaient, dans le secret chatouillement de vanité de cette marche triomphale ; les dames, les épaules nues, trempées de clartés, avaient une douceur ravie ; et, sur les tapis, les jupes traînantes, espaçant les couples, donnaient une majesté de plus au défilé, qu’elles accompagnaient de leur murmure d’étoffes riches ». La partie qui se joue est de l’ordre du billard à plusieurs bandes. Clorinde drague ostensiblement de Marsy, dans le but de pousser son amante jalouse Mme de Llorentz à remettre à l’empereur des lettres dans lesquelles de Marsy se moque de lui : « Clorinde, justement, venait d’abandonner sa main gauche à M. de Marsy, sous prétexte de lui montrer un camée antique, qu’elle avait au doigt ; et elle laissa sa main, le comte prit la bague, la remit ; ce fut presque indécent. Mme de Llorentz, qui jouait nerveusement avec une cuiller, cassa son verre à bordeaux, dont un domestique enleva vivement les éclats ». En parallèle, Rougon est invité à jouer au palet par Sa Majesté, et s’en sort bien, mais Clorinde veille au grain : « Elle lui souffla à l’oreille, au moment où il allait ramasser ses palets : “J’espère que vous n’allez pas gagner.” » En parallèle toujours, Delestang bénéficie de l’estime de l’empereur, qui se pique de socialisme : « Et l’empereur parla culture, élevage, engrais, lentement, par monosyllabes. Depuis sa visite à la Chamade, il tenait Delestang en grande estime. Il louait surtout celui-ci d’avoir tenté pour le personnel de sa ferme un essai de vie en commun, avec tout un système de partage de certains bénéfices et de caisse de retraite ». Une vision nocturne du palais par Rougon permet un exposé de l’état d’esprit de l’empereur, assez contraire, finalement, à ce qu’il s’apprête à demander à Rougon : « Peut-être, maintenant, l’empereur songeait-il au défrichement d’un coin des Landes, à la fondation d’une ville ouvrière, où l’extinction du paupérisme serait tentée en grand. Souvent, il se décidait la nuit. C’était la nuit qu’il signait des décrets, écrivait des manifestes, destituait des ministres. Cependant, peu à peu, Rougon souriait ; il se rappelait invinciblement une anecdote, l’empereur en tablier bleu, coiffé d’un bonnet de police fait d’un morceau de journal, collant du papier à trois francs le rouleau dans une pièce de Trianon, pour y loger une maîtresse ». Les choses semblent bien tourner pour Rougon, puisque l’empereur, qui écoute vaguement ses projets sur les Landes, semble indiquer qu’il songe à lui pour autre chose : « “Il faut rester à Paris, monsieur Rougon.” ».
Chapitre VIII. C’est le chapitre des intrigues pour profiter de l’embellie et cueillir le succès. C’est un travail d’équipe : « Ce fut un travail énorme. Chacun prit un rôle. L’entente eut lieu à demi-mots, chez Rougon lui-même, dans les coins, le dimanche et le jeudi. On se partageait les missions difficiles. On se lançait tous les jours au milieu de Paris, avec la volonté entêtée de conquérir une influence. On ne dédaignait rien ; les plus petits succès comptaient. On profitait de tout, on tirait ce qu’on pouvait des moindres événements, on utilisait la journée entière, depuis le bonjour du matin jusqu’à la dernière poignée de main du soir. Les amis des amis devinrent complices, et encore les amis de ceux-là. Paris entier fut pris dans cette intrigue. Au fond des quartiers perdus, il y avait des gens qui soupiraient après le triomphe de Rougon, sans savoir au juste pourquoi. La bande, dix à douze personnes, tenait la ville. » Le narrateur suggère à demi-mots que Mme Bouchard et Mme Correur usent de leurs charmes : « Mme Correur habitait maintenant deux appartements, l’un rue Blanche, l’autre rue Mazarine ; ce dernier était très coquet ; Mme Bouchard y venait l’après-midi, prenait la clef chez la concierge ». Clorinde également, mais à un plus haut niveau : « Elle se gardait comme un argument irrésistible. Pour elle, se donner ne tirait pas à conséquence. Elle y mettait si peu de plaisir, que cela devenait une affaire pareille aux autres, un peu plus ennuyeuse peut-être. » Bougon, Rougon se fâche parfois, mais Zola, qui prépare ses effets, commence à nous le faire aimer par le défaut de sa cuirasse, son attachement sincère à ses amis : « Pourtant ces familiers, qu’il tenait en si médiocre estime, il avait le besoin de les voir, de régner sur eux ; un besoin de maître jaloux, pleurant en secret les moindres infidélités. Même, au fond de son cœur, il était attendri par leur sottise, il aimait leurs vices. » On arrive à une longue scène très réussie, une journée entière où Rougon rencontre les uns après les autres tous ses amis, chacun lui demandant une faveur ou un soutien, qu’il promet tout en enrageant de ne pas savoir comment faire. Cela culmine avec Gilquin qui a surpris une conspiration pour attenter à la vie de l’empereur. Rougon hésite, puis n’ose pas avertir la police, et finalement, l’attentat d’Orsini a bien lieu ; l’empereur en réchappe, et dix jours plus tard, Rougon est nommé ministre de l’Intérieur.
Chapitre IX. C’est le triomphe de Rougon, enfin dans son élément : « Dans la poussée des hommes du Second Empire, Rougon affichait depuis longtemps des opinions autoritaires. Son nom signifiait répression à outrance ; refus de toutes les libertés, gouvernement absolu. Aussi personne ne se trompait-il, en le voyant au ministère. Cependant, à ses intimes, il faisait des aveux ; il avait des besoins plutôt que des opinions ; il trouvait le pouvoir trop désirable, trop nécessaire à ses appétits de domination, pour ne pas l’accepter, sous quelque condition qu’il se présentât. Gouverner, mettre son pied sur la nuque de la foule, c’était là son ambition immédiate ; le reste offrait simplement des particularités secondaires, dont il s’accommoderait toujours. Il avait l’unique passion d’être supérieur. Seulement, à cette heure, les circonstances dans lesquelles il rentrait aux affaires, doublaient pour lui la joie du succès ; il tenait de l’empereur une entière liberté d’action, il réalisait son ancien désir de mener les hommes à coups de fouet, comme un troupeau. Rien ne l’épanouissait davantage que de se sentir détesté ». On sent que Zola s’identifie à son personnage, lui qui n’a jamais craint d’être détesté par une certaine critique, ou une partie de l’opinion. Rougon se dévoue corps et âme à sa bande, se compromet pour exaucer tous leurs désirs : « Il oubliait ses mépris secrets, en arrivait à les trouver très intelligents, très forts, à son image. Il voulait surtout qu’on le respectât en eux, il les défendait avec emportement, comme il aurait défendu les dix doigts de ses mains. Leurs querelles étaient les siennes. […] Et, sans besoins lui-même, il taillait à la bande de belles proies, il goûtait à la combler la joie personnelle d’agrandir autour de lui l’éclat de sa fortune. » Le chapitre se déroule dans le cabinet de Rougon, où tous ses amis ont leurs entrées, et défilent à la barbe des préfets et autres visiteurs, qui font antichambre des heures durant. Il est question d’un feuilleton publié dans un journal : “Le feuilleton est encore plus odieux. Il s’agit d’une femme bien élevée qui trompe son mari. Le romancier ne lui donne pas même des remords.” » Nouvelle allusion à Madame Bovary ? Les amis comblés de faveurs ont tourné leur veste : « Maintenant, toute la bande était bonapartiste avec passion ». Rougon tire même de l’orgueil d’afficher ses amitiés de Plassans avec les Charbonnel : « Alors, il haussa la voix, rudement : “Écrivez-moi, n’est-ce pas ? Vous savez combien je vous suis dévoué… Et quand vous serez à Plassans, dites à ma mère que je me porte bien.” Il traversa l’antichambre, les accompagna jusqu’à l’autre porte, pour les imposer à tout ce monde, sans aucune honte d’eux, tirant un grand orgueil d’être parti de leur petite ville et de pouvoir aujourd’hui les mettre aussi haut qu’il lui plaisait. » On remarque que Zola a omis de revenir dans ce volume sur les interventions discrètes de Rougon dans les affaires de Plassans ou dans celles d’Aristide Saccard, ce qui aurait resserré les nœuds entre les Rougon-Macquart. Peut-être voulait-il insister sur l’isolement de son héros ? Recevant Clorinde en particulier, il a un retour de désir qu’elle punit à sa façon : « Et, comme il enfonçait les mains, elle lui posa sur le front le bout embrasé de sa cigarette. Il recula en poussant un cri, voulut de nouveau se précipiter sur elle. » Recevant enfin de directeur du journal, Rougon revient sur le feuilleton : « “Il faut absolument qu’elle ait des remords !… Exigez de l’auteur qu’il lui donne des remords !” »
Chapitre X. Voici maintenant un séjour en province, dans les Deux-Sèvres, histoire de soutenir la petite bande. Chacun défile à nouveau pour demander de nouvelles faveurs, jusqu’à Mme Correur qui s’est réconciliée in extremis avec son beau-frère notaire, Martineau, fieffé républicain qu’elle veut sauver de la rigueur des arrestations que Rougon est mandaté pour faire exécuter. L’homme est tellement compromis que tout ce que Rougon peut faire est de demander à Gilquin, devenu « commissaire central » de l’arrêter avec des égards, demande qui scandalise Gilquin, qui se croit irréprochable en la matière : « ”Demande à Du Poizat l’histoire de ce pharmacien que j’ai arrêté au lit, avant-hier. Il y avait, dans le lit, la femme d’un huissier. Personne n’a rien su… J’agis toujours en homme du monde.” ». Rougon, en politicien moderne, se fait souffler par Du Poizat, qu’il a nommé préfet, les informations qui lui permettront d’avoir l’air au courant de tout, de pouvoir adresser à chaque sommité locale un petit mot attentionné. La scène clé du chapitre est l’inauguration des travaux de la ligne de chemin de fer, une scène qui rivalise avec les « comices » de Bovary. On relève de beaux passages qui permettront de faire appréhender aux élèves les aspects non-langagiers de l’argumentation : « Il se tenait à trois pas de Rougon, debout tous les deux ; et, à certaines chutes de phrases cadencées, ils inclinaient légèrement la tête l’un vers l’autre. […] Par moments, sa voix se perdait dans le plein air. Alors, on ne voyait plus que ses gestes, un mouvement régulier de son bras droit ; et le millier de curieux étagés sur le coteau s’intéressaient aux broderies de sa manche, dont l’or luisait dans un coup de soleil. Ensuite, M. Kahn s’avança au milieu de la tente. Lui, avait la voix très grosse. Il aboyait certains mots. Le fond du vallon formait écho et renvoyait les fins de phrase sur lesquelles il appuyait trop complaisamment ». L’arrestation de Martineau est un fiasco complet, et l’homme malade finit par mourir avant d’être incarcéré, un fait qui contribuera à la chute de Rougon, victime d’une sorte de scoumoune dans sa confiance aveugle en ses amis. Un concours de circonstances pousse Gilquin, très impatient de danser avec l’épouse du proviseur, à précipiter cette arrestation en dépit de sa promesse d’épargner la santé de l’homme. Le bal se poursuit nonobstant la mort de cet homme néfaste à la carrière de Rougon, lequel est symboliquement bousculé par la joie de son ami qui va contribuer à sa chute : « Mais un couple surtout soulevait un murmure d’admiration, le commissaire central et la femme du proviseur galamment enlacés, tournant avec lenteur ; il s’était hâté d’aller faire une toilette correcte, habit noir, bottes vernies, gants blancs ; et la jolie blonde lui avait pardonné son retard, pâmée à son épaule, les yeux noyés de tendresse. Gilquin accentuait les mouvements des hanches, en rejetant en arrière son torse de beau danseur de bals publics, pointe canaille dont le haut goût ravissait la galerie. Rougon, que le couple faillit bousculer, dut se coller contre un mur, pour le laisser passer, dans un flot de tarlatane étoilée d’or. »
Chapitre XI. Une étape dans la chute de Rougon : pilotée par Clorinde, Delestang, qui a « obtenu […] le portefeuille de l’Agriculture et du Commerce », discute en plein conseil les opinions de son ami, et lui vole la vedette auprès de l’empereur au sujet d’un livre de colportage que Rougon conseille longuement, au nom de sa politique autoritaire, d’interdire : « Rougon lâché par Delestang, auquel il avait fait donner un portefeuille, uniquement pour s’appuyer sur lui, au milieu de la sourde hostilité du conseil ! » Suit un bel exposé de la profession de foi de Rougon, honnêtement rendue par le narrateur, qui ne tombe pas dans la caricature : « La liberté sans entraves est impossible dans un pays où il existe une faction obstinée à méconnaître les bases fondamentales du gouvernement. Il faudra de bien longues années pour que le pouvoir absolu s’impose à tous, efface des mémoires le souvenir des anciennes luttes, devienne indiscutable au point de se laisser discuter. [1] En dehors du principe autoritaire appliqué dans toute sa rigueur, il n’y a pas de salut pour la France. Le jour où Votre Majesté croira devoir rendre au peuple la plus inoffensive des libertés, ce jour-là elle engagera l’avenir entier. Une liberté ne va pas sans une deuxième liberté, puis une troisième liberté arrive, balayant tout, les institutions et les dynasties. C’est la machine implacable, l’engrenage qui pince le bout du doigt, attire la main, dévore le bras, broie le corps… » […] « Quand à la presse, sire, elle change la liberté en licence. Depuis mon entrée au ministère, je lis attentivement les rapports, je suis pris de dégoût chaque matin. La presse est le réceptacle de tous les ferments nauséabonds. Elle fomente les révolutions, elle reste le foyer toujours ardent où s’allument les incendies. Elle deviendra seulement utile, le jour où l’on aura pu la dompter et employer sa puissance comme un instrument gouvernemental… ». Pris à part après le conseil, Rougon, à qui l’empereur reproche la mort de Martineau ou les couacs du financement de la ligne de chemin de fer de Kahn, soutient mordicus ses amis : « “Voyons, accordez-moi la destitution de M. Du Poizat et promettez-moi d’abandonner les autres.” Rougon était resté impassible. Il s’inclina, il dit d’un accent profond : “Sire, je demande au contraire à Votre Majesté le ruban d’officier pour le préfet des Deux-Sèvres… J’ai également plusieurs faveurs à solliciter…” » Clorinde obtient davantage de succès : « Mais Sa Majesté se montra si galante pour la jeune femme, il la serra bientôt de si près, le cou allongé, l’œil oblique, que Leurs Excellences jugèrent discret de s’écarter peu à peu. »
Chapitre XII. Clorinde attire tout Paris dans son salon de rapiate où elle ne sert que de l’eau sucrée, et fomente la chute de Rougon en encourageant les défections de la bande : « Avant les ambassades, sans qu’on devinât par quelle voie, elle recevait les nouvelles, des rapports détaillés, dans lesquels se trouvaient annoncées les moindres pulsations de la vie des gouvernements. Aussi avait-elle une cour, des banquiers, des diplomates, des intimes, qui venaient pour tâcher de la confesser » Rougon est désormais non plus le « grand », mais « le gros homme », et la scène est un véritable feu d’artifice d’ingratitude, où chacun se déchaîne à cracher sur celui qui lui a tout donné : « Clorinde ne se donnait même plus la peine de les exciter ; ils apportaient toujours quelques nouveaux griefs, mécontents, jaloux, aigris de tout ce que Rougon avait fait pour eux, travaillés par une intense fièvre d’ingratitude. » Cela va jusqu’à retourner la charge : « Rougon est un ingrat. Vous vous souvenez du temps où nous battions tous le pavé de Paris pour le pousser au ministère. » Il y a même un effet farce, lorsque M. Bouchard se plaint que Rougon lui a refusé la promotion de Duchesne, « un des employés de ma division », alors que nous avons su dans le chapitre précédent que son épouse le trompait et trompait son amant d’Escorailles avec ledit Duchesne, pour lequel elle n’avait pas craint de quêter la faveur de Rougon, une des rares choses qu’il ait refusée ! Delestang fait mine de soutenir son ami, mais les flatteries ont raison de lui : « Mme Correur et Mme Bouchard, à demi-voix, le trouvaient beau ; la seconde surtout, avec le goût pervers des femmes pour les hommes chauves, regardait passionnément son crâne nu. » Il est montré comme un pantin à la main de sa femme : « Delestang se montrait d’ailleurs d’une obéissance absolue. Il saluait, souriait, se fâchait, disait noir, disait blanc, selon la ficelle qu’elle avait tirée. Dès qu’il n’était plus monté, il revenait de lui même se remettre entre ses mains, pour qu’elle l’accommodât. » Clorinde monte en puissance auprès de l’empereur : « la puissance de Clorinde grandissait. On causait à voix basse du vif caprice que Sa Majesté éprouvait pour elle. Dans les bals, aux réceptions officielles, partout où l’empereur la rencontrait, il tournait autour de ses jupes de son pas oblique, lui regardait dans le cou, lui parlait de près, avec un lent sourire. Et, disait-on, elle n’avait encore rien accordé, pas même le bout des doigts. » Enfin est annoncé le faux pas de Rougon qui va précipiter sa chute : pour complaire aux Charbonnel, il a ordonné « une visite domiciliaire » au couvent des sœurs que ceux-ci soupçonnent d’avoir volé l’argenterie de l’héritage qu’ils ont réussi à sauver grâce à Rougon. Or cette descente dans un couvent est grossie comme un blasphème terrible, de façon à couler Rougon.
Chapitre XIII. Sentant monter la fronde, « Pour faire taire ses ennemis et asseoir son pouvoir solidement, [Rougon] imagina d’offrir sa démission, en termes très dignes ». Il décide de se rendre à une fête de charité de la haute société, pour braver les regards de ses ennemis. C’est au sein d’une scène bouffonne qu’il apprendra que Sa Majesté accepte sa démission, essuyant pas là-même les moqueries à peine voilées de Clorinde. Les dames patronnesses donnent d’elles-mêmes pour le succès de la vente : « C’était une princesse qui tenait une des boutiques de joujoux ; en face, une marquise vendait des porte-monnaie de vingt-neuf sous, qu’elle ne lâchait pas à moins de vingt francs ; toutes deux rivales, mettant le triomphe de leur beauté dans la plus grosse recette, raccrochaient les pratiques, appelaient les hommes, demandaient des prix impudents, puis, après des marchandages furieux de bouchères voleuses, donnaient un peu d’elles, le bout de leurs doigts, la vue de leur corsage largement ouvert, par-dessus le marché, pour décider les gros achats. » Clorinde s’affiche en putain impériale, dans une scène qu’on a peine à croire tant Zola semble surenchérir avec les tableaux précédents pour y flirter avec son contemporain Leopold von Sacher-Masoch : « Alors, il lui vit un bijou original qu’il ne lui connaissait pas. C’était, à son cou nu, sur ses épaules nues, un collier de chien, un vrai collier de chien en velours noir, avec la boucle, l’anneau, le grelot, un grelot d’or dans lequel tintait une perle fine. Sur le collier se trouvaient écrits en caractères de diamants deux noms, aux lettres entrelacées et bizarrement tordues. Et, tombant de l’anneau, une grosse chaîne d’or battait le long de sa poitrine, entre ses seins, puis remontait s’attacher sur une plaque d’or, fixée au bras droit, où on lisait : J’appartiens à mon maître. […] Elle avait voulu ce servage. Elle l’affichait avec une sérénité d’impudeur qui la mettait au-dessus des fautes banales, honorée d’un choix princier, jalousée de toutes. Quand elle s’était montrée, le cou serré dans ce collier, sur lequel des yeux perçants de rivales prétendaient lire un prénom illustre mêlé au sien, toutes les femmes avaient compris, échangeant des coups d’œil, comme pour se dire : C’est donc fait ! Depuis un mois, le monde officiel causait de cette aventure, attendait ce dénouement. Et c’était fait, en vérité ; elle le criait elle-même, elle le portait écrit sur l’épaule. S’il fallait en croire une histoire chuchotée d’oreille à oreille, elle avait eu pour premier lit, à quinze ans, la botte de paille où dormait un cocher, au fond d’une écurie. Plus tard, elle était montée dans d’autres couches, toujours plus haut, des couches de banquiers, de fonctionnaires, de ministres, élargissant sa fortune à chacune de ses nuits. Puis, d’alcôve en alcôve, d’étape en étape, comme apothéose, pour satisfaire une dernière volonté et un dernier orgueil, elle venait de poser sa belle tête froide sur l’oreiller impérial. » [2] Elle tient son double triomphe, être montée dans le lit de l’empereur, et se faire payer par le ministère de Rougon offert à son cocu ; elle n’a pas le triomphe modeste : « “Voyez-vous, mon cher, je vous l’ai dit souvent, vous avez tort de mépriser les femmes. Non, les femmes ne sont pas les bêtes que vous pensez. Ça me mettait en colère, de vous entendre nous traiter de folles, de meubles embarrassants, que sais-je encore ? de boulets au pied… » Pour exciter encore plus sa jalousie, elle vend un de ses baisers à un étranger richissime pour cent mille francs, et atteint son but : « Alors, cet homme chaste, qui avait reçu sans plier le coup de massue de sa disgrâce, souffrit beaucoup du collier qu’elle portait si effrontément. Elle se penchait davantage, le provoquait, roulait son cou. La perle fine tintait dans le grelot d’or ; la chaîne pendait, comme tiède encore de la main du maître ; les diamants luisaient sur le velours, où il épelait aisément le secret connu de tous. Et jamais il ne s’était senti à ce point mordu par la jalousie inavouée, cette brûlure d’envie orgueilleuse, qu’il avait éprouvée parfois en face de l’empereur tout-puissant. Il aurait préféré Clorinde au bras de ce cocher, dont on parlait à voix basse. » Les détails sont piquants, puisque Delestang semble très conciliant dans son rôle de cocu, et de Marsy y participe pour retourner la manigance de Clorinde à Compiègne par laquelle il avait été évincé au profit de Rougon : « Delestang entra, au bras du comte de Marsy. Il courait sur ce dernier une histoire fort curieuse. À en croire certains chuchotements, il s’était rencontré avec Clorinde au château de Fontainebleau, la semaine précédente, uniquement pour faciliter les rendez-vous de la jeune femme et de Sa Majesté. Il avait mission d’amuser l’impératrice. D’ailleurs, cela paraissait piquant, rien de plus ; c’étaient de ces services qu’on se rend toujours entre hommes. » Rougon a au moins ce mérite, contrairement à ses amis qui l’ont tous trahi, à la seule exception émouvante de sa femme, qu’il ne renie pas ses idées : « “Oui, oui, la visite chez les religieuses… Mon Dieu, parmi toutes les bêtises que mes amis m’ont fait commettre, c’est peut-être la seule chose raisonnable et juste de mes cinq mois de pouvoir.” »
Chapitre XIV. Trois ans plus tard, le parlement se réunit pour une innovation libérale de l’empire, une « adresse » qui permet de répondre au discours du trône. Rougon a obtenu un nouveau poste : « ”L’empereur a fait un singulier choix, en le nommant ministre sans portefeuille et en le chargeant de défendre sa nouvelle politique.” ». Pour son premier discours, il doit répondre à un groupuscule de gauchistes : « Ils étaient cinq maintenant à attaquer l’empire. Ils l’ébranlaient d’une secousse continue, le niaient, lui refusaient leur vote, avec un entêtement de protestation, dont l’effet devait peu à peu soulever le pays entier. Ces députés se tenaient debout, groupe infime, perdu au milieu d’une majorité écrasante ; et ils répondaient aux menaces, aux poings tendus, à la pression bruyante de la Chambre sans un découragement, immobiles et fervents dans leur revanche. » Rougon mange son chapeau, et se fait le chantre de l’« idylle libérale », qu’il avait combattue de toutes ses forces trois ans plus tôt : « Il avait l’éloquence banale, incorrecte, toute hérissée de questions de droit, enflant les lieux communs, les faisant crever en coups de foudre. Il tonnait, il brandissait des mots bêtes. Sa seule supériorité d’orateur était son haleine, une haleine immense, infatigable, berçant les périodes, coulant magnifiquement pendant des heures, sans se soucier de ce qu’elle charriait ». L’ancien incroyant chante aussi les vertus de la foi : « Oui, messieurs, la foi est notre guide et notre soutien, dans cette tâche du gouvernement, si lourde parfois à porter ». Clorinde doit le saluer, « Lorsqu’il parut, rajeuni, comme allégé, ayant démenti en une heure toute sa vie politique, prêt à satisfaire, sous la fiction du parlementarisme, son furieux appétit d’autorité ».
– Une idée de film à étudier en parallèle au roman : un des rares films politiques français, Le Président d’Henri Verneuil, en noir & blanc avec Jean Gabin, Lino Ventura. Les séquences à la chambre entre autres sont des chefs-d’œuvre qu’on dirait inspirés du roman de Zola, bien qu’il s’agisse de l’adaptation d’un roman de… Georges Simenon !
Voir en ligne : Son Excellence Eugène Rougon sur Wikisource
© altersexualite.com, 2015
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Ces phrases seront reprises mot pour mot dans le chapitre de clôture, pour montrer que Rougon n’a pas tourné sa veste, mais qu’il a reconnu l’évolution du régime : « La liberté est devenue possible, le jour où a été vaincue cette faction qui s’obstinait à méconnaître les bases fondamentales du gouvernement. C’est pourquoi l’empereur a cru devoir retirer sa puissante main ; refusant les prérogatives excessives du pouvoir comme un fardeau inutile, estimant son règne indiscutable au point de le laisser discuter. »
[2] On songe aux colliers de Man Ray pour Lee Miller ; voir dans cette analyse de « La mort inutile ».
 altersexualite.com
altersexualite.com