Accueil > Classiques > Monsieur Nicolas, de Nicolas Rétif de La Bretonne (Première époque)
Une des premières autobiographies de la littérature française, pour lycéens et adultes
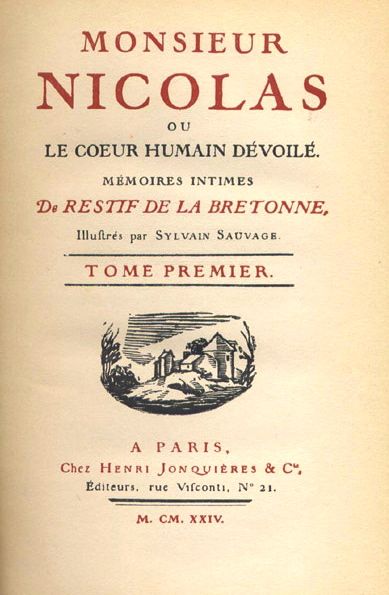 Monsieur Nicolas, de Nicolas Rétif de La Bretonne (Première époque)
Monsieur Nicolas, de Nicolas Rétif de La Bretonne (Première époque)
Gallimard, La Pléiade, 1989, Tome 1, 1600 p., 66,5 €.
samedi 1er septembre 2018
Nicolas Rétif de La Bretonne (1734-1806), que Wikipédia et la BNF s’obstinent à orthographier « Restif » avec un s, est un graphomane du XVIIIe siècle à la fois connu et méconnu. Écrivain paysan autodidacte, il a toujours gravité en marge des écrivains des Lumières, dont il était le cadet (il a 44 ans à la mort de Jean-Jacques Rousseau). Empêtré dans ses contradictions, il fut amateur de femmes, jusqu’au viol, et pratiqua le genre érotique, mais s’opposa à Sade, s’opposa à Rousseau qu’il admirait cependant, et dont la parution posthume des Confessions le poussa à entreprendre son propre projet d’autobiographie, mais une autobiographie pléthorique. À partir des 4e & 5e époques, son livre rivalise avec l’Histoire de ma vie, de Casanova, syphilis et prostituées incluses.
Je me suis toujours intéressé au personnage, d’abord parce que ce patronyme, bien que 25 fois plus fréquent que le mien si l’on en croit ce site, et pas du tout centré sur l’Yonne (le même site permet de vérifier que la graphie « Restif » est carrément centrée sur la Bretagne & ignorée dans l’Yonne), fut celui de membres de ma famille du côté grand-maternel, originaires de Joux-la-Ville, village natif du père de Rétif de la Bretonne. Impossible d’en dire plus faute de recherches généalogiques, vu le nombre de Rétif en France & dans l’Yonne (l’Yonne n’est que le 4e département pour le nombre de Rétif). Lors de mes études sorbonnagres, Le Paysan perverti fut à mon programme dans une matière de DEUG. Pour le reste, il est étonnant combien cet écrivain important est ignoré des manuels scolaires.
La lecture de Monsieur Nicolas, ou Le Cœur humain dévoilé paru en 1989 dans l’édition savante de la Pléiade par Pierre Testud (sans le sous-titre) fournit quelques pistes d’explication. La partie consacrée à l’enfance et à l’adolescence, bien plus développée que celle des Confessions de Rousseau, aurait pu faire un excellent classique scolaire pour les lycées si l’auteur avait enfumé ses expériences sexuelles précoces, qui font de son ouvrage quelque chose d’illisible aujourd’hui. Pensez : un gamin qui entre 11 & 15 ans couche & engrosse plusieurs filles ou femmes & s’en trouve heureux, et lui ne s’en plaignant pas façon « balance ta truie », cela entrerait à l’heure actuelle dans la catégorie « pédophilie » (enfin dans le sens femme-homme pour lequel persiste quelque indulgence impossible dans l’autre sens : voir la biographie macronienne). Qu’un(e) moins de quinze ans éprouve une satisfaction de nature sexuelle avec un(e) plus de quinze ans est désormais impensable pour la doxa bien-pensante, donc Rétif n’existera pas scolairement ; fermez le ban. Il existe cependant une très active Société Rétif de La Bretonne, pour les gens qui ne se contentent pas de la version rabougrie de l’histoire de la littérature. Une autre particularité de cet écrivain, et notamment pour le livre dont il est question dans cet article, est qu’il fut imprimeur de ses propres ouvrages. Comme Léo Ferré bien plus tard, il composa lui-même ses livres en partie parfois directement sur une presse installée à son domicile, de quoi défier la censure. En fait il anticipa de quelques mois, en février 1790, l’abolition des maîtrises et jurandes qui permit à partir d’août 1790, à tout individu d’imprimer. Ce simple fait ne devrait-il pas nous inciter à le lire davantage ? Dans mon expérience personnelle relatée dans un essai paru en 2005 et confirmée depuis, le simple fait de publier à compte d’auteur au XXIe siècle, vous fait éjecter de la sphère des lettres sans même se donner la peine de lire votre ouvrage. Il est impossible de percer si l’on n’a pas son entrée dans cette mafia. Rétif de la Bretonne est la preuve qu’un auteur qui se publia & s’imprima lui-même sans écouter les censeurs, peut être reconnu deux siècles après par les mêmes éditeurs qui rejettent avec dédain tout ce qui est l’œuvre d’un auteur isolé. Rétif est un grand néologiste, quand il ne propose pas de nouvelles acceptions, ou au contraire des archaïsmes, barbarismes ou provincialismes, pour restituer la prononciation ou le langage de ses personnages, jusqu’à la transcription novatrice du patois à l’aide d’artifices d’imprimeur. J’en ai relevé de nombreux au fil des pages, comme d’ailleurs la Néologie (1801) de Louis-Sébastien Mercier en reprend, que le CNTRL cite parfois dans la version de Mercier plutôt que de retrouver l’original ! Ex : admiromane ; souventefois, disez, forcément (au sens de « sans consentement »), barathre, rhynocérote, tempéramenteux, monéraste, polyéraste, etc.) Ce 1er article est consacré à la Première époque (sur 9), qui ne compte que 137 pages, mais quelles ! Précisons que l’édition de la Pléiade est assortie d’une annotation pléthorique tous azimuts.
Première époque (p. 19 à 137).
Monsieur Nicolas est divisé en 9 époques, de longueur très inégale ; le tome 1 de l’édition de la Pléiade contient les époques 1 à 5. La Première époque, à laquelle ce 1er article sera consacré, couvre les 12 premières années de la vie de Rétif, mais ne vous attendez pas à un récit édulcoré, car le jeune Rétif se retrouvera déjà deux fois père avant ses douze ans, ayant mis deux coups au but, sans pour autant devenir père de famille, bien entendu.
Dans son introduction, Rétif est cash : « Mais, d’un autre côté, j’ai été emporté, brutal, furieux, d’un caractère impatient au joug, dur, impérieux, sacrifiant tout au penchant frénétique pour les femmes, me livrant, pour le satisfaire, à des excès punissables ; ne respectant ni la pudeur, ni la décence ; m’exposant moi-même, exposant des âmes encore pures aux suites affreuses du libertinage, achevant de précipiter, dans ce gouffre immonde, des jeunes filles qui ne s’en étaient encore qu’approchées » (p. 4). Mais il réserve la part du bien & du mal, avec des accents rousseauistes : « Inconcevable labyrinthe du cœur humain ! Ô chaos, qui renfermes tous les contraires, qui te débrouillera ?… Moi, dans moi-même. Je ne déguiserai rien, ô lecteur ! ni les vices, ni les crimes, ni les turpitudes, ni les obscénités !… Oui, j’avouerai jusqu’aux motifs secrets qui me font écrire mon histoire. Je veux du moins avoir ce mérite, d’étonner par l’excès de ma sincérité ! » (p. 5).
Nicolas n’est pas forcément modeste : « Il fut ordonné par mon père que mon nom appellatif serait Nicolas. C’est un très beau nom, composé de deux mots grecs : Nikê (victoire), et Laos (peuple) ; il signifie, par conséquent : Vainqueur, ou Dominateur des Peuples » (p. 20). Le petit Nicolas n’est pas celui de Sempé, et il relate une expérience censée avoir eu lieu dès l’âge de 4 ans : « Je me crois obligé de spécifier ici ces caresses, qui ont été préjudiciables, non seulement à mes mœurs, mais à ma santé, en donnant, par la mémoire, avant le développement des forces, trop d’élan à mon imagination brûlante. Marie me baisait sur les joues, sur les lèvres, que j’ai toujours eues appétissantes. Elle allait plus loin, quoique tout, de sa part, fût de la plus grande innocence ; elle mettait sa main sous mes petits jupons, et se plaisait à me fouetter en chatouillant. Enfin elle allait plus loin encore… et alors elle me dévorait de baisers. » Et de préciser en note, partie en latin : « Pour exprimer ceci, j’emploierai une langue savante que les hommes seront forcés de traduire décemment aux femmes : Mentulam testiculosque titillabat, quoadusque erigerem ; tunc subridebat velatis oculis humore vitreo, et aliquoties deficiebat… Et moi je lui rendais ses caresses, avec un rire d’aise désordonné. C’est ainsi qu’une suite de petites causes contribuaient à développer et à fortifier ce tempérament érotique qui va étonner et qui me précipitera dans tant d’écarts !… Grande leçon pour tous les parents qui ont des enfants d’une agréable figure ! » Quelle modernité ! La traduction de la phrase latine proposée par Michel Testud est : « Elle chatouillait la verge et les testicules jusqu’à érection ; alors elle souriait, les yeux voilés d’un liquide vitreux, et quelquefois défaillait » (p. 23). Souvenir précoce ou reconstruction, la modernité de la réflexion étonne ! Deux autres scènes au même âge où le petit Rétif est témoin de rapports sexuels d’adultes, ont été citées par Freud : « Rétif de La Bretonne confirme, avec le récit d’une impression datant de sa quatrième année, cette fausse impression sadique du coït » (Les Théories sexuelles infantiles, PUF 1977, note p. 22).
Le petit Nicolas adore les femmes & craint les hommes, sentiments renforcés par ses « deux frères aînés, alors séminaristes [qui l’] épouvantaient par leur sévérité janséniste » (p. 28). Il est précoce en amour : « C’était par cet éloignement des caresses que je tenais à la nature mâle : les mignardises enfantines me paraissaient faites pour les efféminés » (p. 29). Parmi ses expériences précoces il en est une étonnante, relatée en latin également : une fille de 13 ans, Margot, essaie (vainement) de faire s’accoupler Nicolas & une fillette de son âge, c’est-à-dire 6 ans (p. 36). Témoignage rare de la réalité des mœurs du XVIIIe, sans doute ! Autre trait de mœurs, l’exhibition collective de jeunes garçons : « Omnes, sine verecundia mentulas exhibentes, ad retractionem præputii certatim ludebant. An ad emissionem usque seminis eruperunt, non potui, pro ætate mea, distinguere : sed erubescere vidi neminem » (« ils exhibaient tous leur verge sans pudeur, et par jeu tiraient à qui mieux mieux leur prépuce en arrière. S’ils aboutirent à l’éjaculation, je ne pus le distinguer, étant donné mon âge ; mais je n’en vis aucun rougir de honte » ; p. 40). Très soucieux des bonnes mœurs en dépit de ses frasques précoces, Rétif évoque en note un témoignage bien plus tardif d’un père de famille ayant obtenu de Jean-Jacques Rousseau le conseil suivant d’éducation à la sexualité pour sa fille : « Achevez vous-même d’instruire votre fille, lui répondit le Citoyen de Genève ; dites-lui tout, mais en médecin ; parlez physiquement ; détaillez, et la conception, comme elle se fait, et la grossesse, et ses incommodités ; dites comment se nourrit le fœtus. Parlez ensuite de l’accouchement, et sans trop effrayer son imagination, présentez-lui ces détails dans une vérité qui éteigne la passion ; il n’est rien qui éloigne plus les idées amoureuses, que les suites essentielles de l’amour. Étendez-vous sur la nécessité de donner le sein de leur mère aux enfants ; n’oubliez pas les ravages du lait ; citez-en des exemples ; il en est tant à Paris ! Enfin, allez jusqu’à dire quelque chose de la redoutable syphilis, mais avec les ménagements convenables. Votre fille s’impatientera de ces détails (car le but serait manqué, s’ils ne l’impatientaient pas) ; elle vous en demandera grâce : vous cesserez alors ; mais soyez sûr que, dans la pension, elle n’écoutera plus les entretiens obscènes ; ils ne lui donneront que du dégoût ; vous leur aurez ôté leur charme le plus fort, celui de la curiosité ; elle en saura plus que tout le monde, et elle joindra deux idées, qui se serviront de contrepoids, celle du voluptueux embrassement, et celle des cris d’une femme en couches » (p. 40).
Fétichisme du pied
Le titre de Monsieur Nicolas est justifié dans une note de la p. 42 : « J’étais, moi, Monsieur Nicolas, par mes rapports avec tous les précédents [niveau supérieur d’éducation, d’habitat, qui rejaillit du père sur les enfants], et parce que j’étais un peu mieux habillé que les autres petits paysans. » À huit ans, Nicolas éprouve une première amitié forte pour un garçon, Étienne : « S’il l’avait senti, je crois que nous aurions pu faire de ces choses étonnantes, telles que les merveilles d’amitié qu’on cite des jeunes Grecs » (p. 43). Le fétichisme du pied et de la chaussure féminins se développe vers 9 ans, et donne lieu à un développement étonnant de liberté : « leurs souliers, soignés, recherchés, avaient, au lieu de cordons, ou de boucles, qui n’étaient pas encore en usage à Sacy, de la faveur bleue, ou rose, suivant la couleur de la jupe. Je songeais à ces filles avec émotion ; je désirais… je ne savais quoi ; mais je désirais quelque chose, comme de les soumettre. […] Je doute que les petits nègres, sitôt formés, puisqu’à neuf ou dix ans ils peuvent être pères, désirent les femmes plus tôt que je ne les désirai. On verra bientôt que j’eus la même puissance, et ce phénomène ne sera pas le moins frappant ni le moins intéressant de ma vie… Mais ce goût pour la beauté des pieds, si puissant en moi, qu’il excitait immanquablement les désirs, et qu’il m’aurait fait passer sur la laideur, a-t-il sa cause dans le physique, ou dans le moral ? Il est excessif, dans tous ceux qui l’ont ; quelle est sa base ? Serait-ce ses rapports avec la légèreté de la marche ? avec la grâce et la volupté de la danse ? Le goût factice pour la chaussure n’est que le reflet de celui pour les jolis pieds, qui donnent de l’élégance aux animaux même ; on s’accoutume à considérer l’enveloppe comme la chose. Ainsi, la passion que j’eus, dès l’enfance, pour les chaussures délicates, était un goût factice basé sur un goût naturel : mais celui de la petitesse du pied a seulement une cause physique, indiquée par le proverbe, Parvus pes, barathrum grande ! [« Petit pied, trou énorme »] la facilité que donne ce dernier étant favorable à la génération… Je vais essayer de me faire mieux entendre dans la note » (p. 46). Ladite note commence par du latin : Aperta vulva semper facilitat intromissionem ac projectum seminis in uterum. [« Une vulve ouverte facilite toujours la pénétration et la projection de la semence dans l’utérus » ; latin fantaisiste selon les notes de la Pléiade] et finit par une maxime pour l’éducation des adolescents : « Ce sont les pieds petits, ronds et courts, qui seuls indiquent un barathre… Et qu’on ne l’oublie pas : ce sont les barathres qui facilitent la jouissance à la jeunesse nouvellement pubère. » Si vous le dites ! Le fétichisme du pied est un thème rétivien dont les notes pléthoriques de cette édition donnent maints exemples, dont celui-ci extrait de l’Histoire des compagnes de Maria, qui introduit le mot « fétiche », bien que le sens psychiatrique n’y soit pas encore, puisque l’objet n’est pas considéré en dehors de sa relation avec un pied précis : « Jamais les accapareurs de jupes et de souliers n’ont voulu les rendre : on les a trouvés chez eux dans de jolies niches, comme des idoles, ou plutôt, nous a dit un savant, comme des fétiches de Guinée ayant une sorte de culte et une espèce d’autel » (note p. 1191). Une autre précision de la même note de la Pléiade (note d’une page & demie !) est là encore édifiante ; il s’agit d’un extrait du Journal de Rétif : « bse le pd de Mn » (baisé le pied de Marion [sa fille cadette]), le 20 sept. 1787 (f° 3 v°, n°1202) ; Emiss. 3es […] 3 â le joli pied sur l’île » (trois éjaculations […] la troisième due au joli pied vu sur l’île Saint-Louis), le 27 juillet 1788 (f° 10 v°, n°1414) ; « Emiss. Sem. In calc. Senga » (j’ai éjaculé dans la chaussure d’Agnès [sa fille aînée]), le 8 sept. 1791 (f° 35 r°, n°2502) » On peut peut-être parler pour Pierre Testud, de fétichisme littéraire, pour en arriver à ce point d’érudition ! Par curiosité, j’ai recherché le journal de Rétif en ligne sur Gallica, et le seul document disponible donne une idée du temps de recherche nécessaire pour obtenir la transcription de cette note, en 1989, bien avant les moyens techniques actuels !
À moins de 11 ans, Nicolas ressent du désir : « Sa vue me frappa, mais d’une manière jusqu’alors non éprouvée ! ce furent des désirs, et non de l’amour, que je ressentis : un feu brûlant circula dans mes veines ; Nannette fut la première femme pour moi. J’étais ébahi de cette impression nouvelle, prodigieuse ! […] Là-bas, et je portai sur moi une main… non pollutrice encore, mais qui cherchait la cause d’un phénomène nouveau, altæ rigidæque erectionis… » (p. 54 ; faut-il traduire ?). Dès le lendemain, Rétif (si on le croît) est dépucelé : « Au retour de l’église, l’envie de revoir Nannette me fit surmonter cette pudeur naturelle, qui m’a porté longtemps à fuir, avec un plus grand soin, l’objet qui me plaisait davantage […] Nannette vint doucement derrière moi, me surprit, et me prenant les deux mains : « Il faut que je vous embrasse à mon aise », me dit-elle en riant. Je feignis de vouloir me débarrasser, ce qui redoubla son envie. Elle me pressa contre son sein, le plus beau que j’eusse encore vu… Vivement ému, je l’embrassai moi-même. Alors, Nannette parut comme saisie d’une fureur utérine ; elle me serra, s’empara de tout mon être, et me fit palper tout le sien. Il parait que cette fille était tempéramenteuse à l’excès… Elle pâlit, ses genoux fléchirent ; elle me pressait et repoussait tour à tour… Enfin, il lui prit un tel accès d’érotisme qu’elle voulut être possédée, et elle en prit les moyens ; nouvelle Sapho, elle aida la nature, la fit agir, et causa en moi un bouleversement inconnu… À ce moment, terrible ! de la première crise de la reproduction… je m’évanouis !… En revenant à moi-même, je me trouvai inondé ; mes camarades m’environnaient. Madelon disait à Nannette : « Mais, tu l’as donc chatouillé ? J’ai oublié de te prévenir qu’il ne le fallait pas ; car je sais de sa sœur Margot qu’il se pâme dès qu’on le chatouille. » Nannette rougit, en balbutiant : « O ne m’en doutos pas ! » Toute l’explication finit là. Je n’avais moi-même qu’une connaissance confuse de ce qui s’était passé. Treize années s’écouleront avant que j’en voie les suites : c’est par l’effet que je saurai un jour, que j’ai été homme à dix ans et demi. » (cf. 5e époque) Rétif ajoute à l’expérience une citation latine : « Omne animal post coitum triste ; excepta gallo-gallinaceo, et scholastico futuente gratis. » (Tout animal est triste après le coït, sauf le coq, et l’écolier faisant l’amour gratis ; parodie de la citation apocryphe attribuée tantôt à Ovide, à Aristote, à Claude Galien de Pergame, etc., et de forme variable : « Omne animal triste post coïtum, praeter gallum mulieremque » : sauf le coq et la femme ; p. 55). Il s’agit d’après mes recherches d’un dicton latin datant du début de l’époque moderne, et d’ampleur européenne, peut-être basé sur un catéchisme ou plus vraisemblablement sur une parodie de catéchisme. Vous voyez que cette autobiographie ne peut pas devenir un classique ! À la p. 56, Rétif nomme « Lille-sous-Mauréal » qui selon les notes est l’ancien nom de L’Isle-sur-Serein, dans une graphie propre à Rétif. Il se trouve que je connais bien ce bourg, où ma grand-mère vécut un temps après son veuvage, et qui était intermédiaire entre Avallon & Massangis. Ce dernier, le village de mes grands-parents, est enfin nommé p. 100, sous une variante : « Mais les deux frères [des bergers] étaient alors en service, l’un à Marsangis, l’autre à Coutarnoux, et il fallait attendre un mois pour avoir le plus tôt libre ».
Rétif évoque les jeux de l’époque, comme celui de « la pucelle » : « La pucelle se levait, et donnait la main à celui des garçons qui lui plaisait. C’était son mari, et le jeu finissait là. Le garçon choisi remettait ensuite poliment la jeune fille au milieu de ses compagnes. Il paraît que l’origine de ce jeu est l’ancienne cérémonie du mariage chez les Gaulois du canton, avant et même depuis le christianisme. Ce jeu est absolument cessé aujourd’hui, ainsi que tous les autres. » N’est-il pas amusant de vérifier que dès cette époque on avait l’impression de changements générationnels ? Cependant à propos du jeu du « loup », Rétif évoque une cause de changement qui a toujours sévi dans les campagnes : « Messire Antoine Foudriat ne voulut jamais ni le défendre, ni recommander de la décence dans ce jeu ; il disait que depuis plus de cinq cents ans, on n’avait pas ouï dire qu’il y fût rien arrivé d’essentiel, et qu’il suffirait de le défendre pour qu’il devînt criminel… Ce sage pasteur mourut ; son successeur, messire Louis Jolivet, défendit le jeu, qui devint criminel ; il fallut que le pouvoir civil le proscrivît. Depuis ce temps, il n’y a plus de jeux à Sacy ; on y végète tristement, comme ailleurs : le purisme a toujours été le plus grand ennemi du genre humain » (p. 63). Il évoque même l’origine des rosières, et pas en bien : « Dans l’ancien régime, on avait cru remplacer les jeux par la pédante et plate institution des Rosières. Mais ces tristes fêtes ne sont pas un jeu ; elles sont une source de petites cabales, de petites intrigues, de petites vertus d’ostentation, et de vices réels. Les villages à rosières, loin d’être aujourd’hui les plus innocents, sont les plus licencieux ; le vice s’y cache comme à la ville, et les filles y sont libertines sans faire d’enfants. D’où vient cela ? C’est que les dames qui allaient présider ces ridicules solennités, menaient avec elles leurs valets, leurs amants et leurs vices » (p. 63). Au suffixe près, Rétif invente quasiment le polyamour : « J’observe ici que dès lors, et ensuite pendant mon séjour à Courgis, brûlé par les yeux de Jeannette Rousseau ; que même à la ville, éperdu d’amour jusqu’à la fureur pour Mme Parangon, et toute ma vie, je n’ai jamais été absolument monéraste, mais polyéraste ; à moins qu’on ne trouve bonnes les raisons que je me propose de donner dans le temps, pour prouver que je n’ai aimé qu’une femme. » (p. 66). Rétif note une différence sociologique entre Nitry et Sacy, deux villages icaunais proches : « Les habitants de Nitry, outre leur insouciance, ont une sorte de grandeur et de générosité ; leur récolte n’est pas faite avec exactitude, comme à Sacy ; le Nitriate dit : « Il en faut un peu laisser au pauvre qui n’a pas de vigne, afin qu’il puisse goûter au raisin ; car autrefois, quand il n’y avait que des fruits sauvages, tout était à tous. Il faut donc laisser au pauvre, qui ne possède plus rien, un peu de fruit cultivé, pour le préserver du vol et du désespoir, pour désaltérer le passant ou le pâtre qui abordent ces collines écartées… » » Belle philosophie si étrangère aux réflexions de Balzac sur Les Paysans.
De la lecture
Rétif apprend à lire seul, et apprend à lire le français après le latin, ce qui a de quoi nous étonner. Voici une page d’anthologie sur la lecture : « Ma mère avait un livre que je désirais depuis longtemps, parce que j’en avais entendu lire un passage à mon aïeul Nicolas Ferlet : c’est Le Bon Pasteur, de Jean de Palafox, évêque d’Osma. J’allai le demander un jour, la larme à l’œil. J’étais dans le jardin, monté sur un vieux pommier, pour y lire tranquillement mon psautier latin-français : car il me semblait qu’en me mettant hors d’atteinte, j’assurais mon indépendance. Je tombai, à l’ouverture du livre, sur le psaume Super flumina Babylonis, que je lus en français, pour la première fois. Cette espèce d’élégie m’attendrit : je relus deux fois le psaume, que je ne trouvai pas sec comme les autres ; puis je descendis hâtivement de mon arbre, pour aller trouver ma mère : « Maman ! lui dis-je, voilà un beau psaume ! Voulez-vous que je vous le lise ? — Quand tu me le liras, mon enfant, je n’entends pas le latin. — Je vas vous le lire en français. — Est-ce que tu sais lire le français ? — Oh que oui maman ! et c’est pour cela que je vous demande Le Bon Pasteur, qui est si beau ! — Voyons comme tu lis. » Je lus : « Étant sur le bord des fleuves de Babylone, nous nous y sommes assis, et nous y avons pleuré, en nous rappelant de Sion. Et nous avons suspendu nos harpes aux saules qui bordent ses prairies. Alors ceux qui nous ont emmenés captifs, nous ont dit : « Chantez-nous quelques-uns des cantiques que vous chantiez dans votre pays » Ah ! comment chanterions-nous les cantiques du Seigneur et d’allégresse, dans une terre étrangère ? » Je vis des larmes dans les yeux de Barbe Ferlet : « Tu lis bien, mon enfant ! tu lis fort bien ! — J’ai appris tout seul, maman, dans la Vie de Jésus-Christ, où il y a de jolies lettres frisées… Vous m’aviez promis, dès que je saurais lire, de me donner Le Bon Pasteur, en attendant que vous me donniez, quand je serai bien savant, votre livre d’or. » (C’était une autre Vie de Jésus-Christ reliée en maroquin rouge, et dorée sur tranche.) Ma mère me donna Le Bon Pasteur : « Mon enfant, ne le gâte donc pas ! car je le conserve depuis mon enfance, et je le tiens de feue ma pauvre mère. » Je reçus le livre en palpitant de plaisir, et je courus m’isoler sur un pommier sauvage, dans les prés des Rôs, pour n’être pas distrait. J’eus une illusion délicieuse, qui s’est depuis renouvelée toutes les fois que je l’ai relu, pendant mon enfance » (p. 83).
Un autre passage d’anthologie se situe en classe. Rétif doit partager une paillasse avec un certain Barbier, or il est atteint d’énurésie. Celui-ci le traite de « pissenlit ». Mais la fille de la maison console le garçon en lui disant que l’autre est une brute. Vient une séance de lecture en classe : « Barbier lut le premier. Il ânonnait. […] Vint mon tour de lire mon parchemin gothique : j’allai rapidement et sans broncher, mais à la manière de Sacy, prescrite par messire Antoine Foudriat ; c’est-à-dire que je disais, comme tout le monde, ils étaient, ils achetaient ; ce qui surprit tous les écoliers, qui auraient prononcé : ils estoient, ils acheptoient. Mais le maître ne me dit rien. Je revins fièrement à ma place. Barbier me regardait avec une admiration stupide, et moi, de ce moment, je me sentis tant de supériorité sur lui, malgré mon infirmité, qu’il ne fut plus capable de m’inspirer de la honte. Julie lut après moi : je fus surpris de l’entendre lire autrement qu’elle ne parlait ! elle prononçait, comme s’obstinent à écrire les routiniers, j’adorois, en donnant à la dernière syllabe le son du mot rois. Christophe Berthier vit ma surprise ; il me dit : « Nicolas, autrefois tout le monde prononçait comme on lit encore dans ma classe ; j’ai préféré de laisser lire la jeunesse comme on ne parle plus, à lui donner des règles embarrassantes et contradictoires : l’essentiel est qu’on apprenne à lire par des principes sûrs, non compliqués ; ce qui se trouve contre l’usage se corrige bien vite en fréquentant le monde. […] Lisez comme vous avez coutume : ceux et celles qui voudront vous imiter le peuvent, mais je n’en ferai une loi à personne. » Je suis encore étonné aujourd’hui de la justesse de ces idées dans un maître d’école de campagne ! »
Nouvelle paternité
À onze ans, atteint de la fièvre, lui arrive une deuxième expérience sexuelle suivie d’une nouvelle paternité : « Elle m’embrassait ; elle allait jusqu’à me baiser les mains. On sait que j’avais les sens faciles à émouvoir ; que mon aventure avec Nannette avait développé en moi un sixième sens, exquis dans l’adolescence. Brûlé par la fièvre, enivré des caresses de Julie, je sentis l’aiguillon de la volupté ; je cherchai la jouissance, d’après mes ressouvenirs. Mlle Barbier ne fit pas la moindre résistance : elle se livra… d’un air si tendre, avec tant de complaisance, qu’il fallait que ses lectures eussent entamé son cœur et ses sens. Quant à moi, encore fort excité par la douceur des caresses d’une fille charmante et dévouée, je me trouvai au-delà de la nature, par la tension des organes. Je triomphai… Mais que je payai cher cette exagération accidentelle de mes forces ! Je faillis d’en mourir. Pour Julie, elle était plus âgée que moi, elle se portait bien, et elle était femme ; malgré la douleur de la défloration, qui lui fit jeter un cri, elle m’avoua qu’elle avait goûté toutes les délices de l’amour… Elle fut ensuite infiniment tendre : mais j’étais mourant dans ses bras. Ah ! comme ses attentions furent délicates ! elle me ranimait doucement par ses baisers, par un peu d’élixir… […] Quoique chérissant Julie (que, sans le savoir, je venais de rendre mère), je sentais que ce n’était pas en amant que je l’aimais ; c’était (comme depuis Thérèse sa fille) de la plus pure et de la plus tendre amitié… » Les suites ne l’inquiètent guère, signe que c’était courant à l’époque. On apprendra seulement quelques pages plus loin : « Julie venait d’être mère, à l’insu de tout le monde, son père et la belle-mère exceptés… » (p. 137).
On en vient à un détail fort intéressant pour l’étude des mœurs : « Elle me donna deux oranges, les seules peut-être qui fussent dans le pays, et les premières que j’eusse vues. Elle me dit de m’en parfumer la bouche, après avoir bu aux fontaines. » (p. 97) Deux siècles plus tard, c’était toujours un fruit rare, réservé à la fête de Noël !
Des animaux-machines
D’une expérience de berger, poste qu’il affectionnait, Rétif tire une belle page sur les animaux-machines, qui n’aurait pas dépareillé le sujet de bac S/ES de juin 2018 : « Un des loups, celui qui m’avait assiégé, avait adroitement donné le change à Friquette en passant devant l’autre loup, sur lequel la chienne s’était jetée, et il était revenu, voyant les chiens s’éloigner. Mais, contre son attente, il trouva mon père, qui le tira si heureusement, qu’il lui cassa une patte. Le vieux loup voulut fuir alors ; mais il fut rencontré par les deux mâtins qui s’en revenaient, et qui le retinrent assez pour donner à mon père et aux garçons de charrue le temps de le joindre ; ils l’assommèrent. Mon père le jugea anthropophage ou prêt à le devenir. Il fit observer la sagacité de ce loup gris, qui avait exposé le jeune loup en l’envoyant à l’assaut, tandis qu’il se tenait à l’écart. Ce qu’il y a de vrai, c’est que le jeune loup était un imprudent d’attaquer un cochon ; s’il avait pris un agneau, je ne m’en serais pas aperçu, et j’aurais perdu, pour la première fois, une de mes ouailles. Je ne dois pas omettre la scène qui se passa lorsque la mère truie eût délivré son petit : tout le troupeau de cochons, composé alors de trois ventrées complètes moins un, c’est-à-dire de trente-trois, se mit en rond autour du blessé, les plus jeunes en dedans, les plus gros en dehors, et ils se mirent à répondre à ses plaintes par un grognement si semblable à une conversation, que j’en fus frappé ! Je ne doutai pas alors qu’ils ne le consolassent. La mère était en dehors du cercle, le poil hérissé d’une manière horrible, et poussant de temps en temps une sorte de soupir qui avait quelque chose d’effrayant. L’impression que fit sur moi cette scène singulière a été profonde, et elle m’a toujours, depuis, éloigné du système de Descartes, si mal à propos renouvelé par Buffon, qui n’a que trop souvent sacrifié la vérité à la crainte de la Sorbonne, dans son éloquent et mauvais Discours sur la nature des Animaux ; quoiqu’il revienne ensuite aux vrais principes dans sa courte Histoire du Castor. Comme nous nous en retournions, Friquette revint de la poursuite du jeune loup, le corps rempli d’épines, que mon père arracha : ce qui prouvait qu’elle s’était accolée avec l’ennemi » (p. 101). En réalité, Buffon raconte aussi une histoire semblable sur le cochon, et Rétif est de mauvaise foi ou l’a mal lu, car Buffon est aussi une sorte d’« animaliste » avant la lettre.
Mieux, la suite est un beau texte à intégrer à un corpus sur mensonge et vérité : « Cette aventure ne m’empêcha pas d’aller le lendemain dans la sombre et profonde vallée de Bourdenet, dont j’avais appris que les seigles étaient déblavés. J’y fus joint par mon ami Étienne Dumont, qui conduisait son troupeau de vaches et ses chèvres de mon côté. Je tressaillis de joie. Il la partageait réellement ; car il avait bien des choses à me dire, ne m’ayant point parlé en particulier depuis mon retour de Joux. Il me conta d’abord que je passais dans le village pour avoir tué le loup de la veille ; et il ajouta des circonstances merveilleuses, qui vont donner une idée de la manière dont les fables se forment :
« Tu venais d’arriver dans les prés des Rôs et tu venais de t’asseoir au pied du pommier de la mère Lamberlin, quand un loup blanc, le même qui a mangé la petite sœur de votre Germain il y a vingt ans, est venu à toi par-derrière et a voulu t’étrangler ; mais tu l’as pris à brasse-corps et il t’a porté sur son dos sans pouvoir te mordre. Votre mère truie est venue à ta défense ; elle a enlevé le loup en l’air d’un coup de ses crochets ; et toi, quand et quand tu l’as lâché ; et quand il est tombé, tu lui as donné un bon coup de ton bâton ferré ; et puis la mère truie l’a renlevé en lui ouvrant le ventre ; et quand il est retombé, tu lui as donné un coup de bâton ferré : et puis la mère l’a encore renlevé jusqu’à ce qu’il fût mort quasi. Et puis ton père est venu, qui a dit : « Ah ! mon fils Nicolas ! il a tué le loup ! ça s’appelle avoir du courage ! » Et puis il lui a tiré un coup de fusil, qui lui a cassé la patte. Et puis les chiens l’ont achevé. En fin de quoi Germain lui a coupé la tête avec un couperet ; il l’a écorché pour couvrir le collier de Flamand votre limonier : et quant à la tête, votre Germain l’a vendue aux gens du Vaux-Saint-Martin après l’avoir montrée à tout Sacy. Oh ! quelles dents elle a ! Marie Fouard a tremblé de tout son corps, en disant : « Oh ! s’il l’avait mordu ! » car elle t’aimera toujours. »
Je dis à Étienne la vérité de l’aventure ; mais le récit des autres était bien plus sûr que le mien, sans doute parce qu’il était plus merveilleux. Étienne m’apprit qu’il avait été convenu, entre mon père et Germain, qu’on ne dirait pas les choses comme elles étaient. Je fus obligé de céder ; ma vanité, d’ailleurs, trouvait mieux son compte à la fable qu’à la vérité. Le récit que venait de me faire Étienne est le seul qui ait eu cours dans le pays » (p. 102).
Le père de Rétif évoque son propre père, avec une réflexion sur l’évolution des tempéraments : « Et il ne faut pas croire que mon père, quand il me menait en campagne avec lui, me parlât et conversât ! je marchais derrière, et je n’osais faire une question, ni dire un mot. Au lieu que moi, je te parle, et je vous parle à tous. Non que je m’estime meilleur que mon digne père ! Tant s’en faut ! que c’est parce que je me trouve moins valant, que je ne me crois pas autorisé à en agir comme lui, qui était d’un si grand esprit et d’un si grand mérite, qu’un chacun l’admirait » (p. 112). Courtcou, le berger qui seconde Nicolas est mauvais sujet, mais bon conteur, sauf que ses contes sont licencieux. L’un de ceux que rapporte Rétif contient un motif étonnant (et qui aurait été censuré s’il ne l’avait imprimé lui-même) : « Le valet reparut avec un jeune garçon et une jeune fille. « Y a-t-il longtemps qu’ils n’ont pissé ? — Six heures. » Elle fit un signe, et le valet donna un grand verre à la jeune fille, un grand verre au jeune garçon, qui pissèrent ; il mêla le tout dans un plus grand gobelet, qu’il présenta à genoux. Mais au moment où la blonde allait le prendre, il l’avala, et le valet le remplit d’un tokay délicieux, qu’elle mira en disant : « Elle est belle ! Mais qu’on y mêle quelques gouttes de sang. » Le valet piqua au cou le jeune garçon, sur le vase. Et quand le tokay fut rougi, elle but » (p. 119). Le même Courtcou initie le jeune Rétif aux récits érotiques ; et celui-ci le rapporte en latin : « Mastuprarat, fellaverat, mammaverat, tandem futuerat ingentibus conatibus ; postea pluries vitiatam puellam irrumarat » (Il l’avait masturbée, avait léché sa vulve, ses seins, enfin l’avait possédée au prix de grands efforts ; puis il avait, à plusieurs reprises, introduit sa verge dans la bouche de la jeune fille, ainsi déshonorée ») (p. 126). Courtcou a paradoxalement une bonne influence sur Rétif : « Ses sollicitations me rendirent romancier pour la première fois : j’arrangeai dans ma tête les deux aventures de Nannette et de Julie, et je les lui racontai » (p. 127). Puis c’est l’annonce du départ pour Paris : « Lecteur ! les plus heureux de mes jours sont passés ! » Ainsi se finit la Première époque, et ce 1er article.
– Lire l’œuvre sur Wikisource.
– Lire la suite de cet article : Monsieur Nicolas, 2e et 3e époques, 4e époque et cinquième époque.
Voir en ligne : Société Rétif de La Bretonne
© altersexualite.com 2018
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com