Accueil > Classiques > Commentaires royaux sur le Pérou des Incas, Inca Garcilaso de la (...)
Tous sodomites et anthropophages sauf papa & maman !
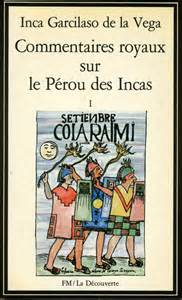 Commentaires royaux sur le Pérou des Incas, Inca Garcilaso de la Vega
Commentaires royaux sur le Pérou des Incas, Inca Garcilaso de la Vega
La Découverte / Poche, 1982, 334 p.
lundi 1er août 2016
Lors d’un séjour à Madrid en avril 2016, j’ai pu visiter à la Bibliothèque nationale d’Espagne, une exposition consacrée à Inca Garcilaso de la Vega (1539-1616), montée à l’occasion du quadricentenaire de la disparition de ce drôle de quidam mort le lendemain de Cervantès. Cela m’a donné envie de feuilleter son œuvre majeure, dans la dernière traduction disponible, celle de René L. F. Durand, pour la collection Unesco dans le cadre de la publication d’œuvres représentatives de la série ibéro-américaine. Il y a trois tomes de 300 pages chacun. On ne prend plus cet ouvrage comme une source fiable sur les Incas, encore moins sur les civilisations qui les ont précédés (Tiwanaku, Huari, culture de Chavín, Chimu, sans oublier nos amis Mochica, etc.), étant donné que ce Garcilaso qui se fait surnommer Inca tient d’une part à survaloriser la culture de sa mère, d’autre part à justifier la conversion au catholicisme des peuples indigènes, qui selon lui aurait été préparée par l’œuvre de moralisation des Incas, notamment en ce qui concerne la répression de ce qu’il appelle les « sodomites ». Cela n’empêche pas qu’il s’agit d’une mine d’informations, et cette lecture peut fournir des extraits intéressants même dans le cadre éducatif, par exemple pour contrebalancer l’opinion d’un Jean de Léry, lui-même pour des raisons contraires, peut-être enclin à enjoliver sa vision des « sauvages » du nouveau monde, ou la vision très « bon sauvage » de Denis Diderot, ou la vision romantico-gauchiste d’Aimé Césaire (« Je vois bien ce que la colonisation a détruit : les admirables civilisations indiennes et que ni Deterding, ni Royal Dutch, ni Standard Oil ne me consoleront jamais des Aztèques ni des Incas » ; Discours sur le colonialisme, 1955, Présence africaine, p. 19). La 4e de couverture qualifie Garcilaso d’« Hérodote des Incas ». J’aurais dû lire ce livre lors d’un voyage au Pérou et en Bolivie que je fis vers les années 1998, bien avant de créer ce site et sa rubrique voyages… Il n’est jamais trop tard…
Tome I : livres premier, deuxième et troisième
La thèse principale de Garcilaso est exposée au ch. 15 du livre premier : « L’expérience a fait voir clairement qu’il ne s’en est point trouvé de plus prompts ni de plus enclins à recevoir l’Évangile que les Indiens qui ont été soumis, gouvernés et instruits par les rois incas ; il en fut autrement des autres nations voisines, auxquelles n’était point parvenu l’enseignement des Incas : plusieurs d’entre elles sont encore aujourd’hui aussi barbares qu’auparavant, bien qu’il y ait soixante et onze ans que les Espagnols sont entrés au Pérou ». Le nom « inca », est « commun à tous les rois du Pérou, de même que les empereurs romains étaient honorés de celui d’Auguste… » (Livre IX, ch. 1, tome 3).
De l’origine des noms
Garcilaso nous apprend l’origine du nom « Pérou » basé selon lui sur une erreur récurrente de communication entre des Espagnols et le premier indigène qu’ils rencontrent et capturent : « Les Espagnols le caressèrent pour lui faire perdre la crainte qu’il avait de voir des gens d’un vêtement différent et avec de la barbe, et lui demandèrent par signes et par paroles quel était ce pays-là et comment il s’appelait. L’Indien, qui par les grimaces et les signes qu’ils lui faisaient, comme à un muet, du visage et des mains, jugeait bien qu’ils lui demandaient quelque chose, mais qui ne savait ce que c’était, répondit en hâte pour prévenir tout mal en prononçant son propre nom, Bérou, et ajoutant en même temps celui de Pélou. Comme s’il eût voulu dire : si vous me demandez mon nom, sachez que je m’appelle Bérou, et si vous voulez que je vous dise où j’étais naguère, je vous avise que j’étais sur le bord de la rivière. Car il faut savoir que le mot Pélou, dans le langage de cette province est un appellatif qui signifie rivière » (p. 84). La lecture de cette anecdote nous met en garde : comment, par la relation de récits oraux recueillis dans sa jeunesse et retranscrits de mémoire à l’âge canonique (à cette époque !) de septante ans, augmentés de renseignements collectés par lettres chez ses amis et relations, l’auteur prétend-il révéler ce qui s’est réellement passé en « l’an 1515 ou 1516 » selon lui ? Le problème de cette traduction commanditée par l’Unesco est qu’elle souffre d’un déficit de notes fort dommageable pour un texte si sujet à controverses. Il m’a fallu un certain temps pour trouver que cette anecdote sur le nom Pérou date sans doute de Pascual de Andagoya, mais je ne puis suppléer à des recherches que personne ne semble avoir faites, du moins pour une édition française. Donc en attendant une nouvelle traduction plus savante, je ne ferai dans cet article que mentionner des allégations de l’auteur, sans m’astreindre à dégager la vérité de l’élucubration, car ces mensonges ont passé longtemps pour vérité, et c’est intéressant en soi, d’autant plus qu’il semble que le présent article soit – à l’heure où nous mettons sous presse, selon l’expression consacrée – le premier à citer sur Internet en langue française des passages conséquents de ce livre oublié, dans la dernière traduction disponible.
Garcilaso rapporte souvent nommément des pages d’auteurs qui l’ont précédé, par exemple un extrait de Francisco Lopez de Gomara selon lequel les noms « Cotoche » et « Yucatan » proviendraient d’une semblable erreur de compréhension de mots signifiant « maison » et « je ne te comprends pas » ! (Livre Ier, ch. 5, p. 87). Au ch. 25 du livre troisième, nous apprenons que Titicaca signifie « montagne de plomb ; le mot est composé de titi, qui veut dire plomb, et de caca, montagne ; il faut prononcer les deux syllabes caca du fond du gosier, car si on les prononce à la façon des Espagnols, le mot signifie oncle maternel » ! Dans le livre second, ch. 5 et suivants, Garcilaso montre que, faute de savoir prononcer les langues vernaculaires, les dominicains chargés de l’enseigner, se trompaient du tout au tout sur les sens des mots, car le même mot écrit en alphabet latin, pouvait avoir des sens bien différents selon la façon de le prononcer (p. 169). Enfin, au ch. 6 du Livre second, il montre que l’usage d’interprètes qui se comprenaient mal aboutissait à ce que « le prêtre ou le séculier qui posait des questions tirait de la réponse ce qui lui semblait le plus conforme à son intention ou le plus à son goût », et c’est exactement ce que Garcilaso semble avoir fait du matériel qu’il a utilisé, qu’il trouve en tout point propice à la glorification de la religion chrétienne !
Anthropophagie
Selon Inca Garcilaso de la Vega, les « anciens idolâtres » (qui précédèrent les Incas), se livraient à des sacrifices bestiaux : « Ce sacrifice d’hommes et de femmes, de garçons et d’enfants, se faisait en les ouvrant en vie par le milieu de la poitrine ; et en leur arrachant le cœur et les poumons ; puis de leur sang chaud encore, ils arrosaient l’idole ». Ces informations sont tirées de l’historien jésuite Blas Valera. S’il s’agit d’un « homme de condition » fait prisonnier dans une guerre, il est dévoré vivant, et cela donne un récit édifiant qu’il faudrait citer en entier. Je ne le prends pas dans la traduction de ce livre, puisqu’il s’agit d’une citation d’un autre livre, mais dans une traduction trouvée sur Internet (que je ne précise pas, car elle-même ne cite guère ses références) : « les habitants des Antis mangent de la chair humaine, sont plus cruels que les tigres […]. S’il arrive que par droit de guerre ou autrement ils fassent un prisonnier et qu’ils le connaissent pour être un homme de peu, ils l’écartèlent incontinent et en donnent les membres à leurs amis ou à leurs valets, afin de les manger s’ils veulent, ou de les vendre à la boucherie. Mais si c’est un homme de condition, les principaux s’assemblent entre eux, avec leurs femmes et leurs enfants, pour assister à sa mort. Alors, ces impitoyables, l’ayant dépouillé, l’attachent tout nu à un gros pieu et le découpent par tout le corps à coups de rasoirs et de couteaux, faits d’un certain caillou fort tranchant et qui est une espèce de pierre à feu. En cette cruelle exécution, ils ne le démembrent pas d’abord, mais ils ôtent seulement la chair des parties qui en ont le plus, comme du gras de la jambe, des cuisses, des fesses et des bras. Après cela, tous pêle-mêle, hommes, femmes et enfants, se teignent du sang de ce malheureux et sans attendre que la chair qu’ils en ont tirée soit ou bouillie, ou rôtie, ils la mangent goulûment, ou, pour mieux dire, ils l’engloutissent sans la mâcher. Ainsi ce misérable se voit mangé tout en vie et enseveli dans le ventre de ses ennemis. Les femmes, ajoutant encore quelque chose à la cruauté des hommes, bien qu’excessivement barbare et inhumaine, se frottent le bout des mamelles du sang de ce patient, afin de le faire sucer à leurs enfants, avec le lait qu’elles leur donnent. Que si ces inhumains ont pris garde que dans les langueurs et les supplices qu’ils ont fait souffrir au misérable défunt, il ait témoigné le moindre sentiment de douleur, ou en son visage, ou aux moindres parties de son corps, ou même qu’il lui soit échappé quelque gémissement ou quelque soupir, alors ils brisent ses os, après en avoir mangé la chair, et les jettent à la voirie ou dans la rivière avec un mépris extrême. Au contraire, s’il s’est montré résolu, constant et même farouche dans les tourments, après en avoir mangé la chair et les entrailles, ils sèchent les os et les nerfs au soleil, les mettent au sommet des collines, les tiennent pour des dieux, les adorent comme tels et leur offrent des sacrifices. » (livre Ier, ch. 11, p. 105-106). Plus loin il est question de « boucheries publiques de chair humaine ; des boyaux ils faisaient des saucisses et des boudins, en les remplissant de chair pour ne pas les perdre » (p. 109). Selon ces auteurs cités par Garcilaso, on faisait engendrer des enfants par des prisonniers ou prisonnières : « ils entretenaient une pépinière de jeunes garçons pour les dévorer » ; ils dévoraient même leurs morts : « dès qu’il y avait quelque défunt, les parents s’assemblaient et le mangeaient bouilli ou rôti, selon qu’il était gras ou maigre » (p. 110). Il faut attendre une note de bas de page au ch. 7 du livre second (p. 182), pour que l’éditeur nous prévienne que Garcilaso nie les sacrifices humains des Incas, alors « qu’il est admis qu’ils furent courants au Pérou », et de citer des passages subséquents des Commentaires où il reconnaît indirectement ces sacrifices. Voir ci-dessous d’autres mentions d’anthropophagie.

Pudeur et impudeur
Non seulement l’auteur trouve impudique la manière de s’habiller des ancêtres des Incas, mais il préfère « ne pas la décrire » et prie « les oreilles honnêtes de ne pas [l]’écouter » (p. 111). Il évoque le fait que l’habit se limitait à « un gros fil », portant ou non « un carré en coton » qui « servait à couvrir les parties honteuses ». Les coutumes de « mariage » de ces barbares sont de même jugées scandaleuses : « ils s’accouplaient comme des bêtes, sans avoir aucune femme qui leur fût particulière et suivant que le hasard les faisait se rencontrer ; d’autres se mariaient au gré de leur fantaisie, sans excepter leurs sœurs, leurs filles et leurs mères. Dans d’autres provinces, il était permis et même louable, pour les filles d’être aussi déshonnêtes et dépravées qu’elles voudraient, et les plus dissolues trouvaient à se marier plus tôt » (Livre Ier, ch. 14, p. 113). Il signale « dans plusieurs provinces du Collao une grande infamie : avant de se marier, les filles pouvaient se prostituer à tout venant, et les plus débauchées trouvaient plus tôt à se marier, comme si l’excès de vice leur eût tenu lieu d’une haute vertu » ; mais les Incas « abolirent toutes ces coutumes » (p. 216), sauf qu’ils épousaient leurs sœurs !
Des « sodomites »
Ce mot ambigu est employé par le traducteur, sans note explicative, de sorte qu’on se demande si, compte tenu de sa pudeur et de ses réticences habituelles, Garcilaso veut parler ou non d’homosexuels masculins pratiquant ou non le coït anal : « Il y eut dans certaines provinces des sodomites, mais ils s’adonnaient en cachette à ce vice qui n’était pas commun à toute la nation ; un petit nombre de particuliers seulement s’y livraient secrètement. Dans quelques régions on en trouvait dans les temples, car les diables les persuadaient que leurs dieux y prenaient un grand plaisir ; ce traître [sic ; dans le texte original, « demonio » est au singulier] devait agir ainsi pour leur ôter le voile de la honte, qui retenait ces gentils, et rendre cette abomination publique et commune entre eux » (Livre Ier, ch. 14, p. 114). Il précise bien plus loin le contexte : lors des conquêtes nombreuses des Incas, un général signale dans des « vallées côtières », l’existence de « quelques sodomites » : « quelques-uns seulement et non tous en général s’adonnaient à cet abominable vice ». Heureusement, « [L’Inca] leur recommanda tout particulièrement de rechercher avec diligence les sodomites et de brûler vifs publiquement ceux qu’ils trouveraient, non seulement coupables, mais encore suspects, pour peu que ce fût. Il voulut aussi que leurs maisons fussent brûlées et démolies, les arbres de leurs propriétés brûlés et déracinés, afin qu’il ne restât aucune mémoire d’une chose si abominable ; il leur ordonna de publier une loi inviolable selon laquelle à l’avenir les Indiens devaient se garder de commettre un tel crime sous peine que le pêché d’un seul n’entraînât la ruine de toute la ville, dont les habitants seraient brûlés » (Livre IIIe, ch. 13, p. 287). Il en résulte que de « ce pêché exécrable », « son nom seul leur était odieux ». Cette histoire édifiante racontée deux fois, est si biblique qu’il est difficile d’y ajouter foi… bien sûr, même à la seconde occurrence, aucune note de bas de page ne permet d’éclairer le lecteur ! Ce qui est amusant c’est que par contre, aucune réprobation ne fait trembler la plume de l’auteur lorsqu’il évoque la consanguinité et les maisons de vierges. L’Inca épousait volontiers sa sœur (ch. 25, Livre Ier), ainsi que tous ses descendants, « pour conserver leur sang pur », mais l’inceste leur était réservé. Au ch. 8 du livre VIII, on apprendra que Huaina Capac, après avoir épousé sa sœur aînée qui s’avéra stérile, épousa sa cadette, puis n’ayant pas d’autre sœur de sang pur, sa cousine la plus proche, par sécurité. Les deux sœurs étaient considérées à égalité comme épouses, « leurs enfants héritant du royaume selon l’ordre accoutumé ». Cela n’empêche pas nos amis incas de s’amuser : « Ils eurent de même de nombreuses maisons de vierges, dont les unes gardaient une perpétuelle virginité sans sortir jamais, et les autres devenaient concubines du roi ». Dans la traduction française de 1830, l’expression « détestable crime de la sodomie » est utilisée pour traduire le mot « sodomitas » qu’on trouve dans l’original (voir Wikisource).
Parité
Les Incas avaient le souci d’un certain équilibre entre les sexes. Par exemple, l’Inca apprenait aux hommes « les métiers de leur sexe », culture, irrigation, fabrication des outils et chaussures. Les Indiennes étaient instruites par la reine au tissage, à la couture et aux soins du ménage. Des pratiques de piercing très à la mode sont décrites comme inouïes : « Ils avaient donc les cheveux coupés, et de plus les oreilles percées, à l’endroit où les femmes les percent en général pour leurs boucles d’oreilles. Toutefois, ils agrandissaient le trou artificiellement, lui donnant une grandeur étrange, incroyable à qui ne l’aurait pas vue ; car il paraît presque impossible que le peu de chair qui fait le bout de l’oreille puisse se distendre de telle sorte qu’il soit capable de supporter un pendant de la grosseur et de la forme d’un bouchon de carafe : telle était la forme ordinaire des pendants qu’ils emprisonnaient dans les trous de leurs oreilles ; si ces derniers venaient à se rompre, on voyait qu’ils avaient une longueur d’un quart de vara, et ils étaient gros d’environ la moitié d’un doigt. À cause de cette coutume des Indiens, les Espagnols les appelèrent oreillards. » (Livre Ier, ch. 22, p. 137). Au ch. 23, il est précisé que dans ce trou, l’Inca par insigne faveur, permettait qu’on enfilât, selon les provinces, un morceau de bois, de la laine, du jonc, ou qu’on portât le trou plus ou moins grand, le plus grand étant de loin sa prérogative (p. 139). Voir ci-dessous d’autres mentions de pratiques du même ordre.
Administration, justice, médecine, littérature…
On trouve avec étonnement mention d’une sorte de théorie de la vitre cassée avant la lettre : « Les Indiens disaient que les soins extrêmes qu’on apportait à châtier les premières fautes empêchait de commettre de nouveaux délits, et qu’il n’était pas possible qu’en un État où l’on ne se donnait point la peine d’arracher les mauvaises herbes dès leur naissance, il ne se commît une infinité de maux ». L’Inca ne rigolait pas avec la loi, comme on le fait en France : « Ainsi personne n’osait tuer le moindre oiseau, car on l’aurait tué lui-même pour avoir violé la loi de l’Inca ; celui-ci n’édictait pas des lois pour qu’on les enfreignît » (tome II, livre VI, ch 6). Qu’on se le dise ! Garcilaso signale des pratiques étonnantes : on utilise l’urine pour soigner les bébés fiévreux, soit en les frictionnant, soit en leur faisant boire de leur propre urine ; on recueillait également le cordon ombilical, et le faisait sucer à l’enfant s’il était malade (p. 231, livre second, ch. 24). Étonnants Incas qui avaient découvert les vertus curatives du sang de cordon ! Garcilaso évoque une littérature orale et même « des représentations théâtrales du temps des rois incas », et une note de bas de page de l’éditeur signale l’existence d’un « drame en vers quéchuas », Ollantay (il écrit « Ollantaï »), mais sans doute très adapté par un prêtre, au XVIIIe siècle.
Tome II : livres quatrième, cinquième et sixième
Un début d’explication au terme « sodomite » est peut-être donné par l’évocation de la peine encourue par une des religieuses de la maison des Vierges du Cuzco au cas où elle « vînt à faillir contre son honneur » : elle était « enterrée vivante, et son complice pendu », et avec eux toute la famille du coupable et « tous les habitants de la ville où il demeurait », troupeaux compris, et jusqu’au sol qui devait être détruit. On constate donc que la répression des sodomites n’est qu’un détail des lois de répression sexuelle, à cela près que Garcilaso précise à propos des vierges que « cette loi ne fut jamais exécutée » ; il parle d’ailleurs à ce moment-là d’un possible viol d’une femme de l’Inca, dont la peine était identique. Les religieuses des maisons des vierges de province fournissaient un vivier pour les concubines du roi, lesquelles étaient impures après avoir été consommées, et comblées d’honneur jusqu’à la fin de leur vie, mais pas touche ! (Livre 4e, ch. 3 et 4). Des femmes de sang royal qui « avaient fait vœu de virginité mais non de claustration », si on venait à découvrir « fourberie » dans leur virginité, elles « étaient brûlées vives, ou jetées dans la fosse aux pumas » (Livre IV, ch. 7). Le roi était un encore plus gros cochon que nos rois à nous, car entre son épouse et sœur, ses concubines parentes, et ses concubines étrangères, il avait « trois sortes d’enfants », dont seuls étaient considérés comme bâtards ceux conçus des étrangères, mais respectés quand même (Livre IV, ch. 9).
Un passage remarquable nous instruit sur une particularité de la langue des incas en ce qui concerne le genre : « Quant ils veulent distinguer les sexes, ils y ajoutent les noms qui signifient mâle ou femelle. Mais pour dire l’enfant ou les enfants, le père emploie le mot churi et la mère le mot uaua. Les frères et sœurs ont quatre noms différents pour s’appeler l’un l’autre. Quand l’homme dit à l’homme huauque, cela signifie frère, et quand la femme dit à la femme ñaña, cela signifie sœur. Si le frère disait à la sœur ñaña, il changerait son sexe. La sœur en ferait autant si elle appelait son frère huauque. Le frère appelle donc sa sœur pana, qui signifie sœur, et la sœur nomme le frere tora, qui signifie frère. Un frère ne peut dire ce mot à l’autre, parce que ce serait se faire femme ; et une sœur ne peut appeler pana une autre sœur, parce que ce serait se faire homme. Il y a par conséquent des noms d’une même signification et d’un même genre, les uns propres aux hommes, et les autres aux femmes, sans qu’ils les puissent changer sous peine de substituer un sexe à l’autre » (Livre IV, ch. 11). Cela me rappelle la langue thaï, où l’on décline son propre sexe en disant bonjour.
Il est brièvement parlé des « femmes publiques », avec une explication linguistique sur le nom « pampairuna » « qui signifie putain », mais au sens littéral femme vivant à la campagne ou sur une place, sous entendue place publique, bref, c’est un euphémisme.
De longues pages sont consacrées à l’éloge du système social des Incas, un système quasi communiste, à ceci près que les rois et leur famille y constituaient (à mon sens ; Garcilaso dans un commentaire « royal » ne pouvant en être conscient) une caste privilégiée et parasite. Mais il n’y avait pas de monnaie, et le travail était réparti de façon égalitaire (sauf pour la caste pullulante des prêtres, et en considérant à égalité un homme seul et une famille dont l’homme pouvait se faire aider par sa femme et ses enfants pour contribuer par la même quantité de travail que l’homme seul). On exploite également le guano avec un partage rigoureux des ressources ; on utilise même l’excrément humain pour engrais (Livre V, ch. 3). Le souci du roi pour son peuple va jusqu’à ce scrupule incroyable de faire payer aux impotents un tribut de poux : « ils demandaient des poux aux impotents parce qu’ils ne pouvaient, comme tout le monde, s’acquitter d’un travail personnel. On disait aussi que la principale intention des Incas en exigeant ce tribut était de faire du bien aux impotents en les obligeant à s’épouiller et à se nettoyer, pour que, comme gens misérables, ils ne périssent pas mangés par les poux » (Livre V, ch. 6).
Sur le chapitre de l’architecture, on apprend ce détail intéressant pour qui a pu admirer les murs de la ville de Cuzco en pierres taillées, dont la fameuse pierre à 12 angles, qui a donné lieu à de nombreux articles contenant souvent une information plus ou moins fausse selon laquelle les murs incas seraient construits sans mortier : « les pierres de leurs bâtiments [étaient] merveilleusement travaillées et si bien ajustées les unes contre les autres qu’elles semblaient être d’une seule pièce. Le mortier qui en faisait la liaison était d’une certaine terre rouge […] très molle, dont il n’apparaissait aucune trace entre les pierres, raison pour laquelle les Espagnols prétendent que les Indiens travaillaient sans aucun mortier. » On apprend aussi que pour les palais royaux, le mortier serait mêlé d’or fondu, ce qui aurait justifié la destruction desdits palais par les Espagnols pour récupérer l’or. Au ch. 27 du livre VII, il est question de la « forteresse du Cuzco » et du prodige des grosses pierres taillées dans les carrières et transportées sur place, alors que les Indiens « n’avaient ni fer ni acier […] pas de bœufs, ni de charrettes ».
Au ch. 5 du livre VI, on apprend que non, il n’y avait pas de sacrifices humains, mais que lors des funérailles des rois incas, « Ils s’offraient eux-mêmes à la mort, ou se la donnaient volontairement, pour l’amour qu’ils portaient à leurs maîtres ». Cela fait penser à la pratique du puputan dans Sang et volupté à Bali, de Vicki Baum. Les chasses royales étaient très réglementées : on faisait une grande battue tous les quatre ans dans chaque grande région (pour en avoir une tous les ans puisqu’il y avait quatre grandes régions), ce qui permettait d’user du cheptel sauvage à peu près comme on l’aurait fait du domestique. Au ch. 7 il est question des fameux « quipus », qui permettaient par un code de couleurs et de chiffres, de suppléer le manque d’écriture. Les messagers postés en hauteur, pouvaient transmettre oralement des messages, de poste en poste, avec une certaine rapidité, messages complétés au besoin par des quipus pour les données chiffrées.
Le thème de la « sodomie » est repris au ch. 11 du livre VIe, mais il semble qu’il s’agisse d’une resucée de ce qui a déjà été dit : « Dans la province de Huaillas il [l’Inca Capac Yupanqui] châtia avec rigueur quelques habitants qui s’adonnaient en grand secret au vice abominable de la sodomie. Or comme jusque-là on n’avait point trouvé un tel péché parmi les Indiens de la montagne, alors que ceux du plat pays le commettaient, comme nous l’avons déjà dit, les Incas furent fort scandalisés qu’il existât parmi les Huaillas, tellement que cela donna lieu à un proverbe chez les Indiens de l’époque, dont on use encore aujourd’hui à la honte de cette nation, qui dit : Astaya Huaillas, ce qui signifie : « éloigne-toi, Huaillas », comme s’ils puaient, à cause de leur ancien péché ». Le texte espagnol dit : « algunos someticos, que en mucho secreto usaban el abominable vicio de la sodomia ». Au ch. 19 du même livre VI, c’est mieux : « il y avait parmi eux des sodomites en assez bon nombre, qu’il fit arrêter ; en un seul jour ils furent brûlés vifs tous ensemble, on ordonna de démolir leurs maisons, de ravager leurs propriétés, d’arracher leurs arbres, pour qu’il ne restât à l’avenir aucun souvenir de ce que les sodomites avaient planté de leurs mains ; ils auraient même brûlé femmes et enfants pour expier le péché de leurs pères, si un tel acte ne leur eût semblé cruel ; car ce fut un vice que les Incas eurent par-dessus tout en abomination ». Le texte espagnol donne ici à nouveau « someticos », et une rare note de bas de page de cette édition, à la page 181, explique qu’il faut comprendre « sodomiticos ou sodomistas », ce qui ne nous avance guère, mais semble confirmer qu’il s’agit bien d’homosexuels. Au ch. 36 du livre VI, on relativise ces procédés anti-sodomites en apprenant que l’Inca Pachacutec légiféra tous azimuts : « contre les blasphémateurs, les parricides, les fratricides, les homicides, les sujets qui avaient trahi leur Inca, les adultères, hommes ou femmes ; contre ceux qui enlevaient les filles de la maison de leurs parents ou qui les violaient, contre ceux qui étaient si hardis que de toucher les vierges choisies, ceux qui volaient quelque chose que ce fût, contre les sodomites, les incendiaires, les incestueux ». La place du mot dans la liste n’est-elle pas remarquable ? !
Le ch. 25 du livre VI fournit un cas amusant de la façon de penser de Garcilaso. Il évoque le fait que les hommes fabriquent leurs propres sandales en les tressant avec un bâton et de la laine. Il en profite pour rectifier le propos d’un historien espagnol, qui aurait écrit que les Incas « filaient » : « on peut tenir pour une règle générale que parmi tous les gentils il n’y a pas eu de gens plus virils que les Incas ni qui aient eu tant en horreur les actions efféminées ». On retrouve une intéressante précision linguistique : « Pour dire que les femmes filent ils emploient le verbe buhca, c’est-à-dire filer avec un fuseau pour tisser. Ce mot signifie encore le fuseau lui-même. Et comme c’était le fait des femmes, les hommes n’usaient point de ce verbe, pour ne pas passer pour efféminés » !
Au ch. 26, on apprend que les Incas, prince compris, subissaient tous la même initiation militaire, qui nous est narrée par le menu sur plusieurs chapitres. Au ch. 27, on apprend que « les jeunes guerriers se plaçaient l’un après l’autre devant le roi, et à genoux recevaient de sa main la première et principale marque d’honneur et de dignité royale, qui était d’avoir les oreilles percées. C’était l’Inca lui-même qui les leur perçait à l’endroit où l’on porte ordinairement les pendants, ce qu’il faisait avec de grosses épingles d’or qu’il y laissait fixées pour élargir peu à peu le trou, dont la dimension était incroyable ».
Au ch. 30, il est question de la croyance des incas : ils « croyaient qu’il y avait un souverain créateur de toutes choses, qu’ils appelèrent Pachacamac, c’est-à-dire celui qui a fait l’univers et qui le maintient ».
Au ch. 34, on apprend que l’Inca Pachacutec eut entre 300 et 400 enfants avec toutes ses femmes : « Étant donné un tel père, les Indiens regrettent que ce nombre n’eût pas encore été plus grand » ! Quant à son fils et successeur Tupac Yupanqui, on apprend qu’« il voulut qu’il y eût des professeurs pour enseigner la langue du Cuzco à tous les hommes utiles à l’État. Il s’ensuivit qu’on ne parlait qu’une même langue dans tout le Pérou ». Cela nous étonne, s’agissant d’une langue non écrite. Garcilaso explique les avantages de cette langue qui conférait selon lui plus d’intelligence à ses locuteurs, et permettait l’évangélisation des Indiens mieux que l’espagnol, car tous les Indiens avaient des facilités à apprendre cette langue proche des leurs (cf. aussi tome III, livre VII, ch. 4).
Au ch. 35 est fait mention d’une tradition d’entraide pour les semailles, la récolte, ou même pour construire une maison : « l’Indien qui avait besoin de bâtir la sienne allait au conseil pour que l’on fixât le jour où on pourrait le faire ; les habitants de la ville accouraient d’un commun consentement pour aider leur compatriote et construisaient sa maison en peu de temps ». N’est-ce pas l’origine de la pratique du « mayouri » en Guyane ?
Tome III : livres septième, huitième et neuvième
Quand c’est au tour des Chirihuanas d’être colonisés, Garcilaso n’y va pas avec le dos de la cuillère : « ils n’avaient ni lois ni bonnes mœurs, et ils vivaient comme des bêtes dans les montagnes, sans villes ni maisons ; ils mangeaient de la chair humaine, et pour s’en procurer ils assaillaient les provinces voisines, mangeaient tous ceux qu’ils faisaient prisonniers, sans respecter âge ni sexe, et buvaient leur sang après les avoir égorgés, afin qu’il n’y eut rien de perdu. […] ils allaient tout nus, et ils s’accouplaient même avec leurs sœurs, leurs filles et leurs mères » […] « S’ils trouvent des bergers qui gardent un troupeau, ils préfèrent s’emparer de l’un des bergers que de tout le troupeau de brebis ou de vaches ». Cela ne manque pas de sel, quand il est clairement exposé que les Incas épousaient leurs sœurs. L’Inca (Tupac Yupanqui si j’ai bien suivi) aurait déclaré suite à ce rapport : « Nous n’avons jamais été si fort obligés à conquérir les Chirihuanas, que nous le sommes à présent, pour les tirer de la barbarie où ils sont plongés et leur apprendre à vivre en hommes, car c’est pour cela que le Soleil notre père nous a envoyés au monde » (livre VII, ch. 17). Qui dit mieux ?! Belle mise en abyme du ressort colonial.
La mort terrible d’un arrogant gouverneur espagnol qui crut vaincre avec quelques cavaliers une troupe démesurée d’Indiens est décrite par le menu, si je puis dire : « À chaque danse, ils coupaient un morceau de chair de Pedro de Valdivia, et un autre du prêtre qu’ils avaient attaché près de lui, ils les faisaient rôtir devant eux et les mangeaient ; et que le bon gouverneur, tandis que ces barbares se comportaient si cruellement envers eux, se confessait au prêtre de ses péchés, et qu’ainsi tous deux finirent leurs jours dans cette torture. » Garcilaso précise que ce n’était pas chez cette tribu-là une habitude, mais une façon de marquer leur « courroux » contre ce gouverneur (livre VII, ch. 24). Au ch. 25, est rapportée une révolte violente des Indiens contre les Espagnols, contemporaine de l’écriture du livre, et dont l’auteur a connaissance par sa correspondance.
Au ch. 5 du livre VIII, Garcilaso évoque la province de Palta et sa pratique étonnante : « Les gens de cette nation avaient comme signe distinctif la tête déformée : dès qu’un enfant naissait, ils lui mettaient une planchette sur le front et une autre sur la nuque, les attachaient ensemble et en resserraient les liens tous les jours tout en laissant constamment l’enfant couché sur le dos ; ils n’enlevaient pas les planchettes avant qu’il eût atteint l’âge de trois ans. Leurs tête était ainsi très laide ». On retrouve le même motif au ch. 8 du livre IX. C’est à propos des Paltas que nous est livrée cette réflexion sibylline : « avant l’arrivée de ces derniers [les Incas], les Cañaris adoraient comme dieu principal la lune, et en second lieu les grands arbres et les pierres qui sortaient de l’ordinaire, surtout si elles étaient jaspées. Après avoir été instruits par les Incas, ils adorèrent le Soleil, auquel ils élevèrent un temple […] ». Le lecteur est amené à réfléchir sur cette acculturation, qui précède celle des Incas soumis au même processus par les Espagnols. Partout il traite les dieux des Incas de « faux dieux », mais ce qui est intéressant ici, c’est que la lune n’est pas plus un vrai dieu que le Soleil, ce qui par ricochet pourrait relativiser l’éloge du catholicisme qui suinte à chaque page sous la plume de Garcilaso.
Au ch. 6 du livre VIII, relation d’une province « appelée Quillacenca, c’est-à-dire nez de fer, parce que les habitants se perçaient le cartilage qui est entre les deux narines, d’où leur tombait sur les lèvres un petit joyau en cuivre, ou en or, ou en argent, en manière de pendentif. L’Inca trouva que ces peuples étaient très vils, sales, mal vêtus, couverts de poux qu’ils n’étaient même pas capables d’enlever ». Nouvelle mention de ce type de pratique au ch. 3 du livre IX : « Les Huancauillcas, hommes et femmes, se perçaient la cloison du nez pour y porter attaché un petit joyau d’or ou d’argent ».
Un aspect plaisant du livre est le soin qu’a l’auteur de souligner fréquemment ses doutes sur sa mémoire : « serais-je tenté de dire, bien que, étant enfant, je ne l’aie pas noté alors avec soin, pour pouvoir en parler à présent justement » (ch. 13 du livre VIII) ; « Lorsque je reprends ma mémoire pour cette négligence, celle-ci me demande pourquoi je la gronde au sujet d’une chose dont je suis seul coupable. » […] « Il y a peut-être là quelque exagération, et d’autre part je n’en ai pas été témoin, mais je ne crois pas […] » (ch. 18 du livre VIII).
La partie consacrée aux plantes s’arrête en un long chapitre sur les vertus médicinales et fortifiantes de la feuille de coca, appelée aussi « cuca » (ch. 15 du livre VIII). Celle consacrée aux animaux nous offre un témoignage indubitable de l’existence du marsupilami, dont certain complot judéo-maçonnique voudrait nous cacher la réalité de l’existence et l’extermination sur ordre des Illuminati ! « Ils sont de la race des macaques, mais en diffèrent par leur très longue queue […]. Ils s’accrochent à une branche avec la queue et se précipitent à l’endroit qu’ils ont choisi ; et quand la distance est grande au point qu’ils ne peuvent la franchir d’un bond, ils usent d’un stratagème fort divertissant, qui consiste à se tenir par la queue les uns les autres et à former de la sorte une espèce de longue chaîne. Puis, se balançant tous, le premier, aidé par la force de ses compagnons, saute, atteint la branche qu’il saisit, et sert de support aux autres jusqu’à ce qu’ils aient tous gagné l’arbre en se tenant par la queue » (ch. 18 du livre VIII). Aucune note, bien sûr, dans l’édition française ni espagnole, et rien sur Internet sur cette légende ou cette vérité. Avis aux amateurs pour éclairer notre lanterne…
On retrouve le thème sodomitique au ch. 2 du livre IX : « Les habitants de Tumpiz étaient les plus voluptueux et les plus enclins au vice de tous ceux que les Incas avaient conquis jusque-là sur la côte. […] Ils s’adonnaient à l’abominable vice de sodomie, adoraient des jaguars et des pumas auxquels ils sacrifiaient le cœur et le sang des hommes ». Dans la même région, le seigneur de l’île de Puna est un sacré libertin : « Tumpalla […] non seulement était orgueilleux, mais encore vicieux, voluptueux, avait quantité de femmes et de mignons [1], sacrifiait des cœurs et du sang humains à ses dieux ». Après la victoire, Huayna Capac, comme il se doit, « ordonna […] d’abandonner leurs dieux, de ne pas sacrifier de sang ni de chair humaine, de ne pas la manger, de ne point s’adonner à l’abominable vice de sodomie, d’adorer le Soleil comme dieu universel, de vivre comme des hommes selon la raison et la justice » (livre IX, ch. 4). Tout va à vau l’eau, car c’est de pis en pis ma brave dame : « Les habitants de Manta […] s’adonnaient à la sodomie plus à découvert et d’une manière plus éhontée que toutes les autres nations chez lesquelles nous avons jusqu’à présent censuré ce vice. Ils se mariaient sous condition que les parents et les amis du futur jouiraient de l’épousée avant le mari. » Le point de non-retour est atteint avec la province de Saramissu : « Ils n’avaient ni femmes ni enfants reconnus ; ils étaient sodomites au su et au vu de tout le monde, ne savaient travailler ni la terre ni rien faire d’autre utile ; ils allaient tout nus […] » Huaina Capac décide exceptionnellement de renoncer à sa mission civilisatrice : « Repartons, car ces gens-là ne méritent pas d’être nos sujets ». Un petit dernier pour la route ? Garcilaso cite un long passage de Pedro Cieza de León (qu’il nomme Pedro de Cieza) à propos de prétendus géants [2] qui auraient envahi le Pérou à une époque donnée : « soit qu’ils manquassent de femmes, car celles du pays étaient trop petites pour eux, soit que ce fût un vice auquel ils s’adonnaient conseillés et poussés par le maudit, ils commettaient entre eux l’abominable, énorme et horrible péché de sodomie, et cela en public et à découvert, sans manifester ni crainte de Dieu ni amour propre. Les indigènes affirment que Dieu Notre-Seigneur, ne voulant pas tolérer un péché aussi infâme, leur envoya un châtiment digne de sa laideur. Ils disent qu’alors qu’ils se trouvaient tous ensemble adonnés à leur maudite sodomie, un feu épouvantable tomba du ciel avec un grand bruit, du sein duquel sortit un ange resplendissant, une épée tranchante et brillante à la main, avec laquelle d’un seul coup, il les tua tous ; le feu les consuma, et il ne resta que des os et des crânes ». On aura pu admirer dans toutes ces mentions de la « sodomie », l’assurance avec laquelle l’auteur (ainsi que son prédécesseur qu’il cite) évoque des faits circonstanciés, tout en précisant que ces informations étaient d’une part taboues, d’autre part, que la langue qui permettait de transmettre ces informations était purement orale ! Où l’on constate que daech n’a rien inventé : pour massacrer un peuple, il est toujours utile de l’accuser de « sodomie ». Puissions-nous atteindre en ce domaine un tel degré d’« abomination » que nous les dégoûtions de nous acculturer à leur haute mission civilisatrice !
Un dit de Huaina Capac nous est rapporté, qui accrédite la thèse selon laquelle les Incas préparèrent l’arrivée du christianisme. Comme il regarde le soleil, et qu’un prêtre lui fait remarquer que c’est interdit, il réplique : « notre père le Soleil doit avoir au-dessus de lui quelqu’un de plus grand et de plus puissant, qui lui fait parcourir le chemin qu’il fait chaque jour sans s’arrêter » (livre IX, ch. 10).
À propos d’Atahualpa, le dernier empereur avant l’arrivée des Espagnols, la version Garcilaso de la Guerre de Succession inca diffère fortement de l’article de Wikipédia, et pourtant certaines informations lui viennent de sa propre mère. Il commence par rapporter une pratique consistant à nommer les coqs et leur cri du nom de l’empereur, soit pour le moquer, soit pour le valoriser : « les Indiens dirent que ces volailles, pour perpétuer l’infamie du tyran et rendre son nom éternellement abominable, prononçaient ce dernier dans leur chant en disant : « Atahualpa ! » Et eux-mêmes le prononçaient en contrefaisant le chant du coq. » (livre IX, ch. 23). Puis il relate par le menu les cruautés de ce roi qui selon lui fit assassiner « deux cents de ses frères », mais encore « ses neveux, oncles et parents, jusqu’au quatrième degré et au-delà ». Les tortures de mort lente infligées aux femmes et aux enfants sont particulièrement détaillées, d’où il résulte pourtant qu’échappèrent à la mort « des garçonnets et des fillettes de moins de onze ou dix ans ». Sa mère et son oncle firent partie de ce nombre, et Garcilaso affirme rapporter leurs propos sur le massacre.
Au ch. 31 livre IX, il est question des différents mots permettant de désigner les habitants du Pérou après la conquête. Le mot « créole » sert pour noirs et blancs : « l’Espagnol et le nègre de Guinée qui sont nés au Pérou sont appelés créoles. Le nègre importé est appelé tout simplement nègre ou Guinéen. Le descendant d’un nègre et d’une Indienne, ou d’un Indien et d’une négresse, est appelé mulâtre ou mulâtresse. Leurs enfants sont désignés sous le nom de cholo ; c’est un mot des îles de Barlovento qui veut dire chien, non de race, mais de ceux qui sont fripons et effrontés ; les Espagnols s’en servent comme d’un terme infamant et offensant. Nous, descendants d’Espagnol et d’Indienne ou d’Indien et d’Espagnole, on nous appelle métis, pour dire que nous sommes un mélange des deux races. […] je le profère quant à moi à pleine bouche et j’en suis fier » (exemple d’appropriation du stigmate ; cf. notre article sur les insultes). Et cela continue, avec les mots « cuatralbos » et « tresalbos », qui doivent correspondre aux mots français « quarteron » et « terceron », quoique « cuarterón » existe en espagnol.
– Les commentaires s’achèvent abruptement sur ce livre IX, qui annonce la suite, mais la seconde partie posthume ne fut publiée qu’en 1617, et reste disponible (hélas, pas en français), sous le titre de Historia General del Perú.
– L’illustration de Théodore de Bry (1528-1598) ci-dessus provient de cet article.
– Pour en savoir plus, lire sur Persée, « Quelques aspects de la religion incaïque, selon les Commentaires royaux de l’Inca Garcilaso de la Vega et certaines chroniques espagnoles du XVIe siècle », un article savant d’Albert Garcia (Bulletin hispanique, 1964). On consultera également un article de Pierre-Olivier Combelles intitulé « À propos du drapeau arc-en-ciel des Incas ».
– L’album de Tintin Le Temple du Soleil aurait bénéficié de la lecture du livre de Garcilaso de la Vega.
Voir en ligne : Les Commentaires sur Wikipédia
© altersexualite.com, 2016.
[2] Cette légende ne semble pas commune avec celle des Patagons d’Antonio Pigafetta, qui auraient donné naissance au nom de la Patagonie.
 altersexualite.com
altersexualite.com