Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Le syndrome d’Alcibiade
Amour, sexualité et littérature jeunesse : quelles alternatives au roman sentimental ?
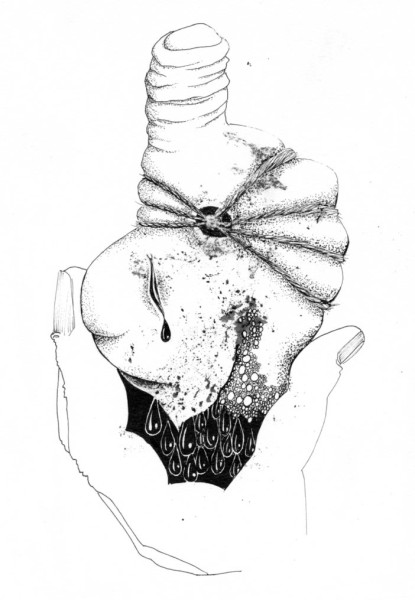 Le syndrome d’Alcibiade
Le syndrome d’Alcibiade
Un article fait pour la revue « Lecture jeune », que cette revue n’a pas daigné publier
vendredi 25 février 2011
Anne Clerc, la rédactrice en chef de cette revue, me contacte en juin 2010 pour un article sur ce thème. Enthousiaste, j’écris trois fois plus long que ce qui est demandé, me disant qu’il n’y aura qu’à élaguer, en gardant le reste pour mon site. Chaque fois que je tente de l’appeler, je tombe sur un répondeur, ou bien la bonne dame est pressée et me rappellera demain. Elle finit par m’envoyer un mail ainsi tourné : « Je revenais vers vous concernant votre article que je trouve admirablement écrit et pourtant, il me gêne un peu et je vais tenter de vous expliquer pourquoi !
Je souhaite dans ce numéro montrer que la litt. ados aborde souvent l’amour par le biais des stéréotypes et qu’elle passe sous silence la sexualité… Le fait que les adultes n’écrivent pas sur ce sujet n’est pas ce qui me dérange le plus, car il s’agit de l’intime… Ce qui me choque, ce sont les catégories sociales figées et les séries « chick lit » à la pelle qui omettent d’évoquer qu’une relation peut être amoureuse ou non, hétérosexuelle, homosexuelle… et pourquoi pas un ado peut aussi ne pas avoir de rapports à cet âge-là… Bref, que la litt. ados puisse éveiller un champ de possible !
Votre article est résolument tourné vers la question de la sexualité, et j’aimerais qu’il soit aussi question de l’amour, d’un point de vue du « sentiment amoureux » car aborder la question sous ce seul angle donne aussi l’impression qu’il faut à tout prix montrer aux ados que la sexualité c’est le plaisir ! Aussi, pourriez-vous modifier un peu l’article en ce sens ? »
Je remanie l’article, le diminue de moitié (quelques heures de travail supplémentaire), m’attendant à ce que le dialogue continue (j’avais rendu ma copie très en avance, et on avait donc largement le temps). Si cette dame m’avait contacté, c’était parce qu’elle appréciait mes articles, dont elle était soi-disant une lectrice assidue. Elle devait donc bien savoir quel était mon angle d’attaque, et d’ailleurs ce qu’elle demandait, c’était de modifier « un peu ». Mais plus le moindre signe, aucun appel, aucun mail, et le numéro paraît fin décembre. On a remplacé mon article par un autre. Je ne conteste pas la liberté éditoriale, j’aurais simplement apprécié un peu de politesse. Un autre problème est qu’on m’avait parlé d’une rémunération. J’ai fait le travail, et trois fois plus, et pour la rémunération, je peux aller me faire foutre. Et bien sûr, ce sont ces gens-là qui vont vous faire des théories de gauche sur les respects des droits, de la dignité, sur la méchante droite capitaliste qui exploite les gentils travailleurs, des valeurs que la bonne littérature jeunesse se doit de défendre. Mon cul ! Bien sûr, en publiant ici la vérité plutôt que de courber le dos, je ne fais que justifier la censure que la mafia de la littérature jeunesse me fait subir depuis que je m’en mêle. On me fera donc payer mon attitude. Mais de toute façon je la paie, alors, autant au moins continuer à dire ce que je pense. Il y a bien quelques centaines de lecteurs qui y trouveront leur compte, et sur tous ceux-là, bien deux ou trois par an qui, pour me remercier, auront la curiosité, la grandeur d’âme, la générosité, d’aller jusqu’à acheter un de mes livres. Voici donc mon article. Je tâcherai de le proposer à des éditeurs jeunesse, mais sans illusion. Ils aiment bien que je leur fasse de la pub avec mes critiques, mais de là à me publier… En cadeau, cette citation du livre IX des - Confessions, de Jean-Jacques Rousseau : « la haine des méchants ne fait que s’animer davantage par l’impossibilité de trouver sur quoi la fonder ; et le sentiment de leur propre injustice n’est qu’un grief de plus contre celui qui en est l’objet. »
La question de l’amour et de la sexualité dans la littérature jeunesse en 2010 remue bien des hypocrisies. L’hypocrisie d’une société entière tout d’abord, qui prétend qu’une révolution sexuelle a eu lieu en 1968, et qui persiste à présenter la sexualité aux adolescents comme une monstruosité terrifiante, tout en les laissant accéder, ou du moins sans parvenir à les empêcher d’accéder à des supports qui leur montrent une tout autre réalité : une activité humaine relativement bon marché, qui permet de bien s’éclater – le « café du pauvre ». L’éducation scolaire à la sexualité se limite trop souvent en effet à une « prévention des risques », qui prononce rarement les mots « désir » ou « plaisir », mais se délecte à mettre en avant sida et MST, grossesses non désirées, violences domestiques ou violences de genre, surtout celles contre les femmes, pornographie, pédophilie, et autres abus sexuels [1]. La seule différence avec le XIXe siècle semble être que la masturbation est devenue, tacitement, la seule planche de salut de l’adolescent (garçon ; pour les filles, cela reste plus compliqué) : elle ne le rend plus sourd, et il arrive que les adultes en plaisantent sans lui promettre l’enfer s’il s’y adonne, comme ce fut le cas jusque dans les années 1950. Ouf ! Cela ne va pas bien sûr jusqu’à évoquer la masturbation en classe ; il faudra encore quelques dizaines d’années pour cela !
Cet état d’esprit contribue à prolonger le tabou sur la sexualité dans les lectures proposées aux jeunes. Si un enseignant donne à lire à toute une classe de troisième un livre contenant par exemple le récit d’une masturbation ou d’une fellation, il y aura forcément sur les trente élèves, quelques-uns qui s’estimeront « choqués » et le feront savoir. Mais ce « choc » aura un retentissement tout particulier par son lien à la sexualité, et de là à donner au responsable la réputation de corrupteur de la jeunesse, il n’y aura qu’un pas (cela vaut bien sûr pour tous les médiateurs, bibliothécaires notamment). « Choquer » est au centre de l’acte éducatif, et quand on apporte une connaissance nouvelle solide, cela implique parfois de briser une certitude ancienne, comme un pot de fer qui trinquerait contre un pot de terre. On « choque » en apprenant que la terre n’est pas plate, que les êtres vivants n’ont pas été créés d’une seule pièce, que la vie sur terre pourrait disparaître ; mais pourquoi a-t-on si peur de « choquer » dès qu’il est question de sexualité ? C’est qu’on touche à l’intime, au pré carré des religions et souvent à la sexophobie et à l’homophobie prônées par ces religions.
Pour mieux s’assurer de ce conditionnement pavlovien, « on », c’est-à-dire l’inconscient collectif représenté par les médias et la classe politique, laisse planer sur tout adulte éducateur le soupçon d’être un corrupteur de la jeunesse, sinon un pédophile en puissance, de façon à le faire réfléchir à deux fois si jamais il lui venait à l’esprit l’idée saugrenue de faire son travail, c’est-à-dire de contribuer à l’éducation sexuelle. Nous appellerons ce soupçon le « syndrome d’Alcibiade », du nom de ce futur général athénien qui dans Le Banquet de Platon, proclame haut et fort son désir de coucher avec son éducateur Socrate, lequel s’y refuse inflexiblement. Ce désir impossible de l’élève pour l’éducateur est au centre de la problématique de nombreux romans pour la jeunesse qui ont contribué, durant ces quinze dernières années, à bousculer le tabou, c’est-à-dire pour être clair à contrebalancer le matraquage anti-pédophile, qui braque une énorme loupe sur l’inverse : le désir de l’éducateur pour l’élève. Bien sûr, pour nous, l’auteur de littérature jeunesse n’est pas innocent dans ce jeu avec son lecteur, et la composante éducative de ce secteur éditorial est trop évidente pour que l’auteur ne se projette pas autant dans le personnage prof que son lecteur dans le personnage élève.
La Loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, qui ne sert plus à rien et dont on se demande quel gouvernement aura le courage de l’abroger [2], a longtemps contribué à cet état d’esprit, en stipulant dans son article 2 : « Les publications visées à l’article 1er ne doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l’enfance ou la jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. » « Débauche » et « démoraliser », voilà qui trahit l’inspiration pétainiste de cette loi. Avant l’existence du Pacs, qui promut l’homosexuel de « débauché » à citoyen respectable, l’homosexualité, la question transgenre, ou toutes expériences altersexuelles* au sens large, étaient autocensurées sinon censurées dans le secteur jeunesse. La même loi, qui servit surtout pendant cinquante ans à censurer les publications destinées aux adultes, permettait par son article 14, au ministre de l’intérieur, d’interdire « de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique » [3]. Dans ces conditions, toute scène susceptible d’être caractérisée de licencieuse ou pornographique – termes impossibles à définir objectivement – était a fortiori inconcevable en littérature jeunesse. Les progrès technologiques d’une part, la mondialisation d’autre part, et la désinhibition insensible des mœurs, ont fait petit à petit éclater le carcan de la littérature jeunesse, de l’intérieur, et de l’extérieur. Le marché du roman sentimental a de beaux jours devant lui, mais nous verrons dans notre première partie qu’il y a un décalage entre une littérature romanesque « pour les filles » et d’autres produits culturels, qu’ils soient réputés pour filles ou pour garçons. Dans la seconde partie, nous étudierons l’intrusion progressive depuis une quinzaine d’années de la sexualité génitale dans la littérature pour ados. La troisième partie nous conduira vers l’apport particulier des personnages homosexuels ou transgenres dans la libération sexuelle de la littérature pour adolescents.
Le roman pour ados et le déni de la sexualité
« Demain, ils s’embrasseraient peut-être. Dans les semaines, dans les mois qui viendraient, ils apprendraient à se toucher, à traduire leurs sentiments en gestes. Un jour, elle l’espérait, ils feraient l’amour.
Mais pour l’instant, elle avait tout ce qu’elle voulait. ».
Dans cet extrait de Quatre filles et un jean, d’Ann Brashares (Gallimard, 2009, L’intégrale de la série. « Le troisième été », p. 717), Bridget, la jeune fille dont il est question, a 17 ans ; Éric, le garçon, 20. Ils se connaissent depuis deux ans, ils sont entraîneurs sportifs dans un camp de vacances pour ados un peu plus jeunes qu’eux ; ils ont la jeunesse, la beauté, la « popularité » ; tout leur sourit. Lors de leur première rencontre, deux ans auparavant, Bridget avait quasiment forcé Éric à coucher avec elle, malgré l’interdit (à l’époque il était éducateur et elle seulement élève ; première version ultra-light du « syndrome d’Alcibiade »). Mais une ellipse avait caché au lecteur, ou plutôt à la lectrice, ce qu’ils étaient censés avoir fait. Deux ans plus tard, on pourrait les croire plus audacieux, d’autant que l’interdit est tombé : ils sont tous deux éducateurs. Eh bien ! non : ils ont dormi sagement à deux dans la même tente, et ça leur suffit. À part ça, tous les personnages adolescents de ce best-seller planétaire d’Ann Brashares, possèdent cartes de crédit et voitures ; ils étudient en fac, et sont de bons Étasuniens presque adultes. Mais ils ne baisent pas, ou s’ils le font, c’est la catastrophe, à l’exemple de Tibby, qui au bout de plusieurs années de flirt avec son petit ami attitré Bryan – modèle de galanterie et de prévenance, tous deux brillants étudiants – finit par se laisser aller à coucher. Malheureusement, c’est le vin qui pousse au coït, et comme on n’a consacré aucune minute de ces longues années de flirt à réfléchir à cette fatale première fois, on le fait n’importe comment, en utilisant un unique préservatif que le garçon conservait dans son portefeuille depuis des mois, voire des années ! Le préservatif se déchire, et c’est le drame, la rupture du couple, etc. Il est significatif de l’état d’esprit de l’Occident actuel que la seule rupture envisagée lors d’une première fois ne soit plus celle de l’hymen. Vous avez dit Pavlov ? Le message est clair : adolescents, fantasmez à fond la caisse (les mille pages de cette intégrale ne sont faites que de fantasmes de ces demoiselles sur les garçons et réciproquement), mais ne baisez pas, sinon les foudres de l’enfer s’abattront sur vous. On croit vérifier l’observation de la sociologue Isabelle Clair : « les larmes et le coït sont attendus comme des moments clés du script amoureux » (Les jeunes et l’amour dans les cités, Armand Colin, 2008). On est dans le roman-photo, et l’on joue à se faire peur avec des sentiments qu’on tâche de vivre comme les grands, en salant la relation de tous les risques qu’on a appris à l’école. Tout coït doit se payer de larmes. Tu n’enfanteras peut-être pas, mais tu baiseras dans la douleur, tel semble être le nouvel oukase de la morale sexuelle laïque. La façon dont nous vivons l’amour en Occident est une idéologie, et cette idéologie et les produits culturels qui la relaient se soutiennent et s’informent réciproquement.
Le roman historique français, une autre niche du marché de l’édition jeunesse, ne présente pas une vision de la sexualité plus ludique. Les adolescents n’ont pas besoin de l’école pour connaître la réputation d’homosexualité et de luxure de la civilisation gréco-romaine. On pourrait espérer que ce soit l’occasion pour les auteurs d’aborder la sexualité en dehors du couple monogame judéo-christiano-islamique. Ce n’est pas si simple, et sauf oubli de ma part, on attend le premier ouvrage qui présenterait une vision altersexuelle de ces cultures. Dans La conspiration des dieux (Galimard Folio, 2009), Richard Normandon évite soigneusement toute allusion à l’homosexualité ; tout au plus évoque-t-il de façon plaisante des relations extra-conjugales hétérosexuelles. Pour Les cendres de Pompéi (Gallimard, 2010), Christine Féret-Fleury a choisi comme jeune héroïne une esclave grecque servante dans un lupanar. Le jour où elle a ses règles, elle fuit l’endroit, car cela signifie qu’elle doit devenir prostituée. Choix audacieux : pour une fois qu’on ne tombe pas dans la facilité d’une civilisation latine qui ne serait qu’obsession de la mythologie. Malheureusement, cette jeune fille, à l’instar du héros de Richard Normandon, est façonnée dans une mentalité occidentale du XXe siècle. Bien que travaillant dans un lupanar, elle considère la sexualité comme un truc super sérieux auquel on pense une fois qu’on a son bac. Aucune alternative entre la sainte et la putain pour nos lecteurs ados (ou plutôt pré-ados pour cette collection « Mon Histoire »).
Il ne faut pas croire que ce déni généralisé de la sexualité en littérature jeunesse, même s’il souffre quelques exceptions qu’on verra dans la partie suivante, trompe les adolescents. Le cinéma et Internet, sont de rudes concurrents, mais ne parlons que du secteur livres. Le retard de la littérature pour ados historique est patent et pathétique. Les mêmes ados qui bâillent en lisant des romans historiques édulcorés, se délectent de séries de bandes dessinées comme Le vent des dieux, de Patrick Cothias et Philippe Adamov, qui montre sans fausse pudeur par le dessin la sexualité telle qu’elle a pu se pratiquer dans la société féodale japonaise du XIIIe siècle. La série Murena de Jean Dufaux et Philippe Delaby (8 volumes parus depuis 1997) montre nos ancêtres romains du Ier siècle tels qu’ils furent, sexualité (hétéro et homo) comprise. On ne saurait trop conseiller aux éditeurs de romans historiques jeunesse de se pencher sur cette concurrence, de façon à dépoussiérer leur catalogue.
Et comment ne pas évoquer le phénomène des mangas ? Il n’est pas étonnant que de nombreux adolescents ne lisent que des mangas. Les « yaoi », qu’on appelle désormais « Boy’s love », racontent, à destination des jeunes filles, prétend-on, des romances de garçons gays. Le roman sentimental à la japonaise, dépoussiéré des hypocrisies occidentales. En effet, pourquoi aimer faire l’amour empêcherait-il d’être sentimental ? La sexualité y est souvent montrée sans fausse pudeur, y compris dans son aspect génital. Le succès foudroyant de ces publications ne devrait-il pas inciter le marché du roman sentimental à évoluer vers moins d’hypocrisie, de crainte de voir filer son lectorat ? Mais ne touche-t-on pas à un problème de la littérature jeunesse en France, qui est celui du passage obligé par les prescripteurs, surtout les enseignants ? Les mangas se lisent toujours comme sous le manteau, et nombre d’enseignants n’en ont toujours pas ouvert un seul. Les romans doivent passer sous les fourches caudines de la critique, pas la critique littéraire qui ne se préoccupe que d’art, mais la critique moralisatrice qui se préoccupe des risques dont il faut préserver nos adolescents. Ce qui ne manque pas de sel, c’est que dès que l’on sort du pré carré de la littérature tamponnée « Loi de 1949 », les prescripteurs n’hésitent pas à conseiller des œuvres dans lesquelles la sexualité est au premier plan. La vie devant soi, de Romain Gary en est un bon exemple : un garçon de 10 ans se livre à toutes les expériences avec son sexe, fréquente des prostituées et un travesti. C’est un roman très souvent choisi en classe de seconde, et avec raison. A-t-on osé l’équivalent dans une collection pour ados ?
L’intrusion de la sexualité génitale dans le roman pour ados
La sexualité génitale a longtemps été tacitement exclue du domaine de la littérature jeunesse, ce qui n’empêchait pas qu’on pouvait y évoquer des problématiques liées à la sexualité. Petit à petit, une autre loi tacite s’est plus ou moins établie avec l’apparition de collections pour adolescents de 15 ans et plus (donc ayant atteint en France la majorité sexuelle) : pas de sexualité génitale dans les romans destinés aux collégiens (jusqu’en troisième) ; sexualité au-delà. Je me suis moi-même imposé ce distinguo entre mes deux romans L’année de l’orientation (Publibook, 2003) puis Karim & Julien (Publibook, 2007). Dans le premier, les personnages échangeaient des idées sur la sexualité, l’homosexualité ; dans le second, ils expérimentaient. Il se trouve que cela correspondait à la trajectoire de mes personnages, de même qu’il correspond à la trajectoire de Momo dans La vie devant soi d’expérimenter la sexualité bien plus précocement. Cette loi tacite rend d’autant plus admirable le tour de force de Gudule, qui avait fait le pari avec l’éditeur Thierry Magnier d’insérer une scène quasiment porno dans un roman destiné aux élèves de 4e / 3e, voire plus jeunes, et qui est devenu un best-seller : L’amour en chaussettes. En fait de porno, il s’agissait de peu de choses : raconter en détail la première fois d’un garçon et d’une fille. De plus, cette première fois avait l’avantage de guérir l’héroïne de son « syndrome d’Alcibiade » : au début du roman, elle fantasmait sur son prof qui donnait de sa personne pour enseigner le maniement du préservatif, et se mettait à le harceler. Heureusement, le prof la remet en place, en utilisant un argument un peu facile : présenter à la demoiselle son petit ami, de façon à la rabattre sur des camarades de jeu de son âge. Œuvre salutaire et très morale quand les éducateurs passent leur temps à rabâcher aux ados que non, le cinéma porno ce n’est pas ça l’amour, et qu’ils n’ont rien à proposer à la place qui soit l’amour. Mais les censeurs ne voient pas la contradiction – d’autant plus que Gudule, avant même la date-clé du Pacs, avait doublé la provocation en présentant un prof homo qui ne fût pas pédophile mais au contraire victime d’une ado adultophile ! – et le livre fit scandale dans le cloaque de l’extrême droite familialiste, ce qui aida à son succès. Un extrait de cette longue scène : « Brusquement, j’ai réalisé qu’il ne bégayait plus. Et ça m’a donné un tel choc que mon bassin a foncé vers l’avant sans que je puisse l’en empêcher. Et crac ! son « truc » est entré d’un coup jusqu’au fond de moi. J’ai senti quelque chose se déchirer dans mon ventre, et j’ai crié.
Arthur n’osait plus bouger. Il me serrait contre lui à m’écraser.
— Delphine... Delphine... Delphine… il haletait.
La douleur s’est calmée très vite, remplacée par une sensation mouillée, un peu comme des règles. Quand il a senti que je me décrispais, Arthur s’est lentement retiré, puis est re-rentré. Ce n’était plus douloureux, ça glissait bien. Au bout de deux ou trois mouvements, il a eu comme un grand frisson et s’est laissé tomber de tout son poids sur moi. Il grelottait. J’ai compris que c’était fini. »
En 2004, les éditions Gallimard ne veulent pas être en reste, et font traduire Une idée fixe, de Melvin Burgess (paru en 2003 en anglais), le sulfureux auteur de Junk, dans la collection Scripto, mais avec la mention apotropaïque de « hors-série », pour avertir les trop innocents lecteurs et conjurer le mauvais sort des fort peu innocents familialistes. Ce roman ose parler de sexualité avec naturel et sans pudeur, d’une façon qui intéresse les jeunes, qui les renvoie à leurs problèmes quotidiens dont ils n’osent sans doute guère parler même avec leurs amis. Et pour une fois, la sexualité est vue côté garçons, ce qui donne une patine tant soit peu macho, ainsi qu’une homophobie de convenance si l’on peut dire, qui peuvent agacer. Cerise sur le gâteau, on retrouve notre fameux « syndrome d’Alcibiade », mais cette fois-ci, Melvin Burgess ose le passage à l’acte : non seulement Ben, 16 ans, se tape sa prof de théâtre, mais celle-ci, nymphomane et dépressive, insiste pour que leurs rapports aient lieu au sein même du lycée, dans les endroits et aux moments les plus insolites ! Où l’on voit que le fantasme du film porno est à portée de main ! Une étape a donc été franchie : un roman jeunesse entièrement consacré à l’amour et à la sexualité, et qui n’hypertrophie pas les risques au détriment du plaisir. Nous ne voulons pas non plus faire croire aux ados que la sexualité soit forcément plaisir, mais replacer le curseur au centre.
Dernière étape, le roman porno pur et simple. Je reviens de mourir, d’Antoine Dole (2007, Sarbacane, collection Exprim’) a fait scandale. Histoire complexe de la déchéance d’une jeune femme qui tombe sous la dépendance d’un maquereau, croisée avec celle d’une femme qui vit une sexualité débridée. Le style, très recherché, ne rechigne pas à la pornographie : « Une fille comme elle, qui nique comme un mec, sans minauder ni enrober les choses dans de la guimauve, elle les rend complètement dingues. Il a aimé qu’elle lui grimpe dessus et qu’elle décide de tout, du moment où elle s’est empalée sur sa queue jusqu’à celui où elle l’a fait jouir en le branlant » (p. 29). Personnages adultes, style adulte, collection qui s’affranchit de la loi de 1949. Parfait, mais en quoi s’agit-il encore de littérature pour adolescents ? Peut-être un certain côté moral : prévenir les jeunes lectrices des risques qu’elles courent à s’enticher d’un garçon un peu louche ? Le roman se rachèterait du péché de la pornographie en donnant une image délétère, dysphorique, de la sexualité : en gros, on reste dans le « regardez comme c’est mal ». En tout cas, cette étape franchie, on passe à une étape suivante, où le sentiment amoureux, y compris la sexualité, peut être mentionné sans tabou au sein d’un roman dont ce n’est pas la thématique centrale. Nous citerons trois exemples.
Le photographe, de Mano Gentil (Syros, 2006) est l’histoire de la dernière exécution capitale en France. On est plongé dans l’esprit de l’exécuteur, en veine de confidences sur sa vie privée, avec un ton typique d’une littérature jeunesse décomplexée : « J’aime sa peau. Elle est douce. Très douce. Nicole s’épile beaucoup. Aucun poil ne lui résiste. Au début, j’ai été surpris par son pubis réduit à peu et puis je m’y suis fait. J’y ai même pris goût. » (p. 25). « Ensuite elle a cherché mon sexe de la main et, le trouvant en mauvaise forme, son excitation a redoublé » (p. 31). Un roman rare en catégorie jeunesse, en ce sens que les personnages, tous adultes, ne permettent pas l’identification du lecteur. Mais il est remarquable que l’auteure ait conféré un intérêt à la sexualité du personnage, et que son éditeur l’ait suivi. L’accès du bourreau à l’érotisme permet en effet de comprendre que la peine de mort tranche désormais avec l’évolution des mœurs, et que son abolition devient inéluctable. Conclusion : quand Ann Brashares instillera de l’érotisme dans ses romans, la peine de mort sera abolie aux États-Unis !
Tout doit disparaître, de Mikaël Ollivier (Thierry Magnier, 2007) commence par la découverte précoce de l’amour par le personnage principal, Hugo, dont les parents s’installent à Mayotte, une île française musulmane où le sexe est considéré comme naturel et se pratique précocement. Zaïnaba, âgée de 16 ans alors que Hugo en a 14, et déjà mère d’un petit garçon, l’entraîne dans son « banga » et fait l’amour avec lui ; les voilà qui sèchent les cours pour se livrer à cette éducation sexuelle moins rébarbative que celle dispensée par les profs. Quand il apprend qu’elle est enceinte, le garçon prend peur et rentre en France pour vivre une histoire d’amour plus conforme aux normes sociales métropolitaines. Le style n’est pas du tout érotique, mais on est aux antipodes au sens propre et au sens figuré de notre conception occidentale de la sexualité, et du roman sentimental, qu’on rejoint dans la deuxième partie du roman.
Rien que ta peau, de Cathy Ytak (Actes Sud Junior, D’une seule voix, 2008), contient le récit d’une première fois que l’auteure a situé symboliquement en un lieu assez inattendu, mais familier à ses lecteurs : sur un lac gelé, dans un duvet. Le style est métaphorique, on est dans la lignée de Gudule, et on reste en littérature jeunesse : « Ton sexe est entré dans le mien. Le rideau de velours rouge s’est ouvert. Tu as repoussé, doucement, ce petit bout de peau d’enfance. » (p. 72). Il reste un aspect moral et, disons, pédagogique, qui nous rappelle le roman d’Ann Brashares : le garçon a tenu à apporter un préservatif (et un seul !), mais ce n’est pas le préservatif qui rompt ; l’hymen existe encore dans les romans ruraux 100 % bio de Cathy Ytak ! Ce souci un peu conditionné du préservatif en littérature jeunesse nous conduit à notre dernière partie : la place particulière de l’homosexualité et des trangenres. En effet, si les homos sont entrés dans cette littérature, avec de grandes réticences au début, ç’a été par le détour ou le prétexte de la lutte contre le sida et du bourrage de crâne que l’on fait subir aux adolescents depuis bientôt trente ans pour l’utilisation du préservatif – et donc le rappel constant du risque du sida et de la grossesse non désirée – qui constitue souvent l’alpha et l’oméga de notre triste éducation à la sexualité. La littérature jeunesse participe de ce conditionnement pavlovien univoque au risque zéro ; pourtant, les auteurs et les auteures devraient se rappeler les bonnes vieilles méthodes Ogino et Billings, sans doute plus adaptées dans le cas de deux personnages puceaux au risque de MST nul !
L’intrusion des personnages altersexuels en littérature jeunesse
Commençons par citer le contre-exemple significatif de Harry Potter. J.K. Rowling, après la publication du dernier tome de la série, a déclaré que son personnage Dumbledore était homosexuel, ce qui lui a valu des félicitations du monde entier comme si elle était devenue la Lancelote de la lutte contre l’homophobie. Or, de cette révélation fracassante, aucune trace explicite dans l’œuvre ! L’auteure n’a sans doute pas voulu choquer ses lecteurs ! Le sentiment amoureux est quasiment absent chez les jeunes personnages. Ils sont tous à 100 % hétérosexuels, ne songeant qu’au mariage et à la progéniture qui poursuivra leur lignée. On pourrait voir dans la manie de Harry de se toucher la cicatrice qu’il a sur le front, une métaphore à l’ancienne de la masturbation, puisque cette cicatrice est la trace du Mal en lui, qu’il faut extirper. Bref, on reste dans la lignée du roman sentimental ringard, ce qui explique son succès planétaire, et la tentative de l’auteure de tirer à elle la couverture de la lutte contre l’homophobie fait pitié.
L’entrée en littérature jeunesse de personnages homosexuels, et dans une bien moindre mesure, transgenres, même si elle a une préhistoire, date surtout de l’adoption du Pacs en France, et de la reconnaissance des couples de même sexe dans les autres pays d’Europe (dont certains sont totalement ignorés par les éditeurs français qui ne semblent connaître dans le domaine jeunesse, en dehors du mastodonte anglo-saxon, que les langues scandinaves, le néerlandais et l’allemand). Sur plus d’une centaine de titres que j’ai recensés depuis 2005 sur le site altersexualite.com, je n’en mentionnerai que cinq ici, en plus de celui de Gudule cité supra. Mais avant de commencer, quelques mots sur les personnages transgenres, dont la présence est encore taboue en littérature jeunesse. Le plus explicite est sans doute La face cachée de Luna, de Julie Anne Peters (Milan, coll. Macadam, 2004), qui présente le parcours de transition d’une jeune transgenre MtF (homme vers femme), raconté par sa sœur. Mais la préoccupation du changement de sexe laisse de côté celle de l’amour. Il existe un roman publié non pas en collection jeunesse, mais chez L’Harmattan, qui me semble plus réaliste : Ne m’appelez plus Julien, de Jimmy Sueur (2003). Il retrace le parcours d’une transgenre depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte, sans cacher les difficultés sociales liées à ce parcours, ni la sexualité, parfois forcée, parfois désirée, du personnage. Cela en fait à mon avis un roman particulièrement adapté aux adolescents, qui devrait être repris par un bon éditeur jeunesse. En dehors de ces deux livres, citons également Le garçon bientôt oublié, de Jean Noël Sciarini (2010), que je trouve un tantinet trop militant et noircissant le tableau, et Alexis, Alexia…, d’Achmy Halley (2004). Il existe aussi deux recueils de nouvelles traduits de l’anglais et du japonais, et puis c’est tout, à ma connaissance ! Passons maintenant aux romans à personnages homosexuels.
Frère, de Ted Van Lieshout (La Joie de Lire, 1996), est un chef-d’œuvre publié en Belgique flamande en 1996, et traduit en français non pas bien sûr en Wallonie, ni même en France, mais par un éditeur suisse, en 2001 ! C’est un modèle assez indépassable du roman pour jeunes à personnages homosexuels permettant l’identification, et qui se bat sur les deux fronts, de la revendication de tolérance, et de la sexualité génitale. Avant l’ouvrage de Gudule [4] (mais après dans la publication française), il présente une scène de dépucelage explicite parfaitement adaptée à un public adolescent : « On n’est jamais certain que l’autre a lui aussi une quéquette tant qu’on ne l’a pas vue. Ou sentie ! Je sentais son organe se presser contre mon ventre et le mien s’écrasait tout aussi fort contre lui. Mais ce qui était étrange, c’était que je n’arrivais pas à déterminer lequel des deux était le mien et lequel celui de Lex. J’en sentais deux et ils appartenaient à nous deux. Nos hanches coulissaient d’avant en arrière et nos tiges se poursuivaient, se croisaient, se détachaient brusquement, se recroisaient – c’était comme si nos corps étaient faits l’un pour l’autre, tant tout s’emboîtait à merveille, tant nous étions destinés l’un à l’autre. Je ne vois pas d’autre explication. Dans les films de cape et d’épée, les gars brandissent leurs armes dans le but de mettre l’autre KO – Lex et moi menions, nous aussi, une sorte de duel à l’épée, mais entre nous la paix régnait » Toute plaisanterie mise à part, on peut se demander si la loi de 1949 en France comme la Clause 28 au Royaume-Uni [5], n’ont pas joué un rôle de frein dans la libération sexuelle de la littérature jeunesse, si l’on considère la liberté des auteurs scandinaves, néerlandais ou flamands qui n’étaient pas soumis à ces lois.
Mentionnons brièvement All together, d’Edward van de Vendel, parce qu’il nous semble constituer l’aboutissement et le pendant du précédent. Publié en 2006 et traduit du néerlandais en 2010, voici un des premiers romans à personnages homosexuels que l’on puisse considérer comme post-lutte contre l’homophobie. Il n’y a plus aucune volonté revendicative ; les parents du personnage homo ne savent plus quoi faire pour l’inciter à vivre à fond sa première expérience amoureuse avec un garçon. Les personnages se contentent de jouir de la vie et de profiter de leur expérience people (ils sont sélectionnés pour participer au concours de l’Eurovision). On peut le considérer comme un roman sentimental homo, même s’il reste, à l’état de traces, des mentions de sexualité dans la parlure des personnages, mais jamais dans une scène, alors que c’est le garçon homo qui est le narrateur : « Le matin, on a baisé en douceur » (p. 59) ; « Je suis une vraie pute » (p. 87) ; « j’ai joui comme je n’avais plus joui depuis des mois » (p. 348). Le comble est que le personnage central est censé suivre les cours d’une école de création littéraire ! Comme écrivait André Gide, « L’art naît de contrainte, vit de lutte, meurt de liberté » (« L’évolution du théâtre », Prétextes).
Sweet Homme, de Didier Jean et Zad (Syros jeunesse, 2003) est un beau roman dont l’action se situe dans un collège. La sexualité génitale n’est pas présente, mais si je le cite c’est parce qu’on y retrouve un cas significatif, une forme bénigne du « syndrome d’Alcibiade ». Axel entretient une relation amoureuse avec un surveillant du collège, ce qui entraîne une erreur fâcheuse des auteurs, qui font déclarer au conseiller d’éducation, lorsque les parents d’Axel se plaignent à lui, que, du moment qu’Axel a plus de 15 ans, le surveillant « ne peut pas être attaqué en tant que personne ayant pratiqué un abus d’autorité sur mineur ». Le surveillant est dans l’univers du fantasme adolescent, une sous-espèce alternative au prof, et de tels romans sont utiles sans doute parce qu’ils mettent par écrit le non-dit fantasmatique de la vie scolaire.
On ne peut pas oublier dans cet article le chef d’œuvre et best-seller de Marie-Aude Murail, Oh boy ! (2000). Dans ses romans, Marie-Aude Murail a souvent recours à un détour génial pour évoquer la sexualité : montrer à quel point la perversion est souvent un fantasme d’adultes plaqué sur des enfants. Josyane, médecin, veut absolument prouver que son demi-frère Bart, homo, est incapable de prendre en charge leurs frère et sœurs devenus orphelins. Elle fait parler la benjamine, Venise, sur ses poupées, et se méprend sur sa curiosité à propos de la sexualité desdites poupées, de façon à en tirer un argument d’immoralité contre son frère. Puis elle envoie Venise consulter une psychologue de ses amies, qui s’efforce de prouver que Bart a choqué la petite fille. Ce tour de force est sans doute dû à la particularité de la collection « Médium » de L’école des loisirs, un éditeur qui persiste à proposer une seule collection pour les pré-ados et les ados, entre dix et vingt ans.
Concluons ce bref panorama par un titre d’une collection qui par son nom, « photo roman », semble destinée à inverser les ressorts du roman sentimental. C’est, côté lesbien, le roman qui nous semble aller le plus loin à la fois dans l’expression de la sexualité génitale, et dans notre fameux « syndrome d’Alcibiade ». Un amour prodigue, roman de Claudine Galea sur des photos de Colombe Clier (Thierry Magnier, 2009), présente une histoire sur trois générations rapprochées, puisque la grand-mère Léa et sa fille ont enfanté à l’âge de 16 ans, et, selon le principe de la psychogénéalogie sans doute, Phili, la petite-fille, se rapproche de sa jeune grand-mère à ce même âge, au moment où elle vit une histoire d’amour interdit avec… la lectrice d’anglais du lycée – autre forme atténuée du « syndrome d’Alcibiade » ! [6] Comme une psychanalyse inversée, Léa raconte en détail à Phili son aventure avec cette prof d’histoire-géo âgée de 34 ans, puis la deuxième histoire, plus simple, avec Marc, le grand-père, qui était à l’époque animateur du club photo du lycée (encore une version édulcorée du syndrome !). Cela se passait en 1975, au cœur de la libération sexuelle d’avant le sida, quelques années après l’affaire Gabrielle Russier, cette prof persécutée par la justice et poussée au suicide parce qu’elle avait répondu à l’amour d’un élève de 17 ans. Il n’y a pas vraiment de scènes de sexe, du fait du dispositif narratif : Léa relate ses discussions avec Phili ; mais la parole est sans tabou (y compris dans la crudité du langage) entre la grand-mère et sa petite-fille, symboliquement au-delà de la mère, l’intermédiaire entre ces deux générations, laquelle a sans doute été traumatisée de découvrir la sexualité avec le sida. Voici un excellent roman qui nous semble ouvrir une époque où la sexualité telle qu’on la présente aux adolescents, pourrait redevenir la voie euphorique vers « la splendeur de la jouissance, la richesse et l’infinie variété des sensations et des émotions » (p. 108), et non le concentré de tous les risques, tel qu’on s’ingénie à la présenter aux enfants et aux adolescents.
Voir en ligne : Site de l’association Lecture jeunesse, éditrice de la revue « Lecture jeune »
© altersexualite.com, 2010
Un grand merci à Robert Vigneau pour m’avoir autorisé à illustrer cet article de son dessin Adolescence. Pour acheter les œuvres graphiques de Robert Vigneau, voir Le blog de Robert Vigneau.
[1] Pour la première fois de ma carrière j’ai eu cette année une élève (de première) qui a accouché pendant l’année scolaire. J’ai été effaré du peu d’empressement de l’entourage scolaire (élèves ou profs) à accueillir cette grossesse, comme si la chose, s’agissant d’une élève, était une faute.
[2] En fait les éditeurs sont libres de la laisser tomber en désuétude, comme le fait Sarbacane, mais il ne faut pas oublier que cette loi est aussi une rente juteuse pour auteurs et éditeurs, et une rente peut se payer d’un peu d’hypocrisie.
[3] Sur l’historique de cette loi, lire Histoires de censure — Anthologie érotique, de Bernard Joubert, La Musardine, 2006.
[4] Gudule étant d’origine belge, on peut se demander s’il n’y aurait pas un complot belge pour démoraliser nos adolescents gaulois et les inciter à la débauche, aux termes de la loi de 1949 !
[5] Loi en vigueur entre 1986 et 2003 interdisant aux enseignants de mentionner l’homosexualité.
[6] Ce motif nous rappelle le succès du 1er film de Cédric Klapisch, Le péril jeune, dans lequel l’un des lycéens, Léon, se tapait l’assistante d’anglais ; à propos, comment se fait-il que ce film de lycéens n’ait pas encore fait l’objet d’une « novélisation » ?
 altersexualite.com
altersexualite.com