Accueil > Culture générale et expression en BTS > Seuls avec tous > Le Bouc émissaire, de René Girard
Se sacrifier pour le bien de la communauté, pour étudiants et adultes
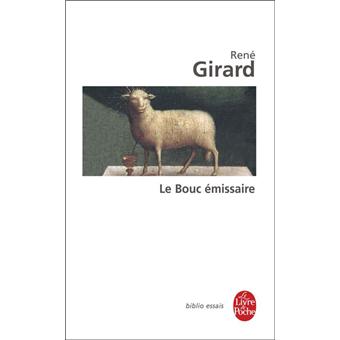 Le Bouc émissaire, de René Girard
Le Bouc émissaire, de René Girard
Le Livre de poche, 1982, 320 p., 7,9 €.
samedi 23 mars 2019
Le Bouc émissaire de René Girard (1923-2015) est un des livres inscrits sur la liste proposée au Bulletin Officiel de l’Éducation nationale pour le thème de BTS « Seuls avec tous ». J’avais envie de le lire depuis longtemps, cette question touchant de près la problématique altersexuelle, donc j’ai sauté sur l’occasion. C’est ce que j’attends à titre personnel de cette opportunité d’enseigner en BTS. Quand notre métier croise aussi nos goûts personnels, pourquoi se priver ? L’illustration de couverture de l’édition de poche, un détail de l’Agneau mystique (achevé en 1432) d’Hubert & Jan Van Eyck, contredit le titre en annonçant le contenu, puisqu’au lieu d’un bouc, nous avons un agneau, qui semble s’offrir en sacrifice plutôt que le subir. C’est un essai tardif écrit par un homme de près de 60 ans, qui semble régler ses comptes avec ses collègues, ce qui a de quoi surprendre pour un type qui enseignait depuis 1950 dans une prestigieuse université étasunienne, avait reçu les prix les plus prestigieux, était connu pour avoir répandu le concept de « désir mimétique », etc. Mais ce genre d’apparatchiks est difficile à satisfaire, l’assaut d’hommages ne les ravit jamais assez… Une pincée d’humour aide cependant à faire passer la sauce. Bref, les 150 premières pages sont assez confuses et l’on ne comprend pas grand-chose à certains règlements de comptes à fleurets mouchetés entre universitaires des années 80, et ce n’est que vers la page 150 que le type crache enfin sa Valda. C’est tellement un ponte sans doute, que personne parmi ses disciples n’osa lui conseiller de kärchériser son livre, dommage ! Enfin quand on en arrive au cœur de l’ouvrage, on est séduit par la richesse de la réflexion, mais pourquoi ne pas avoir exposé les choses simplement ? Avec un tel titre, le lecteur lambda était en droit d’attendre qu’on commence par un exposé clair du sujet et du corpus mythologique, puis une discussion. René Girard donne souvent l’impression de s’adresser à un séminaire de thésards taiseux. Je pense donc conseiller à mes étudiants de commencer le livre au milieu ! Cet article sera surtout constitué de larges extraits exploitables en classe.
Guillaume de Machaut, juifs et boucs émissaires
Dans le ch. Ier « Guillaume de Machaut et les juifs », René Girard entame sa réflexion par une citation de Guillaume de Machaut (1300-1377) faisant état d’un massacre de juifs suite à une épidémie de peste, dont il est assez facile d’induire que les juifs servent de boucs émissaires. Cette référence reviendra tout au long de l’ouvrage. Il cite La Fontaine (« La peste (puisqu’il faut l’appeler par son nom) ») pour comparer la réticence de Machaut (« Fors tant que c’estoit maladie / Qu’on appelloit epydimie », p. 8-9). Le mot « épidémie » (que Girard se garde d’employer, afin d’éviter que des lecteurs en-deçà de bac + 8 puissent le comprendre) trouvait là une de ses premières occurrences en français, sous cette orthographe archaïque, comme vous pourrez le constater en consultant l’article du CNRTL ou du TLF sur le mot « épidémie ».

Dans le ch. II « Les stéréotypes de la persécution », Girard poursuit par la liste des crimes susceptibles de susciter une réaction de type bouc émissaire : « Certaines accusations sont tellement caractéristiques des persécutions collectives qu’à leur seule mention les observateurs modernes soupçonnent qu’il y a de la violence dans l’air ; ils cherchent partout d’autres indices susceptibles de confirmer leur soupçon, c’est-à-dire d’autres stéréotypes persécuteurs.
À première vue, les chefs d’accusation sont assez divers, mais il est facile de repérer leur unité. Il y a d’abord des crimes de violence qui prennent pour objet les êtres qu’il est le plus criminel de violenter, soit dans l’absolu, soit relativement à l’individu qui les commet, le roi, le père, le symbole de l’autorité suprême, parfois aussi dans les sociétés bibliques et modernes, les êtres les plus faibles et les plus désarmés, en particulier les jeunes enfants.
Il y a ensuite les crimes sexuels, le viol, l’inceste, la bestialité. Les plus fréquemment invoqués sont toujours ceux qui transgressent les tabous les plus rigoureux, relativement à la culture considérée.
Il y a enfin des crimes religieux, comme la profanation d’hosties. Là aussi ce sont les tabous les plus sévères qui doivent être transgressés.
Tous ces crimes paraissent fondamentaux. Ils s’attaquent aux fondements mêmes de l’ordre culturel, aux différences familiales et hiérarchiques sans lesquelles il n’y aurait pas d’ordre social » (p. 25).
Quelques analyses basées sur l’étymologie sont bienvenues : « La foule tend toujours vers la persécution car les causes naturelles de ce qui la trouble, de ce qui la transforme en turba ne peuvent pas l’intéresser. La foule, par définition, cherche l’action mais elle ne peut pas agir sur les causes naturelles. Elle cherche donc une cause accessible et qui assouvit son appétit de violence. Les membres de la foule sont toujours des persécuteurs en puissance car ils rêvent de purger la communauté des éléments impurs qui la corrompent, des traîtres qui la subvertissent. Le devenir foule de la foule ne fait qu’un avec l’appel obscur qui la rassemble ou qui la mobilise, autrement dit, qui la transforme en mob. C’est de mobile, en effet, que vient ce terme, aussi distinct de crowd que le latin turba peut l’être de vulgus. La langue française ne comporte pas cette distinction.
Il n’est de mobilisation que militaire ou partisane, autrement dit contre un ennemi déjà désigné ou qui le sera bientôt s’il ne l’est pas encore par la foule elle-même, en vertu de sa mobilité » (p. 26).
Les stéréotypes du bouc émissaire
L’exposé des « stéréotypes » d’accusation dont les boucs émissaires sont l’objet est pour le moins confus. Je ne parviens pas à comprendre ce que Girard appelle « crise indifférenciée ». Je suppose que c’est une notion qu’il a expliquée dans un de ses précédents ouvrages. Supposons qu’il s’agit de la crise au cours de laquelle la société se choisit des boucs émissaires. En tout cas voici le 2e stéréotype des victimes : « Il est donc toujours question d’infanticide rituel, de profanations religieuses, de relations incestueuses et de bestialité. Mais les cuisines de poisons jouent aussi un grand rôle dans ces affaires, de même que les manœuvres coupables contre des personnages influents ou prestigieux. En dépit de son insignifiance personnelle, par conséquent, la sorcière s’adonne à des activités susceptibles d’affecter le corps social dans son ensemble. C’est bien pourquoi le diable et ses démons ne dédaignent pas de faire alliance avec elle » (p. 28).
Et voici le 3e stéréotype, un passage fondamental qui peut constituer un extrait de corpus : « Les minorités ethniques ou religieuses tendent à polariser contre elles les majorités. Il y a là un critère de sélection victimaire relatif, certes, à chaque société mais transculturel dans son principe. Il n’y a guère de sociétés qui ne soumettent leurs minorités, tous leurs groupes mal intégrés ou même simplement distincts, à certaines formes de discrimination sinon de persécution. Ce sont les musulmans surtout qui se font persécuter dans l’Inde, et au Pakistan les hindous. Il existe donc des traits universels de sélection victimaire et ce sont eux qui constituent notre troisième stéréotype.
À coté des critères culturels et religieux, il y en a de purement physiques. La maladie, la folie, les difformités génétiques, les mutilations accidentelles et même les infirmités en général tendent à polariser les persécuteurs. Pour comprendre qu’il y a là quelque chose d’universel il suffit de regarder autour de soi ou même en soi. Aujourd’hui encore, bien des gens ne peuvent pas réprimer, au premier contact, un léger recul devant l’anormalité physique. Le mot lui-même, anormal, comme le mot peste au Moyen Âge, a quelque chose de tabou ; il est à la fois noble et maudit, sacer dans tous les sens du terme. On juge plus décent de le remplacer par le mot anglais : « handicapé ».
Les « handicapés » font encore l’objet de mesures proprement discriminatoires et victimaires sans commune mesure avec le trouble que leur présence peut apporter à la fluidité des échanges sociaux. C’est la grandeur de notre société qu’elle se sente obligée, désormais, de prendre des mesures en leur faveur.
L’infirmité s’inscrit dans un ensemble indissociable de signes victimaires et dans certains groupes — un internat scolaire par exemple — tout individu qui éprouve des difficultés d’adaptation, l’étranger, le provincial, l’orphelin, le fils de famille, le fauché, ou, tout simplement, le dernier arrivé, est plus ou moins interchangeable avec l’infirme. Lorsque les infirmités ou les difformités sont réelles, elles tendent à polariser les esprits « primitifs » contre les individus qui en sont affligés. Parallèlement, lorsqu’un groupe humain a pris l’habitude de choisir ses victimes dans une certaine catégorie sociale, ethnique, religieuse, il tend à lui attribuer les infirmités ou difformités qui renforceraient la polarisation victimaire si elles étaient réelles. Cette tendance apparaît nettement dans les caricatures racistes.
Ce n’est pas dans le domaine physique seulement qu’il peut y avoir anormalité. C’est dans tous les domaines de l’existence et du comportement. Et c’est dans tous les domaines, également, que l’anormalité peut servir de critère préférentiel dans la sélection des persécutés.
Il y a, par exemple, une anormalité sociale ; c’est la moyenne ici qui définit la norme. Plus on s’éloigne du statut social le plus commun, dans un sens ou dans l’autre, plus les risques de persécution grandissent. On le voit sans peine pour ceux qui sont situés au bas de l’échelle.
On voit moins bien, par contre, qu’à la marginalité des miséreux, ou marginalité du dehors, il faut en ajouter une seconde, la marginalité du dedans, celle des riches et des puissants. Le monarque et sa cour font parfois songer à l’œil d’un ouragan. Cette double marginalité suggère une organisation sociale tourbillonnaire. En temps normal, certes, les riches et les puissants jouissent de toutes sortes de protections et de privilèges qui font défaut aux déshérités. Mais ce ne sont pas les circonstances normales qui nous concernent ici, ce sont les périodes de crise. Le moindre regard sur l’histoire universelle révèle que les risques de mort violente aux mains d’une foule déchaînée sont statistiquement plus élevés pour les privilégiés que pour toute autre catégorie.
À la limite ce sont toutes les qualités extrêmes qui attirent, de temps à autre, les foudres collectives, pas seulement les extrêmes de la richesse et de la pauvreté, mais également ceux du succès et de l’échec, de la beauté et de la laideur, du vice et de la vertu, du pouvoir de séduire et du pouvoir de déplaire ; c’est la faiblesse des femmes, des enfants et des vieillards, mais c’est aussi la force des plus forts qui devient faiblesse devant le nombre. Très régulièrement les foules se retournent contre ceux qui ont d’abord exercé sur elles une emprise exceptionnelle.
Certains trouveront scandaleux, je pense, de voir les riches et les puissants figurer parmi les victimes de la persécution collective au même titre que la faiblesse et la pauvreté. Les deux phénomènes ne sont pas symétriques à leurs yeux. Les riches et les puissants exercent sur leur société une influence qui justifie les violences dont ils peuvent faire l’objet en période de crise. C’est la sainte révolte des opprimés, etc. » (p. 29-31). Le mythe littéraire de Don Juan n’est pas abordé dans ce livre, mais cette page m’y fait furieusement penser.

Dans le ch. III « Qu’est-ce qu’un mythe ? », le mythe d’Œdipe attire l’attention : « Plus un individu possède de signes victimaires, plus il a de chances d’attirer la foudre sur sa tête. L’infirmité d’Œdipe, son passé d’enfant exposé, sa situation d’étranger, de parvenu, de roi, font de lui un véritable conglomérat de signes victimaires » (p. 40). René Girard s’étonne que si nous concluons à une persécution réelle à la base de phénomènes historiques comme les procès en sorcellerie, nous devrions aboutir à la même conclusion pour les mythes comme celui d’Œdipe. C’est une hypothèse « structurale » (p. 44). D’où vient la différence de traitement ? « Dans les persécutions historiques, les « coupables » restent suffisamment distincts de leurs « crimes » pour qu’on ne puisse pas se méprendre sur la nature du processus. Il n’en va pas de même dans le mythe. Le coupable est tellement consubstantiel à sa faute qu’on ne peut pas dissocier celle-ci de celui-là. Cette faute apparaît comme une espèce d’essence fantastique, un attribut ontologique. Dans de nombreux mythes, il suffit de la présence du malheureux dans le voisinage pour contaminer tout ce qui l’entoure, donner la peste aux hommes et aux bêtes, ruiner les récoltes, empoisonner la nourriture, faire disparaître le gibier, semer la discorde autour de lui. Sur son passage tout se détraque et l’herbe ne repousse pas. Il produit les désastres aussi naturellement que le figuier ses figues. Il lui suffit d’être ce qu’il est » (p. 57). Girard utilise une allégorie empruntée à Homère : « Dans les textes des persécuteurs historiques, le visage des victimes transparaît derrière le masque. Il y a des lacunes et des lézardes alors que dans la mythologie le masque est encore intact ; il couvre tout le visage si bien que nous ne soupçonnons pas qu’il s’agit d’un masque. Il n’y a personne là derrière, pensons-nous, ni victimes ni persécuteurs. Nous ressemblons un peu aux cyclopes, ses frères, que Polyphème aveuglé par Ulysse et ses compagnons appelle vainement à son secours. Nous réservons notre œil unique à ce que nous appelons l’histoire. Quant à nos oreilles, si nous en avons, elles n’entendent jamais que ce personne, personne…, qui s’enracine dans la violence collective elle-même et nous la fait tenir pour nulle et non avenue, tout entière inventée par un Polyphème en veine d’improvisation poétique » (p. 59). Selon lui en Europe jusqu’au XVIe siècle environ, « Dans la plupart des sociétés humaines, la croyance en la sorcellerie n’est pas le fait de certains individus seulement ou même de beaucoup, mais de tous » (p. 61).
Ce qu’ajoute le mythe à la persécution historique, c’est que la victime incarne l’ordre qu’elle contribue à rétablir : « La conjonction perpétuelle dans les mythes d’une victime très coupable et d’une conclusion simultanément violente et libératrice ne peut s’expliquer que par la force extrême du mécanisme de bouc émissaire. Cette hypothèse, en effet, résout l’énigme fondamentale de toute mythologie : l’ordre absent ou compromis par le bouc émissaire se rétablit ou s’établit par l’entremise de celui qui l’a d’abord troublé. Mais oui, c’est bien cela. Il est pensable qu’une victime passe pour responsable des malheurs publics, et c’est bien ce qui se passe dans les mythes, comme dans les persécutions collectives, mais voici que dans les mythes, et dans les mythes seulement, cette même victime ramène l’ordre, le symbolise et même l’incarne. […] Le délinquant suprême se transforme en pilier de l’ordre social » (p. 66). « Au-delà d’un certain seuil de croyance, l’effet du bouc émissaire invertit complètement les rapports entre les persécuteurs et leurs victimes, et c’est cette inversion qui produit le sacré, les ancêtres fondateurs et les divinités. […] À l’exécration unanime de celui qui rend malade, par conséquent, doit se superposer la vénération unanime pour le guérisseur de cette même maladie » […] « Pour ne pas renoncer à la victime en tant que cause, elle la ressuscite s’il le faut, elle l’immortalise, au moins pour un temps, elle invente tout ce que nous appelons le transcendant et le surnaturel » (p. 68-69).
Dans le ch. IV « Violence et magie », l’idée est prolongée : « Plus crédules encore que les nôtres, les persécuteurs mythologiques sont possédés par leurs effets de bouc émissaire au point d’être vraiment réconciliés par eux et de superposer une réaction adoratrice à la réaction de terreur et d’hostilité que leur inspirait déjà leur victime » (p. 78). Selon René Girard, cette « seconde transfiguration […] a presque complètement disparu » suite à une « décadence des formes mythiques », d’où notre difficulté à interpréter les mythes (p. 78).
L’accusation utilise souvent des voies téléphonées : « Le juif passe lui aussi pour particulièrement lié au bouc et à certains animaux. Là encore, l’idée d’une abolition des différences entre l’homme et l’animal peut reparaître sous une forme inattendue. En 1575, par exemple, la Wunderzeitung illustrée de Johann Fischart, de Binzwangen, près d’Augsbourg, montre une femme juive en contemplation devant deux petits cochons dont elle vient d’accoucher » (p. 76).
Dans le ch. V « Teotihuacan », Girard établit un parallèle entre les mythes aztèques et un saint chrétien : « Entre saint Sébastien et les flèches, ou plutôt l’épidémie, il existe une espèce d’affinité et les fidèles espèrent qu’il suffira au saint d’être là, d’être représenté dans leurs églises, pour attirer sur lui les flèches errantes et pour qu’il soit frappé à leur place. On propose saint Sébastien, en somme, comme cible préférentielle à la maladie ; on le brandit comme un serpent d’airain. Le saint joue donc un rôle de bouc émissaire, protecteur parce que pestiféré, sacralisé par conséquent au double sens primitif de maudit et de béni » (p. 92).
Girard ironise sur notre naïveté condescendante sur les cultures premières : « Quand ces attitudes ressurgissent dans notre société, nous refusons avec indignation de nous en faire les complices mais nous les adoptons sans sourciller quand il s’agit d’Aztèques ou d’autres peuples primitifs » (p. 97).
Dans le ch. VI « Ases, Kourètes et Titans », Girard reproche aux ethnologues, comme Lévi-Strauss, de ne pas voir que l’évolution des mythes va toujours dans le même sens : « Après avoir battu ses cartes, le prestidigitateur les étale une seconde fois dans un ordre différent. On a d’abord l’impression qu’elles sont toutes là, mais est-ce bien vrai ? Si nous regardons mieux, nous verrons qu’en réalité il en manque toujours une et c’est toujours la même, c’est la représentation du meurtre collectif » (p. 109). Selon lui, « il y a une histoire de la mythologie » (p. 110).
Dans le ch. VII « Les crimes des dieux », Girard cite La République de Platon (livre II) pour souligner sa « volonté d’effacer la violence mythologique » : « Quant aux actes […] de Cronos et ce qu’il endura de son fils, même si c’était la vérité, il ne faudrait pas, selon moi, aller avec une pareille légèreté les débiter à des êtres dépourvus de jugement et naïfs, mais bien plutôt les taire complètement ; et s’il existait quelque obligation de les dire, il faudrait que ce fût par des formules secrètes de Mystères, pour un auditoire le plus réduit possible, et après le sacrifice non pas d’un porc, mais de quelque victime qui fût d’importance et difficile à se procurer, afin qu’en conséquence il y eût le plus petit nombre possible de gens à les entendre ! » L’horreur et l’erreur de Platon et autres philosophes grecs selon Réné Girard est que « à la différence des prophètes juifs et plus tard des Évangiles, ils ne peuvent pas concevoir qu’une victime ainsi traitée puisse être innocente » (p. 116).
Le trickster ou fripon compte aussi parmi les boucs émissaires : « Parmi les variantes de la faute minimisée, il faut compter les activités du trickster nord-américain et de tous les dieux « décepteurs » un peu partout. Ces dieux sont des boucs émissaires comme les autres. Leurs bienfaits se ramènent tous à un pacte social ressoudé aux dépens de la victime » (p. 124).
D’après l’une des versions de la mort de Romulus par Plutarque, Girard tire une règle des comportements de foule meurtrière : « Cette fin rappelle le diasparagmos dionysiaque ; la victime meurt déchirée par la multitude. Les échos mythologiques et religieux sont donc indubitables, mais le diasparagmos se reproduit spontanément dans les foules prises de frénésie meurtrière. Le récit des grands tumultes populaires en France pendant les guerres de religion fourmille d’exemples analogues au texte de Plutarque. Les émeutiers se disputent jusqu’aux restes les plus infimes de leur victime ; ils y voient de précieuses reliques qui peuvent faire ensuite l’objet d’un véritable commerce et atteindre des prix exorbitants. Des exemples innombrables suggèrent un rapport étroit entre la violence collective et un certain processus de sacralisation qui n’exige pas, pour s’esquisser, une victime déjà puissante et renommée. La métamorphose des restes en reliques est également attestée pour certaines formes de lynchage raciste dans le monde contemporain. Ce sont les meurtriers eux-mêmes, en somme, qui sacralisent leur victime » (p. 132).
Apologie du christianisme
Il faut parvenir à la 2e moitié du livre et le ch. IX « Les maîtres mots de la passion évangélique » pour découvrir le point essentiel de l’argumentation de René Girard, le fait que le christianisme révèle « les ressorts » de la persécution (p. 153). Son apologie du christianisme est volontiers caustique : « La victime des Psaumes est gênante, c’est un fait, elle est même assez grinçante à côté d’un Œdipe qui a le bon goût, lui, de se rallier à la merveilleuse harmonie classique. Voyez donc avec quel art, avec quelle délicatesse, au moment voulu, il fait son autocritique. Il y met l’enthousiasme du psychanalysé sur son divan ou du vieux bolchevique à l’époque de Staline. Il sert de modèle, n’en doutez pas, au conformisme suprême de notre temps, qui ne fait qu’un avec l’avant-gardisme tonitruant. Nos intellectuels s’empressaient à tel point pour la servitude qu’ils stalinisaient déjà dans leurs cénacles avant même que le stalinisme ne fût inventé. Comment s’étonner de les voir attendre cinquante ans et plus pour s’interroger discrètement sur les plus grandes persécutions de l’histoire humaine. Pour nous entraîner au silence nous sommes à la meilleure école, celle de la mythologie. Entre la Bible et la mythologie, nous n’hésitons jamais. Nous sommes classiques d’abord, romantiques ensuite, primitifs quand il le faut, modernistes avec fureur, néo-primitifs quand nous nous dégoûtons du modernisme, gnostiques toujours, bibliques jamais » (p. 157).
La Passion est donc un modèle de bouc émissaire, dans lequel la foule joue le rôle d’entraînement du pouvoir : « Même les disciples les plus chers n’ont pas un mot, pas un geste pour s’opposer à la foule. Ils sont littéralement absorbés par elle. C’est l’évangile de Pierre qui nous fait savoir que Pierre, le chef de file des apôtres, a renié publiquement son maître. Cette trahison n’a rien d’anecdotique, elle n’a rien à voir avec la psychologie de Pierre. Le fait que les disciples eux-mêmes ne puissent pas résister à l’effet de bouc émissaire révèle la toute puissance sur l’homme de la représentation persécutrice. » […] « Pilate est le vrai détenteur du pouvoir mais au-dessus de lui il y a la foule. Une fois mobilisée, elle l’emporte absolument, elle entraîne les institutions derrière elle, elle les contraint à se dissoudre en elle. C’est donc bien ici l’unanimité du meurtre collectif générateur de mythologie. Cette foule, c’est le groupe en fusion, la communauté qui littéralement se dissout et ne peut plus se ressouder qu’aux dépens de sa victime, son bouc émissaire » […] « Pilate, cependant, n’a pas d’intérêts véritables dans l’affaire. Jésus ne compte pour rien à ses yeux. C’est un personnage trop insignifiant pour qu’un esprit le moins du monde politique puisse courir le risque d’une émeute à seule fin de le sauver. La décision de Pilate est trop facile, en somme, pour illustrer fortement la subordination du souverain à la foule, le rôle dominant de la foule en ce point d’effervescence extrême où se déclenche la mécanique du bouc émissaire » (p. 158-159). Le Dernier repas (1629-30) de Daniele Crespi photographié à la Pinacothèque de Brera de Milan me semble illustrer cette dissolution du groupe des apôtres dont tous les regards sont désorientés.

Et pourtant ce n’est pas là le plus important, mais justement le rejet des mécanismes de boucs émissaires qu’enseignent les Évangiles selon Girard : « La défaillance du Vendredi saint fait place, chez les disciples, à la fermeté de la Pentecôte et le souvenir de la mort de Jésus va se perpétuer avec une signification tout autre que celle voulue par les puissances, une signification qui ne parvient pas, certes, à s’imposer immédiatement dans toute sa nouveauté prodigieuse mais qui n’en pénètre pas moins peu à peu les peuples évangélisés, leur enseignant de mieux en mieux à repérer autour d’eux les représentations persécutrices et à les rejeter. » […] « Le mécanisme du bouc émissaire entre dans la lumière la plus éclatante qui soit ; il fait l’objet de la publicité la plus intense, il devient la chose la plus connue du monde, le savoir le plus répandu, et c’est ce savoir-là que les hommes apprendront, lentement, très lentement, car ils ne sont pas très intelligents, à glisser sous la représentation persécutrice » (p. 162). « Perdre son temps comme font certains commentateurs modernes, à s’interroger sur la façon toujours inégale selon eux dont les Évangiles répartiraient le blâme entre les divers acteurs de la passion, c’est méconnaître au départ l’intention véritable du récit. Pas plus que le Père éternel ici, les Évangiles ne font acception des personnes parce que la seule donnée qui les intéresse vraiment c’est l’unanimité des persécuteurs » (p. 163).
« Ils ne savent pas ce qu’ils font »
Voici la notion d’« inconscient persécuteur » : « La phrase qui définit l’inconscient persécuteur figure au cœur même du récit de la passion, dans l’évangile de Luc, et c’est le célèbre : Mon Père, pardonne-leur parce qu’ils ne savent pas ce qu’ils font (Lc 23, 34) » (p. 165). « Les Actes des Apôtres mettent la même idée dans la bouche de Pierre qui s’adresse à la foule de Jérusalem, la foule même de la passion : « Cependant, frères, je sais que c’est par ignorance que vous avez agi, ainsi d’ailleurs que vos chefs. » L’intérêt considérable de cette phrase vient de ce qu’elle attire notre attention une fois de plus sur les deux catégories de puissances, la foule et les chefs, tous également inconscients. Elle rejette implicitement l’idée faussement chrétienne qui fait de la passion un événement unique dans sa dimension maléfique alors qu’il est unique seulement dans sa dimension révélatrice. Adopter la première idée c’est fétichiser encore la violence, c’est retomber dans une variante de paganisme mythologique » (p. 166).
Dans le ch. X « Qu’un seul homme meure… », Girard analyse la parole du grand prêtre Caïphe dans Jn 11, 47-53 : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière » […] « L’effet de bouc émissaire qui se constitue sous nos yeux rejoint l’effet de bouc émissaire à l’origine des sacrifices judaïques. Caïphe est le sacrificateur par excellence, celui qui fait mourir des victimes pour sauver les vivants. En nous le rappelant, Jean souligne que toute décision véritable dans la culture a un caractère sacrificiel (decidere, je le redis, c’est couper la gorge de la victime) et par conséquent remonte à un effet de bouc émissaire non dévoilé, à une représentation persécutrice de type sacré » (p. 169).
« L’essentiel de la révélation sous le rapport anthropologique, c’est la crise de toute représentation persécutrice qu’elle provoque. Dans la passion elle-même, il n’y a rien d’unique sous le rapport de la persécution. Il n’y a rien d’unique dans la coalition de toutes les puissances de ce monde. Cette même coalition est à l’origine de tous les mythes. L’étonnant c’est que les Évangiles en soulignent l’unanimité non pour s’incliner devant elle, pour se soumettre à son verdict, comme feraient tous les textes mythologiques, tous les textes politiques, et même tous les textes philosophiques, mais pour dénoncer en elle une erreur complète, la non-vérité par excellence.
C’est là qu’est le radicalisme insurpassable de la révélation. Pour le comprendre il faut évoquer brièvement, par contraste, la réflexion politique dans le monde occidental et moderne.
Les puissances de ce monde se divisent visiblement en deux groupes non symétriques, d’une part les autorités constituées et de l’autre la foule. En règle générale, les premières l’emportent sur la seconde ; en période de crise, c’est l’inverse. Non seulement la foule l’emporte mais elle est une espèce de creuset où viennent se fondre même les autorités les moins ébranlables en apparence. Ce processus de fusion assure la refonte des autorités par l’intermédiaire du bouc émissaire, c’est-à-dire du sacré. La théorie mimétique éclaire ce processus que la science politique et les autres sciences de l’homme ne parviennent pas à pénétrer.
La foule est si puissante qu’elle n’a pas besoin de rassembler toute la communauté pour obtenir les résultats les plus surprenants. Les autorités constituées s’inclinent devant elle et lui cèdent les victimes que réclame son caprice, de même que Pilate cède Jésus ou Hérode Jean-Baptiste. Les autorités viennent alors grossir la foule de leur nombre, elles se laissent absorber par elle. Comprendre la passion, c’est comprendre qu’elle abolit temporairement toute différence non seulement entre Caïphe et Pilate, entre Judas et Pierre, mais entre tous ceux qui crient ou laissent crier : « Crucifiez-le ! »
Qu’elles soient « conservatrices » ou « révolutionnaires » les pensées politiques modernes ne critiquent jamais qu’une seule catégorie de puissances, soit la foule soit les pouvoirs établis. Il leur faut systématiquement s’appuyer sur l’autre. C’est ce choix qui les détermine en tant que « conservatrices » ou « révolutionnaires ».
La fascination durable qu’exerce le Contrat social ne vient pas des vérités qu’il pourrait contenir, mais de l’espèce d’oscillation vertigineuse qui s’y produit entre les deux catégories de puissances. Au lieu de choisir résolument l’une d’entre elles et de s’y tenir, avec les « rationnels » de tous les partis, Rousseau voulait concilier les inconciliables et son œuvre ressemble un peu au tourbillon d’une révolution réelle, incompatible avec les grands principes qu’elle énonce » (p. 171).
C’est alors que se justifie l’illustration de couverture : « L’expression bouc émissaire n’est pas là, certes, mais les Évangiles en ont une autre qui la remplace avantageusement et c’est l’agneau de Dieu. Tout comme bouc émissaire, elle dit la substitution d’une victime à toutes les autres mais en remplaçant les connotations répugnantes et malodorantes du bouc par celles, toutes positives, de l’agneau, elle dit mieux l’innocence de cette victime, l’injustice de sa condamnation, le sans cause de la haine dont elle fait l’objet » (p. 174).
Dans le ch. XI « La décollation de Saint Jean-Baptiste », Girard ironise sur ses collègues savants : « Voyez comme c’est primitif les Évangiles, nous répètent de toutes les manières nos savants les plus huppés. Voyez ce supplice collectif au beau milieu, comme dans les mythes les plus sauvages, voyez donc cette affaire de bouc émissaire. Comme c’est curieux ! Quand les mythes dits « ethnologiques » sont seuls en cause, il n’est jamais question de violence. Il n’est pas permis de qualifier les mythes et les religions de primitifs ou surtout de plus ou moins sauvages. On refuse toute pertinence à cette « problématique ethnocentrique ». Mais voici qu’il redevient possible et même louable de recourir à ces termes quand les Évangiles entrent en lice » (p. 188). Girard explique la différence entre Jésus et Moïse en opposant un épisode du début de l’Exode (Ex, 2-14) où Moïse tue un Égyptien qui maltraite un Hébreu, puis se voit reprocher ce crime le lendemain alors qu’il voit « deux Hébreux qui se querellaient ». Au contraire, dans Lc 12, 13-14, Jésus répond à un homme qui lui demande de régler une querelle d’héritage entre frères : « qui m’a établi pour être votre juge ou régler vos partages » : « Jésus suggère que sa mission est très différente de celle de Moïse. L’heure du libérateur national et du législateur est passée. Il n’est pas possible de séparer les frères ennemis par une violence réglée qui mettrait fin à la leur. La contestation de l’Hébreu qui rappelle à Moïse son meurtre de la veille est universellement valable désormais. Il n’y a plus de distinction possible entre violence légitime et violence illégitime. Il n’y a plus que des frères ennemis, et l’on peut seulement les mettre en garde contre leur désir mimétique en espérant qu’ils y renonceront » (p. 193).

L’analyse de l’épisode de Salomé met le doigt sur des détails qui m’avaient échappé en étudiant les Trois contes de Flaubert, du temps où j’enseignais en collège : « La fille d’Hérodiade est une enfant. L’original grec ne la désigne pas du mot kore, jeune fille, mais du diminutif korasion, qui signifie petite fille. La Bible de Jérusalem traduit correctement par fillette. Il faut oublier la conception qui fait de Salomé une professionnelle de la séduction. Le génie du texte évangélique n’a rien à voir avec la courtisane de Flaubert, la danse des sept voiles et le bric-à-brac orientaliste. Bien qu’enfantine encore ou plutôt parce qu’elle est encore enfant, Salomé passe presque instantanément de l’innocence au paroxysme de la violence mimétique » (p. 196). Cela dit, le texte de Girard n’explique pas le désir sexuel engendré par une « enfant ». Comment Flaubert aurait-il pu traiter cela ? Mais poursuivons, car Girard est en verve : « Même si Hérodiade entendait suggérer le type de mort qu’elle souhaite pour le prophète quand elle s’écrie : « La tête de Jean-Baptiste », on ne peut pas en conclure qu’elle voudrait tenir cette tête dans ses mains, qu’elle désire l’objet physique. Même dans les pays à guillotine, demander la tête de quelqu’un comporte une dimension rhétorique méconnue par la fille d’Hérodiade. Salomé prend sa mère au mot. Elle ne le fait pas exprès. Il faut être adulte, on le sait, pour distinguer les mots et les choses. Cette tête est le plus beau jour de sa vie.
Avoir Jean-Baptiste en tête est une chose, avoir sa tête sur les bras en est une autre. Salomé s’interroge sur la meilleure façon de s’en débarrasser. Cette tête fraîchement coupée il faudra bien la déposer quelque part et le plus raisonnable est de la poser sur un plat. C’est la platitude même que cette idée, c’est un réflexe de bonne ménagère. Salomé regarde les mots trop fixement pour en reproduire exactement le message. Pécher par littéralisme excessif c’est mal interpréter car c’est interpréter sans le savoir. L’inexactitude de la copie ne fait qu’un avec le souci myope d’exactitude. Ce qui paraît le plus créateur, en somme, dans le rôle de Salomé est au contraire ce qu’il y a de plus mécanique et de proprement hypnotique dans la soumission du désir au modèle qu’il s’est donné » (p. 204).
« Tout est pardonné »
Le ch. XII « Le reniement de Pierre » assimile presque Pierre à une des filles du roi Lear. En effet, il se prend une rafale lorsque Jésus répond à ses protestations de fidélité qu’il le reniera : « Tous les types d’adhésion que les hommes en groupe peuvent donner à une entreprise quelconque sont déclarés indignes de Jésus. Et ce sont bien les attitudes que nous voyons se succéder circulairement, interminablement, tout au long du christianisme historique, notamment à notre époque. Les disciples deuxième manière rappellent l’antitriomphalisme triomphant de certains milieux chrétiens actuels, leur anticléricalisme toujours clérical. Le fait que ce genre d’attitudes soit déjà stigmatisé dans les Évangiles montre bien qu’on ne peut pas ramener l’inspiration chrétienne la plus haute à ses propres sous-produits psychologiques et sociologiques » (p. 234).

Le ch. XIII « Les démons de Gerasa » revient sur l’apologie des Évangiles : « En révélant ce mécanisme et tout le mimétisme qui l’entoure, les Évangiles montent la seule machine textuelle qui puisse mettre fin à l’emprisonnement de l’humanité dans les systèmes de représentation mythologique fondés sur la fausse transcendance d’une victime sacralisée parce que unanimement tenue pour coupable » (p. 245). Les types d’exécution du bouc émissaire sont conçus pour rompre la chaîne des vengeances : « Ces modes d’exécution [lapidation, chute d’une falaise, crucifixion] n’offrent aucune prise à l’appétit de vengeance car elles éliminent toute différence dans les rôles individuels. Les persécuteurs agissent tous de la même façon. Quiconque rêve de vengeance est obligé de s’en prendre à la collectivité tout entière. C’est comme si la force de l’État, encore inexistante dans ce type de société, se mettait à exister de façon temporaire mais réelle, et non pas symbolique seulement, dans ces formes violentes de l’unanimité » (p. 260). À partir de l’épisode de Luc 8-33 « Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita du haut de l’escarpement dans le lac et se noya », Girard réfléchit : « Quelle est la force qui catapulte les porcs dans la mer de Galilée si ce n’est pas notre désir à nous de les y voir tomber ou la violence de Jésus lui-même ? Qu’est-ce qui peut motiver tout un troupeau à s’autodétruire sans y être contraint par qui que ce soit ? La réponse est évidente. Elle s’appelle l’esprit grégaire, c’est lui qui fait du troupeau, justement, un troupeau, autrement dit la tendance irrésistible au mimétisme. Il suffit qu’un premier porc tombe dans la mer, par hasard ou par accident peut-être, sous l’effet d’une panique stupide ou des convulsions provoquées par l’invasion démoniaque, pour que tous ses congénères en fassent autant. Le suivisme frénétique se combine très bien avec l’indocilité proverbiale de l’espèce. Au-delà d’un certain seuil mimétique, le même justement qui définit la possession, la troupe entière reproduit instantanément toute conduite qui lui paraît sortir de l’ordinaire. C’est un peu le phénomène de la mode dans les sociétés dites avancées, au sens où celles de Gérasa est déjà fort avancée.
Qu’une bête quelconque soudainement perde pied, sans le faire exprès, et voilà une nouvelle mode de lancée, celle de la plongée aux abîmes, qui va transporter d’enthousiasme jusqu’au dernier goret » (p. 269).
Le ch. XV « L’histoire et le paraclet » évoque le christianisme devenu persécuteur : « À partir de Constantin, le christianisme triomphe au niveau de l’État lui-même et, très vite, il va couvrir de son autorité des persécutions analogues à celles dont les chrétiens des premiers âges avaient été les victimes. Comme tant d’entreprises religieuses, idéologiques et politiques après lui, le christianisme encore faible subit les persécutions, dès qu’il est fort, il se fait persécuteur » (p. 299). Mais il faut se garder de juger sans recul : « Ce n’est pas parce que les hommes ont inventé la science qu’ils ont cessé de chasser les sorcières, c’est parce qu’ils ont cessé de chasser les sorcières qu’ils ont inventé la science. L’esprit scientifique, comme l’esprit d’entreprise en économie, est un sous-produit de l’action en profondeur exercée par le texte évangélique. L’Occident moderne oublie la révélation pour ne s’intéresser qu’aux sous-produits. Il en a fait des armes, des instruments de la puissance et voici qu’aujourd’hui le processus se retourne contre lui. Il se croyait libérateur et il se découvre persécuteur. Les fils maudissent leurs pères et se font leurs juges » (p. 300).
Voici la définition du Paraclet par rapport à Satan : « Satan ne règne qu’en vertu de la représentation persécutrice partout souveraine avant les Évangiles. Satan est donc essentiellement l’accusateur, celui qui trompe les hommes en leur faisant tenir pour coupables des victimes innocentes. Or, qui est le Paraclet ? Parakleitos, en grec, c’est l’équivalent exact du français avocat, ou du latin ad-vocatus. Le paraclet est appelé auprès du prévenu, de la victime, pour parler à sa place et en son nom, pour lui servir de défenseur. Le Paraclet, c’est l’avocat universel, le préposé à la défense de toutes les victimes innocentes, le destructeur de toute représentation persécutrice. Il est donc bien l’esprit de vérité, celui qui dissipe les brumes de toute mythologie » (p. 305). Girard s’étonne que Jérôme n’ait pas traduit ce mot simplement par « avocat », ce qui aurait évité l’opacité de « paraclet ».
Voici la conclusion du livre : « Il s’agit certainement des premiers chrétiens persécutés par les juifs ou par les Romains, mais il s’agit aussi des juifs, plus tard, persécutés par les chrétiens, il s’agit de toutes les victimes persécutées par tous les bourreaux. Sur quoi porte le témoignage en effet ? Je dis qu’il porte toujours sur la persécution collective génératrice des illusions religieuses. Et c’est bien à cela que la phrase suivante fait allusion : L’heure vient même où qui vous tuera estimera rendre un culte à Dieu. Dans le miroir des persécutions historiques, médiévales et modernes, nous appréhendons, sinon la violence fondatrice elle-même, du moins ses succédanés, d’autant plus meurtriers qu’ils n’ont plus rien d’ordonnateur. Les chasseurs de sorcières tombent sous le coup de cette révélation, ainsi que les bureaucrates totalitaires de la persécution. Toute violence désormais révèle ce que révèle la passion du Christ, la genèse imbécile des idoles sanglantes, de tous les faux dieux des religions, des politiques et des idéologies. Les meurtriers n’en pensent pas moins que leurs sacrifices sont méritoires. Eux non plus ne savent pas ce qu’ils font et nous devons leur pardonner. L’heure est venue de nous pardonner les uns les autres. Si nous attendons encore, nous n’aurons plus le temps » (p. 311).
– Parmi les œuvres en lien avec ce thème, voir Le Sacrifice d’Isaac du Caravage (illustration ci-dessus).
– On aurait pu commencer par cela (qui manque au livre) : Le bouc émissaire dans la Bible sur le site de l’Observatoire du bouc émissaire.
– Et ce qui manque au livre de René Girard est un recensement des scènes de boucs émissaires dans la Bible. Je pense au péricope de la femme adultère bien sûr, dont on trouvera des analyses sur ces deux sites intéressants : site René Girard et Nomana.
– Suggestion cinéma : visionner la scène de Le Soleil brille pour tout le monde de John Ford (1953) dans laquelle le juge protège le jeune noir accusé de viol, en traçant une ligne sur le sol façon Jésus dans l’épisode de la femme adultère.
– Vous retrouverez deux extraits de ce livre dans le cours de BTS sur le thème « Seuls avec tous ».
– Un photogramme du film Tout l’or du monde (1961), de René Clair (1898-1961) illustre cet article. Toine, un berger un peu simplet, y est traité en « ennemi du peuple » pour avoir refusé comme son père de céder son champ à un promoteur immobilier. La maire mène l’attaque depuis le bureau de l’instituteur, avec la formule « L’égoïsme d’un seul s’oppose à l’intérêt de tous » inscrite au tableau noir. Ce film sera exploité dans le cadre du sujet « À toute vitesse » !.
Voir en ligne : Site consacré à René Girard
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com