Accueil > Classiques > Journal, de Samuel Pepys
Londres au XVIIe siècle comme si vous y étiez, pour adultes
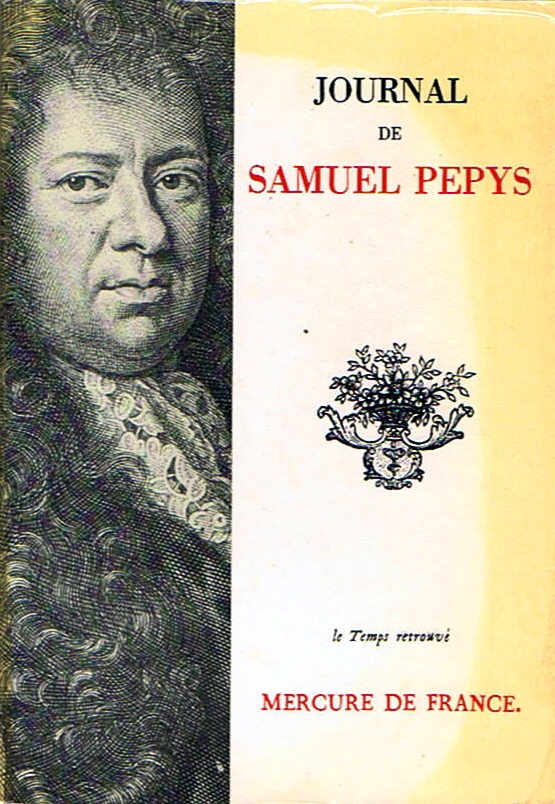 Journal, de Samuel Pepys
Journal, de Samuel Pepys
Mercure de France, 1985 (1660-1669), 410 p., épuisé.
samedi 21 février 2015
Samuel Pepys (1633-1703) est un haut fonctionnaire, membre du Parlement anglais, connu pour cet extraordinaire journal tenu de 1660 à 1669 non seulement en sténographie, mais à partir d’une certaine date, en mélangeant différentes langues vivantes ou mortes. Le manuscrit ne sera d’ailleurs déchiffré puis publié que dans les années 1820, dans une version expurgée. C’est seulement à mon quatrième séjour à Londres que j’ai eu l’idée de glisser dans ma valise une sélection d’extraits parue en 1985 au Mercure de France (410 p., traduction de Renée Villoteau, préface de Jean-Louis Curtis). Il existe depuis 1994 une éditions complète en deux volumes (collection Bouquins), mais mon amour pour l’histoire d’Angleterre n’est pas allé jusque-là. C’est sans doute un tort, car Wikipédia nous apprend que « ce n’est qu’à la fin du XXe siècle (1970-1983), avec l’édition méticuleuse en 11 volumes réalisée par Robert Latham et William Matthews, que l’on a pu disposer enfin d’une version complète non expurgée ». Or la traduction de Renée Villoteau est bien antérieure à ce livre de 1985 que j’ai lu, et donc à l’édition non expurgée. Or, qui sait si, à l’instar de l’Histoire de ma vie de Jacques Casanova, des pages encore plus altersexuelles que celles qui y figurent déjà ne faisaient pas partie de la purge subie par le journal ? Sans doute attendrai-je ma retraite pour me lancer dans la lecture exhaustive ! Cependant, ce bref aperçu de 400 pages m’a passionné. Le principal intérêt historique de l’œuvre est une sorte de reportage au jour le jour sur la grande peste de Londres (1665-66) ainsi que sur le grand incendie de Londres (1666), sans oublier les considérations sur les débuts de la restauration anglaise après l’épisode Cromwell, sous Charles II d’Angleterre. C’est d’ailleurs l’impression qu’il vivait un épisode crucial de l’histoire qui a poussé Pepys à écrire son journal. Mais la vie privée de ce haut fonctionnaire soucieux d’arrondir son petit pécule ne manque pas de sel. Croyant n’être lu de personne, il confiait aux pages blanches ses strausskahnisations quotidiennes de soubrettes et autres épouses d’assujettis. Jaloux sans raison de sa femme dont il se dit très satisfait au début de son journal, c’est bientôt lui qui lui donne toutes les raisons d’être fort jalouse.
Souper et au lit
Beaucoup de journées se terminent par une formule du type « Souper, prières et au lit » (et si l’un des trois saute, ce n’est ni le souper, ni le lit !). Une variante fréquente, c’est que soit en déplacement, soit chez lui, Pepys ou sa femme partagent leur lit avec un visiteur, une servante, etc., pratique semble-t-il courante au point qu’il le signale sans y penser, d’où l’intérêt d’un tel journal pour nous apprendre tout ce que d’habitude on ne prend pas la peine de noter : « Chez moi, mangé un morceau de pain et de fromage avec mon frère et au lit avec lui » (4 août 1663). Souvent Pepys se rend au théâtre avant de rentrer chez lui, et dit franchement si ça lui a plu, souvent sans lien avec la postérité éventuelle des œuvres ; ainsi trouve-t-il souvent des Shakespeare rasoir ! Exemple, le 7 novembre 1667 : « À midi j’ai décidé avec sir William Pen d’aller voir jouer La Tempête, une vieille pièce de Shakespeare. […] C’est la pièce la plus innocente qui soit. On n’y trouve guère de mots d’esprit, mais elle est bonne, au-dessus de la moyenne ». Le 25 septembre 1660, il goûte pour la première fois du thé et précise : « c’est une boisson chinoise ». Il note le 7 octobre 1660 « un dicton favori [du père de Lord Sandwich] : « Quand un homme fait un enfant à une fille et l’épouse, c’est comme s’il avait d’abord [chié] dans son chapeau avant de se le camper sur la tête » (Wikipédia signale que Montaigne est la source du prétendu dicton).
Peine de mort et autres divertissements
Voici intégralement l’époustouflante journée du 13 octobre 1660 : « Chez Mylord dès le matin, mais comme il n’était pas encore levé, je suis allé à Charing-Cross, pour voir pendre, écarteler et dépecer le major Harrisson ; ce qui fut fait, le major paraissant d’aussi bonne humeur que peut l’être un homme en pareille circonstance. On le coupa en morceaux et l’on présenta sa tête et son cœur au peuple qui poussa de grands cris de joie. Ainsi, le sort a donc voulu que je visse décapiter le Roi à Whitehall, et que je visse encore aujourd’hui, à Charing-Cross, le premier sang versé pour le venger. De là chez Mylord, où j’ai retrouvé le capitaine Cuttance et M. Sheply pour aller manger des huîtres à la taverne du Soleil. Ensuite, par la rivière, chez moi où je me suis emporté contre ma femme qui laisse traîner ses affaires partout. Dans ma colère, j’ai brisé à coups de pied le joli petit panier que je lui avais acheté en Hollande. J’en fus bien fâché ensuite. Passé l’après-midi à installer des rayons dans ma bibliothèque. Le soir au lit. » (p. 37). Il s’agit des représailles de l’exécution de Charles Ier, après l’épisode Cromwell. Pepys tremble pour sa carcasse, car il craint qu’on ne se souvienne qu’il fut républicain ! L’extrait de Pepys est à mettre en relation avec l’incipit des Réflexions sur la guillotine d’Albert Camus, où celui-ci évoque son père, plutôt partisan a priori de la peine capitale, revenant d’une exécution à laquelle il avait voulu assister : « Ma mère raconte seulement qu’il rentra en coup de vent, le visage bouleversé, refusa de parler, s’étendit un moment sur le lit et se mit tout d’un coup à vomir. » Autres temps, autres mœurs : le 11 avril 1661, en voyage dans la campagne : « Nous sommes passés à cheval auprès du pendu de Shooter’s Hill. C’était répugnant à voir, cette chair desséchée sur les os ». Le 21 janvier 1664, Pepys se mêle à une foule de « douze ou quatorze mille personnes » pour assister à la pendaison d’un voleur.
Des mœurs domestiques et courtisanes
Humaniste, Pepys ? À l’église, il s’insurge que ses serviteurs s’assoient juste derrière lui : « il n’est pas convenable que nos serviteurs soient placés ainsi, comme s’ils étaient nos égaux » (11 novembre 1660). Il n’hésite pas à rosser une servante (cf. 1er décembre 1660). Le 28 janvier 1661 au théâtre : « J’étais placé en arrière, dans un coin sombre, lorsqu’une dame se retournant, cracha sur moi par mégarde, ne m’ayant point aperçu ; mais comme je vis aussitôt qu’elle était fort jolie, je n’en fus pas fâché le moins du monde ». Ses relations avec sa femme se dégradent progressivement : « j’ai eu avec elle une violente discussion parce qu’elle avait des rubans de deux couleurs mal assorties. J’en suis vite arrivé aux gros mots, à tel point que, dans ma colère imbécile, je l’ai appelée putain, ce que j’ai regretté par la suite » (19 décembre 1661). Il se met à reluquer les servantes, ce qui vaut mieux que de les battre. Le 1er août 1662, il n’ose pas faire des propositions à sa servante, de peur qu’elle ne cafte. Le puritanisme de Cromwell s’éloigne. Le 25 décembre 1662, Pepys note que les courtisans « se sont tous mis à rire en pleine chapelle, quand [l’évêque] a blâmé leurs mauvaises actions ». Les nouvelles de France, souvent inexactes, émaillent le texte, et souvent de façon à souligner combien la France est supérieure à l’Angleterre en ces temps difficiles. Exemple, le 19 juin 1663 : « Quand [Louis XIV] va voir sa maîtresse, Mlle de La Vallière, une charmante jeune femme qui est enceinte de lui en ce moment, il s’y rend au vu et au su de tous, avec ses gardes, les trompettes et les timbales ; et la troupe stationne devant la maison le temps que le roi y demeure ». Remplacez le carrosse par un scooter : rien n’a changé ! Le 26 avril 1667 : « Il a [Louis XIV] lui aussi, des maîtresses, mais il se moque de la sottise de notre roi qui donne à ses bâtards le titre de prince, gaspille pour eux ses revenus et fait de ses maîtresses, ses maîtres. Le roi de France n’a jamais accordé à La Vallière de faveurs à distribuer et ne donne qu’une faible pension à ses bâtards ».
Casanovisme honteux
Le 24 septembre 1663 : « j’ai été à Westminster trouver Mlle Lane. Je l’ai emmenée à Lambeth et là, je fis avec elle ce que je voulais, sauf le principal, à quoi elle ne voulut point consentir, ce dont Dieu soit loué. Avec la grâce de Dieu, je ne recommencerai jamais, tant que je vivrai ». Souvent, Pepys renonce à des occasions avec des prostituées, par peur panique de la vérole (ce qui arrêtera rarement Casanova), ce pourquoi il préfère les soubrettes de la maison ou les femmes qu’il connaît. Le 15 mars 1664, c’est le récit objectif de l’agonie et la mort de son frère, qui, une fois n’est pas coutume, l’empêche de dormir, mais provoque le lendemain cette confession : « Seigneur, comme le monde fait peu de cas de la mémoire d’un homme une heure après sa mort ! J’ai vraiment des reproches à m’adresser. Certes, quand je le vis mourant, puis mort, j’éprouvai un réel chagrin pendant un moment, tant que je l’eus sous les yeux. Mais aussitôt après, et depuis lors, j’ai eu, à la vérité, bien peu de peine pour lui ». Les bonnes résolutions de Pepys ne tiennent guère. C’est aussi l’époque où il se met à truffer ses pages de mots étrangers, notamment français, mais d’un français malhabile : « J’ai trouvé Mme Bagwell qui m’attendait au bureau après le repas. Je l’ai emmenée dans un cabaret où nous avions déjà été ensemble et là, j’eus sa compagnie et je pris mon plaisir avec elle. Curieux de voir comment une femme, en dépit de son soi-disant grand amour à son mari, et malgré sa religion, peut être vaincue. Puis je suis revenu travailler un peu au bureau et je suis retourné chez le barbier pensant avoir rencontrais Jane, mais elle n’étais pas dedans. Puis au bureau où, à ma grande satisfaction, j’ai fait vœu de me consacrer à mes affaires et de laisser aller les femmes pendant un mois » (23 janvier 1665). Autre exemple de polyglossie, le 13 avril 1667 : « Cet après-midi, Mme Lowther est venue me trouver au bureau et là, je did toker ses mamelles and did baiser them and su boca ». Chaque année, le 26 mars, Pepys fête scrupuleusement l’anniversaire de son opération de la pierre, et se réjouit d’être en bonne santé ; bel exemple d’optimisme ! En revanche, le 10 octobre 1666 : « C’est aujourd’hui l’anniversaire de mon mariage. Combien d’années depuis, je ne saurais le dire, mais ma femme affirme que cela en fait dix » (en fait, ils se trompent tous les deux de jour et d’année, car ils se sont mariés le 1er décembre 1655 d’après le registre de la paroisse cité en note ! Bel exemple d’humilité par rapport à la mémoire humaine…)
Peste et grand incendie
Le mot « peste » est écrit par Pepys le 10 juin 1665, alors qu’elle avait commencé depuis le 12 avril (article de Wikipédia). Il note : « Ce soir, en rentrant pour souper, j’apprends que la peste vient de faire son apparition dans la Cité ». Le 7 juin, il avait déjà noté : « Aujourd’hui, bien malgré moi, j’ai vu dans Drury Lane deux ou trois maisons avec une croix rouge sur la porte et l’inscription : « Dieu ait pitié de nous ». Triste spectacle, le premier de cette sorte que je voie, autant qu’il m’en souvienne. » (Il rédigeait souvent son journal après coup pour plusieurs jours, d’où sans doute le « autant qu’il m’en souvienne »). Pour cette partie, consulter ce site.
Peste ou pas, son statut de fonctionnaire n’empêche jamais Pepys de s’amuser ; d’ailleurs, il remarque à plusieurs reprises que certains riches ont tort d’accumuler de l’argent en se disant qu’ils en jouiront plus tard, au risque que plus tard n’arrive jamais. Le 6 janvier 1668, notre hédoniste philosophe : « C’est là la plus grande et la plus véritable satisfaction que je puisse espérer dans ce monde, et […] si nous travaillons, c’est dans cet espoir ; aussi je m’amuse de tout mon cœur, bien persuadé que, si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai peut-être pas plus tard en supporter la dépense ou bien avoir la santé nécessaire pour en jouir ; je devrai alors me contenter de la vaine attente du plaisir ou même m’en passer complètement ». Le 14 août 1666, ils s’amusent avec quelques amis à se grimer en démons, plus à se travestir : « Je les ai fait boire, nous sommes montés au premier étage et nous nous sommes mis à danser (William Batelier danse bien) et à nous habiller lui et moi en femmes ; Mercer avait mis un costume de Tom et était en garçon ». Il reconnaît qu’il s’est rarement aussi bien amusé dans sa vie que pendant l’épisode de la peste. Le 2 septembre 1666, c’est le grand incendie de Londres, qui intervient par ces mots : « Vers trois heures du matin, Jane vint nous appeler pour nous dire qu’on voyait un grand incendie dans la Cité. Je me levai pour aller à la fenêtre. Je jugeai que c’était au plus loin à Mark Lane, trop loin tout de même pour être dangereux, à mon avis, aussi je me recouchai et me rendormis ». La peste, qui avait cessé avec l’hiver 65-66, et avait repris au printemps 66, est au moins stoppée net par l’incendie. Le roi, qui avait fui Londres au gros de l’épidémie, n’est pas grandi aux yeux de Pepys : « Le Roi et sa cour n’ont jamais été aussi dissolus qu’aujourd’hui. Toujours le jeu, les blasphèmes, les catins, l’ivrognerie et les vices les plus abominables qui soient. Tout cela finira mal » (27 juillet 1667).
Crise conjugale
Le 25 octobre 1668 commence la crise finale avec sa femme : « Et, après souper, je me suis fait peigner les cheveux par Deb [la servante] : ce fut la cause du plus grand chagrin de ma vie, car ma femme, survenant à l’improviste, me trouva en train d’embrasser la petite. Je demeurai absolument saisi, la petite aussi. Je cherchai en vain une défaite. Ma femme, d’abord muette de stupeur, fut gagnée par la colère ; elle retrouva la parole et parut hors d’elle-même ». Pepys fait toutes les promesses exigées par sa femme et par sa mauvaise conscience, mais ne peut s’empêcher de consacrer toute son énergie à retrouver la servante chassée de la maison : « À dire vrai, j’ai grande envie d’avoir la virginité de cette fille ; je ne doute pas d’y arriver si je could get time para be con her » (13 novembre 1668). Le bougre ne hait pas tant sa légitime : « Rentré pour souper, j’ai ensuite dormi avec grand contentement auprès de ma femme. Je dois rappeler ici que j’ai couché avec ma moher (impossible de savoir le sens de ce mot) en tant qu’époux, plus souvent depuis cette querelle que pendant les douze mois précédents, et avec plus de plaisir pour elle, je le crois, que depuis tout le temps de notre mariage » (14 novembre 1668). Il parvient à retrouver la donzelle : « Incapable d’écouter ma raison, je voulus la voir ce soir même. La nuit était venue. Je pris un carrosse et je did baiser her… Cependant, je lui donnai les meilleurs conseils que je pus : prendre soin de son honneur, craindre Dieu et ne permettre à nul homme para avoir to do con her as je have done, ce qu’elle me promit » (18 novembre).
Des lésions aux yeux lui rendent impossible la rédaction du journal. Le 31 mai 1669, après avoir relaté une dernière relation extra-conjugale avec une certaine Betty Michell, il conclut ainsi ces neuf années diaristes : « Ainsi finit sans doute tout ce que je pourrai jamais écrire moi-même dans mon journal, car je suis incapable de le faire : depuis longtemps déjà je pense perdre la vue chaque fois que je prends la plume. Quoi qu’il advienne, il me faut m’abstenir. Dorénavant, je ferai tenir mon journal par les miens en langage clair et je devrai me résigner à n’y rien noter qui ne puisse être connu d’eux et de tout le monde. S’il se trouve quelque chose (ce ne sera guère, maintenant que mes amours avec Deb sont finies et que mes yeux m’interdisent à peu près tous les plaisirs), je tâcherai de réserver une marge dans mon livre pour y ajouter çà et là une note en langage chiffré, de ma propre main. Ainsi je m’arrête à ce parti ; c’est un peu comme si je me voyais descendre au tombeau. À cela et à tous les maux qui accompagnent ma cécité, Dieu veuille me préparer ! »
L’épouse adorée meurt l’année suivante, et Pepys lui survit plus de trente ans, poursuivant sa carrière avec des hauts très hauts (conseiller de Jacques II) et des bas très bas (prison à trois reprises). Je n’ai pas trouvé dans l’article de Wikipédia d’indication sur le fait qu’il ait ou non dicté la suite de son journal, comme il l’envisageait, mais c’est à supposer que non, ni d’indication sur l’évolution de sa cécité, mais c’est à supposer que ça ne s’est pas aggravé, sans quoi eût-il poursuivi une telle carrière ?
Voir en ligne : Lire le journal en anglais, jour par jour
© altersexualite.com 2014
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com