Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > La Peur, de Gabriel Chevallier
Violences faites aux hommes, pour lycéens
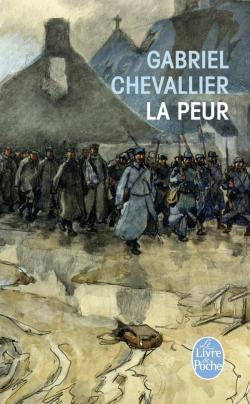 La Peur, de Gabriel Chevallier
La Peur, de Gabriel Chevallier
Le Livre de Poche, 1930 (2010), 410 p., 7,1 €
mercredi 13 décembre 2017
Après avoir lu Clochemerle de Gabriel Chevallier, j’ai eu envie de lire La Peur, son roman-témoignage sur la Première Guerre mondiale, d’autant que j’avais vu entre-temps l’adaptation cinématographique éponyme de Damien Odoul (La Peur, 2014). Le narrateur s’appelle Jean Dantremont, mais on est très proche de l’autobiographie. C’est un livre marquant d’abord par son titre, auquel il doit sans doute d’être beaucoup moins lu que les grands classiques que nous connaissons tous, puis par le style et le côté « vu des tranchées », qui l’oppose par exemple à La Débâcle d’Émile Zola, sur la guerre de 1870. Il semble avoir été redécouvert récemment, car l’édition Livre de Poche est toute récente (2010). La guerre de 14-18 fut la plus grande tuerie miliaire de l’histoire, aujourd’hui dépassée par la Seconde Guerre, mais sur notre territoire, elle est de loin la plus importante en nombre de morts. Des morts ultra-majoritairement de sexe masculin, on a parfois honte à le rappeler. Eh oui, la guerre, les guerres du passé surtout, ont fait partie des « violences faites aux hommes », que le politiquement correct actuel tend à passer par pertes et profit derrière les « violences faites aux femmes ». Les femmes mortes pour la France constituent un épiphénomène parmi les centaines de milliers d’hommes morts pour la France, mais s’il y a parmi elles un ou dix milliers de femmes qui n’ont pas été tuées mais violées, la doxa contemporaine fait mine de considérer que ces milliers de viols constituent le summum de violence, et les 1,4 millions de morts et 3,5 millions de blessés et invalides, à 99 % hommes paraissent comme une conséquence normale de la guerre. Idem en Corée du Sud par exemple, où lorsqu’on a évoqué avec soupirs et hochements de tête la question des femmes de réconfort, on a l’impression d’avoir fait le tour de la question ; mais c’est oublier que c’était la guerre entre Corée et Japon, et que les victimes masculines, mortes et enterrées, ont été bien plus nombreuses que les femmes violées (et certaines torturées et tuées). Le livre de Gabriel Chevallier nous rappelle l’existence de ces « violences faites aux hommes » que la bien pensance contemporaine tend à oublier, à force de faire de l’excès de vitesse sur les autoroutes de la pensée. Heureusement de nos jours la situation des femmes progresse et certaines ont enfin l’opportunité de combattre héroïquement dans les plus grandes armées, à l’instar de Moi, Viyan, combattante contre Daech. Pour cet article, nous n’avons pas de commentaires à faire ; nous nous contenterons de renvoyer à de bonnes pages, et nous en citerons d’autres intégralement.
Première victime de la guerre
Dans l’après-midi du 3 août, en compagnie de Fontan, un camarade de mon âge, je parcours la ville.
À la terrasse d’un café du centre, un orchestre attaque La Marseillaise. Tout le monde l’entend debout et se découvre. Sauf un petit homme chétif, de mise modeste, au visage triste sous son chapeau de paille, qui se tient seul dans un coin. Un assistant l’aperçoit, se précipite sur lui, et, d’un revers de main, fait voler le chapeau. L’homme pâlit, hausse les épaules et riposte : « Bravo ! courageux citoyen ! » L’autre le somme de se lever. Il refuse. Des passants s’approchent, les entourent. L’agresseur continue : « Vous insultez le pays, je ne le supporterai pas ! » Le petit homme, très blanc maintenant, mais obstiné, répond : « Je trouve bien que vous offensez la raison et je ne dis rien. Je suis un homme libre, et je refuse de saluer la guerre ! » Une voix crie : « Cassez-lui la gueule à ce lâche ! » Une bousculade se produit de l’arrière, des cannes se lèvent, des tables sont renversées, des verres brisés. L’attroupement, en un instant, devient énorme. Ceux des derniers rangs, qui n’ont rien vu, renseignent les nouveaux arrivants : « C’est un espion. Il a crié : Vive l’Allemagne ! » L’indignation soulève la foule, la précipite en avant. On entend des bruits de coups sur un corps, des cris de haine et de douleur. Enfin, le gérant accourt, sa serviette sous le bras, et écarte les gens. Le petit homme, tombé de sa chaise, est étendu à travers les crachats et les bouts de cigarettes des consommateurs. Son visage tuméfié est méconnaissable, avec un œil fermé et noir ; un filet de sang coule de son front et un autre de sa bouche ouverte et enflée ; il respire difficilement et ne peut se lever. Le gérant appelle deux garçons et leur commande : « Enlevez-le de là ! » Ils le traînent plus loin sur le trottoir où ils l’abandonnent. Mais un des garçons revient, se penche et le secoue d’un air menaçant : « Dis donc, et ta consommation ? » Comme le malheureux ne répond pas, il le fouille, retire de la poche de son gilet une poignée de monnaie dans laquelle il choisit, en prenant la foule à témoin : « Ce salaud serait parti sans payer ! » On l’approuve : « Ces individus sont capables de tout ! – Heureusement qu’on l’a désarmé ! – Il était armé ? – Il a menacé les gens de son revolver. – Aussi, nous sommes trop bons en France ! – Les socialistes font le jeu de l’Allemagne, pas de pitié pour ces cocos-là ! – Les prétendus pacifistes sont des coquins. Ça ne se passera pas comme en 70, cette fois ! »
Pour fêter cette victoire, on réclame à nouveau La Marseillaise. On l’écoute en regardant le petit homme sanglant et souillé, qui geint faiblement. Je remarque près de moi une femme pâle et belle, qui murmure à son compagnon : « Ce spectacle est horrible. Ce pauvre homme a du courage… » Il lui répond : « Un courage d’idiot. On ne s’avise pas de résister à l’opinion publique. »
Je dis à Fontan :
– Voilà la première victime de la guerre que nous voyons.
– Oui, fait-il rêveusement, il y a beaucoup d’enthousiasme ! » (p. 24).
Grand-mère inquiète
– La grand-mère écrit de sa propre initiative au commandant pour faire exempter son petit-fils : « On ne devrait envoyer à la guerre que ceux qui sont forts (sic) et ne pas exposer les jeunes gens trop délicats, incapables de résister aux émotions violentes, qui ne seront là-bas d’aucune utilité » (p. 39).
Général mateur
Nous allions chaque semaine à la douche. Le service sanitaire avait imaginé, pour détruire les parasites, de nous passer le corps au Crésyl. Les infirmiers nous aspergeaient avec une éponge. Ce traitement nous brûlait pendant une heure, mais demeurait sans effet pour les poux, que nous retrouvions en bonne santé et pleins d’appétit dans nos vêtements qu’on ne désinfectait pas. Ces douches constituaient une attraction, grâce au « père Rondibé ». On avait surnommé ainsi un général de division, maigre, sale et voûté, aux yeux sanguinolents, qui s’y tenait constamment. Ce chef sadique n’aimait voir les soldats que nus. Il passait en revue chaque nouvelle fournée, alignée sous les jets, à petits pas de vieillard, en tenant son regard à mi-corps. Si quelque objet le frappait par la dimension, il félicitait l’homme : « Tu en as une belle, toi ! » Son visage se ridait de contentement et il bavait. On ne le rencontrait qu’à la douche et aux feuillées. Il s’absorbait dans la contemplation des fosses, y plongeait sa canne, et accueillait les hommes, surpris de le trouver là : « Allez-y, mes petits, ne vous gênez pas. Quand le ventre va, tout va. Je viens m’informer de votre moral. » Ces mœurs, qui eussent été inadmissibles ailleurs qu’à la guerre, amusaient les soldats, peu difficiles sur les distractions. » (p. 57)
Esthétique de la guerre : danse macabre ou vanité ?
En fouillant hors des boyaux, je découvris dans le sous-sol d’une maison deux cadavres allemands très anciens. Ces hommes avaient dû être blessés par des grenades et murés ensuite, dans la précipitation du combat. Dans ce lieu privé d’air, ils ne s’étaient pas décomposés, mais racornis, et un récent obus avait éventré cette tombe et dispersé leurs dépouilles. Je demeurai en leur compagnie, les retournant d’un bâton, sans haine ni irrespect, plutôt poussé par une sorte de pitié fraternelle, comme pour leur demander de me livrer le secret de leur mort. Les uniformes aplatis semblaient vides. De ces ossements épars ne subsistait vraiment qu’une demi-tête, un masque, mais d’une horreur magnifique. Sur ce masque, les chairs s’étaient détachées et verdies, en prenant les tons sombres d’un bronze patiné par le temps. Une orbite rongée était creuse, et, sur ses bords, avait coulé, comme des larmes, une pâte durcie qui devait être de la cervelle. C’était le seul défaut qui gâtât l’ensemble, mais peut-être y ajoutait-il, comme la lèpre de l’usure ajoute aux statues antiques dont elle a entamé la pierre. On eût dit qu’une main pieuse avait fermé l’œil, et, sous la paupière, on devinait le contour lisse et le volume de son globe. La bouche s’était crispée dans les derniers appels de la terrible agonie, avec un rictus des lèvres découvrant les dents, grande ouverte, pour cracher l’âme comme un caillot. J’aurais voulu emporter ce masque que la mort avait modelé, sur lequel son génie fatal avait réalisé une synthèse de la guerre, afin qu’on en fît un moulage qu’on eût distribué aux femmes et aux enthousiastes. Du moins, j’en pris un croquis que je conserve dans mon portefeuille, mais il n’exprime pas cette horreur sacrée que m’inspire le modèle. Ce crâne mettait dans le clair-obscur des ruines une grandeur dont je ne pouvais me détacher, et je ne partis que lorsque le jour qui déclinait entoura d’ombres indistinctes les reflets du front, des pommettes et des dents, le transforma en un Asiatique ricanant. (p. 66)
Siffler en guerroyant
Une fois, notre caporal me demanda :
— Tu n’as pas eu trop peur ?
— Oh ! répondit un ancien, j’étais derrière lui, il n’a pas arrêté de siffler.
C’était vrai. Je n’aime pas à être réveillé brusquement. Aussi apportais-je à ces alertes la mauvaise humeur d’un homme dont on choque les habitudes et qui refuse absolument de s’intéresser à un spectacle qu’il blâme. Mes sifflotements, qui avaient étonné l’ancien, exprimaient mon mépris pour cette guerre qui empêchait les gens de dormir et faisait tant de bruit pour si peu d’effets. (p. 76)
À l’attaque !
– En avant ! Vite ! Vite !
On se jeta dehors en tombant, en s’accrochant, en criant. On se jeta dans la nuit froide, sifflante, dans la nuit en déflagration, la nuit pleine d’obstacles, d’embuscades, de tronçons et de clameurs, la nuit qui cachait l’inconnu et la mort, rôdeuse muette aux prunelles d’éclatements, cherchant ses proies terrifiées. Des êtres abandonnés, entamés, étendus quelque part, de notre régiment peut-être, hurlaient comme des chiens malades. Des caissons fous, ravitailleurs du tonnerre, passaient ventre à terre, culbutant, écrasant tout pour échapper. Nous courions de toutes nos forces, sur des jambes insuffisantes, surchargées, trop petites, trop faibles pour nous soustraire aux trajectoires instantanées. Nos sacs, nos musettes, nous serraient les poumons, nous tiraient en arrière, nous rejetaient dans la zone étincelante, brusquement surchauffée, du fracas. Et toujours ce fusil qui glisse de l’épaule, arme inutile, dérisoire, qui échappe et embarrasse ! Et toujours cette baïonnette qui entrave ! Nous courions, nous guidant sur un dos, les yeux dilatés mais prêts à se fermer pour ne pas voir le feu, à se fermer sur la pensée recroquevillée, qui refuse sa fonction, qui voudrait ne pas savoir, ne pas comprendre, qui est un poids mort pour la carcasse qui bondit, cravachée par les lanières tranchantes de l’acier, qui fuit le knout plombé rugissant à ses oreilles. Nous courions, le corps penché en avant, avec l’inclinaison préparée de la chute qui doit être plus rapide que l’obus. Nous courions comme des brutes, non plus des soldats, mais déserteurs, dans le sens de l’ennemi, résonnant intérieurement de ce seul mot : assez ! à travers les maisons titubantes, soulevées et retombant en poussière sur leurs assises.
Une salve, si directe qu’elle nous surprit debout, monta de la terre comme un volcan, nous rôtit la face, nous brûla les yeux, tailla dans notre colonne, comme dans la propre chair de chacun de nous.
La panique nous botta les fesses. Nous franchîmes comme des tigres les trous d’obus, fumants, dont les lèvres étaient des blessés, nous franchîmes les appels de nos frères, ces appels sortis des entrailles et qui touchent aux entrailles, nous franchîmes la pitié, l’honneur, la honte, nous rejetâmes tout ce qui est sentiment, tout ce qui élève l’homme, prétendent les moralistes – ces imposteurs qui ne sont pas sous les bombardements et exaltent le courage ! Nous fûmes lâches, le sachant, et ne pouvant être que cela. Le corps gouvernait, la peur commandait. (p. 89)
Premier cadavre français
Subitement, le soldat qui me précédait s’accroupit, se traîna sur les genoux pour passer sous un encombrement de matériaux. Je m’accroupis derrière lui. Quand il se releva, il démasqua un homme de cire, étendu sur le dos, qui ouvrait une bouche sans haleine, des yeux sans expression, un homme froid, raidi, qui avait dû glisser sous cet illusoire abri de planches pour mourir. Je me trouvai brusquement nez à nez avec le premier cadavre récent que j’eusse vu de ma vie. Mon visage passa à quelques centimètres du sien, mon regard rencontra son effrayant regard vitreux, ma main toucha sa main glacée, assombrie par le sang qui s’était glacé dans ses veines Il me sembla que ce mort, dans ce court tête à tête qu’il m’imposait, me reprochait sa mort et me menaçait de sa vengeance. Cette impression est l’une des plus horribles que j’ai rapportées du front.
Mais ce mort était comme le gardien d’un royaume des morts. Ce premier cadavre français précédait des centaines de cadavres français. La tranchée en était pleine. (Nous débouchions dans nos anciennes premières lignes, d’où était partie notre attaque de la veille). Des cadavres dans toutes les postures, ayant subi toutes les mutilations, tous les déchirements et tous les supplices. Des cadavres entiers, sereins et corrects comme des saints de châsses ; des cadavres intacts, sans traces de blessure ; des cadavres barbouillés de sang, souillés et comme jetés à la curée de bêtes immondes ; des cadavres calmes, résignés, sans importance ; des cadavres terrifiants d’êtres qui s’étaient refusés à mourir, ceux-là, furieux, dressés, bombés, hagards, qui réclamaient la justice et qui maudissaient. Tous avec leur bouche tordue, leurs prunelles dépolies et leur teint de noyés. Et des fragments de cadavres, des lambeaux de corps et de vêtements, des organes, des membres dépareillés, des viandes humaines rouges et violettes, pareilles à des viandes de boucherie gâtées, des graisses jaunes et flasques, des os laissant fuir la moelle, des entrailles déroulées, comme des vers ignobles que nous écrasions en frémissant. Le corps de l’homme mort est un objet de dégoût insurmontable pour celui qui vit, et ce dégoût est bien la marque de l’anéantissement complet.
Pour échapper à tant d’horreur, je regardai la plaine. Horreur nouvelle, pire : la plaine était bleue.
La plaine était couverte des nôtres, mitraillés, butés le visage en terre, les fesses en l’air, indécents, grotesques comme des pantins, pitoyables comme des hommes, hélas ! Des champs de héros, des chargements pour les nocturnes tombereaux…
Une voix, dans le rang, formula cette pensée que nous taisions : « Qu’est-ce qu’ils ont pris ! » qui eut aussitôt en nous ce retentissement profond : « Qu’est-ce que nous allons prendre ! » (p. 94)

Le mort qui rit
Aucune vie, aucune lumière, aucune couleur n’accrochait le regard et ne distrayait l’esprit. Il fallait suivre la tranchée y chercher les cadavres, au moins pour les éviter. Je constate qu’on ne distinguait plus les vivants des morts. Nous avions rencontré quelques soldats immobiles, accoudés au parapet, que j’avais pris pour des veilleurs. Je vis qu’ils étaient tués également et qu’une légère inclinaison les avait maintenus droits contre le talus de la tranchée.
J’aperçus de loin le profil d’un petit homme barbu et chauve assis sur la banquette de tir, qui semblait rire. C’était le premier visage détendu, réconfortant que nous rencontrions, et j’allais vers lui avec reconnaissance, me demandant : « Qu’a-t-il à rire de la sorte ? » Il riait d’être mort ! Il avait la tête tranchée très nettement par le milieu. En le dépassant, je découvris, avec un mouvement de recul, qu’il manquait la moitié de ce visage hilare, l’autre profil. La tête était complètement vide. La cervelle, qui avait roulé d’un bloc, était posée bien proprement à coté de lui – comme une pièce chez un tripier – près de sa main qui la désignait. Ce mort nous faisait une farce macabre. De là, peut-être, son rire posthume. Cette farce atteignit au comble de l’horreur lorsqu’un des nôtres poussa un cri étranglé et nous bouscula sauvagement pour fuir.
— Qu’est-ce qui te prend ?
— Je crois que c’est… mon frère ! (p. 96)
Rameurs dans la sape
Nous nous arrangeâmes aussi pour dormir et éviter les crampes. Chacun de nous, entre ses jambes écartées, fit place à son voisin. Nous étions disposés comme des rameurs. La nuit, toute la rangée s’inclinait en arrière et les ventres servaient d’oreiller aux têtes. (p. 101).
Première blessure
Je suis soulevé, sourd, aveuglé par une fumée, traversé par une odeur aiguë. Des griffes me labourent, me déchirent. Je dois crier sans m’entendre. Ma pensée jette cette lueur dans mon obscurité : « Tes jambes sont arrachées ! » Pour un début… Mon corps s’élance et court. L’explosion l’a déclenché comme une machine. Derrière moi, on crie : « Plus vite ! » sur un ton d’affolement et de souffrance. Alors seulement je m’aperçois que je cours.
Ma raison revient un peu, s’étonne, contrôle : « Sur quoi cours-tu ? » Je crois courir sur des tronçons de jambe… Elle ordonne : « Regarde ! » Je m’arrête, dans le boyau où passent des hommes que je ne vois pas. Ma main, qui a peur de rencontrer quelque chose d’affreux, descend lentement le long de mes membres : les cuisses, les mollets, les souliers. J’ai mes deux souliers !… Alors mes jambes sont entières ! Joie, mais joie incompréhensible. Pourtant il m’est arrivé quelque chose, j’ai reçu un coup…
Ma raison poursuit : « Tu te sauves… As-tu le droit de te sauver ? ». Nouvelle inquiétude. Je ne sais plus si je souffre, ni où. J’ausculte mon corps, je le tâte dans l’ombre. Je rencontre ma main gauche qui ne répond plus à ma pression, dont les doigts ne peuvent serrer. Du poignet coule un liquide tiède : « Bon ! je suis blessé, j’ai le droit de partir ! ».
Cette constatation me calme et me rend aussitôt le sentiment de la douleur. Je geins faiblement. Je suis surtout étourdi et étonné.
Je retrouve la première barricade où l’on a fait une brèche pour faciliter le passage. Le capitaine est toujours là. Personne ne m’arrête. Les soldats de mon bataillon, dont les baïonnettes brillent, tendent leurs visages pâles et anxieux pour voir ce premier blessé. Je reconnais des hommes de la classe 15, qui me disent :
— Veinard ! (p. 113)
Mutilés de guerre
À ma gauche, je reconnais le jeune sous-lieutenant qui commandait notre section. De sa bouche molle sort une plainte monotone et faible de petit enfant. Il agonise. C’était un brave garçon et tout le monde l’aimait.
La place manque. À terre sont affalés des malheureux, des blocs boueux surmontés d’un visage hagard, empreint de cette atroce soumission que donne la douleur. Ils ont le regard des chiens qui rampent devant le fouet. Ils soutiennent leurs membres brisés et psalmodient le chant lugubre monté des profondeurs de leur chair. L’un a une mâchoire fracassée qui pend et qu’il n’ose toucher. Le trou hideux de sa bouche, obstrué par une langue énorme, est une fontaine de sang épais. Un aveugle, derrière son bandeau, lève la tête vers le ciel dans l’espoir de capter une faible lueur par le soupirail de ses orbites, et retombe tristement dans le noir de son cachot. Il sonde le vide autour de lui en tâtonnant, comme s’il explorait les parois visqueuses d’une basse-fosse. Un troisième a les deux mains emportées, ses deux mains de cultivateur ou d’ouvrier, ses machines, son gagne-pain, dont il disait probablement, pour prouver son indépendance : « Quand un homme a ses deux mains, il trouve partout du travail ». Elles lui manquent déjà pour souffrir, pour satisfaire ce besoin si naturel, si habituel, qui consiste à les porter à l’endroit douloureux, qu’elles serrent, afin de calmer. Elles lui manquent pour se tordre, se crisper et supplier. Celui-là ne pourra plus jamais toucher. Je réfléchis que c’est peut-être le plus précieux des sens.
On a apporté aussi un débris humain si monstrueux que tous, à sa vue, ont reculé, qu’il a étonné ces hommes que plus rien n’étonne. J’ai fermé les yeux : je n’ai que trop vu déjà, je veux pouvoir oublier plus tard. Cela, cet être, hurle dans un coin comme un dément. Notre chair soulevée nous suggère qu’il serait généreux, fraternel de l’achever. (p. 117)
Cauchemar de fièvre
La fièvre me reprend, me secoue, m’hallucine. Elle dresse devant moi une barricade fulgurante, un bûcher où flamboient des hommes bleus et gris, qui ont des visages de cadavres ricanants, des mâchoires privées de gencives, comme le masque de Neuville-Saint-Vaast. Ils se lancent à la tête des grenades qui les couronnent d’explosions. Le nuage dissipé, à moitié décapités, sanguinolents, ils continuent de se battre avec acharnement. L’un a un œil qui pend. Pour ne pas perdre de temps, il tire la langue et le gobe. Un autre, un grand Allemand, a le dessus du crâne ouvert ; le cuir chevelu fait charnière et retient l’os qui ballotte comme un couvercle. Au moment où il manque de munitions, il plonge la main dans son crâne, en retire la cervelle et la jette à la figure d’un Français qu’elle enduit d’une bouillie répugnante. Le Français s’essuie, et, furieux, entrouvre sa capote. Il déroule ses intestins et leur fait un nœud coulant. Il lance ce lasso au cou de l’Allemand, lui met son pied contre la poitrine, et, penché en arrière, suspendu de tout son poids, l’étrangle avec ses boyaux. L’Allemand tire la langue. Le Français la tranche avec son couteau et la fixe à sa capote avec une épingle anglaise, comme une décoration. (p. 122)
Parodie de discours belliciste
« Primo, nous avons la baïonnette. Cette baïonnette, tu la mets au bout d’un lebel, tu mets un fantassin animé de la furia française. En face, tu disposes les Boches. Qu’est-ce qui arrive, immanquablement ? Les Boches foutent le camp ou font camarade. Pourquoi penses-tu qu’ils ont planté des barbelés devant leur ligne. À cause de la baïonnette, dit de Poculote. »
Une blessure mal placée
Depuis quatre jours se trouve dans notre salle un blessé qu’on a amené un soir et installé dans un angle isolé. Il semblait très abattu et s’est tenu obstinément tourné contre le mur. Le premier jour, j’avais cru remarquer chez les infirmières un certain étonnement lorsqu’elles l’avaient questionné et, les jours suivants, qu’elles lui parlaient sur un ton bizarre, où je discernais, moi qui les connais bien, une précautionneuse pitié, avec une nuance indéfinissable de supériorité. De la part de toutes, des coups d’œil furtifs et un attrait de curiosité. Pourtant l’homme ne se plaignait pas et mangeait normalement. Tout à l’heure (je commence à faire quelques pas), je me suis dirigé sournoisement de son côté. Il ne m’a pas entendu venir et nos regards se sont rencontrés quand j’ai été tout près de lui. Je lui ai demandé :
— Rien de très grave, mon vieux ?
Il a hésité, puis brusquement :
— Moi ? je ne suis plus un homme !
Comme je ne comprenais pas, il a soulevé sa couverture :
— Regarde !
Au bas de son ventre, j’ai vu la honteuse mutilation.
— J’aurais préféré n’importe quoi !
— Tu es marié ?
— Deux mois avant la guerre. Une bath petite gosse…
Il m’a tendu la photographie, prise sous son traversin, d’une jolie brune aux yeux vifs, au corsage ferme. Il répétait : « N’importe quoi ! »
Je lui ai dit :
— Ne t’inquiète donc pas. Tu la feras encore jouir, ta femme !
— Tu crois !
— Certainement.
Je lui ai raconté ce que je savais sur les eunuques, sur le plaisir qu’ils peuvent procurer aux pensionnaires des harems, je lui ai cité des cas d’ablation volontaire. Il m’a saisi par la manche, et, sur le ton dont on exige un serment :
— Tu en es sûr ?
— Tout à fait sûr. Je t’indiquerai un livre qui traite ces questions.
Il regardait la photographie.
— Moi, à la rigueur… Mais tu comprends, c’est à cause d’elle…
Après un long silence, il m’a confié la somme de ses réflexions :
— Les femmes, vois-tu, c’est avec ça qu’on les tient !
Je n’ai révélé cela à personne, de crainte de l’ennuyer. Il est certain que tous auraient pitié de lui, mais c’est cette pitié justement qui serait terrible et il a bien le temps de la subir. Pour le moment le petit ton (je me l’explique maintenant) des infirmières suffit. Cette nuance, de leur part, m’étonne. Parmi elles, plusieurs jeunes filles bien, de bonne famille, certaines pieuses et probablement vierges ; elles sont pourtant sensibles à la chose. Devant un être incomplet, elles perdent cet air de soumission et de crainte, très discret, que les femmes ont devant l’homme. Leur attitude trop libre signifie : celui-ci n’est pas dangereux, la pire injure qu’une femme puisse nous adresser. Il a raison, le pauvre diable : ça est essentiel avec elles, toutes. Les prudes, qui en ont peur, y pensent autant que les voluptueuses, qui en ont besoin. (p. 141)
Dialogue avec une infirmière
Une infirmière apprivoisée en amena une autre, et ainsi de suite. Les conversations commencèrent, je fus entouré et pressé de questions. On m’interrogea sur la guerre :
— Qu’avez-vous fait au front ?
— Rien qui mérite d’être rapporté si vous désirez des prouesses.
— Vous vous êtes bien battu ?
— Sincèrement, je l’ignore. Qu’appelez-vous se battre ?
— Vous étiez dans les tranchées… Vous avez tué des Allemands ?
— Pas que je sache.
— Enfin, vous en avez vu devant vous ?
— Jamais.
— Comment ! En première ligne ?
— Oui, en première ligne, je n’ai jamais vu d’Allemand vivant, armé, en face de moi. Je n’ai vu que des Allemands morts : le travail était fait. Je crois que j’aimais mieux ça… En tout cas, je ne peux vous dire comment je me serais conduit devant un grand Prussien féroce, et comment ça aurait tourné pour l’honneur national… Il y a des gestes qu’on ne prémédite pas, ou qu’on préméditerait inutilement.
— Mais alors qu’avez-vous fait à la guerre ?
— Ce qu’on m’a commandé, strictement. Je crains qu’il n’y ait là-dedans rien de très glorieux et qu’aucun des efforts qu’on m’a imposés n’ait été préjudiciable à l’ennemi. Je crains d’avoir usurpé la place que j’occupe ici et les soins que vous me donnez.
— Que vous êtes énervant ! Répondez donc. On vous demande ce que vous avez fait !
— Oui ?… Eh bien ! j’ai marché le jour et la nuit, sans savoir ou j’allais. J’ai fait l’exercice, passé des revues, creusé des tranchées, transporté des fils de fer, des sacs de terre, veillé au créneau. J’ai eu faim sans avoir à manger, soif sans avoir à boire, sommeil sans pouvoir dormir, froid sans pouvoir me réchauffer, et des poux sans pouvoir toujours me gratter… Voilà !
— C’est tout ?
— Oui, c’est tout… Ou plutôt, non, ce n’est rien. Je vais vous dire la grande occupation de la guerre, la seule qui compte : J’AI EU PEUR.
J’ai dû dire quelque chose d’obscène, d’ignoble. Elles poussent un léger cri, indigné, et s’écartent. Je vois la répulsion sur leurs visages. Aux regards qu’elles échangent, je devine leurs pensées : « Quoi, un lâche ! Est-il possible que ce soit un Français ! »
Mlle Bergniol (vingt et un ans, l’enthousiasme d’une enfant de Marie propagandiste, mais des hanches larges qui la prédestinent à la maternité, et la fille d’un colonel) me demande insolemment :
— Vous êtes peureux, Dartemont ?
C’est un mot très désagréable à recevoir en pleine figure, publiquement, de la part d’une jeune fille, en somme désirable. Depuis que le monde existe, des milliers et des milliers d’hommes se font tuer à cause de ce mot prononcé par des femmes… Mais la question n’est pas de plaire à ces demoiselles avec quelques jolis mensonges claironnants, style correspondant de guerre et relation de faits d’armes. Il s’agit de la vérité, pas seulement de la mienne, de la nôtre, de la leur, à ceux qui y sont encore, les pauvres types. Je prends un temps pour m’imprégner de ce mot, de sa honte périmée, et l’accepter. Je lui réponds lentement, en la fixant :
— En effet, je suis peureux, mademoiselle. Cependant, je suis dans la bonne moyenne.
— Vous prétendez que les autres aussi avaient peur ?
— Oui.
— C’est la première fois que je l’entends dire et je l’admets difficilement : quand on a peur on fuit.
Nègre, qui n’est pas sollicité, m’apporte spontanément un renfort sous cette forme sentencieusee :
— L’homme qui fuit conserve sur le plus glorieux cadavre l’inestimable avantage de pouvoir encore courir !
Ce renfort est désastreux. Je sens qu’en ce moment notre situation ici est compromise, je sens monter chez ces femmes une de ces colères collectives, comparables à celle de la foule en 1914. J’interviens rapidement :
— Tranquillisez-vous, on ne fuit pas la guerre on ne peut pas…
— Ah ! on ne peut pas… mais si on pouvait ?
Elles me regardent. Je fais le tour de leurs regards.
— Si on pouvait ?… Tout le monde foutrait le camp !
Aussitôt, Nègre déchaîné :
— Tous sans exception. Le Français, l’Allemand, l’Autrichien, le Belge, le Japonais, le Turc, l’Africain… Tous… Si on pouvait ? Vous parlez d’une offensive à l’envers, d’un sacré Charleroi dans toutes les directions, dans tous les pays, dans toutes les langues… Plus vite, en tête ! Tous, on vous dit, tous !
Mlle Bergniol, postée entre nos lits, comme un gendarme à un carrefour, veut arrêter cette déroute. Elle nous jette :
— Et les officiers ?… On a vu des généraux charger en tête de leur division !
— Oui, ça s’est dit… Ils ont marché une fois pour crâner, pour épater la galerie – ou, sans savoir, comme nous avons marché nous-mêmes le premier coup ! Une fois mais pas deux ! Quand on a tâté des mitrailleuses en rase campagne, on ne ramène pas ses os devant ces engins pour le plaisir… Soyez assurées que si les généraux faisaient partie des vagues d’assaut, on n’attaquerait pas à la légère. Mais voilà, ils ont découvert l’échelonnement en profondeur, les bons vieillards agressifs ! C’est la plus belle découverte des états-majors !
— Ah ! c’est horrible ! dit Mlle Bergniol, pâle et ardente.
Elle nous fait peine, et nous jugeons que la discussion ne peut se prolonger davantage. Nègre retourne la situation :
— Ne vous frappez pas, mademoiselle, on exagère. Nous avons tous vaillamment fait notre devoir. Ce n’est pas si terrible maintenant que nous commençons d’avoir des tranchées couvertes, avec le confort moderne. Il manque encore le gaz pour la cuisine, mais nous avons déjà les gaz pour la gorge. Nous avons l’eau courante tous les jours de pluie, des édredons piqués d’étoiles la nuit, et quand le ravitaillement n’arrive pas, on s’en balance : on bouffe du Boche !
Il interpelle la salle :
– Pas, les copains, qu’on a bien rigolé à la guerre ?
– On a salement rigolé !
– C’est un truc qu’est marrant !
[…] Pourtant, Mlle Bergniol m’a déclaré :
– Je n’élèverai pas mes fils dans vos idées.
– Je le sais, mademoiselle. Vous qui pourriez être porteuse de flambeaux en même temps que porteuse d’êtres, vous ne transmettrez à vos fils que la vacillante chandelle que vous avez reçue, dont la cire coule et vous brûle les doigts. Ce sont ces chandelles qui ont mis le feu au monde au lieu de l’éclairer. Ce sont ces cierges d’aveugles qui, demain à nouveau, allumeront les brasiers où les fils de vos entrailles se consumeront. Et leur douleur ne sera que cendre, et, dans l’instant que leur sacrifice se consommera, ils le sauront et vous maudiront. Avec vos principes, si l’occasion s’en présente, à votre tour vous serez des mères inhumaines. (p. 152 sq.)
L’hôpital
Voici que l’hôpital est devenu une terre promise. Il représente pour des millions d’hommes le suprême espoir, et ses misères et ses douleurs, et les navrants spectacles qu’il présente sont pourtant le plus grand bonheur qu’un soldat puisse entrevoir. Autrefois, celui qu’on descendait de la voiture d’ambulance s’attristait en franchissant ce seuil et se sentait menacé. Aujourd’hui, celui qu’on transporte sur un brancard croit recevoir du gardien, avec sa fiche d’entrée, un brevet de vie. (p. 184)
Dialogue avec les amis du père
– Vous avez de bons moments là-haut ?
Suffoqué, je regarde ce vieux cornichon blafard. Mais je lui réponds vite, suavement :
— Oh ! oui, monsieur…
Son visage s’épanouit. Je sens qu’il va s’écrier : « Ah ! ces sacrés poilus ! »
Alors, j’ajoute :
— On s’amuse bien : tous les soirs nous enterrons nos copains ! (p. 191)
Les grades
L’ambition qui pouvait pousser un sergent de 1800 nous est interdite : les maréchaux ne sortent plus du rang. Cette guerre ne distingue et n’élève personne parmi ceux qui risquent, elle ne paie pas. Pour ces raisons, les emplois sont généralement plus recherchés que les grades. On estime qu’un cuisinier a une meilleure place qu’un chef de bataillon, dans un grand nombre de cas, et qu’un commandant de compagnie peut envier un secrétaire de colonel. Un homme qui part à la division est considéré comme sauvé définitivement. Il peut être tué, mais accidentellement, par fatalité, comme des gens de l’intérieur se font écraser ou sont victimes d’une secousse sismique ».
À l’écoute des soldats
Mais je profite surtout de ces tournées, où le temps ne nous est pas mesuré, pour m’arrêter dans les abris et écouter parler les hommes. Les unités, grossies de renforts successifs, se composent de soldats venus de tous les coins du pays et du front, le plus grand nombre ayant déjà été blessé et ayant appartenu à d’autres régiments. Tous ont des souvenirs. Par leurs récits, je connais la guerre sous ses différents aspects, car leurs conversations roulent souvent sur la guerre, qui les a rassemblés et à laquelle ils sont mêlés depuis deux ans. (p. 217)
Mensonge éventé
Ce chef habile, qui ne manquait pas de sang-froid dans la présentation des faits, réfléchit qu’aucune mission officielle ne viendrait enquêter sur les lieux. Son rapport transforma notre défaite accidentelle en un récit de défense à outrance, relata le sacrifice de mille hommes cramponnés au terrain, s’ensevelissant sous les ruines. Cette versiojn, si conforme à l’enseignement militaire, fut adoptée d’emblée par le colonel, qui la transmit à la division en l’amplifiant encore. Car il est admis, par une étrange aberration, que la diminution des effectifs prouve le courage de celui qui les commande – en vertu de cet axiome hiérarchique que la valeur des chefs fait celle des soldats, axiome qui n’a pas de réciproque. (p. 218)
La bonne blessure
Le moyen le plus simple d’attraper une bonne blessure était, au début, d’appliquer sa main contre un créneau repéré. On en avait usé en différents endroits. Mais les balles dans la main, gauche surtout, très rapidement, ne furent plus admises. Un autre moyen consiste à armer une grenade et à tenir sa main derrière un pare-éclats : l’avant bras est arraché. Il paraît que des hommes y ont eu recours. On ne saurait nier que pour consommer cette lâcheté il ne faille un certain courage et un terrible désespoir. (p. 224)
Chasse aux colombins
Pour moi, le plus fort, c’est le père Floconnet, le commandant qu’on avait en Champagne. Y passait son temps à faire la chasse aux colombins. Les poilus allaient tous poser culotte dans un sentier, à la sortie du village, et le vieux manquait jamais de venir rôder par là, tous les matins. Il avait inventé un truc énorme. Avec sa canne ferrée, y piquait tous les papiers et les apportait à l’adjudant : « Tenez, qu’y disait, triez-moi ça et foutez quatre jours à chacun de ces salopards ! » Comme les poilus se torchaient avec des enveloppes, ils étaient tous chocolat ! Mais on l’a possédé. À la fin on préparait des enveloppes exprès avec l’adresse du vieux.
Visite surprise du général
En marchant, le général questionne le lieutenant sur l’activité des Allemands, les positions qu’on découvre en dessous de nous, la consommation des projectiles, etc. Subitement, il s’arrête près d’une sentinelle et lui demande :
— Si le Boche attaque, mon ami, que faites-vous ?
Dans un secteur comme celui-ci, où l’on a du temps à consacrer aux règlements intérieurs, tous les cas sont prévus et font l’objet de consignes spéciales, qu’on ne cesse de répéter aux soldats : tirer deux coups de fusil ; lancer trois grenades, actionner les Klaxon, etc.
Mais l’homme de trouble, croit voir de l’étonnement ou de la sévérité sur le visage de cet inspecteur imposant. Il estime qu’il faut se décider vite, puisqu’il s’agit d’une attaque, et répond avec une énergie désespérée :
— Ben, tiens, je me dém… !
— Le lieutenant est navré. Le général, qui a de l’esprit, l’entraîne et le console :
— Évidemment, ce ne sont pas précisément les termes du Grand Quartier… Mais ça se ramène à ça !… L’essentiel est qu’il se dém… bien ! (p. 242)
Le Boche
À propos d’un Allemand qui se rend parce qu’il n’est pas fait pour ça : « Il est rigolo, ce Boche ! Car on ne saurait appeler un Allemand que Boche. Ce terme n’est pas méprisant dans l’esprit des hommes, il est simplement commode, bref et amusant. » (p. 247)
Engueulade dans la nuit
Alors, dans mon coin, on entend une voix empreinte d’une indignation risible, qui gémit :
— C’est honteux d’exposer ainsi des hommes de quarante ans, des pères de famille !
— Tiens, voilà un pépère qui se déclare inapte à faire un cadavre ! gouaille un Parisien, avec son accent de faubourg.
— Tais-toi, morveux !
— T’as assez forniqué dans ta vie, grand-père ! Passe la main…
— Tu ne sais pas ce que tu dis, gamin ! Il s’agit de nos femmes…
— Laisse donc ta femme tranquille ! Elle avait soupé de ta cafetière, elle se fera consoler par les petits jeunes. C’est les vieux qui doivent clamecer les premiers, tout le monde le sait ! […] (p. 249)
Blessure providentielle
Un coup de feu claqua, à quelques mètres, suivi de hurlements. Un soldat considérait stupidement son browning fumant. C’est toujours la même histoire avec les pistolets automatiques. Ceux qui en sont possesseurs les portent chargés et ne pensent jamais, lorsqu’ils veulent les démonter, à retirer la balle du canon. Cet oubli occasionne des accidents.
On se dirigea vers le blessé, qui criait toujours et désignait sa jambe. Pendant qu’on allait chercher du secours, on commença de lui retirer son pantalon. Le maladroit fut injurié copieusement.
Le jeune médecin auxiliaire arriva, se pencha sur la cuisse et dit en riant :
— Veux-tu bien ne plus gueuler ! Tu ne vois pas que c’est le filon !
Le blessé se tut instantanément et son visage s’éclaira. Le major palpa la jambe :
— Je ne te fais pas mal ? Là non plus ?
— Non !
— Ça vaut de l’or une blessure comme ça ! Et en dormant ! Tu vas tirer trois mois à l’arrière !
Le blessé sourit, tout le monde sourit. Le pansement terminé, on appela l’homme au pistolet. Sa victime lui serra la main, le remercia, et partit sur un brancard, en recevant les félicitations du camp.
Depuis, le maladroit tire gloire de sa maladresse. On l’entend dire : « C’est moi que j’ai fait évacuer Pigeonneau ! » Et même : « Le jour que j’ai sauvé la vie à Pigeonneau… » (p. 250)
Piteux pitaine
Notre pire ennemi est notre capitaine. Nous le redoutons plus que les patrouilleurs allemands, et, pendant la nuit, nous sommes plus attentifs aux bruits de l’arrière qu’à ceux de l’avant. Il a obtenu, avec sa tyrannie, ce résultat stupide, que nous détournons notre attention des gens d’en face pour la reporter dans notre propre camp. […] Pendant une ronde, le capitaine a fait une lourde chute sur les reins et a dû regagner son P.C. Soutenu par ses agents de liaison. Une fusillade aérienne, une sorte de fantasia, a fêté cette nouvelle. […] Une sourde haine gronde contre cet homme qui devrait nous aider à supporter nos misères et nous fait plus souffrir que l’ennemi. Les soldats le tueraient plus volontiers qu’un Allemand – avec plus de raisons, pensent-ils.
Cataplasme humain
« Je suis blessé ! »
L’obus vient d’éclater là, à ma droite. J’ai reçu à la tête un coup qui me laisse étourdi. J’ai retiré ensanglantée la main que j’avais portée à ma figure, et je n’ose me rendre compte de l’importance du désastre. Je dois avoir un trou dans la joue… Je suis entouré de sifflements, d’éclatements, de fumée. Des soldats me bousculent en hurlant, la folie dans les yeux, et je vois une trainée de sang. Mais je ne pense qu’à moi, à mon malheur, la tête penchée en avant, les mains contre le talus, dans la posture d’un homme qui vomit. Je ne ressens pas de douleur.
Quelque chose se détache de moi et tombe à mes pieds : un morceaux de chair rouge et flasque. Est-ce de ma chair ? Ma main remonte avec horreur, hésite, commence par le cou, le maxillaire… Rien. Alors je comprends : l’obus a déchiqueté un homme et m’a appliqué sur la joue ce cataplasme humain. (p. 303)
Assaut de fureur
Je saute dans la tranchée à côté de l’Allemand, qui me fait face. Il lève un bras, ou deux, je ne sais pas, ni dans quelle intention. Mon corps lancé plonge, casque en avant, avec une force irrésistible, dans le ventre de l’homme gris qui tombe à la renverse. Sur ce ventre encore, je saute, talons joints, de tout mon poids. Cela fléchit, cède sous moi, comme une bête qu’on écrase. Alors seulement, je pense à mon révolver…
Devant moi, un second Allemand, béant de peur, les mains ouvertes à hauteur d’épaules. Bien ! Il se rend, laissons le tranquille. Je n’aurais peut-être pas dû faire de mal à l’autre, mais il m’a visé quand j’étais encore à vingt mètres, l’idiot ! Et tout s’est passé tellement vite !
Je fixe le prisonnier, ma rage subitement calmée, ne sachant que faire. À ce moment, une baïonnette lancée violemment de la plaine, lui traverse la gorge, s’enfonce dans la paroi du boyau, la crosse du fusil portant sur le parapet. Un de nos hommes suit l’arme. L’Allemand reste suspendu, genoux fléchis, la bouche ouverte, la langue pendante, barrant la tranchée. C’est affreux. […]
Notre vague a envahi la tranchée en hurlant. Les poilus sont pareils à des fauves en cage. Le grand Chassignole crie :
— Là, y a de l’homme ! On peut s’expliquer !
Un autre me prend le bras, m’entraîne et me dit fièrement, en me montrant un cadavre :
Regarde le mien !
C’est la réaction. L’excès d’angoisse nous a donné cette joie féroce. La peur nous a rendus cruels. Nous avons besoin de tuer pour nous rassurer et nous venger. Pourtant les Allemands qui ont échappé aux premiers coups s’en tireront indemnes. Nous ne pouvons nous acharner sur ces ennemis désarmés. (p. 307)
Fusil inutile
Après des années de guerre, notre conviction est faite : le fusil ne sert à rien à des gens comme nous, dont le rôle est de galoper dans les boyaux et le constant souci d’éviter les rencontres inopinées avec l’ennemi. Il a, par contre, des inconvénients sérieux : les soins que réclament sa culasse et son canon, son poids, son glissement sur l’épaule. Quelques-uns encore sont armés d’un mousqueton, instrument assez commode qui se porte en bandoulière. (p. 320).
Méridionaux
Les soldats du Midi sont très démonstratifs. Pendant les pauses, aux abords des cantonnements, ils s’interpellent d’une fraction à l’autre et s’injurient amicalement dans leur patois coloré.
— Oh ! Barrachini, commen ti va, lou miô amiqué ?
— Ta mare la pétan ! Qué fas aqui ?
— Lou capitani ma couyonna fan dé pute ! (p. 322)
Fraternisation
Aussi, ce cri qui monte parfois des tranchées allemandes : « Kamerad Franzose ! » est probablement sincère. Fritz est plus près du poilu que de son feld-maréchal. Et le poilu est plus près de Fritz, en raison de la commune misère, que des gens de Compiègne. Nos uniformes diffèrent, mais nous sommes tous des prolétaires du devoir et de l’honneur, des mineurs qui travaillent dans des puits concurrents, mais avant tout des mineurs, avec le même salaire, et qui risquent les mêmes coups de grisou. (p. 331)
Lettres du front
Nous rédigeons pour l’arrière une correspondance pleine de mensonges convenus, de mensonges qui « font bien ». Nous leur racontons leur guerre, celle qui leur donnera satisfaction, et nous gardons la nôtre secrète. Nous savons que nos lettres sont destinées à être lues au café, entre pères qui se disent : « Nos sacrés bougres ne s’en font pas ! – Bah ! Ils ont la meilleure part. Si nous avions leur âge… » À toutes les concessions que nous avons déjà consenties à la guerre, nous ajoutons celle de notre sincérité. Notre sacrifice ne pouvant être exprimé à son prix, nous alimentons la légende, en ricanant. (p. 336)
Courage ?
Je me sens incapable de courage si je ne suis pas décidé à donner ma vie. En dehors de ce choix, il n’y a que fuite. Mais on prend cette décision pour un instant, on ne la prend pas pour des semaines et des mois. L’effort moral est trop considérable. De là la rareté du vrai courage. […] Jusqu’ici j’ai eu deux fois le courage absolu. Ce sera ce que j’aurai fait de plus grand dans la guerre. (p. 346)
Révolte
J’en ai marre ! J’ai vingt-trois ans, j’ai déjà vingt-trois ans ! J’ai entamé cet avenir que je voulais si plein, si riche en 1914 et je n’ai rien acquis. Mes plus belles années se passent ici, j’use ma jeunesse à des occupations stupides, dans une subordination imbécile, j’ai une vie contraire à mes goûts, qui ne m’offre aucun but, et tant de privations, de contraintes se termineront peut-être par ma mort… J’en ai marre ! Je suis le centre du monde et chacun de nous, pour soi-même, l’est aussi. Je ne suis pas responsable des erreurs des autres, je ne suis pas solidaire de leurs ambitions, de leurs appétits et j’ai mieux à faire qu’à payer leur gloire et leurs profits de mon sang. Que ceux qui aiment la guerre la fassent, je m’en désintéresse. C’est affaire de professionnels, qu’ils se débrouillent entre eux, qu’ils exercent leur métier. Ce n’est pas le mien ! De quel droit disposent-ils de moi ces stratèges dont j’ai pu juger les funestes élucubrations ? Je récuse leur hiérarchie qui ne prouve pas la valeur, je récuse les politiques qui ont abouti à ceci. Je n’accorde aucune confiance aux organisateurs de massacres, je méprise même leurs victoires pour avoir trop vu de quoi elles sont faites. Je suis sans haine, je ne déteste que les médiocres, les sots, et souvent on leur donne de l’avancement, ils deviennent tout-puissants. Mon patrimoine, c’est ma vie. Je n’ai pas de bien plus précieux à défendre. Ma patrie, c’est ce que je réussirai à gagner ou à créer. Moi mort, je me fous de la façon dont les vivants se partageront le monde, de leurs tracés de frontières, de leurs alliances et de leurs inimitiés. Je demande à vivre en paix, loin des casernes, des champs de bataille et des génies militaires de tout poil. Vivre n’importe où, mais tranquille, et devenir lentement ce que je dois être… Mon idéal n’est pas de tuer. Et si je dois mourir, j’entends que ce soit librement, pour une idée qui me sera chère, dans un conflit où j’aurai ma part de responsabilité… »
– Dartemont !
– Mon commandant ?
– Allez tout de suite voir à la 11e où sont placées les mitrailleuses.
– Bien, mon commandant ! (p. 362)
Général poète
[Des amis, riches industriels, flattent un général en faisant jouer une de ses œuvres patriotiques, de façon à favoriser une planque pour leur fils]. Je constate combien il est utile pour un jeune homme, dans une période troublée, d’avoir un père riche et une mère active… Je me dis aussi qu’à tout prendre les généraux sont moins redoutables lorsqu’ils signent des poésies que des ordres d’opérations. Celui qui vient de partir, du moins, n’assassine que la langue.

Adaptation cinématographique
Damien Odoul a tiré du livre un film intitulé également (La Peur, sorti en 2014. Je l’ai vu à la cinémathèque, en présence du réalisateur. Un bon petit film de guerre, avec toute la difficulté du film de guerre basé sur des livres à cheval entre roman et témoignage. Celui-ci contient quelques anecdotes personnelles reprises du livre ou puisées ailleurs, mais noyées dans des scènes que tous les poilus ont pu expérimenter. La scène (ou plutôt l’image) du champ de cadavres de chevaux, qui précisément ne figure pas dans le roman, car le narrateur ne voit jamais le moindre cheval (à moins que j’aie été inattentif), fournit une belle image du film, et je me souviens des explications du réalisateur, qui avait eu le plus grand mal à se faire livrer ces carcasses sur le lieu de tournage au Canada… Mais se donner tant de mal pour en garder seulement trois plans ! (vers la 30e minute du film)… Le film est raconté en voix off par le narrateur (« Gabriel Dufour »), censé écrire à sa fiancée, « Marguerite », dont les seins nous sont montrés au début du film, et le cul et le corps entier au milieu. C’est une trahison du livre, puisque justement le narrateur explique qu’il est impossible de ne pas mentir dans les lettres écrites du front, les gens de l’arrière étant incapables de comprendre. Et quant à la « fiancée », le livre l’évacue en une scène de retrouvailles avec une ancienne amante, point barre. Cela me rappelle un sonnet de Léo Ferré : « Mais il y faut surtout la paire de nichons / Pour trouver l’abruti qui donnera l’oseille » (« Les cinéastes »). Le film pâtit de la manque de moyens et d’une distribution inégale. Certes, on peut mater une théorie de choupinous plus mignonnets les uns que les autres, mais les dialogues sonnent parfois amateur. Jusqu’au gars dont les mains tremblent en tenant son fusil, en arrière-plan d’une longue scène, pour exprimer sa peur. Et puis quitte à recruter ces beaux gosses, quel dommage de gommer les passages les plus choquants (le général amateur de garçons) pour multiplier ces évocations de la fiancée du narrateur, absentes du livre. Les pointilleux apprécieront le soldat allemand portant un bon vieux casque à pointe (supprimé dès 1915), alors qu’on vient d’évoquer la bataille du chemin des Dames (1917). Mode oblige, plusieurs scènes montrent des tirailleurs sénégalais, totalement absents du livre ; et d’une scène de danse africaine est tirée la jolie photo de l’affiche… Les scènes de guerre tiennent du feu d’artifice sur ciel nocturne (plus photogénique de nuit).

Certaines scènes sont plus réussies, comme celle où Ferdinand se fait dégoupiller une grenade par Gabriel en tenant sa main derrière un bouclier, mais pourquoi ces « enculé » à l’accent méridional qui gâchent tout ? Le livre offrait pourtant toute cuite une fort belle scène d’insultes de soldats méridionaux ; oui mais voilà, le tirailleur sénégalais c’est sans doute plus tendance que l’Occitan, et ça plaît davantage à la commission d’avances sur recettes que la fidélité à l’œuvre qu’on prétend adapter. On cuisine des rats, ce qui rappelle le Dépeceur de rats de Narcisse Chaillou visible au Musée de Saint-Denis (époque de la Commune de Paris). Mais quel rapport avec le livre de Gabriel Chevallier ? Le tournage au Canada nous vaut quelques scènes avec des acteurs à l’accent joual (on a les méridionaux qu’on peut). Bref, un joli petit film.
– Article sur Gabriel Chevallier.
– Article sur la représentation de la guerre dans l’œuvre d’Otto Dix (1891-1969).
– Lire un extrait des Croix de bois, de Roland Dorgelès.
– Lire un extrait de M’sieur, de Frigyes Karinthy, le seul texte que j’aie jamais lu qui évoque cette discrimination selon laquelle seuls les hommes ont le droit de servir de viande de boucherie à la guerre.
– Les Maraudeurs attaquent (1962) de Samuel Fuller est un film au point de vue radicalement opposé, puisque les personnages sont des engagés volontaires. Leurs souffrances sont égales, mais ils savent pourquoi ils se battent, et l’harmonie qui règne dans leur unité est parfaite, du soldat au général.
Voir en ligne : Article de Wikipédia
© altersexualite.com 2017
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
 altersexualite.com
altersexualite.com