Accueil > Classiques > XXe et XXIe siècles > L’Inde sans les Anglais, de Pierre Loti
L’illusion du voyage et les terreurs du seuil
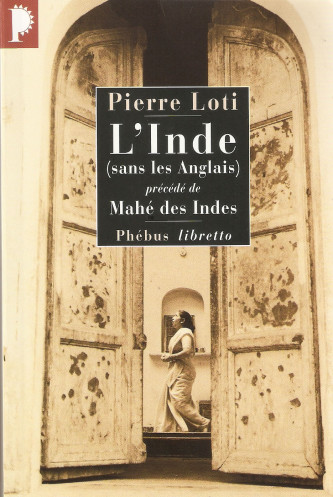 L’Inde sans les Anglais, de Pierre Loti
L’Inde sans les Anglais, de Pierre Loti
Du Tamil Nadu à Bénarès
mercredi 9 août 2017
Pierre Loti voyage en Inde autour du 1er janvier 1900, nanti d’une mission pour le compte du ministère des affaires étrangères. Trois ans plus tard, loin du sérieux de sa mission, il publie ce journal de voyage très littéraire et personnel dont le style parfois agace, parfois émeut, notamment quand il se montre sensible à l’insensibilité indienne face à la misère. Le titre se justifie par la volonté de faire abstraction de la présence anglaise en Inde, mais sans polémique. Extraits choisis, sans commentaires, car peu de choses ont changé (la misère a décru, bien sûr), et je ne saurais rivaliser avec le style fleuri de Loti. Le récit commence comme mon voyage de 2003 dans le Tamil Nadu, et se termine, comme mon voyage de 2017, à Bénarès (Varanasi). Cet article qui n’est qu’un florilège du livre de Loti vous est donc proposé en marge de mes Notes de voyage en Inde (2017). Commençons par l’avertissement final : « D’abord, suis-je assuré que l’on me suivrait dans ces régions abstraites, qui paraîtraient si en dehors de ma voie ? On n’attend de moi, je le sais, que l’illusion du voyage, le reflet des mille choses sur lesquelles j’ai promené mes yeux. Ensuite et surtout, après un semblant d’initiation qui a duré si peu de jours, comment me croirais je capable d’enseigner ? Le peu que je saurais dire ne pourrait que déséquilibrer, mener peut-être jusqu’aux terreurs du seuil, mais non plus loin. » Attention : les intertitres en gras ne sont pas de Pierre Loti !
Beauté des hommes. « C’est cependant une surprise, une déception pour les yeux, que ces femmes rencontrées en si grand nombre ne soient pas plus jolies, quand la plupart des hommes sont beaux : la couleur bronze leur sied moins bien qu’aux visages mâles, l’épaisseur des lèvres, qui se dissimulait sous les moustaches viriles, paraît chez elles excessive, et, à part quelques très jeunes, aux contours purs comme ceux des Tanagra, presque toutes ont la poitrine hâtivement déformée, d’ailleurs sans aucune draperie pour en masquer le déclin. Elles portent une boucle d’or passée dans chaque narine, et le lobe de leurs oreilles, allongé démesurément par le poids des anneaux, chez les vieilles traîne jusque sur l’épaule. Il est vrai, ce sont des femmes de parias ; celles des hautes castes ne courent point les routes en charriant des fardeaux, et nous ne les avons pas vues encore. »
J’aime bien cette photo ratée d’une famille indienne, enfin la mère et le petit, au seuil de la cuisine.

Caste matrilinéaire. « Les principales familles du Travancore appartiennent à une caste, infiniment ancienne et à peu près disparue du reste de l’Inde, où la transmission des noms, des titres et des fortunes se fait uniquement par les femmes — qui ont en outre le droit de répudier à volonté leur mari. Dans la famille royale, la Maharani est l’aînée des filles, le Maharajah est l’aîné des fils de la première princesse du sang. La reine actuelle, ni ses sœurs, n’ayant eu de descendance féminine, la dynastie est fatalement condamnée à bientôt s’éteindre. Et les enfants du Maharajah non seulement n’ont aucun droit à régner, mais ne portent même pas le titre de prince. Les femmes de cette caste, appelée Nayer, ont presque toutes les traits d’une finesse rare. »
Backwaters. « Des barques, qui arrivent à Trivandrum, à chaque instant croisent la nôtre : la lagune est la plus grande voie de communication de ce pays tranquille. Des barques immenses, en forme de gondole, qui sont lentes et ne font pas de bruit ; les bateliers aux beaux gestes plastiques les mènent en poussant du fond avec des perches ; elles portent aussi des maisons de poupe, remplies d’Indiens et d’Indiennes, et tous ces grands yeux très noirs nous regardent, nous, gens plus pressés, qui ramons à quatorze bras. Le soleil monte et, malgré l’ombre, malgré l’eau remuée, on sent par degrés s’alourdir la torride chaleur. Notre vitesse pourtant n’en est point ralentie ; ils vont toujours de même, mes bateliers, leur chef de temps à autre les excitant par un appel impérieux de la langue, qui fait roidir comme un coup de fouet tous leurs muscles et auquel ils répondent par des cris en fausset, pareils à des cris de singe. » (il s’agit des fameux backwaters ; ce nom n’est pas utilisé).
Nouveau siècle. « Le silence ensuite s’alourdit à nouveau, figé, définitif en quelques secondes, avec je ne sais quoi de triste et d’accablé qu’il n’avait pas avant. Et je me rappelle maintenant que nous sommes la nuit du 31 décembre 1899 : tout à l’heure, un siècle, qui fut celui de ma jeunesse, va tomber à l’abîme… [1] Et les étoiles qui se dessinent, pour nous quasi éternelles, viennent comme toujours jeter dans ma pensée de pauvre éphémère une plus écrasante notion d’éternité ; la chute de ce petit siècle qui finit, le lever du siècle suivant qui m’emportera, me semblent des riens tout à fait négligeables, dans la suite terrifiante des durées. Angoisse coutumière, de si vite passer et mourir ; inquiétude étrange et délicieuse, d’être entouré de grands bois et de temples, d’être enserré par l’Inde brahmanique, dans l’ombre ; sentiment de l’exil et persistance quand même de l’illusion que ce vieux jardin me donne, avec ses jasmins et ses rosiers ; ensemble incohérent et indicible, que j’ai si souvent connu par tous pays, mais qui s’émousse avec les années, comme toutes choses, — et qui, ce soir, s’embrume très vite dans la bonne fatigue physique, dans la langueur chaude de la nuit, dans le sommeil… ».
Juifs du Travancore. « En même temps, des visages de Juifs se montrent partout, aux fenêtres, aux portes, dans la petite rue sombre, et leur apparition déconcerte autant que le brusque changement du décor. […] Ce sont les Hollandais sans doute qui avaient construit ce quartier, comme dans la mère patrie, à l’époque des premières colonisations où l’on ignorait encore l’art d’approprier les bâtisses aux exigences des climats, et, après leur départ, ces Juifs de Cranganore auront pris place dans leurs logis abandonnés. Des Juifs, rien que des Juifs, ici, toute une juiverie pâle, anémiée par l’Inde et les maisons trop closes ; ces deux mille ans de séjour au Malabar n’ont en rien modifié le type originel, contrairement aux théories admises, ni seulement basané les figures. Et ce sont les mêmes personnages, les mêmes longues robes que l’on rencontrerait à Jérusalem ou à Tibériade ; jeunes femmes aux traits fins ; vieilles chafouines au nez crochu ; enfants trop blancs et trop roses, lymphatiques avec des airs futés, une petite papillote sur chaque oreille, comme en portent leurs frères de Chanaan. Ces gens descendent sur le seuil des portes pour regarder l’étranger qui passe, car il n’en vient guère à Matanchéri. Ils paraissent plutôt souriants et hospitaliers, et, dans presque toutes les maisons, je serais courtoisement reçu si j’entrais. Il n’en reste aujourd’hui que quelques centaines au plus, de ces exilés qui, d’après la tradition, arrivèrent jadis au nombre de dix mille ; depuis tantôt deux millénaires, l’habitat dépressif a constamment étiolé leur race persistante ; ils vivent, paraît-il, de commerce clandestin, d’usure, et, lorsqu’ils sont riches, affectent de ne pas l’être. » [2]
Temple brahmanique. « D’abord des salles, écrasées et étouffantes, où l’on psalmodie dans l’ombre. Plus haut un temple, vaste comme une cathédrale, avec une forêt de colonnes soutenant la poussée terrible des pierres d’au-dessus ; il est permis aux profanes d’y entrer, dans celui-là, à condition de ne pas s’avancer trop ; on ne voit pas où il finit ; des couloirs au fond, des grottes sculptées vont se perdre dans la nuit du rocher ; dans un coin, près d’un soupirail, des enfants brahmes étudient les livres saints, guidés par un vieillard tout couvert de poilaison blanche. Contre les voûtes sont remisés les prodigieux accessoires des défilés brahmaniques : personnages, chars, chevaux, éléphants, plus grands que nature, d’une conception étrange et minutieuse, en carton, en papier peint, en clinquant sur de frêles charpentes de bambou ; et, — la vie, ici, étant toujours enfiévrée de reproduction, — des tribus d’oiselets, hirondelles ou moineaux, ont trouvé le temps, entre deux défilés religieux, de remplir de nids les carcasses fantastiques ; cette confusion de monstres suspendus est tout animée d’un va-et-vient d’ailes, toute bruissante du pépiement des couvées, et la fiente de ce petit peuple léger tombe comme grêle sur les dalles. »
Fête des couleurs. « Dans les rues, malgré tout, la fête a continué jusqu’à nuit close. On se jetait les uns aux autres, à pleines mains, des poudres parfumées et colorées, qui adhéraient aux visages, aux vêtements. Des gens sortaient de la bagarre avec une moitié de figure poudrée de bleu, ou de violet, ou de rouge. Et toutes les robes blanches portaient la trace de mains trempées dans des teintures éclatantes, cinq doigts marqués en rose, en jaune ou en vert. »
Mourir de faim. « En ce moment, il s’agit de décharger sur un trottoir, devant des greniers sans doute trop remplis, une centaine de sacs de grains que des chameaux apportent, et il faut pour cela déranger trois petits enfant squelettes, de cinq à dix ans, tout nus, qui reposaient ensemble à la place choisie. « Ce sont trois frères, explique une voisine ; les parents qui les avaient amenés sont morts (de faim, c’est sous-entendu) ; alors ils sont là, ils restent là, ils n’ont plus personne.
Et elle paraît le trouver tout naturel, cette créature, qui pourtant n’a pas l’air d’une méchante femme !… Mon Dieu, qu’est-ce donc que ce peuple ? Et comment sont faites les âmes de ces gens, qui pour rien au monde ne tueraient un oiseau, mais qui ne se révoltent pas de ce qu’on laisse, devant leur porte, mourir les petits enfants ? Le plus petit des trois paraît le plus près de finir. Il est sans mouvement, il n’a plus la force de chasser les mouches collées au bord de ses paupières closes ; on dirait que son ventre a été vidé comme celui d’une bête à faire cuire ; et les os de son frêle bassin ont percé la peau, à force de traîner sur les pavés de la rue. »
Des crocos et des hommes. « Enfin, le grand étang, enfermé lui aussi dans de terribles murs et à demi desséché par deux ou trois années sans pluie. Là, sur les vases, sommeillent les énormes crocodiles centenaires, semblables à des rochers ; mais un vieil homme tout blanc arrive et se met à chanter, sur les marches d’un escalier qui descend dans l’eau, à chanter, chanter, d’une voix claire de muezzin, avec de grands gestes de bras pour appeler. Alors ils s’éveillent, les crocodiles, d’abord lents et paresseux, bientôt effroyables de rapidité et de souplesse, et ils s’approchent à la hâte, nageant en compagnie de grosses tortues voraces qui ont entendu l’appel et veulent manger aussi. Tout cela vient former cercle au pied des marches où le vieillard se tient, assisté de deux serviteurs portant des corbeilles de viandes. Les gueules visqueuses et livides s’ouvrent, prêtes à engloutir, et on y jette des quartiers de chèvre, des gigots crus, des poumons, des entrailles.
Mais dehors, dans les rues, personne n’appelle, avec des chants de muezzin, les affamés pour leur donner la pâture. Les nouveaux venus rôdent encore, tendant la main, frappant leur ventre plat si quelqu’un les regarde ; les autres, qui ont perdu l’espoir d’un secours, gisent n’importe où, sous les pieds, parmi la foule et les chevaux. Au croisement de deux avenues de palais et de temples roses, sur une de ces places qu’encombrent les marchands, les cavaliers, les femmes drapées de mousselines et couvertes d’anneaux d’or, un étranger, un Français vient d’arrêter sa voiture, près d’un tas sinistre de décharnés qui ne bougent plus, et il s’est baissé pour mettre des pièces de monnaie dans leurs mains inertes.
Alors, soudainement, c’est comme la résurrection de toute une tribu de momies ; les têtes se dressent de dessous les haillons qui couvraient les figures ; les yeux regardent, puis les formes squelettales se remettent debout : « Quoi ! on fait l’aumône ! Il y a quelqu’un qui donne ! On va pouvoir acheter à manger. » Le macabre réveil se propage en traînée subite jusqu’à d’autres tas qui gisaient plus loin, dissimulés derrière des promeneurs, derrière des piles d’étoffes ou des fourneaux de pâtissier. Et tout cela grouille, surgit et s’avance : masques de cadavres dont les lèvres recroquevillées laissent trop voir les dents, yeux caves aux paupières mangées par les mouches, mamelles qui pendent comme des sacs vides sur les cercles du thorax, ossatures qui se heurtent avec des bruits de morceaux de bois. Et l’étranger, en une minute, est entouré d’une ronde de cimetière, pressé, griffé par des mains déjà terreuses, aux grands ongles, qui cherchent à lui arracher son argent, — tandis que les pauvres yeux, au contraire, demandent pardon pour cette violence, remercient et supplient. Et puis, silencieusement, cela s’effondre. Un des spectres, qui chancelait de faiblesse, s’est accroché au spectre voisin, qui a chancelé à son tour, et la chute s’est communiquée de proche en proche, sans un cri, sans une résistance, tous les épuisés se cramponnant les uns aux autres et tombant ensemble, comme de lamentables marionnettes, comme s’abattent des quilles, puis roulant dans la poussière, évanouis, et ne se relevant plus ».
Un seul fakir vous manque, et tout est dépeuplé. « L’Hindou assis en face de moi leva au plafond ses yeux d’ascète ; une moue contracta son visage fin et dur, son masque de Dante, encadré d’un turban blanc :
― Des fakirs ? répondit-il. Des fakirs ?… Il n’y a plus de fakirs. Et j’entendais ainsi, par la bouche d’un homme de haute compétence en cette matière spéciale, la condamnation sans recours de tout espoir de rencontrer un peu de merveilleux sur terre.
― Même à Bénarès ? dis-je avec crainte. J’avais espéré qu’à Bénarès. On m’avait affirmé…
J’hésitais à le prononcer, ce nom de Bénarès, car c’était ma dernière carte jouée, et si, même là, il ne devait rien y avoir…
― Entendons-nous. Des fakirs mendiants, des fakirs anesthésiés ou contorsionnistes, il en reste beaucoup, et vous n’avez pas besoin de nous pour en trouver. Mais des voyants , des fakirs ayant des pouvoirs, j’ai connu les derniers. Sur ce point encore, croyez-en notre parole : ils ont existé. Mais le siècle qui vient de finir les a vus disparaître. Le vieil esprit fakirique de l’Inde est mort. Nous sommes une race qui décline, au contact des races plus matériellement actives de l’Occident, — lesquelles d’ailleurs déclineront à leur tour ; à cette déchéance, nous nous résignons, car c’est la loi… »
Mosquée vs pagode. « Et, pour qui vient comme moi de l’Inde brahmanique, ce qui frappe dès l’abord, c’est le changement absolu dans la conception des monuments religieux, les mosquées remplaçant les pagodes ; l’art sobre, précis et svelte, succédant à l’énormité et à la profusion. Au lieu de l’entassement, de l’orgie de divinités et de monstres qui caractérisait les temples inspirés des Pouranas, les lieux où l’on adore, au pays d’Agra, sont ornés de purs dessins géométriques s’entrecroisant dans la blancheur des marbres, avec à peine quelques fleurs rigides, çà et là dessinées sur le poli des surfaces.
Les Grands Mogols ! On dirait aujourd’hui un nom de vieux conte oriental, un nom de légende. Ils vécurent ici, ces souverains magnifiques, maîtres du plus vaste empire qui ait existé au monde. Et un de leurs écrasants palais domine cette ville d’Agra, qu’ils retrouveraient à peu près telle qu’ils l’ont laissée, sauf le délabrement et la misère que sans doute ils n’y avaient point connus. »

Sur les ghats de Bénarès. « On les voit ce soir jusqu’aux dernières marches, les grands escaliers, jusqu’aux assises qui ne se découvrent que dans les années de malheur, et dont l’apparition signifie misère et famine. Ils sont vides, à cette heure du jour, ces escaliers majestueux où, jusqu’à midi, s’étageaient en foule les marchands de fruits, les marchands de gerbes pour les vaches sacrées, surtout les marchands de ces bouquets et de ces guirlandes que l’on jette en hommage au vieux fleuve adoré ; mais les innombrables parasols de sparterie qui abritaient tout ce monde restent là, plantés à demeure sur des hampes, et très penchés vers le Levant pour le soleil du matin ; des parasols sans plissures, ressemblant à des disques de métal, et tous les granits qui servent de base à la ville en sont couverts, à perte de vue ; on dirait un champ de boucliers. »
« Maintenant, au sommet des gigantesques escaliers, une recrue nouvelle pour les bûchers fait son apparition ; un cinquième cadavre débouche là-haut d’un couloir d’ombre qui est une rue, et s’achemine vers le vieux Gange, où sa cendre sera jetée. Sur des branches de bambou liées en brancard, six hommes de basse caste, dépenaillés et demi-nus, l’amènent les pieds en avant, presque debout, tant la pente est rapide ; personne ne suit, personne ne pleure, et des enfants, qui descendent aussi pour se baigner, comme s’ils ne voyaient rien, sautent gaîment alentour. À Bénarès, l’âme seule compte pour quelque chose ; quand elle est partie, on se détache de ce qui reste après. Il n’y a guère que les pauvres qui accompagnent les leurs au recoin des morts, par crainte que le bois ne soit insuffisant et que les brûleurs ne jettent au fleuve des membres non consumés. »
La grande prostitution du soir. « Errant sans but dans Bénarès, j’arrive cette fois, et par hasard, au quartier des bayadères et des courtisanes. Au-dessus des mille petites échoppes où les marchands de mousselines pailletées, de mousselines dorées et peintes, viennent d’allumer leurs lampes, tous les étages supérieurs des maisons, d’un bout à l’autre de la rue, appartiennent aux créatures de caresses et de ténèbres ; elles commencent de se montrer, à leurs fenêtres, à leurs balcons, très barbarement parées pour la grande prostitution du soir ; derrière elles, on aperçoit leurs logis éclairés, avec une profusion enfantine de girandoles et de verroteries retombant des solives, et, sur les murs blanchis à la chaux, des images de Ganesâ, d’Anouman ou de la sanglante Kali. À leurs bras nus, à leurs oreilles, à leurs narines, brillent des anneaux et des pierreries ; des colliers de fleurs naturelles, aux parfums qui entêtent, descendent en plusieurs rangs sur leur gorge. Elles ont les mêmes yeux de velours, et sans doute aussi les mêmes chairs de bronze et d’ambre que ces inapprochables filles de Brahmes qui se dévoilent le matin au bord du Gange, et dont elles pourraient donner l’illusion dans l’étreinte… »

Sarnath. « Et, non loin de ce banc si spécial, inspirateur d’antique et froide sagesse, s’élève une tour large comme une colline, en granit massif, qui fut très ouvragée en son temps, mais sur laquelle deux millénaires ont passé, usant les sculptures, installant du haut en bas les herbes et les broussailles sauvages : ce sont les restes du premier temple bouddhique, construit dans l’ancienne Bénarès. Sur les parois de l’énorme tour, à hauteur d’homme, presque toutes les saillies, toutes les pierres frustes sont dorées à l’or fin, et l’éclat en est étrange, imprévu dans cette vétusté extrême : des pèlerins chinois, annamites ou birmans, lorsqu’ils réalisent ce rêve de venir voir le banc et le temple, se font un devoir d’apporter, de leur patrie reculée, des feuilles d’or, et de les fixer là ; c’est leur hommage, — leur carte de visite, pourrait-on dire, — au vieux sanctuaire méconnu. »
L’illusion de ce monde. « Je suis à peu près le seul qui ne prie pas, sur le Gange à cette heure, ou tout au moins suis-je le seul à ne pas accomplir des rites religieux : ablutions, révérences, offrandes de jasmin ou de fleurs jaunes. La grande extase de chaque matin est commencée sur tous les radeaux, sur toutes les marches, et je n’ai point ma place parmi les croyants dédaigneux, qui ne semblent même pas me voir ; je passe comme n’importe lequel de ces touristes, qui affluent maintenant à Bénarès, depuis que le voyage est facile et que l’Inde s’est ouverte à tous… Mais je ne suis déjà plus le même qu’en arrivant ; les heures passées dans la maison des Sages ont laissé en moi une empreinte qui sans doute ne s’effacera plus jamais. J’ai franchi les « terreurs du seuil » et j’entrevois l’apaisement, dans la résignation aux vérités nouvelles. Tout commence à changer d’aspect, la vie et même la mort, depuis que réapparaissent en avant de ma route, sous une forme différente, des durées infinies que depuis longtemps je n’apercevais plus.
Et cependant, combien l’« illusion de ce monde » — pour parler comme ces Sages — me tient et m’obsède encore ! Le détachement suprême, dont ils ont déjà déposé le germe dans mon âme, le renoncement à tout ce qui est terrestre et transitoire, je ne connais pas sur terre un lieu capable en même temps d’y conduire plus vite et d’en éloigner davantage que cette Bénarès, à la fois mystique et charnellement affolante, où un peuple entier ne songe qu’à la prière et à la mort, et où, malgré cela, tout est piège pour les yeux, pour les sens : la lumière, les couleurs, les jeunes femmes demi-nues aux voiles mouillés, aux regards de langueur ardente ; le long du vieux Gange, l’étalage de l’incomparable beauté indienne… »
– Du même auteur, lire Pêcheur d’Islande.
– Retourner à mes Notes de voyage en Inde. Lire aussi Une certaine idée de l’Inde, d’Alberto Moravia, L’Odeur de l’Inde de Pier Paolo Pasolini ; et Bucolique, suivi de Élégiaque, de Robert Vigneau.
Voir en ligne : Le texte sur Wikisource
© altersexualite.com 2017.
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Erreur fréquente : le XIXe siècle a en fait duré jusqu’au 31 décembre 1900, de même qu’il a fallu attendre le 1er janvier 2001 pour que commence le 3e millénaire.
[2] Lire un article très documenté : « Différentes communautés Juives en Inde », par Frédéric Viey, sur judaicultures.info.
 altersexualite.com
altersexualite.com