Accueil > Classiques > XIXe siècle > Le Rouge et le Noir, de Stendhal
Sexe, religion et politique
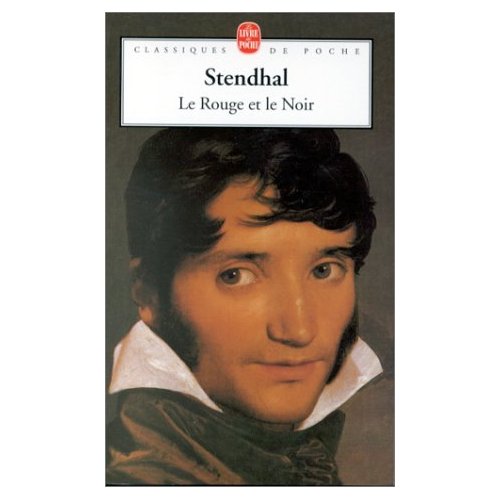 Le Rouge et le Noir, de Stendhal
Le Rouge et le Noir, de Stendhal
Le livre de poche, éd. Michel Crouzet, 1997, 576 p., 4,5 €.
vendredi 29 août 2008
J’avais lu ce grand classique en classe de seconde, je devais donc avoir 15 ans, et ne l’avais jamais rouvert depuis. Le prof de français que j’avais en seconde ne m’a pas laissé un souvenir impérissable. Son nom m’est resté, à peu près son physique ; attitude familière — mais est-ce ma mémoire qui mélange ? — d’un cul posé sur le coin du bureau, le menton sur la main, et blabla. Rien de négatif d’ailleurs, mais des livres étudiés cette année-là ne me restent que les titres — c’est déjà pas mal ! Les deux profs de français qui m’ont marqué et ont sans doute été pour une part dans ma vocation, sont mes profs de 3e et de 1re, ce qui peut-être a nui à la mémoire de ce régent ! D’eux, je me souviens de détails de leurs cours, de choses dites sur des textes. Après tout, je peux écrire leur nom ici pour leur rendre hommage : Marie-Claude Lancelot et Alain Roze. Mais en 2de, je me souviens avoir lu Le Rouge et le Noir, Lorenzaccio, et sans doute d’autres livres, peut-être Les Lettres persanes ? Je m’interroge : mon enseignement laissera-t-il aux élèves qui l’ont subi quelque autre souvenir que celui de la façon dont je déambule dans la classe, pose mon cul sur un coin de bureau, ou la forme de mon visage ? Je n’en sais rien, et puis cela diffère sans doute d’un ancien élève à l’autre. Bref, la question ne m’obsède pas vraiment, hein, ce que j’en dis, c’est pour bêler la conversation. Bêh ! Revenons-en à nos moutons.
Il ne me restait aucun souvenir précis de ce roman. C’était une histoire romantique, un homme aimait deux femmes, et mourait ; suis-je sûr de me souvenir qu’il mourait ? J’ai donc été bien surpris de découvrir un brûlot de 1830, tirant à boulets rouges sur les Sarkozy et Delanoë de l’époque, professant un athéisme sans concession, ou plutôt un anticléricalisme provocateur, et donnant de l’amour une conception assez peu « romantique » selon l’acception vulgaire. L’auteur y passe sur le corps sans vie de la France un scalpel trempé à la forge de ses voyages en Europe. Cerise sur le gâteau, il s’amuse à couronner chacun de ses chapitres d’une épigraphe, dont la plupart sont apocryphes, comme la célèbre formule « Un roman : c’est un miroir qu’on promène le long d’un chemin », attribuée à Saint-Réal en tête du ch. I, 13, avant d’être reprise en II, 19. Cela méritait bien un article, non ? Ce roman est au programme des classes de Première générale de l’année scolaire 2019-2020, avec le parcours « Le personnage de roman, esthétique et valeurs ».
Résumé
Inutile de résumer Le Rouge et le Noir, cela est mille fois mieux fait sur Wikipédia par exemple. Concentrons-nous sur quelques points. Stendhal s’est inspiré entre autres de l’affaire Berthet pour inventer Julien Sorel, un paysan devenu précepteur qui courtise la mère des enfants dont il a la charge, puis tente de la tuer dans une église, et est exécuté. Il y ajoute l’ambition, l’épisode de Paris, la politique, le cynisme amoureux, en s’inspirant de son expérience personnelle, ce qui lui fait sans doute rajeunir la victime de Julien de 36 à 30 ans. L’excellente édition de Michel Crouzet pour le Livre de Poche fournit un dossier complet sur l’Affaire Berthet, les longs articles de la Gazette des Tribunaux (28 au 31 décembre 1827) que Stendhal a dû lire, suivis de deux fort longues critiques sur le roman, l’une signée Jules Janin du Journal des Débats. Je signale particulièrement le dernier article de la Gazette, le plus court, consacré à l’exécution. Très utile pour une séquence consacrée à la peine de mort. Julien Sorel, donc, fils d’un charpentier qu’il déteste autant que ses frères, est l’intellectuel de la famille. Amoureux de Napoléon, il apprend par cœur la Bible à la façon d’un taliban freelance, pour épater les bourgeois, sans en croire un traître mot. Le hasard m’a fait emporter ce livre dans mes bagages pour un voyage en Iran, où je me suis amusé du parallèle entre l’hypocrisie religieuse ultra de la Restauration et celle du régime des mollahs.
Ambiguïté sexuelle
Stendhal multiplie les allusions ambiguës et paradoxales sur son personnage. Quand il se présente, « Mme de Rênal eut d’abord l’idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée, qui venait demander quelque grâce à M. le maire. » (chapitre I, 6). Puis elle lui trouve « l’air fort méchant » (qualificatif récurrent), enfin : « La forme presque féminine de ses traits et son air d’embarras ne semblèrent point ridicules à une femme extrêmement timide elle-même. L’air mâle que l’on trouve communément nécessaire à la beauté d’un homme lui eût fait peur. » Au chapitre I, 9, Stendhal s’amuse à un petit quiproquo : comme M. de Rênal fait changer sans prévenir les paillasses des lits, Julien est paniqué, et demande à sa presque maîtresse de le sauver en extrayant discrètement un portrait qu’il y a caché. « Julien est donc amoureux, et je tiens là le portrait de la femme qu’il aime ! » se dit-elle, défaite. Mais on apprend qu’il ne s’agit que du « portrait de Napoléon » ! Voilà pour le romantisme : l’héroïsme avant l’amour. Difficile à faire passer à nos élèves… De même lorsqu’il rencontrera le comte Altamira, exilé espagnol : « Julien était amoureux de son conspirateur » (II, 9). Stendhal prend également le contre-pied de la tradition homophobe sur Henri III : « Hélas ! se disait Mathilde, c’était à la cour de Henri III que l’on trouvait des hommes grands par le caractère comme par la naissance ! Ah ! si Julien avait servi à Jarnac ou à Moncontour, je n’aurais plus de doute. En ces temps de vigueur et de force, les Français n’étaient pas des poupées. » (II, 14).
Julien jouit d’une amitié sans faille avec son aîné Fouqué, dont Stendhal a fait une sorte d’amant platonique et asexué : « Mais Fouqué renonce à se marier, il me répète que la solitude le rend malheureux. Il est évident que s’il prend un associé qui n’a pas de fonds à verser dans son commerce, c’est dans l’espoir de se faire un compagnon qui ne le quitte jamais. » (Ch. I, 12. Cet extrait constitue d’ailleurs un des premiers courts exemples du procédé de monologue intérieur que Stendhal a presque inventé pour ce roman (cf. aussi Mathilde à la fin des ch. II, 8 et II, 11, par exemple, ou Julien au ch. II, 15). Il faut citer aussi l’étonnante scène avec le très jeune évêque d’Agde, que Julien surprend essayant ses habits et répétant son geste de bénédiction. Stendhal suggère du bout de la plume, sans appuyer : « Les beaux yeux de Julien firent leur effet » (I, 18). Il en sera de même dans la seconde partie avec le Chevalier de Beauvoisis, « un grand jeune homme, mis comme une poupée » (II, 6), dont l’élégance séduira Julien, puis avec le prince Korassof, dandy russe de « haute fatuité » (II, 7) qui lui donne des conseils de séduction et des lettres toutes faites à recopier (II, 24). Mais le personnage de l’abbé Pirard fournit aussi quelques belles scènes. Ce Socrate en soutane cache un cœur sensible sous un visage dur, et tempère l’anticléricalisme de l’auteur, qui est plutôt un anti-jésuitisme. Voici un beau passage que les enseignants prendront pour eux. Julien vient de recevoir une « promotion » de l’abbé :
« Il s’approcha de l’abbé Pirard, et lui prit la main, qu’il porta à ses lèvres.
— Qu’est ceci ? s’écria le directeur, d’un air fâché ; mais les yeux de Julien en disaient encore plus que son action.
L’abbé Pirard le regarda avec étonnement, tel qu’un homme qui, depuis longues années, a perdu l’habitude de rencontrer des émotions délicates. Cette attention trahit le directeur ; sa voix s’altéra.
— Eh bien ! oui, mon enfant, je te suis attaché. Le ciel sait que c’est bien malgré moi. Je devrais être juste, et n’avoir ni haine ni amour pour personne. Ta carrière sera pénible. Je vois en toi quelque chose qui offense le vulgaire. La jalousie et la calomnie te poursuivront. En quelque lieu que la Providence te place, tes compagnons ne te verront jamais sans te haïr ; et s’ils feignent de t’aimer, ce sera pour te trahir plus sûrement. […] Il n’y avait si longtemps que Julien n’avait entendu une voix amie, qu’il faut lui pardonner une faiblesse : il fondit en larmes. L’abbé Pirard lui ouvrit les bras ; ce moment fut bien doux pour tous les deux. » (I, 29).
Dans la seconde partie l’abbé poursuit son rôle de Mentor : « Le fait est que l’abbé se faisait un scrupule de conscience d’aimer Julien, et c’est avec une sorte de terreur religieuse qu’il se mêlait aussi directement du sort d’un autre. » (II, 1).
Les femmes et l’amour
« Mme de Rênal, riche héritière d’une tante dévote, mariée à seize ans à un bon gentilhomme, n’avait de sa vie éprouvé ni vu rien qui ressemblât le moins du monde à l’amour. Ce n’était guère que son confesseur, le bon curé Chélan, qui lui avait parlé de l’amour, à propos des poursuites de M. Valenod, et il lui en avait fait une image si dégoûtante, que ce mot ne lui représentait que l’idée du libertinage le plus abject. Elle regardait comme une exception, ou même comme tout à fait hors de nature, l’amour tel qu’elle l’avait trouvé dans le très petit nombre de romans que le hasard avait mis sous ses yeux. Grâce à cette ignorance, Mme de Rênal, parfaitement heureuse, occupée sans cesse de Julien, était loin de se faire le plus petit reproche. » (Ch.I, 6). Stendhal est un maître de la psychologie romanesque, dit-on si on est d’accord avec ses analyses ! En tout cas il montre à deux reprises, pour Mme de Rênal et pour Mlle de la Mole, comment leur vient malgré elle et par des chemins différents l’envie d’aimer Julien. Pour Mme de Rênal, aux mains des curés, elle ballottera sans cesse entre pulsions et remords, et Stendhal s’en amuse : « Elle était dévorée d’un remords. Elle avait tant grondé Julien de l’imprudence qu’il avait faite en venant chez elle la nuit précédente, qu’elle tremblait qu’il ne vînt pas celle-ci. » (I, 16). C’est après la maladie du petit Stanislas que l’amour de Mme de Rênal et celui de Julien atteignent leur plus haut niveau : « Sa vie fut le ciel et l’enfer : l’enfer quand elle ne voyait pas Julien, le ciel quand elle était à ses pieds. […] « je suis damnée, irrémissiblement damnée. […] Mais au fond, je ne me repens point. Je commettrais de nouveau ma faute si elle était à commettre ». […] La méfiance et l’orgueil souffrant de Julien […] ne tinrent pas devant la vue d’un sacrifice si grand, si indubitable et fait à chaque instant. Il adorait Mme de Rênal. Elle a beau être noble, et moi le fils d’un ouvrier, elle m’aime… Je ne suis pas auprès d’elle un valet de chambre chargé des fonctions d’amant. Cette crainte éloignée, Julien tomba dans toutes les folies de l’amour, dans ses incertitudes mortelles. […] Son amour ne fut plus seulement de l’admiration pour la beauté, l’orgueil de la posséder. […] Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. » (I, 19). La très romanesque, ironique et théâtrale scène des lettres anonymes transforme l’innocente adultère en comédienne qui regarde son mari avec un œil neuf : « Une ou deux fois, durant cette grande scène, Mme de Rênal fut sur le point d’éprouver quelque sympathie pour le malheur fort réel de cet homme qui pendant douze ans avait été son ami. » (I, 21).
Mathilde de La Mole est romanesque, elle lit Voltaire et ne peut se résoudre à épouser un homme jeune, riche et beau qui n’ait aucun plus : « Je ne vois que la condamnation à mort qui distingue un homme, pensa Mathilde : c’est la seule chose qui ne s’achète pas. » (II, 8). Elle est la proie d’une sorte de syndrome de Stockholm, et n’admire jamais autant Julien que lorsqu’il la menace d’une épée (II, 17), ou lui fait le même coup qu’avec Mme de Rênal : grimper chez elle par une échelle (il n’y a sans doute pas d’escaliers ni de couloirs dans ces hôtels particuliers !) : « Punis-moi de mon orgueil atroce, lui disait-elle, en le serrant dans ses bras de façon à l’étouffer ; tu es mon maître, je suis ton esclave, il faut que je te demande pardon à genoux d’avoir voulu me révolter. Elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds. Oui, tu es mon maître, lui disait-elle encore ivre de bonheur et d’amour ; règne à jamais sur moi, punis sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter. » (II, 19) [1]. Mme de Rênal, après son meurtre raté, aura de semblables élans : « Et mourir de la main de Julien, c’est le comble des félicités. » (II, 36). Se rendant à l’évêché pour demander la grâce de Julien, elle aura cette phrase révélatrice de lectures sadiennes chez notre auteur malicieux (qui glisse cette allusion sans appuyer, pour les happy few) : « Je puis m’asseoir sur un fauteuil, et ce fauteuil me saisir les bras, j’aurai disparu. » (II, 38).
Les hommes et l’amour
Julien ne songe pas plus à l’amour que Mme de Rênal au début, ou du moins il y songe comme d’un devoir à accomplir, et Stendhal multiplie les métaphores guerrières, à comparer à la fameuse tirade de Dom Juan de Molière (I, 2). Prendre la main de Mme de Rênal, la séduire, ne sont que des défis qu’il se lance ; l’amour vient à la suite, et il en va de même pour Mathilde, c’est sa vanité qui le conduit. On pourrait pasticher le mot que Georges Brassens attribue à Pascal : « Mettez-vous à flirter, baisez et embrassez, Faites semblant d’aimer, et bientôt vous aimerez ». Stendhal n’a-t-il pas vu juste, et ne sont-ce pas les mêmes sentiments qui poussent la plupart de nos ados d’aujourd’hui, qui ne se font hétéros au début que par défi, et parce que ça se fait pour « être un homme » [2] ? Certains motifs me semblent par contre d’une psychologie forcée, ce sont les fréquents passages où Julien en vient à douter de l’amour de Mme de Rênal ou d’autre chose, et modifie immédiatement son attitude extérieure, comme si un détail infime pouvait à tout instant remettre en cause une relation de plusieurs mois. L’usage du passé simple au lieu de l’imparfait renforce cette impression : « Une heure ne s’était pas écoulée, qu’à son grand étonnement, il découvrit que Mme de Rênal lui faisait mystère de quelque chose. Elle interrompait ses conversations avec son mari dès qu’il paraissait, et semblait presque désirer qu’il s’éloignât. Julien ne se fit pas donner deux fois cet avis. Il devint froid et réservé ; Mme de Rênal s’en aperçut et ne chercha pas d’explications. Va-t-elle me donner un successeur ? pensa Julien. » (I, 23).
Dès qu’il aura quitté Verrières pour Besançon, Julien redevient un pantin de virilité. Rencontre-t-il une jolie serveuse dans un café ? Il la séduit en récitant La Nouvelle Héloïse. Cette fille vient-elle à être rejointe par son amant titulaire, lequel le regarde ? Il s’apprête à se battre en duel ! On croirait lire un reportage sur des rebeus de téci ! (Dans le film L’Esquive, La Nouvelle Héloïse est remplacée par Le Jeu de l’amour et du hasard !). Il est vrai que cette fanfaronnade permet de faire ressortir par contraste sa veulerie lorsqu’il se présente au séminaire et qu’il s’évanouit parce que l’abbé Pirard lui fait les gros yeux (I, 25). Julien se montre souvent odieux. Stendhal multiplie avec les deux amantes les situations d’escalade érotique. Quand il revient voir Mme de Rênal avant son départ pour Paris, il la viole quasiment, par orgueil, et cela fournit quelques pages parmi les plus surprenantes quant à la psychologie (I, 30). La séduction de Mathilde obéit à un étrange sentiment autodestructeur : paradoxalement, il ne veut pas s’élever grâce à elle, mais éprouve une jouissance à la voir s’abaisser à son niveau : « Je vous ferai comprendre et bien sentir que c’est pour le fils d’un charpentier que vous trahissez un descendant du fameux Guy de Croisenois, qui suivit Saint Louis à la croisade. » (II, 13). Là aussi, les métaphores militaires sont de la partie : « Dans la bataille qui se prépare, ajouta-t-il, l’orgueil de la naissance sera comme une colline élevée, formant position militaire entre elle et moi. » (II, 14).
Julien se déteste parfois : « Oui, couvrir de ridicule cet être si odieux, que j’appelle moi, m’amusera. » (II, 26), mais a des retours de vanité : « Après tout, pensait-il, mon roman est fini, et à moi seul tout le mérite. J’ai su me faire aimer de ce monstre d’orgueil » (II, 34). Rares sont, finalement, les allusions érotiques, qui ressortent d’autant, comme lorsque Julien se laisse abandonner à un certain fétichisme : « Dans ses moments d’oubli d’ambition, Julien admirait avec transport jusqu’aux chapeaux, jusqu’aux robes de Mme de Rênal. Il ne pouvait se rassasier du plaisir de sentir leur parfum. Il ouvrait son armoire de glace et restait des heures entières admirant la beauté et l’arrangement de tout ce qu’il y trouvait. Son amie, appuyée sur lui, le regardait ; lui regardait ces bijoux, ces chiffons qui, la veille d’un mariage, emplissent une corbeille de noce. […] Pour Julien, jamais il ne s’était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l’artillerie féminine. » (I, 16). Citons un extrait de la préface de Michel Crouzet pour terminer ce panorama de l’amour dans ce roman : « Chronique d’une révolution dont il ne parle pas, le Rouge, plein de violence dès le début, est une œuvre de crise et de tension, une lutte des consciences et des classes, une confrontation constante des personnages, les amants sont des ennemis, comme les maîtres et les « domestiques », le heurt des individus renvoie toujours à des conflits collectifs, l’amour lui-même est un fait de classe ; la peur et la haine y sont politiques ; tout y est politique, même ce qui est le plus intime. » (p. II).
L’art de la narration
« Quelques heures après, quand Julien sortit de la chambre de Mme de Rênal, on eût pu dire en style de roman, qu’il n’avait plus rien à désirer. En effet, il devait à l’amour qu’il avait inspiré, et à l’impression imprévue qu’avaient produite sur lui des charmes séduisants, une victoire à laquelle ne l’eût pas conduit toute son adresse si maladroite. » (I, 15). Voici l’une des ellipses pudiques qu’affectionne Stendhal, dans le chapitre malicieusement intitulé « Le chant du coq », où Julien perd sa virginité, et où la scène à faire n’inspire à notre auteur qu’un délicieux oxymore ! Avec Mathilde, le procédé se répète identique en II, 19 : « Mais il est plus sage de supprimer la description d’un tel degré d’égarement et de félicité », d’autant plus que vu les propos de Mathilde, il aurait fallu à Stendhal rivaliser avec le marquis de Sade ! La grossesse de Mathilde est amenée comme un cheveu sur la soupe en une phrase lapidaire, au ch. II, 32, et jusqu’à la fin Julien n’imaginera qu’avoir un fils. De même, la scène de l’exécution nous sera-t-elle épargnée et réduite à une phrase expéditive et ironique : « Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part sans aucune affectation » (II, 45). La scène de l’assassinat elle-même est un modèle de récit sommaire : une seule page sépare la lecture de la lettre de Mme de Rênal lue à Paris et les coups de pistolet vengeurs à Verrières (II, 35). Le dénouement ne daignera pas aborder la question du fameux « fils », après la macabre attitude de Mathilde, qui ravira nos élèves gothiques [3]…
La modernité de l’auteur se manifeste à des détails, comme l’usage, fameux, des « etc. », plus discret que dans Lucien Leuwen, ou ici, d’une abréviation osée : « Elle peut tout dire, grand Dieu ! à ce c… d’abbé Maslon, qui prend prétexte de la maladie d’un enfant de six ans, pour ne plus bouger de cette maison, et non sans dessein. » (I, 19). Stendhal ne se prive pas de s’adresser au narrataire, avec qui il entretient parfois une connivence de classe, comme lorsqu’il se livre à des comparaisons géographiques avec l’Italie ou l’Allemagne. Mais il alterne aussi sans prévenir narration, pensées du personnage et aphorismes d’auteur : « Les sales paysans au milieu desquels il vivait déclarèrent qu’il avait des mœurs fort relâchées. Nous craignons de fatiguer le lecteur du récit des mille infortunes de notre héros. Par exemple, les plus vigoureux de ses camarades voulurent prendre l’habitude de le battre ; il fut obligé de s’armer d’un compas de fer et d’annoncer, mais par signes, qu’il en ferait usage. Les signes ne peuvent pas figurer, dans un rapport d’espion, aussi avantageusement que des paroles. » (I, 27). Je connaissais la citation suivante, mais j’ignorais qu’elle fût de Stendhal : « Pourquoi veut-on que je sois aujourd’hui de la même opinion qu’il y a six semaines ? En ce cas, mon opinion serait mon tyran. » (II, 4). Un autre aphorisme célèbre « La politique, reprend l’auteur, est une pierre attachée au cou de la littérature, et qui, en moins de six mois, la submerge. La politique au milieu des intérêts d’imagination, c’est un coup de pistolet au milieu d’un concert. » (II, 22) met le doigt sur une contradiction de Stendhal, dont le chef-d’œuvre est à la fois histoire d’amour et pamphlet politique ! Et pour l’athéisme : « Ma foi, si je trouve le Dieu des chrétiens, je suis perdu : c’est un despote, et, comme tel, il est rempli d’idées de vengeance ; sa Bible ne parle que de punitions atroces. Je ne l’ai jamais aimé ; je n’ai même jamais voulu croire qu’on l’aimât sincèrement. » (II, 42), à moins que ce ne soit plutôt du déisme : « Ah ! s’il y avait une vraie religion… […] Mais un vrai prêtre, un Massillon, un Fénelon… […] Ce bon prêtre nous parlerait de Dieu. Mais quel Dieu ? Non celui de la Bible, petit despote cruel et plein de la soif de se venger… mais le Dieu de Voltaire, juste, bon, infini… […] Mais comment, dès qu’on sera trois ensemble, croire à ce grand nom de DIEU, après l’abus effroyable qu’en font nos prêtres ? » (II, 44).
– Lire le chapitre consacré à Stendhal dans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Seul Stendhal, selon la philosophe, fait de la femme — dans le cadre du matérialisme historique, c’est-à-dire en tenant compte des limitations que lui imposent le contexte historique, les conditions d’existence qui lui sont faites — « cette conscience autre qui dans la reconnaissance réciproque donne au sujet autre la même vérité qu’elle reçoit de lui. » (p. 387) ; « Jamais Stendhal ne se borne à décrire ses héroïnes en fonction de ses héros : il leur donne une destinée propre » (p. 388). Un bon sujet de dissertation, non ?
Voir en ligne : Stendhalia, université de Grenoble
© altersexualite.com 2008
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] N’est-ce pas la devise de « Ni pute ni soumise » ?
[2] On songe aussi à la maxime 136 de La Rochefoucauld : « Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureux s’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour ».
[3] À rapprocher de l’histoire qu’on trouve dans La Cité des dames, de Christine de Pizan, tirée de Boccace, d’Isabeau dont l’amant est tué par ses frères, et qui récupère sa tête et la met dans un pot de basilic.
 altersexualite.com
altersexualite.com