Accueil > Essais & Documentaires (adultes) > Les Origines de la sexologie 1850-1900, de Sylvie Chaperon
Une mine de connaissances, pour les éducateurs
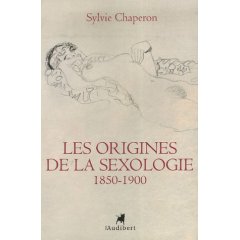 Les Origines de la sexologie 1850-1900, de Sylvie Chaperon
Les Origines de la sexologie 1850-1900, de Sylvie Chaperon
Éditions Louis Audibert / La Martinière, 2007, 288 p, 22 €.
dimanche 8 juillet 2007
Cet ouvrage est le résultat d’une recherche exhaustive, comme en témoignent l’abondante bibliographie et l’extrême précision des notes. Sylvie Chaperon, historienne, a bénéficié d’une « délégation CNRS », et elle l’a bien utilisée. Elle semble avoir dépouillé tout ce qui s’est publié en Europe dans la littérature scientifique dans cette période, en s’aidant des recherches précédentes. L’ouvrage présente avec objectivité l’état de la pensée scientifique sur la sexualité, en s’abstenant de juger avec les critères actuels, mais « pour mettre en évidence les croyances, les représentations culturelles, les logiques et les enjeux de pouvoir qui sous-tendent ces discours ». Elle a fait au sujet de ces médecins pour la plupart ce qu’eux, du moins dans la première période, ne faisaient pas, c’est-à-dire se baser sur un échantillon représentatif avant de passer des observations aux conclusions. La lecture de l’ouvrage est édifiante quant à la légèreté avec laquelle certains « scientifiques » de ces débuts de la médecine pouvaient tirer des conclusions générales à partir de quelques cas qu’il leur était donné d’observer en prison ou en asile. Il restitue aussi le travail d’Hercule de ces précurseurs, qui ont frayé la voie de la liberté sexuelle à travers les ténèbres d’une science trop normative. Reste à savoir si notre discours actuel sur la sexualité paraîtra aussi exotique dans un siècle et demi.
Pour schématiser les conclusions de l’auteure, au tournant du XIXe, les médecins, souvent dans une optique anticléricale, « ont établi une distinction entre les comportements normaux et les conduites déviantes ». Ils « sécularisent certains des interdits religieux » et « aspirent à remplacer le clergé dans la direction non pas morale mais hygiénique de leurs congénères ». Vers la fin du siècle, la toute puissance des médecins sera balancée par l’émergence de la psychologie d’une part, et des « mouvements militants, féministe, abolitionniste, néo-malthusien, homosexuel », « qui aboutiront à la sexologie » (p. 10 / 11). L’objet de recherche est limité à la science, et à de rares exceptions près, ne fait pas de parallèles avec la littérature. Il contient 3 parties et 9 chapitres, que nous allons passer en revue, mais il est impossible de rendre compte d’une telle profusion d’informations, qui permettront d’éviter de noyer dans le vague tout ce qui s’est passé avant Freud.
La ronde des médecins autour de la sexualité
Cette partie étudie « La vogue de l’hygiène conjugale », « Les plaisirs réguliers du mariage », « Les déviants sexuels : criminels ou malades ? » et « Les lois de la sexualité ». Les ouvrages sur la sexualité se vendent bien, et comme on s’en doute, tous les lecteurs ne sont pas attirés uniquement par l’aspect scientifique, malgré l’autocensure des médecins et la censure permise par la loi de 1882 durcie en 1898 par le sénateur René Béranger, dit « Père la pudeur ». Certains titres laissent rêveur : Leçons sur les déformations vulvaires et anales produites par la masturbation, le saphisme, la défloration et la sodomie, de Louis Martineau (p. 24). À ce propos, je regrette de n’avoir pas trouvé dans le livre une allusion à l’utilisation par la justice de ces élucubrations, par exemple dans les procès de Paul Verlaine ; ce qui aurait été intéressant sachant que dans les récentes poussées homophobes au Cameroun, ces vieilles lunes ont été sorties du placard ! La profession médicale est marquée par l’omniprésence des hommes, et leur misogynie pathologique dont quelques exemples édifiants sont cités. Longtemps inspirés de « l’antique tradition des humeurs », des médecins ont conseillé la pratique modérée du coït pour empêcher « la réplétion des canaux spermatiques » (p. 30). Les progrès de l’auscultation, l’utilisation de « spéculums et sondes diverses », ainsi que la possibilité « d’étudier les corps des pauvres livrés à leurs soins » (p. 31), notamment les prostituées qui n’ont pas la pudeur de la clientèle bourgeoise, permettent de passer des systèmes philosophiques à l’observation. Dans le même temps, le mariage devient affaire de sentiments plus que de transmission de patrimoine, et « la mode du voyage de noces » se répand qui permet au couple de « se découvrir tout à loisir » (p. 33). Les médecins prônent les « effets positifs du coït » (p. 34), et leur anticléricalisme les pousse souvent à condamner le célibat pour diverses raisons : « Les célibataires sont des êtres stériles et égoïstes, ils nourrissent l’armée de la prostitution, sèment les germes des maladies vénériennes, provoquent les adultères », etc. (p. 37). Leur misogynie leur fait croire que les rapports sexuels conjugaux « seront l’antidote à l’absurde revendication d’émancipation des femmes » (p. 41). De même, la pudeur et le nécessaire non-consentement, ainsi que la moindre fréquence du désir et la passivité leur semblent devoir caractériser la femme.
Félix Roubaud « relie le plaisir masculin à la seule éjaculation, mais conditionne le plaisir féminin à l’intromission pénienne » (p. 46). Les médecins sont partagés sur le malthusianisme, qu’ils pratiquent tout en le déconseillant au nom du « coït physiologique » (p. 49), mais qu’ils jugent en général nécessaire dans les milieux populaires. On parle d’« onanisme conjugal » et de « fraudes conjugales ». Onanisme peut avoir un sens assez large, et désigner la fellation et la masturbation. Ce n’est pas un mince intérêt de l’ouvrage que de préciser les glissements de sens des mots de la sexualité, y compris les néologismes, qu’ils aient connu ou non une postérité, notamment ceux concernant l’homosexualité dans les parties suivantes. Le mot psychiatrie par exemple, date de 1842 (voir Les folles d’enfer de la Salpêtrière, de Mâkhi Xenakis). La demande d’expertise des tribunaux va entraîner une débauche d’études sur « les désirs les plus extravagants, les mises en scène érotiques les plus saugrenues ». « L’érotisme, le jeu sexuel, l’art du sexe, vont donc entrer dans la médecine par la porte des fous » (p. 60). De même, c’est dans une revue pénale fondée par Alexandre Lacassagne qu’il sera traité pour la première fois de « l’inversion » (p. 62). Les accusés de leur côté, élaborent leur discours de façon à donner à entendre aux médecins ce qu’ils attendent pour obtenir le plus d’indulgence, ce qui tend à tourner en cercle vicieux (voir Herculine Barbin, dite Alexina B, édition de Michel Foucault). Le mot « sexualité » à sa création désigne la séparation des genres, et non « les activités érotiques » (p. 75). Des médecins proposent de mentionner « « S.D. » (sexe douteux) » dans l’acte de naissance dans les cas de détermination problématique (p. 79). Les théories se succèdent pour expliquer les perversions : monomanies, ou dégénérescence. Cette dernière connaîtra un grand succès. Tout selon elle « est susceptible de se fixer dans l’hérédité et de s’accroître chez les descendants » (p. 84), que ce soit les maladies, les toxicomanies, l’environnement urbain ou les vices. On recherche alors les « stigmates physiques du dégénéré ».
Des folies érotiques aux perversions sexuelles
Cette 2e partie contient « Petit catalogue des aberrations et autres perversions sexuelles » et « Thérapeutiques et prophylaxie ». On s’amusera du rappel des idées reçues sur la masturbation, dont le grand Prêtre est le Suisse Samuel-Auguste Tissot, auteur d’un ouvrage paru en 1760 et réédité jusqu’en 1905. Ce « vent de folie antimasturbatoire » (expression de R.-H. Guerrand) perdra de sa force au cours du siècle. Les idées reçues concernant la frigidité ou « anaphrodisie » sont aussi édifiantes, et le mot « impuissance » se spécialise progressivement du côté masculin. Vous saurez tout sur le « vaginisme », le vampirisme, la nécrophilie [1], la zoophilie, la bestialité, l’exhibitionnisme (mot forgé par Charles Lasègue en 1877) (p. 100), le fétichisme ou « azoophilie », sans oublier le « satyriasis ». Avec l’étude de l’inversion, on passe du « vieux modèle des monomanies » à une conception plus psychologique de la perversion. Sylvie Chaperon fournit une étude approfondie de cette période où l’homosexualité est conceptualisée, à partir de 1869, avec l’invention par un Allemand de la notion d’inversion (traduction de conträre Sexualempfindung), et des mots « homo » et « hétérosexualité », « dans deux pamphlets anonymes » (sic) par Karoly Maria Kertbeny, écrivain hongrois (p. 109). Ambroise Tardieu, en 1857, recense les « signes pathognomoniques » du « pédéraste passif » : « développement excessif des fesses, une déformation infundibuliforme de l’anus », etc. (p. 102). Ulrichs, un Allemand, propose les termes uranien et dionien, en référence à Pausanias. (Voir aussi sur cette période L’invention de l’hétérosexualité, de Jonathan Ned Katz).
Malgré leur ton moralisateur, les aliénistes et psychiatres ont en général prôné l’indulgence pour les « pervertis » dont on leur confiait l’expertise, et pris position, dans toute l’Europe, contre la pénalisation de l’homosexualité masculine. Les partisans de l’homosexualité innée sont en fait des défenseurs masqués de la cause, qui prônent la tolérance, à l’instar du fameux Richard von Krafft-Ebing, dont on étudie le progrès et le « revirement » (p. 144) des idées à travers les 14 rééditions de son ouvrage fameux, Psychopathia sexualis entre 1886 et 1903, et de Charles Féré, dont les avis sont souvent très modernes. Ce dernier utilise cependant un argument étonnant pour promouvoir la tolérance (ne pas guérir les invertis pour qu’ils demeurent stériles, et éviter ainsi la dégénérescence). La notion d’inversion désigne « moins la transgression de l’union charnelle normale que le processus anormal de la sexuation » (p. 106). Il va sans dire que la question transgenre est confondue avec l’inversion. (Un seul cas de travestissement, p. 109). Julien Chevalier s’intéresse aux lesbiennes et différencie « tribadisme », « clitorisme » et « saphisme » dans leurs rapports (p. 108). Krafft-Ebing invente aussi les mots « sadisme » et « masochisme » en 1891, et « pédophilie » en 1896. Les classifications des perversions sortent peu à peu du « recueil de cocasseries sexuelles » (p. 116) pour aller vers le découpage proposé par Krafft-Ebing entre les « perversions de but et les perversions d’objet ». Les thérapies proposées vont des corsets anti-masturbatoires à la cautérisation du clitoris, en passant par l’électrothérapie, l’infibulation du prépuce, la circoncision à vif, selon le degré de sadisme des praticiens. Plus sérieuse est l’hypnose, qui conduit vers les psychothérapies. C’est Charcot qui reprend le magnétisme et le rebaptise hypnotisme (p. 131).
Remises en question du savoir médical
Cette 3e partie contient « Vers une psychologie de la vie sexuelle », « Le temps des observations » et « Contestations militantes ». « Gagnés par le positivisme et la méthode expérimentale, les psychologues se séparent alors de la philosophie et des courants spiritualistes pour s’arrimer à la médecine et à la physiologie afin de revendiquer le caractère scientifique de leur savoir » (p. 139). Les psychologues s’intéressent désormais moins à d’éventuelles « lésions du système nerveux » ou à la « dégénérescence » qu’à « la seule histoire psychique de l’individu » (p. 142). L’inconscient intervient, et Freud pointe son nez. Sylvie Chaperon montre ce qu’il doit aux « idées formalisées dans les années 1890 » (p. 149), ainsi qu’à l’évolution de la transcription des observations par les cliniciens, de la narration inspirée « par les récits de la tentation » (p. 153) à des (auto)biographies sexuelles inspirées des Confessions de Rousseau, souvent rédigées par le patient lui-même. Les extrapolations basées sur des cas uniques et monstrueux glanés dans les asiles et les prisons laissent la place dans les années 1890 à des études portant sur des centaines ou des milliers de cas. Krafft-Ebing signale seulement « 107 cas d’inversion connus », dont 35 par lui-même (p. 155) ! Magnus Hirschfeld en revendiquera 10000. Les femmes, mais aussi les milieux modestes, sont sous-représentés. Il faut s’interroger sur « les conditions sociales qui permettent de cultiver un goût sexuel particulier », mais aussi sur la connivence masculine entre patient et médecin (p. 161), lequel se réfère à un « aveu » qui tient de la confession, et permet aussi souvent d’obtenir un verdict clément pour « irresponsabilité mentale » (p. 167). Les témoignages sont souvent ceux de lecteurs, invertis eux-mêmes, qui écrivent aux auteurs pour les encourager, ou de clients des cabinets privés des médecins, d’où la sur-représentation de milieux aisés à la fin du siècle, en remplacement des expertises judiciaires et des aliénés (p. 172).
Les contestations militantes viennent de certains de ces lecteurs, mais aussi de féministes, comme l’autodidacte Céline Renooz et les abolitionnistes qui, au nom de valeurs chrétiennes, s’opposent à la prostitution, tolérée jusque-là sous prétexte du nécessaire exutoire à fournir aux hommes « avant un mariage de plus en plus reculé » (p. 181). On note une différence entre protestants et catholiques, les seconds associant sexualité et péché, tandis que les premiers condamnent le célibat. « Seuls quelques anarchistes, dont le très radical Paul Robin, développent une vision libertaire et hédoniste de la sexualité » (p. 186). Ce dernier est un altersexuel avant la lettre. Qu’on en juge : il dénonce « l’hypocrisie actuelle du célibat et de la monogamie légale. Lesquels n’aboutissent qu’à de pitoyables mensonges, comme l’adultère ou le concubinat plus ou moins mal dissimulés, ou à des crimes sociaux comme le vol et la prostitution » (p. 189). Il réclame des syndicats pour les prostitués « comme tous les autres travailleurs », et se livre à une attaque en règle du mariage ! Il propose le matriarcat pour assurer la fin du patriarcat. Les pères doivent renoncer à toute autorité sur leurs enfants. Certaines féministes réclament une éducation sexuelle des enfants, mais d’autres pensent que « c’est à la mère, quand elle le juge utile, de donner ces notions » (p. 186). Les mouvements homosexuels se structurent, moins en France qu’en Allemagne et en Angleterre, où les actes contre nature sont punis. Il y a une tension entre militants de « l’âme féminine dans un corps d’homme », version Magnus Hirschfeld, et partisans de l’amour viril et de l’idéal hellène. En France, Marc-André Raffalovich prend la défense de l’« unisexualité », et crée une échelle des goûts sexuels (p. 198), en précurseur fort moderne non seulement de la bisexualité de Freud, mais de la fameuse échelle d’Alfred Kinsey… et de l’altersexualité, même si lui aussi prône la chasteté ! Le mot sexologie est inventé à la fin du siècle aux États-Unis, et seulement vers 1910 en France — même si Havelock Ellis lui préfère « psychologie sexuelle » (p. 199). « L’innovation sémantique répond d’abord à une volonté politique : il s’agit de rompre avec les perspectives médicales et d’intégrer les revendications militantes » (p. 200).
En conclusion, voici un ouvrage fort recommandable, en particulier aux personnes qui entreprennent des études médicales ou para-médicales, et pourquoi pas dans les établissements préparant aux filières médico-sociales ? En effet, si le contenu est touffu, le style est très accessible aux non-spécialistes.
– Lire un article de Jean-Yves sur Henry Havelock Ellis.
Voir en ligne : Articles de Sylvie Chaperon sur le site CLIO
© altersexualite.com 2007
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Pour les amateurs je signale un livre fort documenté sur le sujet, ce que ne laisserait pas présager son titre : Au Père-Lachaise, de Michel Dansel, éditions Fayard, 1973, nouvelle édition 2007.
 altersexualite.com
altersexualite.com
Messages
1. Les origines de la sexologie 1850-1900, de Sylvie Chaperon, 28 septembre 2007, 12:26, par Sylvie Chaperon
Merci beaucoup de cette lecture si attentive et précise