Accueil > Culture générale et expression en BTS > Invitation au voyage… > L’Inde où j’ai vécu, d’Alexandra David-Néel
Mémoires d’une baroudeuse
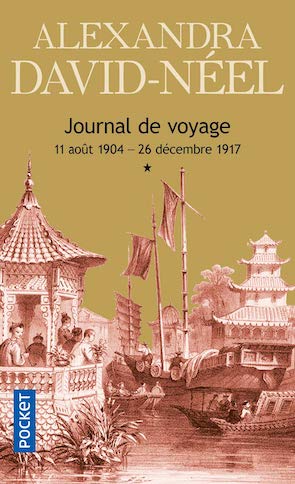 L’Inde où j’ai vécu, d’Alexandra David-Néel
L’Inde où j’ai vécu, d’Alexandra David-Néel
Pocket, 1951-1969, 7,7 €
samedi 27 août 2022, par
L’Inde où j’ai vécu ne figure pas sur la liste du BO pour le thème de Culture générale & expression 2022-2023 : « Invitation au voyage… », au contraire d’un autre livre de la même auteure : Voyage d’une Parisienne à Lhassa. Je me suis permis cette substitution, au nom de la « liberté pédagogique » des enseignants qui fond comme peau de chagrin, parce que j’ai relevé dans Les Femmes aussi sont du voyage de Lucie Azema une citation caviardée dont j’ai retrouvé l’original, et qui sera je pense le texte phare pour introduire ce thème à mes étudiants. Alexandra David-Néel (1868-1969) est une icône dans le monde des écrivains-voyageurs. Spécialiste du bouddhisme, polyglotte, féministe de fait, cantatrice, anarchiste, franc-maçonne, morte centenaire, c’est un continent à elle toute seule. Son nom accole les patronymes de ses parents (David) et de son mari (Néel). Je vous donne à décider quel est le féminisme le plus efficace, entre cette femme aventureuse & libre qui se contente de prêcher d’exemple, ou les féministes wokistes propagandistes & orchidotomistes de l’idéologie dominante de la caste au pouvoir.
Dans cet article, je nommerai Alexandra David-Néel « ADN » en abrégé, hommage à Alexandra Henrion-Caude ! Dans ce livre publié sous le titre L’Inde. Hier, aujourd’hui, demain en 1951 alors qu’elle était encore toute jeune (83 ans), puis réédité et augmenté en 1969 (à 100 ans !) sous le titre L’Inde où j’ai vécu, ADN fait le bilan de ses voyages en Inde (et à Ceylan) avant et après l’indépendance ; elle revient aussi sur son goût du voyage, et brosse un portrait sans concession de l’Inde de l’indépendance. C’est un livre abordable & exaltant sur l’Inde, sur le voyage, sur l’esprit d’aventure, à lire en priorité à notre époque où les tyrans nationaux-covidistes & les escrocs du prétendu « réchauffement climatique » veulent nous parquer comme des moutons dans l’enclos de nos frontières.
Voici un premier extrait digne de figurer dans un corpus : « En ce temps-là, le musée Guimet était un temple. C’est ainsi qu’il se dresse, maintenant, au fond de ma mémoire.
Je vois un large escalier de pierre s’élevant entre des murs couverts de fresques. Tout en gravissant les degrés, l’on rencontre successivement un brahmine altier versant une offrande dans le feu sacré ; des moines bouddhistes vêtus de toges jaunes s’en allant quêter, bol en main, leur nourriture quotidienne ; un temple japonais posé sur un promontoire auquel conduit, par-delà un torii rouge, une allée bordée de cerisiers en fleur. D’autres figures, d’autres paysages de l’Asie sollicitent encore l’attention du pèlerin montant vers le mystère de l’Orient.
Au sommet de l’escalier, le « saint des saints » du lieu apparaît comme un antre sombre. À travers une lourde grille qui en défend l’accès, l’on entrevoit une rotonde dont les murs sont entièrement garnis de rayons chargés de livres. Dominant de haut la bibliothèque, un Bouddha géant trône, solitaire, abandonné à ses méditations.
À gauche, des salles, très discrètement éclairées, donnent asile à tout un peuple de déités et de sages orientaux. Dans le silence solennel de cette demeure créée pour eux, les uns et les autres poursuivent une existence secrète, incarnée dans leurs effigies ou dans les ouvrages qui perpétuent leurs paroles.
À droite, est une toute petite salle de lecture où les fervents de l’orientalisme s’absorbent en de studieuses recherches, oublieux de Paris dont les bruits heurtent en vain les murs du musée-temple, sans parvenir à troubler l’atmosphère de quiétude et de rêve qu’ils enclosent.
Dans cette petite chambre, des appels muets s’échappent des pages que l’on feuillette. L’Inde, la Chine, le Japon, tous les points de ce monde qui commence au-delà de Suez sollicitent les lecteurs… Des vocations naissent… la mienne y est née.
Tel était le musée Guimet quand j’avais vingt ans » (p. 10).
Chapitre Premier : « Premiers pas vers l’Inde »
L’auteure a le goût du luxe ; elle vient de faire un héritage qui lui permet de ne pas compter : « J’y avais retenu une cabine à une seule couchette, afin que nul voisinage ne troublât mon recueillement ; j’ai, d’ailleurs, toujours eu horreur de la promiscuité.
Oh ! temps heureux où l’on pouvait l’éviter dans les trains et dans les paquebots, offrant ample espace aux voyageurs. Depuis, est venu le régime de la cohue, du troupeau que l’on entasse pêle-mêle et qui s’y« Un de mes étonnements est que les hommes, après avoir goûté d’une large mesure de liberté, aient pu y renoncer ; bien plus, qu’un grand nombre d’entre eux ignorent qu’il y a un peu plus de cinquante ans [1], chacun de nous pouvait parcourir la terre à son gré. Cinquante ans, cela ne nous fait pas remonter à une époque préhistorique ; il serait naturel que l’on se souvînt des coutumes qui prévalaient alors ou, tout au moins, qu’on en eût connaissance.
Me faut-il donc réveiller les souvenirs endormis de certains de mes lecteurs et éclairer les autres ? Au temps béni où j’abordai à Ceylan pour la première fois, les passeports étaient inconnus, comme l’étaient aussi les multiples vaccinations que l’on inflige maintenant aux hommes transformés en cobayes pour l’instruction – ou le simple amusement – de quelques expérimentateurs dilettantes [2].
Quelle sinistre farce que les Assemblées, les Congrès où, à grand renfort de discours, des politiciens prétendent préparer l’union des peuples ! Nous y étions arrivés, en partie ; il ne restait aux frontières que des barrières douanières peu gênantes. On se promenait à son gré de par le monde, emportant avec soi autant d’argent qu’on le pouvait pour subvenir à ses besoins.
Aujourd’hui, les peuples sont parqués en des cages distinctes en attendant le moment où ils franchiront de nouveau les clôtures qui les séparent pour se ruer les uns contre les autres et s’entre-détruire » (p. 15). prête docilement » (p. 12).
La folie des passeports & vaccins n’est pas nouvelle
Et voici l’extrait repéré qui m’a donné envie de lire ce livre pour mes étudiants :
Dès son premier voyage, ADN exerce son regard critique : « Il m’est arrivé plus tard de discuter avec des artistes indigènes de l’insignifiance des énormes poupées qui représentent le Bouddha. En règle générale, j’ai pu constater que peintres et sculpteurs confondaient l’impassibilité, la sérénité avec l’absence complète d’expression. Il en résultait qu’ils nous montraient des formes sans vie, des êtres pires que morts : des êtres qui n’avaient jamais vécu. Certains artistes chinois ou japonais, et de plus rares tibétains, constituent cependant de brillantes exceptions ; nous leur devons d’émouvantes figures du Bouddha et de ses disciples » (p. 21).
ADN a visité Ceylan en passant : « Je n’avais pas l’intention de m’installer à Ceylan ; mon but était l’Inde. Cependant, il me parut bon de consacrer quelque temps à parcourir l’île et, tout d’abord, j’y devais visiter les temples et les monastères bouddhistes qui, je le savais, sont nombreux » (p. 17). « Porter un jugement sur Ceylan, sur ses religieux et sur sa population laïque, parce que deux vilaines statues jaunes avaient choqué mon sens artistique aurait été absurde de ma part ; je ne commis pas cette erreur. Je savais qu’il existait, dans l’île, des moines érudits et déjà, à Paris, j’avais entendu des orientalistes parler avec respect de Souryagoda Soumangala, le défunt chef des bhikkhous cinghalais. Je savais aussi que Ceylan comptait parmi les siens des laïques distingués. Enfin, je n’ignorais pas qu’il ne manquait pas à Ceylan, de paysages pittoresques, de ruines de cités historiques et de monuments anciens. Je me proposai donc de revenir pour voir, à loisir, gens et choses au cours d’un nouveau et plus long séjour. Quand ? – Je n’en savais rien. Mon voyage n’avait aucune durée limitée ; je l’envisageais, plutôt, comme devant se prolonger pendant longtemps : rien ne m’empêchait donc de remettre à plus tard ce qui concernait Ceylan et de partir immédiatement pour l’Inde » (p. 23).
Les mauvais moments en voyage
Belle page à intégrer dans un corpus : « L’horreur vint quand la population animale des cales, chassée de ses abris peut-être par de l’eau qui s’y infiltrait, envahit le salon et les cabines. Ce furent des courses de rats affolés et le glissement lent de véritables couches de cancrelats, de cloportes et autres insectes que mon ignorance ne me permet pas de nommer. Tout en fut bientôt couvert : le tapis, la couchette ; ils grimpaient le long des rideaux et débordaient du lavabo qu’ils avaient empli. Cette scène d’enfer dantesque était éclairée par une grosse bougie, enfermée dans l’ustensile que l’on appelle aux colonies un photophore. Le photophore était suspendu et se balançait à chaque coup de roulis, promenant de droite à gauche la maigre lueur de la bougie… Nous n’étions pas encore au temps de l’éclairage électrique et maints paquebots n’en étaient point munis. Il ne pouvait en être question sur notre « rafiot ».
Dès le début de la tempête, l’indigène faisant fonction de steward, voyant que je ne voulais pas m’étendre sur la couchette, m’avait apporté un fauteuil pliant. Celui-ci glissant sur le tapis à chaque mouvement du bateau me jetait, alternativement, les pieds ou la tête en bas ou me projetait contre l’une ou l’autre des parois de la cabine. Ballottée de-ci de-là, me heurtant aux angles du mobilier, j’avais fini par tomber dans un tel état d’hébétement douloureux que la force me manquait pour me débarrasser des insectes qui excursionnaient sur moi et de quelques rats curieux qui grimpaient le long de mon fauteuil pour m’examiner de près.
Jamais, au long de ma longue vie de voyageuse, je n’ai vécu un plus dégoûtant cauchemar.
C’est alors que des hurlements forcenés m’éveillèrent de ma torpeur. Qu’arrivait-il encore ?… Est-ce que nous coulions ?… Il fallait m’en informer. Je me traînai hors de la cabine. Dans la petite salle à manger il n’y avait, naturellement, aucun passager.
Le steward, affalé dans un recoin, s’aperçut de ma présence au moment où je me cognai contre un angle de la table, la douleur m’arrachant une exclamation. Il se leva.
– Voulez-vous une banane ? me demanda-t-il et, avant que j’aie pu lui répondre, il étendit le bras et d’un placard, à sa portée, je le vis extraire une petite corbeille contenant quelques fruits.
Des bananes ! Je songeais bien à cela dans l’état présent de mon estomac. Leur vue seule redoublait mes nausées.
Quelque part dans le bateau, des gens hurlaient toujours.
– Que se passe-t-il ? Demandai-je.
– Rien, répondit le steward. Ce sont les passagers de pont qu’on a enfermés parce que la mer les aurait balayés. Ils ont essayé de soulever les panneaux qui les protégeaient, alors on y a enfoncé quelques clous pour les maintenir. Mais, en entendant clouer, ces gens ont pris peur. Ils crient maintenant que le bateau sombre, qu’on va sauver les passagers de cabine et les marins, et qu’eux, on les abandonnera.
Il y avait bien de quoi porter ces malheureux à hurler.
– Nous ne sombrons pas, ajouta le steward d’un air rassuré. Mangez donc une banane… et il avança de nouveau vers moi la petite corbeille.
Je l’aurais volontiers battu, tant il m’exaspérait mais, accrochée d’une main à la portière de ma cabine et me retenant de l’autre au dossier d’un siège vissé au plancher, je n’en avais pas la possibilité. En trébuchant, je regagnai mon fauteuil et le cauchemar, parmi les insectes répugnants et les rats furtifs accompagnés par les hurlements désespérés des prisonniers et le tam-tam assourdissant des vagues qui nous martelaient, dura jusqu’au matin, lorsque nous jetâmes l’ancre devant Tuticorin.
Notre misérable bateau, tout ruisselant, vomit alors une centaine d’indigènes chancelants et hagards, qui se laissèrent immédiatement choir sur le sol. Les missionnaires s’efforçaient de faire bonne contenance, mais leur mine blafarde décelait les tourments qu’ils avaient endurés.
Pour moi, les pénibles heures que je venais de vivre s’étaient déjà reculées dans un passé suffisamment lointain pour ne plus m’affecter. Dès que j’avais posé les pieds sur un terrain solide, je m’étais sentie de nouveau gaillarde et pleine d’enthousiasme.
Cette plage de sable, ce paysage quasi désertique baignant dans la clarté rosée du matin, c’était l’Inde de mes rêves que je venais d’atteindre » (p. 25).
Le train indien était déjà aussi lent qu’il l’est encore maintenant ! « Le train avançait à la vitesse de nos trains omnibus sur les lignes secondaires ; j’avais tout le temps d’examiner le pays plat et monotone que nous traversions. Nous avions déjà roulé depuis longtemps, avec des arrêts prolongés dans diverses petites gares, lorsque mon taciturne compagnon s’éveilla » (p. 29).
« Je noterai ici que, parmi les commodités que le développement du « progrès » a fait disparaître de l’Inde, étaient les salles d’attente pour dames seules avec salle de bains attenante et service d’une femme de chambre. Dans l’intervalle d’un changement de train, une voyageuse pouvait, par les chaleurs torrides de l’été, se plonger dans l’eau fraîche et même être massée, car la plupart des femmes de chambre indiennes étaient d’expertes masseuses. La salle de bains consistait en une pièce nue au dallage de pierre et de simples baquets en bois servaient de baignoires, mais la propreté était parfaite » (p. 30).
ADN explique que ce livre ne sera pas chronologique mais thématique : « Je ne me propose pas de rédiger un journal de voyage dans lequel mes mouvements à travers l’Inde et les divers épisodes qui les ont accompagnés se succéderaient par ordre chronologique. Ce que je désire offrir ici, c’est plutôt une série de tableaux présentant la vie mentale, encore plus que la vie matérielle de l’Inde ; il convient donc de ne point morceler ces tableaux et de grouper en un tout les informations obtenues à divers moments sur un même sujet » (p. 31). Cela dit, après un développement thématique, le chapitre suivant déroule la suite de son premier voyage, façon habile de construire ce livre en combinant les agréments du récit et de l’essai.
ADN nous explique les secrets de l’hindouisme en tâchant de se baser sur des anecdotes qui font passer l’érudition : « Tandis que je résidais à Bénarès, un de mes amis hindous, obligé de partir en voyage, me pria de prendre chez moi une statuette de Krishna et de l’honorer en son absence. Il vivait seul et il ne
trouvait à sa portée personne qui lui paraissait mériter sa confiance. En fait, ce qui m’était demandé, c’était « d’alimenter » la statuette pour l’empêcher de dépérir ou, comme je dirai prosaïquement, en reprenant la comparaison de l’accumulateur, pour l’empêcher de se « décharger ».
Je ne pouvais pas refuser de rendre ce menu service à mon ami. Le Krishna fut installé sur une tablette, mon boy acheta chaque matin quelques fleurs qu’il lui offrit et, le soir, je fis brûler des
bâtons d’encens devant lui. En même temps, je lui disais familièrement quelques paroles aimables.
Krishna est un dieu enjoué et charmant, il n’exige pas qu’on le traite avec solennité » (p. 39).
Comment se débarrasser d’un importun
« La coutume qui voulait que les femmes de bonne famille ne montrent pas leur visage, facilitait beaucoup les incursions en terrain interdit. Il suffisait d’être accompagnée d’un brahmine authentique, pouvant jouer le rôle de frère ou d’époux, et de tenir son sâri à peu près fermé sur sa figure pour passer sans attirer l’attention. En quelques occasions je me risquai même seule, déguisée de cette manière, dans des temples où j’avais déjà été auparavant et dont je connaissais la disposition.
De nos jours où les femmes ne ramènent plus leur sâri sur la tête, courir cette aventure serait plus difficile.
Malgré tout, il m’arriva pourtant d’être reconnue ou, du moins, d’inspirer des doutes. Un jour, à Bénarès, un jeune homme m’aborda dans la rue :
– Vous avez été au temple de Vishveshvara, me dit-il. Comment se fait-il que les stewards vous aient laissé entrer ?
Comme j’en avais l’habitude à Bénarès, je portais ce jour-là la robe couleur orange des sannyâsins. Je ne répondis rien au questionneur ; je le regardai avec gravité, élevai légèrement la main droite et prononçai : âshîrvada, la formule consacrée de bénédiction et de bons souhaits que les sannyâsins adressent aux laïques ; puis je continuai imperturbablement mon chemin, laissant le curieux interloqué, figé au bord de la route » (p. 44).
Hygiène et relativité des coutumes
ADN ne se gêne pas pour affirmer ses préférences : « Quant à ce qui me concerne, j’ai réussi à jouir de la société d’Indiens érudits ou philosophes et à observer les mœurs populaires tout en évitant de me trouver en opposition avec les préjugés de caste et, pour cela, je me maintenais strictement dans les observances que l’hygiène et mes habitudes héréditaires me dictaient. Cela ne froissait personne et, bien au contraire, m’attirait du respect. Je ne me gênais jamais pour refuser des friandises ou autres mets que l’on m’offrait. « Vous m’excuserez, disais-je, votre façon de faire la cuisine me paraît malpropre ; toucher les aliments avec les doigts est répugnant. Laver le sol avec de l’urine de vache, ou enduire le fourneau avec de la bouse de vache rend impur tout ce qui y cuit. »
Quant à mon lit de camp que j’emportais en voyage, seul mon premier boy, qui n’était jamais un hindou, avait la permission de le déplier et, le lendemain matin, de l’enfermer dans un double sac, avant que les coolies le transportent.
Je m’astreignais, sous prétexte de ne pas me souiller, à maintes règles gênantes : je ne buvais jamais un verre d’eau que celle-ci n’eût été préalablement bouillie dans un ustensile m’appartenant » (p. 64).
Les castes : un casse-tête
« Un jour, alors que je résidais dans les environs de Madras, je demandai à un brahmine de mes amis : « Quelle est la plus basse des castes ? » Il me répondit : « C’est là une chose impossible à dire. Vous ne trouverez jamais un homme, si vile que sa caste soit tenue par nous, qui n’en désigne pas une autre qu’il considère comme plus vile encore et avec les membres de laquelle il refusera de manger ou de s’unir par mariage. »
Et le brahmine me proposa d’aller avec lui jusqu’à l’entrée d’une ruelle habitée par des « intouchables ».
– Il ne m’est pas permis d’y entrer, me dit-il, le faire me rendrait impur, mais vous qui n’êtes pas hindoue, vous n’êtes pas assujettie à ce genre de lois. Allez voir les gens qui vivent là. Ce sont les corroyeurs, ils écorchent les bêtes mortes et en préparent le cuir. Nul d’après nous n’est plus immonde qu’eux, pourtant ils interdisent aux individus d’une certaine autre caste de traverser leur rue, prétendant que l’ombre de ces derniers en passant sur leur nourriture et sur leurs taudis les souillerait » (p. 78).
Elle note avec amusement que les convertis n’abandonnent pas les castes : « Dans les églises, on continue à réserver aux différentes castes des nefs séparées ou des places marquées par des clôtures, et les fidèles pénètrent dans l’église par des portes différentes. Ces mêmes fidèles, de castes plus hautes, protestent avec véhémence si, sans y songer, le prêtre à l’autel se tourne vers le côté où se trouvent des parias « intouchables » (p. 80).
Un peu d’altersexualité
ADN a l’occasion unique d’assister à une représentation exceptionnelle du Râmayâna, juchée sur un éléphant. Elle y remarque entre autres que les rôles féminins sont joués par des jeunes hommes : « Un détail à noter est que tous les rôles, y compris ceux de femmes, sont tenus par des jeunes garçons. Aux hommes adultes ne sont dévolus que quelques rôles de vieux sages, ceux de démons et ceux des singes formant l’armée de Râma conduite par le singe divin Hanouman. Tous les acteurs sont brahmines, à l’exception de certains démons et des « simples soldats » de l’armée des singes » (p. 94).
« Il serait exagéré de dire que l’attitude et la physionomie des jouvenceaux tenant les rôles de femmes correspondaient aux descriptions dithyrambiques que le poème fait de la beauté et de la grâce des princesses et de leurs suivantes. Les pauvres garçons, gênés par les atours féminins qu’ils n’avaient pas l’habitude de porter, par le maquillage qui leur collait au visage, par les anneaux accrochés à leurs oreilles et à leur nez, et embarrassés dans leur marche par les lourds cercles d’argent pesant à leurs chevilles, avaient l’air affreusement gauches et piteux » (p. 96).
Elle évoque une particularité altersexuelle du Mahâbhârata : « Ceux-ci [des livres], en des contes dont quelques-uns peuvent rivaliser avec ceux de Boccace, nous montrent un garçon d’une beauté et d’une attraction sexuelle exceptionnelles qui, à l’âge de onze ans, est l’amant d’une centaine de maîtresses. Ces débuts prometteurs ne mentiront point car, par la suite, un nombre de dix-huit mille concubines est attribué à Krishna devenu prince souverain » (p. 100).
ADN a l’occasion de rencontrer un mystique transgenre d’une catégorie étonnante. Je reprends quelques paragraphes d’une longue relation de cette rencontre : « « Eh bien ! continua mon interlocuteur, Hariprasad est un de ces mystiques qui, dans leur dévotion à Krishna, se considèrent comme étant des femmes et les épouses de Krishna. » […] « Mirai Bai n’est pas la seule qui ait professé cette croyance bizarre ; de nombreux vaishnavas la partagent, du moins avec quelques restrictions, et leur attitude religieuse consiste à affecter la condition féminine. Les adeptes masculins de certaines de leurs sectes s’adressent les uns aux autres en se donnant le titre de « sœurs ». […] « Je fus aimablement accueillie par un homme aux proportions de bel athlète, drapé dans une étoffe rayée de soie blanche. Il portait les cheveux longs, artistiquement disposés en un chignon dans lequel une touffe de jasmin était piquée ; quelques autres fleurs blanches apparaissaient derrière une de ses oreilles, il avait les pieds nus dans des babouches de satin rouge, ornées de broderies de fil d’or. Plusieurs colliers en pierres précieuses s’étalaient sur sa poitrine et des bagues de grand prix brillaient à ses doigts minces. Il était violemment parfumé. » […] « L’on alluma des lampes et, immédiatement, toutes les glaces, les miroirs à facettes, les pendeloques en cristal des lustres et les bijoux portés par Hariprasad se mirent à scintiller d’extravagante façon, troublant la vue comme les parfums violents qui saturaient l’air troublaient l’odorat.
Puis, d’une autre pièce invisible, nous parvinrent des mélopées langoureuses célébrant l’amour de Krishna. Ce devait être l’heure du culte vespéral dans l’oratoire de la maison.
Hariprasad, qui jusque-là avait soutenu la conversation très lucidement, se tut soudain. Sa figure prit une expression extatique et, après quelques instants d’immobilité complète, il se leva lentement et se mit à danser.
Sa danse ne ressemblait en rien aux gesticulations frénétiques auxquelles j’avais vu certains vaishnavas se livrer. Ses gestes demeuraient mesurés et harmonieux. Bien loin d’être grotesque, son grand corps souple de bel athlète se ployait avec grâce tandis qu’il enroulait et déroulait successivement les amples draperies de soie blanches qui l’enveloppaient.
La passion amoureuse qu’il mimait ne décelait aucun sentiment bassement lascif, mais seulement une exaltation mystique tendant éperdument à une union spirituelle avec un bien-aimé de rêve.
Comment Hariprasad conciliait-il son rôle d’amante de Krishna avec l’accomplissement normal de ses devoirs de mari ? Ce problème m’intriguait un peu et je le proposai discrètement au Révérend J… dans la voiture qui allait me déposer chez moi.
– La femme du pandit est elle-même une grande dévote de Krishna, me répondit le missionnaire. Elle aussi doit le considérer comme son amant.
Le Révérend J… n’avait jamais vu la dame, qui vivait selon la règle stricte du purdah, mais Mrs. J… la connaissait et c’était d’elle qu’il tenait ces renseignements.
Quoi qu’il en pût être, la bizarrerie de leurs sentiments religieux ne paraissait pas avoir gêné les époux dans leur vie conjugale : trois fils robustes, nés de leur mariage, en témoignaient » (pp 117-122).
Religion, superstitions, sati
ADN n’est pas une touriste-vandale, mais n’hésite pas à désobéir : « Dans une chapelle où je fus admise, le gardien qui me conduisait me fit remarquer une petite balançoire de la taille d’un jouet, en cuivre doré, placée sur une table garnie de fleurs. Elle avait la forme d’une nacelle, pourvue d’un siège comme les véritables balançoires que nous suspendons dans les jardins à l’usage des enfants ; sur le siège était placée une minuscule idole représentant le jeune Krishna. Une mince cordelette attachée à la nacelle permettait de la faire osciller pour amuser bébé Krishna que l’on jugeait, probablement, prendre plaisir à ce jeu.
Avant que le brahmine sacristain ait eu le temps de m’en empêcher, je tirai légèrement la ficelle et Krishna se balança. Mon guide eut un sursaut, marquant son inquiétude, et s’empressa de m’escorter au-dehors » (p. 125).
ADN n’a de cesse de dénoncer les incuries inhérentes aux superstitions des hindous, les uns profitant des croyances des autres, y compris dans une situation de famine : « La raison, je la connaissais. Le réfugié, étranger à la ville, sans bagage, sans gîte, n’avait ni endroit où il pouvait faire cuire son riz, ni aucun ustensile de cuisine pour l’y bouillir. Sachant l’embarras dans lequel il se trouvait, des individus sans scrupules le guettaient, ils lui proposaient, en échange du riz cru qu’il venait de recevoir, une bolée de soupe aqueuse qui n’était guère que de l’eau dans laquelle du riz avait été bouilli. Le pauvre hère, torturé par un long jeûne et pressé de se mettre quelque chose dans l’estomac, acceptait et le gredin emportait le riz » (p. 135).
Réduction des naissances sans vergogne : « Chinois et Indiens ont fait la même remarque et, chez eux, nuls préjugés religieux ou autres ne s’opposent à la réduction volontaire des naissances.
Dans l’Inde, j’ai été frappée par la franchise complète avec laquelle s’affirme la volonté de ne point procréer contre son gré. Tandis qu’en Occident les appareils destinés à servir ce dessein se vendent plus ou moins discrètement, il était curieux de noter que, dans une grande ville comme Calcutta, l’on voyait aux vitrines des boutiquiers des écriteaux annonçant « articles en caoutchouc ». Dans une rue transversale aboutissant à Dhurumtollah, j’en ai compté une douzaine. Le libellé était souvent en anglais : rubber goods et cela amenait à penser que ces articles avaient été manufacturés en Angleterre. Pour le bénéfice des masses indigènes qui ne savent pas lire l’anglais, certains commerçants avaient ingénument traduit, en hindi : « Articles d’Angleterre » » (p. 138).
ADN ne s’affole pas d’une épidémie de peste et de choléra qui sévit à Bénarès, mais blâme l’aveuglement des locaux, même cultivés : « Tous les jours, mon boy lave les dalles des chambres avec de l’eau additionnée de désinfectant et il en verse un peu dans les jarres où se trouve l’eau qui sert à ma toilette. La prudence s’impose pendant une épidémie combinée de peste et de choléra aussi forte que celle que nous subissons.
Mon pandit hausse les épaules d’un air méprisant.
– Les Étrangers sont absurdes, déclare-t-il. La peste, le choléra sont apportés par l’air. Inutile de lui parler de contagion par les microbes, j’ai tenté de le faire, il m’a ri au nez. « Les Étrangers sont stupides de croire pareilles fables », réplique-t-il » (p. 140).
ADN n’est pas vraiment séduite par l’aspect pittoresque des crémations : « À part quelques yoguins enduits de cendres, et coiffés de leur tignasse embroussaillée comme d’un volumineux turban, dont on trouve toujours quelques exemplaires assis en contemplation à proximité des bûchers ou de parents venus accompagner un mort, les gens traversent le ghât funèbre avec une complète indifférence, sans jamais s’arrêter pour donner un coup d’œil aux ultimes gesticulations des bras et des jambes qui, vivants, ont été actifs pour le travail ou pour le plaisir, sans que le bruit sec des crânes qui éclatent, les amène à se demander quelles pensées ont pu engendrer et nourrir les cervelles qui s’en échappent et s’écoulent bouillantes comme du lait répandu. Les solides gaillards préposés au service de la crémation, qui travaillent le torse nu, un court doti couvrant le haut de leurs cuisses, contribuent à donner à leur opération macabre un vague et banal air de cuisine. Armés de longues gaules, ils tournent et retournent dans le feu les morceaux déjà disjoints des corps, le bassin surtout dont les os résistent les derniers. Souvent ; les familles pauvres n’ont pas les moyens d’acheter une quantité de bois suffisante pour amener une prompte et complète combustion. Alors, quoi ? Il faut pousser dans le Gange les restes à demi carbonisés.
Du reste, en période d’épidémie plus qu’en tout autre temps, il faut se hâter. Couchés sur des civières, enveloppés dans un linceul, les pieds ou la moitié du corps baignant dans le fleuve sacré pour assurer leur salut, d’autres « clients » attendent leur tour. Actuellement, ils font « queue ».
Tout près d’eux écartant parfois une civière, des hommes nus, à part un minuscule cache-sexe, fouillent avec les mains dans la vase, s’aventurent dans l’eau plus profonde, y plongent parfois, toujours fouillant et examinant les poignées de vase qu’ils retirent. Ces misérables cherchent de menus morceaux des bijoux qu’on a laissés aux corps des défunts riches et qui se sont mêlés aux cendres et aux débris d’ossements qui ont été jetés au fleuve » (p. 145).

C’est dans le même chapitre qu’est évoqué le sacrifice des veuves déjà remarqué pour ma part dans Sang et volupté à Bali, de Vicki Baum : « Des stèles naïves, de petits monuments hauts de cinquante centimètres donnent aussi à rêver sur ce ghât funèbre. Ils rappellent que ce ne sont pas seulement des morts qui y ont été brûlés, mais que des femmes vivantes ont été couchées là, sur le bûcher de leur défunt époux. Les stèles montrent, grossièrement sculptée, l’image d’un homme et d’une femme debout l’un près de l’autre, elles sont d’ancienne date… La sinistre superstition dont elles commémorent les effets tragiques est-elle bien définitivement morte ?… Les Anglais sont partis, qui avaient édicté des lois punissant les meurtres rituels… A-t-on lieu d’être parfaitement rassuré pour l’avenir ?… Faudrait-il en douter ?… » (p. 151). Elle livre plusieurs anecdotes souvent de seconde main, et conclut : « Détournons-nous de ces spectacles qui, quoiqu’en puissent penser certains Indiens, nous remplissent d’horreur et souhaitons que les Indiens, s’étant libérés du joug politique de l’étranger, se libèrent aussi du joug, plus pesant et plus néfaste, des anciennes superstitions qui s’attardent encore parmi eux » (p. 156).
Voici maintenant la déesse mère : « Dominant les innombrables dieux qui, aux dires de ceux qui « savent », représentent les différents aspects du même Dieu ou, plutôt, les différentes manières dont les hommes le conçoivent, se dresse l’image terrible ou ironiquement souriante de la Mère.
La Mère, c’est Dieu au féminin, ce qui est propre à troubler nos notions héréditaires occidentales de Dieu, imaginé comme mâle : le Père.
La Mère est non pas une déesse – celles-ci sont légion dans l’Inde, comme le sont les dieux – elle est la Déesse à l’absolu : Shakti.
Shakti, son nom l’indique – et, ceux qui sont initiés à ses mystères le savent – c’est l’Énergie » […] Elle cite une légende : « « C’est par Shakti que Brahmâ est créateur. Vishnou conservateur et Shiva destructeur : ils sont aussi inertes que des cadavres. Seule l’Énergie (Shakti) est agissante. » » (p. 157-8).
Dans ce chapitre consacré aux cultes secrets, sont évoqués des sacrifices animaux : « C’est par milliers que des chèvres sont quotidiennement sacrifiées devant les nombreux autels élevés à Kâli dans l’Inde. Certains temples, comme celui de Kâlighat à Calcutta, sont de véritables abattoirs. Les chèvres y sont amenées par les fidèles et décapitées par un prêtre préposé à cet office. Celui qui a offert la bête peut en emporter le corps et manger la viande chez lui. Des échoppes de bouchers occupent le voisinage du temple ; on peut y acheter, au détail, de la viande provenant d’animaux qui ont été sacrifiés. En fait, ceux des hindous orthodoxes qui consomment de la viande ne devraient manger que celle des bêtes qui ont été offertes en sacrifice.
Quant à la déesse, il lui suffit apparemment d’avoir vu ruisseler le sang des victimes et d’en avoir humé l’odeur » (p. 169).
Joli passage sur la femme : « « La femme qui s’attache à l’homme comme la liane s’attache à l’arbre et l’enserre », dit un texte indien.
Il est aisé de tourner en mauvaise part cette comparaison poétique et de remarquer que la liane étouffe et tue l’arbre auquel elle s’enroule. Je ne me faisais pas faute de taquiner mes amis indiens à ce sujet, mais ils me répondaient généralement avec une belle assurance : « Nos femmes ne ressemblent pas à celles de votre pays ; ce sont des lianes qui parent de leurs fleurs les arbres auxquels elles s’appuient sans leur causer aucun mal » (p. 181).
L’exposé sur le tantrisme dévoile quelques aspects qui de nos jours et dans nos contrées seraient considérés comme condamnables : « Le vîra est autorisé à célébrer le rite complet, avec cette restriction que la femme à laquelle il s’unira sera son épouse légitime. Toutefois, il peut arriver que la femme du vîra n’ait pas atteint un degré de développement spirituel égal au sien, qu’elle ne soit point vîra elle-même et, par conséquent, qu’elle n’ait pas le droit de pratiquer le rite. Dans ce cas, il est licite pour le vîra de choisir une autre partenaire.
Il épousera celle-ci suivant la forme d’union dénommée Shaiva mariage. Ce mariage sera valable pour la durée du rite seulement, ou bien la même partenaire pourra être conservée pour des célébrations occasionnelles, sans limites de temps. La femme devient alors la sadhadarmini, l’épouse en religion, du vîra. Il convient de rappeler ici que l’hindouisme permet la polygamie, de sorte que le fait de cette union n’a rien de choquant pour les hindous » (p. 183). ADN n’hésite pas à pratiquer l’observation participative du sociologue : « Bon, concéderont probablement les lecteurs, nous admettons que pour être fructueuse, une enquête concernant les rites secrets des adorateurs de la Déesse, comme toutes enquêtes concernant les pratiques des cultes ésotériques, exige un séjour prolongé dans le pays où ceux-ci sont en vigueur ; mais vous qui écrivez ce livre, vous qui avez séjourné pendant une grande partie de votre vie dans l’Inde, n’avez-vous aucune expérience vraiment personnelle au sujet de ce singulier rite du pancha tattva ?
Si, j’en ai quelques-unes. Mon désir de me rendre compte par moi-même est trop fort pour me permettre de me contenter, en n’importe quelle matière, de ce que je puis apprendre dans les livres ou par les récits d’autrui.
En fait, il m’est arrivé trois fois d’être témoin de la célébration complète du rite aux cinq éléments…
Une fois j’ai été admise à me joindre aux fidèles et ceux-ci usaient, m’a-t-on dit, d’un procédé psychique peu usité.
Deux fois j’ai épié les dévots en étant cachée grâce à des complicités qui m’y avaient aidée » (p. 192). Elle relate ces expériences par le menu. L’une d’entre elles lui vaut une excitation d’aventurière : « Ma curiosité surexcitée, mêlée d’un soupçon d’appréhension, me causait, pendant l’attente, un léger énervement qui, ma foi, n’était pas désagréable. Un subtil parfum d’aventure se mêlait aux effluves suaves qui emplissaient la salle et l’aventure est pour moi l’unique raison d’être de la vie. Instinctivement, j’avais pourtant repéré du regard une porte qui, au besoin, me permettrait de m’échapper » […] « Oserais-je confesser que je ne rêvais plus, j’étais complètement éveillée : ma conscience professionnelle d’orientaliste-reporter me dictait l’impérieux devoir de tout noter » (pp. 195-6). Loin d’elle l’idée de condamner ce dont elle est témoin : « Les sadakas, absolument silencieux et recueillis, assis le buste droit dans l’attitude de certaines idoles tantriques de dieux unis à leurs épouses, accomplissaient un véritable acte religieux exempt de toute lubricité.
Que d’autres shaktas en d’autres assemblées, se vautrent ivres, dans l’orgie, on le sait et j’en ai vu quelque chose au Népal, mais tel n’était pas le cas dans cette maison inconnue où je m’étais introduite en fraude » (p. 203).
Sannyâsin, gourous & sadhous
C’est au tour des « gourous » de faire l’objet d’un chapitre. « Autrefois ces gourous s’attribuaient des droits extraordinaires sur les familles qu’ils étaient censés guider dans les voies spirituelles. Un de ces droits bizarres ressemblait au « droit du Seigneur » au temps de notre féodalité. Le gourou avait le droit et, même, le devoir d’étrenner la mariée immédiatement après la cérémonie du mariage. À cet effet, un coin de la salle où celle-ci avait été célébrée, ou une pièce contiguë, en était isolé par des rideaux. À un moment donné, la mariée, généralement une fillette de huit à onze ans, passait derrière le rideau et y trouvait le gourou. Il lui était prescrit de lui dire : « Je suis Radha, tu es Krishna » (allusion à Radha la maîtresse de Krishna). Alors le gourou s’emparait d’elle et, son « office » terminé, il donnait un signal sur lequel des musiciens se mettaient à jouer un air bruyant. Il est douteux que cette coutume soit encore souvent suivie, mais on n’oserait affirmer qu’elle est complètement abolie et qu’on n’en puisse signaler des exemples modernes » (p. 208).
« D’après ce que j’ai pu constater moi-même dans l’Inde moderne et d’après les histoires relatives à des gourous des siècles passés, je suppose que les Indiens ont toujours été prodigues du titre vénérable de gourou et l’ont distribué à tort et à travers à des intellectuels hautement respectables, à des dévots hallucinés et à d’impudents imposteurs de la plus méprisable espèce » (p. 210).
Quant à l’âge du mariage, une note de bas de page le précise : « Quatorze ans, suivant la loi édictée à cette époque par l’administration anglaise. Le gouvernement de l’Inde indépendante a fixé l’âge légal à quinze ans. Les hindous mariaient leurs enfants à n’importe quel âge et sans que l’âge des conjoints s’accordât. Une enfant de cinq ans pouvait être donnée comme femme à un homme de soixante » (p. 221).
Le collège du gourou Rabindra Nath Tagore s’ouvre aux filles : « Le collège admettait des jeunes filles ; cette tentative de coéducation était une innovation hardie alors que sévissait encore très fortement dans l’Inde, le système du purdah qui tenait les femmes cloîtrées dans leurs appartements et ne leur permettait de paraître devant aucun homme, en dehors de leur mari et de leurs proches parents. De nos jours cette règle s’est considérablement relâchée sans être, toutefois, complètement abolie » (p. 223).
Voici un extrait assez long sur le détour que prend volontiers l’enseignement des gourous :
« Un magistrat désirait obtenir la direction spirituelle d’un sannyâsin qui enseignait quelques disciples. (Je reviendrai plus loin sur les gourous sannyasins). Ce gourou habitait dans les environs de Madras à environ quatre kilomètres de la demeure du magistrat.
D’après les idées reçues dans l’Inde, arriver en voiture ou à cheval chez celui dont on veut solliciter instruction et conseils témoignerait d’un très répréhensible manque de déférence. Le magistrat fit donc la route à pied, malgré la chaleur torride et des nuages de poussière aveuglante. Arrivé devant la chambre où le gourou se tenait, il le salua en se prosternant puis resta debout près de la porte. Le maître ne lui accorda pas la moindre attention et continua à s’entretenir avec quelques disciples. Le magistrat resta debout pendant longtemps, peut-être pendant plusieurs heures. Alors le gourou, ayant congédié ses disciples, se retira dans une autre pièce dont il ferma la porte. Le magistrat se prosterna de nouveau et rentra chez lui, à pied.
Le lendemain il retourna, toujours à pied, à la demeure du maître et le résultat de sa démarche fut identique à celui de la veille.
Pendant six mois il se rendit quotidiennement auprès du sannyâsin et se tint debout à sa porte sans que celui-ci parût remarquer sa présence. Ces six mois étant écoulés, le maître leva, un jour, les yeux vers lui et lui commanda : « Assieds-toi. »
Une autre période de visites commença alors. Tout ce que le magistrat avait gagné, était de pouvoir s’asseoir au lieu de rester debout, le gourou ne lui adressant pas la parole.
Il se passa encore nombre de mois avant que le sannyâsin, apparemment satisfait de la persévérance dont le quémandeur avait fait preuve, commençât à lui donner quelques avis.
Devons-nous penser que bien que, pendant plus d’une année de visites quotidiennes, le gourou n’ait rien enseigné à l’aspirant disciple, ce dernier n’avait rien appris et qu’il avait perdu son temps et sa peine ? Telle n’est pas l’opinion des Indiens qui se souviennent de l’histoire de Satyakâma et de bien d’autres analogues. Non seulement le magistrat avait fourni la preuve de l’importance qu’il attachait à s’instruire, à parvenir à la claire vision de la réalité, mais tandis qu’il cheminait par la chaleur et dans la poussière pénible de la route, le long de celle-ci, comme à Satyakâma, des connaissances qu’il ne possédait pas auparavant s’étaient manifestées à lui » (p. 234).
Après les gourous, les sadhous : ADN en évoque plusieurs, sans être sûre qu’il s’agisse de charlatans ou de sincères. Certains adoptent une posture perpétuelle, y compris pour dormir, assis, couchés, etc. Elle se moque volontiers d’eux, ce qui n’est pas bien vu chez les Indiens, mais nous fournit un exemple de réflexion critique sur ce qu’il nous est donné de voir en voyage :
« Enfin, j’appris qu’un ascète, dont la spécialité était de s’étendre sur ce genre de couche, demeurait sur une petite place voisine de la mosquée d’Aurengzeb. Il y enseignait, disait-on, quelques disciples qui s’assemblaient autour de son lit clouté.
Quand mon amie en fut informée elle ne se tint plus d’impatience. Nous devions aller voir ce sadhou. J’y consentis volontiers et, souhaitant causer avec le « saint homme » je crus préférable de choisir, pour me rendre près de lui, le milieu de la journée où vraisemblablement il serait seul, ses prédications ayant lieu dans la soirée.
Je ne réussis que trop bien. Non seulement les disciples ne se trouvaient point là, mais leur gourou était absent. Un seul fidèle gardait le lit de torture placé sous un auvent. Il nous dit que son maître ne tarderait pas à revenir et reprendrait sa place.
Cependant le temps passait, l’ascète ne revenait pas. Mon amie manifestait un pénible désappointement ; elle ne verrait pas le bonhomme étendu sur des clous… Une idée baroque me passa alors par la tête.
– Ne te chagrine pas, lui dis-je, si tu tiens vraiment à voir quelqu’un couché sur des clous, je puis te montrer cela. Lorsqu’on a vécu pendant de nombreuses années dans l’Inde et que l’on s’y est intéressé aux pratiques des yogas physiques, l’on n’est pas sans avoir appris à effectuer certains exercices bizarres.
– Regarde, dis-je à la curieuse.
J’enlevai mon sâri de mousseline, l’espèce de toge dans laquelle les Indiennes se drapent, et ne conservai qu’un mince pantalon et une veste légère, puis je m’étendis de tout mon long sur les pointes des clous. De là je continuai à causer avec mon amie terrifiée.
Le pire, ou le plus amusant de l’aventure, fut que tandis que je conversais ainsi, nous entendîmes, venant d’une ruelle qui débouchait sur la place, la voix d’un guide promenant des touristes.
– Ladies and gentlemen, clamait-il en anglais, vous allez voir le célèbre fakir qui pratique l’austérité inouïe de demeurer couché sur les point acérées d’un lit de clous.
Son boniment s’achevait à peine quand le peloton des touristes fit irruption près de l’auvent sous lequel je me trouvais. Ébahissement général. Guide et touristes demeuraient muets, médusés.
– How do you do, dis-je et je continuai en anglais. Il fait plutôt chaud à Bénarès n’est-ce pas ? Je ne suis pas le fakir, cela se voit. Il va revenir ; je me reposais à l’ombre tandis que sa place était vacante.
Sur ce, je me levai lentement. Quelques-uns des étrangers, trop abasourdis pour dire un mot, s’en vinrent inspecter les clous et s’écorchèrent les doigts, car les clous n’étaient nullement truqués, mais bel et bien pointus.
– Vous avez vu quelque chose de bien plus étonnant qu’un fakir, dis-je alors aux touristes, vous avez vu une Parisienne couchée sur un lit de clous, c’est plus rare. Soyez donc généreux envers le sadhou qui va revenir, donnez quelque monnaie à son disciple que voilà, il la lui remettra » (p. 264).
Cela dit, ADN reconnaît que les sadhou savent mener jusqu’au bout leur délire : « D’effroyables pratiques superstitieuses, dont la disparition ne remonte guère au-delà d’un siècle et dont certaines ont tendance à subsister encore de nos jours, attachent des souvenirs sinistres à certains coins de la ville. On y montre des lingams ayant servi de billots sur lesquels des dévots, ayant au préalable fait don de leurs biens à des brahmines, posaient leur tête et se la faisaient trancher en sacrifice à Shiva, espérant mériter par cet acte de renaître dans un paradis » (p. 265).
Voici un extrait assez long sur la nudité cultuelle, que je note pour un éventuel cours sur le corps : « D’après eux, cet état transcendant se manifestait extérieurement par une indifférence complète pour les choses de ce monde, amenant le rejet de tout ce qui s’y rattache : coutumes sociales aussi bien que possessions matérielles. Le type parfait de l’individu intégralement « libéré » était le sadhou dépouillé de tout, même de vêtements : « Vêtu des quatre points cardinaux » selon l’euphémique, pittoresque et charmante expression des textes sanscrits.
De ce type j’avais rencontré plus d’un exemplaire, mais tous appartenaient au sexe masculin, aussi fus-je passablement surprise quand j’appris que le gourou de l’un de mes doctes visiteurs était une yoguini qui pratiquait la nudité totale.
On lui donnait le titre de Ma (mère), elle vivait dans une hutte au fond d’un jardin et demeurait presque constamment plongée dans la méditation.
Naturellement je brûlais d’envie de connaître cette femme singulière et je me réjouis fort lorsque son disciple me proposa d’aller la voir.
Elle habitait à la campagne et comme j’en avais été informée, son logis consistait en une hutte en branchages couverte d’un toit de chaume. Quand j’arrivai, la yoguini était assise sur une natte et égrenait un chapelet en répétant les différents noms de Vishnou. Elle devait avoir atteint la cinquantaine si même elle ne l’avait pas dépassée, mais son âge s’inscrivait plutôt sur son visage que sur son corps, dont la peau était demeurée lisse et tendue ; la couleur sombre de celle-ci contribuait à faire paraître la femme moins nue, bien qu’elle le fût totalement, sans la concession du moindre bout de chiffon.
Je crois que sa nudité constituait son principal titre à la vénération qu’elle inspirait. Rien dans l’entretien que j’eus avec elle ne dénota une suprématie intellectuelle quelconque ; elle était peu instruite et le sens profond des doctrines indiennes paraissait lui être étranger. Elle s’adonnait uniquement à la dévotion : l’adoration de Vishnou, la lecture des récits concernant ses divers avatars et la répétition de ses multiples noms. Tout savoir était vain, disait-elle. Il suffisait d’abandonner entre les mains de Dieu sa volonté et ses désirs personnels, d’accepter, sans lui demander compte de rien, les douleurs comme les joies qu’il lui plaisait de nous envoyer. Même, puisque rien ne se produit que par son ordre, il fallait nous réjouir d’éprouver les tortures de l’enfer puisque, s’il nous les infligeait, c’est qu’il y prenait plaisir et que nous devions être heureux de lui procurer ce plaisir.
Je savais que des mystiques vaishnavas, un Chaitanya et d’autres de la même trempe, avaient atteint cet état d’esprit, mais je doutais qu’il fût celui de la quinquagénaire nue qui me parlait. Dans tous les cas je saisissais mal la relation entre la profession de foi que j’entendais et le fait de ne pas se vêtir.
Quant au disciple de la yoguini, il débordait d’enthousiasme et s’imaginait, probablement, que je vibrais au même diapason.
J’en eus la preuve deux jours plus tard lorsqu’il revint me voir. Ses deux amis l’accompagnaient, une expression de singulière gravité était empreinte sur les visages de mes visiteurs, leur démarche même avait une solennité inusitée.
Écourtant les politesses habituelles, le disciple de la yoguini me demanda, ou plutôt au lieu de questionner, il affirma :
– Vous avez été fortement émue par votre rencontre avec la vénérable Ma, n’est-ce pas ?…
Ma courtoisie se trouvait mal à l’aise.
– C’est une femme remarquable, répondis-je évasivement.
– Elle est un exemple… un exemple pour vous…
Suivit un long silence. Les deux compagnons du notaire priaient à voix basse.
Ce dernier n’était pas seulement érudit, il était, aussi, éloquent. Au fur et à mesure que sa rhétorique me devenait claire la stupéfaction m’envahissait. L’exemple qui m’était proposé était la nudité de la yoguini et cela, de façon aggravée, car la bonne dame vivait isolée tandis que j’habitais parmi les Occidentaux qui, bien qu’épris d’indianisme, n’eussent point compris une pareille fantaisie de ma part. Mieux encore, les trois bonshommes projetaient de m’emmener – en voiture il est vrai – rendre une seconde visite à la yoguini sous mon nouvel aspect.
Je n’avais même plus envie de rire, le grotesque de la chose provoquait l’hébétement.
– Mes voisins me feraient enfermer comme folle et les agents de la police m’arrêteraient si je sortais nue hors du domaine, répliquai-je enfin, et d’ailleurs, je ne crois pas à l’utilité d’exhiber mon corps comme moyen d’éclairer mon esprit.
Les trois fanatiques attaquèrent alors ma sincérité, je me dupais ou je cherchais à duper autrui en lisant les Écritures sacrées et en me livrant à la méditation ; je ne cherchais pas véritablement la libération spirituelle.
Comme je demeurais muette, ne fournissant aucun élément de controverse à mes visiteurs, leur ardeur s’apaisa peu à peu et ils me quittèrent douloureusement désappointés avec ces mots d’adieu :
– Il n’y a rien à faire pour vous… Vous ne comprenez point… Jamais les Occidentaux ne comprendront…
Cela me paraissait probable. J’ignorais alors l’existence des nudistes occidentaux… » (p. 294).
Dernière notation sur la situation des femmes en Inde traditionnelle : « Religion et philosophie, ascétisme et mysticisme sont en Orient et particulièrement dans l’Inde, l’affaire des hommes et des élites. Pourquoi les femmes ne sont-elles, en général, pas admises à faire profession de sannyâsa ?
La raison m’en a été exprimée passablement crûment :
« Sannyâsa, m’a dit mon interlocuteur, comporte la chasteté totale. Les hommes en sont capables, les femmes, non. »
Une opinion contestable, qui fait s’exclamer les Occidentaux à qui je la communique, mais qui est très courante dans l’Inde, est en effet, que les femmes livrées à elles-mêmes ne peuvent résister à leurs désirs sensuels. Assez récemment, un jeune étudiant me le répétait encore. « Il est nécessaire de tenir les femmes enfermées », me disait-il, et la liberté dont elles commencent à jouir dans l’Inde, lui paraissait, ainsi qu’à beaucoup d’autres, une abomination qui allait entraîner l’Inde à sa perte » (p. 322).
L’Inde nouvelle
Le dernier chapitre est consacré aux voyages récents de l’auteure et à la révolution qu’il lui fut donné d’observer. Les femmes se libèrent : « Quand je me réveillai, le soleil brillait ; à travers les persiennes de ma chambre, je voyais une rue animée par de nombreux passants, toutes les boutiques qui la bordaient étaient ouvertes. Béantes, dans les immeubles qui me faisaient vis-à-vis, les fenêtres laissaient entrevoir des intérieurs indiens pourvus de mobiliers semi-occidentaux ; des femmes en sâri, mais non voilées, s’accoudaient aux balcons, des femmes respectables, j’entends, épouses ou parentes des commerçants dont les boutiques bordaient la rue. Autrefois, seules les prostituées se montraient aux balcons. Nombre de fillettes portaient des robes de mode européenne… Je commençais à prendre contact avec l’Inde nouvelle » (p. 327).
ADN se livre à un constat objectif des massacres de l’indépendance :
« Les hindous ne tardèrent pas à répliquer. Ils le firent avec une férocité égale à celle des musulmans. Les sikhs, dont la religion est presque identique à celle de l’islam, se distinguèrent spécialement par leur fureur contre les musulmans. Le nombre des musulmans massacrés par eux et par les hindous surpassa celui des hindous tués par les musulmans au début du carnage.
La division de l’Inde en pays hindou et pays musulman était devenue inévitable. Elle fut consacrée par la proclamation de l’indépendance de l’Inde le 15 aoùt 1947. Le Pakistan était né ; Jinnah et la ligue musulmane avaient gagné la partie contre Gandhi, Nehru et le Congrès » (p. 334).
« Les fugitifs hindous avaient tout à craindre en passant par les zones habitées par des musulmans ; il en était de même pour les musulmans traversant les zones occupées par des hindous. Pendant la nuit, surtout, des bandes armées de sabres et de piques se jetaient sur les voyageurs harassés, sommeillant parmi leurs chariots, leurs bestiaux et leurs hardes. C’était moins le désir du pillage qui animait ces bandits que la soif de tuer ; une vague de folie sanguinaire déferlait sur les belles routes de l’Inde.
Il en était de même le long des voies ferrées et jusque dans les gares. Des trains de réfugiés furent assaillis par les assassins, embusqués sur leur passage, et leurs passagers égorgés jusqu’au dernier. Les sikhs se distinguèrent à Amritsar, les musulmans à Lahore et ailleurs. D’après les termes de Nehru : « L’horreur s’amoncela sur l’horreur. » Pendant ce temps, Gandhi priait et il allait jeûner. La doctrine de l’ahimsa, le « non-tuer », la « non-violence », thème de ses prédications pendant un quart de siècle, avait fait faillite.
Une sorte d’apaisement sembla se produire après ce dramatique exode, mais ne dura guère. En 1950, les massacres recommencèrent dans le Bengale oriental et à Calcutta et ils menacent de s’étendre à d’autres régions.
Il est à craindre que les tentatives faites pour établir dans l’Inde un gouvernement laïque, neutre en matière religieuse, ne soient rendues vaines par le fanatisme des factions sectaires. Les masses de l’Inde ne paraissent pas capables d’apprendre à être « indiennes ». Elles demeurent obstinément hindoues ou musulmanes, nourrissant ces haines irraisonnées qui ont animé les adeptes de toutes les doctrines, dans tous les pays du monde et y ont provoqué ces persécutions et ces tueries dont l’Histoire nous a conservé le souvenir » (p. 336).
Témoignages objectifs personnel ou non, sur Gandhi : « En 1909, Gandhi écrivait :
« Le salut de l’Inde consiste à désapprendre ce qu’elle a appris pendant les cinquante dernières années, chemins de fer, télégraphe, hôpitaux, hommes de lois, médecins et toutes choses analogues doivent disparaître. Ceux qui appartiennent à ce que l’on appelle les classes sociales supérieures doivent apprendre à mener la vie simple du paysan, comprenant qu’elle procure le vrai bonheur. »
La plupart des partisans de Gandhi étaient loin de partager ces opinions ; ils ne se sentaient nullement disposés à abandonner les avantages matériels et intellectuels que la civilisation moderne leur avait apportés, à descendre au niveau des classes déshéritées, à vivre dans des huttes de terre couvertes de chaume, à labourer avec des charrues antiques et à occuper le temps laissé libre par les travaux des champs en filant avec un rouet primitif.
Ce rouet était devenu un symbole. Pendant longtemps les partisans de Gandhi se distinguèrent en portant des vêtements faits d’un tissu grossier produit de ce tissage domestique. Un rouet prit place au milieu d’ameublements de style occidental moderne, et des maîtres de maison affectèrent de s’en servir.
À ce sujet, je raconterai un fait caractéristique qui m’est personnel.
J’étais allée rendre visite à Gandhi. Je trouvai celui-ci s’entretenant avec un des membres de sa maison. Il tenait des papiers en mains, d’autres étaient étalés sur une table devant lui. Nul rouet n’était en vue. Cependant, j’étais à peine là depuis quelques minutes, lorsque, comme s’il avait perçu un signe que je n’avais pas remarqué, ou comme s’il était dressé à cet effet, un serviteur apporta un rouet, le plaça devant Gandhi et, celui-ci, délaissant ses papiers, se remit à filer, tout en causant avec moi » (p. 338).
« En hindou orthodoxe, Gandhi vénérait les vaches ; il était même président d’une société fondée pour leur protection. Ce sentiment de vénération le portait, disait-on, à refuser, par respect, de boire du lait de vache et à le remplacer par du lait de chèvre. Or, comme il en consommait une grande quantité et qu’il le lui fallait tout frais, il était nécessaire qu’un petit troupeau fût toujours tenu à sa portée. Lorsqu’il devait accomplir, en chemin de fer, un de ces trajets à travers le vaste territoire de l’Inde qui durent plusieurs jours, des chèvres étaient embarquées dans le train où il voyageait » (p. 341).
Assassinat de Gandhi
L’assassinat de Gandhi nous vaut quelques réflexions brutes de décoffrage :
« Sacrifice est bien le mot qui convient. Il ne s’agit point de crimes politiques au sens ordinaire de ce terme mais, comme dans l’acte de Godse, de l’accomplissement d’un devoir religieux. Le condamné peut être tenu pour vénérable et son meurtrier se prosternera devant lui, comme le fit Godse, avant de l’abattre, mais le « saint » a été jugé dangereux pour le maintien de la foi et de la discipline traditionnelles de l’antique orthodoxie. Dès lors il doit disparaître » (p. 351).
ADN remarque que Gandhi n’a pas prononcé le mot « pardonnez » avant d’expirer : « Parce que Gandhi n’a pas dit : « Pardonnez », ses parents, ses amis, la foule à qui il a prêché I’ahimsa n’ont pas cru devoir pardonner à Godse qui a tué au nom d’une mystique différente de celle de Gandhi ; mais aussi authentiquement indienne que la sienne. Ils l’ont envoyé à la potence, ce qui est un geste vulgaire, commun aux « justices » de tous les pays et n’ont point donné au monde, qui l’attendait peut-être, le spectacle d’un geste de haute spiritualité qui eût clos en beauté la page d’histoire gandhienne » (p. 355).
« L’un de ceux-ci concerne la situation des femmes. L’émancipation civique des femmes est advenue très soudainement dans l’Inde où elle constitue une révolution infiniment plus importante qu’elle ne l’a été en France ou en Angleterre car la situation des Indiennes, cloîtrées dans leur maison et tenues dans la sujétion leur vie durant, n’avait rien de comparable avec celle des Françaises ou des Anglaises, même avant que ces dernières fussent électrices et éligibles.
Cette émancipation, les suites qu’elle a déjà entraînées et celles qui ne peuvent manquer de se produire encore ne sont pas du goût des réactionnaires hindous. Gandhi lui-même y était opposé. Il souhaitait, certes, que la situation des femmes fût améliorée mais à leur propos, comme à celui des classes populaires, il estimait que l’étendue des améliorations ne devait pas dépasser une très étroite mesure » (p. 379).
La loi sur le mariage dont il a déjà été question ci-dessus, a été amendée : « Un des premiers actes du gouvernement de la République de l’Inde a été de réexaminer la législation concernant le mariage.
Sous la pression de l’opinion étrangère, une loi fut promulguée qui interdisait les mariages d’enfants et fixait à quatorze ans l’âge légal du mariage pour les filles. Précédemment, des fillettes de sept à huit ans se voyaient livrées à des hommes adultes, parfois à des vieillards ; certaines devenaient mères à neuf ans, et treize ans semblait, aux hindous, un âge très convenable pour une première maternité » (p.380).
« En reprenant l’examen des anciennes lois concernant le mariage, le gouvernement les a amendées en portant à quinze ans l’âge légal du mariage des filles qui, auparavant était à quatorze ans, et en édictant qu’une peine d’emprisonnement et une amende seront infligées aux parents coupables de dérogation à la loi » (p. 383).
Le livre se termine sur un « appendice » qui date sans doute de 1969. La mort de Nehru (1964) est mentionnée, et Indira Gandhi y est évoquée en tant que Premier ministre, ce qui date de 1966. Elle revient sur le peuple Naga et son hobby de coupage de têtes, et sur l’Assam, qu’elle regrettait peut-être d’avoir oubliés. Détail amusant : le livre s’achève, à l’évocation de l’indépendance du Nagaland (1963), sur les mots « glorieuse ivresse », peut-être les derniers qu’ait écrits (ou dictés ?) l’auteure ?
– L’interview d’Alexandra David-Néel par Arnaud Desjardins réalisée à l’âge de cent ans et diffusée le 02.11.1969 (2 mois après sa mort), est disponible ici (extrait de 9 minutes).
– Émission sur Radio-Canada : « La vie d’Alexandra David Neel racontée par Evelyne Ferron ».
– « Qui était l’exploratrice et aventurière Alexandra David-Néel ? » sur le site de Géo, avec une information sur l’étonnante pratique du Toumo, technique de yoga tibétain pour résister au froid.
– Le petit Tibet d’Alexandra David Néel, film de 26 minutes sur la vieillesse active d’ADN.
– En 2022, la Poste édite une série très wokiste de 12 timbres « Les Grands Voyageur » (photo ci-dessus). Alexandra David-Néel fait partie de la promo, parmi d’autres femmes, dont Nelly Bly et Jeanne Barret, en lieu et place de Bougainville, car qu’on se le dise c’est elle la grande voyageuse ! Qu’est-ce qu’ils sont cons ces wokistes ! Bizarrement il n’y a aucun « racisé » parmi ces grands voyageurs… Étonnant que LFI n’ait pas protesté.
– Voir un sujet de corpus Liberté de voyager ? qui inclut un texte extrait de ce livre.
– Lire mon article Retour en Inde et Voyage littéraire à Ceylan.
– Article repris sur Profession gendarme.
Voir en ligne : Alexandra David-Néel pionnière exploratrice du bouddhisme, sur France Inter
© altersexualite.com 2022
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Exactement avant 1914.
[2] À propos de prophylaxie, je lis, dans un journal, qu’au Brésil l’on oblige les passagers descendant de l’avion, à se laisser mettre un thermomètre dans la bouche, le même thermomètre servant pour tous, après avoir été rapidement trempé dans un liquide supposé être désinfectant.
 altersexualite.com
altersexualite.com
