Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Théâtre, Poésie & Chanson > Le Mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Au programme des classes de 1re technologique en 2019-2020
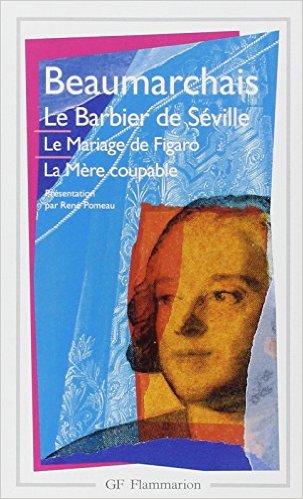 Le Mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Le Mariage de Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
GF- Flammarion, 1784 (1965).
samedi 17 août 2019, par
Le Mariage de Figaro de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) est une des trois pièces au programme de 1re technologique en 2019-2020. C’est d’ailleurs aussi l’œuvre commune aux programmes de 1re générale. Contrairement au roman, je la choisis de bon cœur car il y a de quoi faire plaisir aux élèves de 1re, avec un contenu plaisamment altersexuel. Cela faisait un moment que je désirais l’étudier en œuvre intégrale. Et puis on peut compléter par des extraits de l’opéra de Mozart / Da Ponte, formule qui avait enchanté mes élèves sur Don Juan. Le « parcours associé » est « la comédie du valet », ce qui ne présente pas de difficulté. L’édition que j’ai choisie est inutilisable pour les élèves, elle contient la trilogie dans une édition de René Pomeau, et date de… 1965, et toujours au catalogue ! De nombreuses phrases incompréhensibles pour le lecteur du XXIe siècle sont dans cette édition laissées sans explication, ce qui dérouterait nos élèves (et je suis moi-même incapable de comprendre le sens de nombreuses phrases !) Cette vieille édition est disponible en PDF.
Préface et notice de René Pomeau
L’éminent professeur parle d’« Un comique prestissimo. Beaumarchais accélère l’échange des répliques : l’interlocuteur comprend à demi-mot, coupe, va de l’avant ». Figaro ne rêve pas de subvertir l’ordre social. « Il ressort que, passant de l’aristocratie de la naissance à celle de l’argent, il n’a pas cessé d’appartenir à la classe dirigeante ». Contrairement aux valets traditionnels, Arlequin ou Sganarelle, qui « ne disposent pas d’une biographie s’étendant de l’enfance à la vieillesse » et « portent un âge invariable, lié à leur caractère », « les avatars de Figaro démontrent les ressources d’un tel caractère, plus riche assurément que ses prédécesseurs les valets de comédie ». La pièce est approuvée par le censeur et reçue par acclamation à la Comédie Française, mais le roi Louis XVI qui se fait lire la pièce l’interrompt après le monologue du Ve acte et déclare « Cela ne sera jamais joué ; il faudrait détruire la Bastille pour que la représentation de cette pièce ne fût pas une inconséquence dangereuse ». Une représentation est cependant prévue pour la Cour, interdite au dernier moment, ce qui « soulève les protestations du public élégant ». Une nouvelle lecture par Beaumarchais « devant un aréopage de censeurs officieux » obtint leur approbation, et Louis XVI se rendit. La pièce fut donnée dans la salle de l’actuel Odéon le 27 avril 1784. La représentation dura cinq heures, saluée d’applaudissements enthousiastes, qu’interrompit seulement un mouvement de stupeur, pendant le monologue : que Figaro osât narguer ainsi les pouvoirs, signifiait la défaite de ceux-ci — état de choses inouï jusqu’alors au théâtre, dont confusément on pressentait les conséquences ». La suite est rocambolesque : « Louis XVI crut que l’allusion à de tels fauves [dans une lettre de Beaumarchais défendant sa pièce] le désignait. Courroucé « comme un mouton enragé », il écrit sur une carte de jeu l’ordre d’enfermer Beaumarchais à Saint-Lazare. On imagine la sensation. L’auteur du Mariage, quinquagénaire considérable, président de la Société des auteurs dramatiques, financier influent, conseiller du ministère dans les affaires d’Amérique, — incarcéré dans la prison des mauvais garçons, où la règle veut qu’une fessée soit administrée à tout nouvel arrivant ! Au bout de cinq jours, Louis XVI, comprenant sa faute, fait libérer le prisonnier, et s’applique à calmer sa colère. Élargi de Saint-Lazare, Beaumarchais est invité à assister à Trianon à une représentation du Barbier où le rôle de Rosine est tenu par la reine Marie-Antoinette ».
Préface de Beaumarchais
Cette préface est fort longue (26 pages dans l’édition GF) ; en voici donc certains extraits qu’il est inutile d’alourdir d’explications.
« Personne n’étant tenu de faire une comédie qui ressemble aux autres, si je me suis écarté d’un chemin trop battu, pour des raisons qui m’ont paru solides, ira-t-on me juger, comme l’ont fait MM. tels, sur des règles qui ne sont pas les miennes ? imprimer puérilement que je reporte l’art à son enfance, parce que j’entreprends de frayer un nouveau sentier à cet art, dont la loi première, et peut-être la seule, est d’amuser en instruisant ? »
« À force de nous montrer délicats, fins connaisseurs, et d’affecter, comme j’ai dit autre part, l’hypocrisie de la décence auprès du relâchement des mœurs, nous devenons des êtres nuls, incapables de s’amuser et de juger de ce qui leur convient » « Déjà ces mots si rebattus, bon ton, bonne compagnie […] ont détruit la franche et vraie gaieté qui distinguait de tout autre le comique de notre nation. »
« J’ai donc réfléchi que si quelque homme courageux ne secouait pas toute cette poussière, bientôt l’ennui des pièces françaises porterait la nation au frivole opéra-comique, et plus loin encore, aux boulevards, à ce ramas infect de tréteaux élevés à notre honte, où la décente liberté, bannie du théâtre français, se change en une licence effrénée ; où la jeunesse va se nourrir de grossières inepties, et perdre, avec ses mœurs, le goût de la décence et des chefs-d’œuvre de nos maîtres. »
« La fable est une comédie légère, et toute comédie n’est qu’un long apologue : leur différence est que dans la fable les animaux ont de l’esprit, et que, dans notre comédie, les hommes sont souvent des bêtes, et, qui pis est, des bêtes méchantes. »
« Mais gardons-nous bien de confondre cette critique générale, un des plus nobles buts de l’art, avec la satire odieuse et personnelle : l’avantage de la première est de corriger sans blesser. »
« Feu M. le prince de Conti, de patriotique mémoire (car, en frappant l’air de son nom, l’on sent vibrer le vieux mot patrie), feu M. le prince de Conti, donc, me porta le défi public de mettre au théâtre ma préface du Barbier, plus gaie, disait-il, que la pièce, et d’y montrer la famille de Figaro, que j’indiquais dans cette préface. Monseigneur, lui répondis-je, si je mettais une seconde fois ce caractère sur la scène, comme je le montrerais plus âgé, qu’il en saurait quelque peu davantage, ce serait bien un autre bruit ; et qui sait s’il verrait le jour ? Cependant, par respect, j’acceptai le défi ; je composai cette Folle journée, qui cause aujourd’hui la rumeur. »
« Pendant ces quatre ans de débat je ne demandais qu’un censeur ; on m’en accorda cinq ou six. Que virent-ils dans l’ouvrage, objet d’un tel déchaînement ? La plus badine des intrigues. Un grand seigneur espagnol, amoureux d’une jeune fille qu’il veut séduire, et les efforts que cette fiancée, celui qu’elle doit épouser, et la femme du seigneur, réunissent pour faire échouer dans son dessein un maître absolu, que son rang, sa fortune et sa prodigalité rendent tout-puissant pour l’accomplir. Voilà tout, rien de plus. La pièce est sous vos yeux.
D’où naissaient donc ces cris perçants ? De ce qu’au lieu de poursuivre un seul caractère vicieux, comme le joueur, l’ambitieux, l’avare, ou l’hypocrite, ce qui ne lui eût mis sur les bras qu’une seule classe d’ennemis, l’auteur a profité d’une composition légère, ou plutôt a formé son plan de façon à y faire entrer la critique d’une foule d’abus qui désolent la société. »
« Oh ! que j’ai de regret de n’avoir pas fait de ce sujet moral une tragédie bien sanguinaire ! Mettant un poignard à la main de l’époux outragé, que je n’aurais pas nommé Figaro, dans sa jalouse fureur je lui aurais fait noblement poignarder le puissant vicieux ; et comme il aurait vengé son honneur dans des vers carrés, bien ronflants, et que mon jaloux, tout au moins général d’armée, aurait eu pour rival quelque tyran bien horrible, et régnant au plus mal sur un peuple désolé ; tout cela, très loin de nos mœurs, n’aurait, je crois, blessé personne ; on eût crié Bravo ! ouvrage bien moral ! Nous étions sauvés, moi et mon Figaro sauvage.
Mais ne voulant qu’amuser nos Français et non faire ruisseler les larmes de leurs épouses, de mon coupable amant j’ai fait un jeune seigneur de ce temps-là, prodigue, assez galant, même un peu libertin, à peu près comme les autres seigneurs de ce temps-là. Mais qu’oserait-on dire au théâtre d’un seigneur, sans les offenser tous, sinon de lui reprocher son trop de galanterie ? N’est-ce pas là le défaut le moins contesté par eux-mêmes ? J’en vois beaucoup d’ici rougir modestement (et c’est un noble effort) en convenant que j’ai raison. »
« un seigneur assez vicieux pour vouloir prostituer à ses caprices tout ce qui lui est subordonné, pour se jouer, dans ses domaines, de la pudicité de toutes ses jeunes vassales, doit finir, comme celui-ci, par être la risée de ses valets. »
« croisé dans tous ses projets, le comte Almaviva se voit toujours humilié, sans être jamais avili. »
« On accorde à la tragédie que toutes les reines, les princesses aient des passions bien allumées qu’elles combattent plus ou moins ; et l’on ne souffre pas que, dans la comédie, une femme ordinaire puisse lutter contre la moindre faiblesse ! Ô grande influence de l’affiche ! Jugement sûr et conséquent ! Avec la différence du genre, on blâme ici ce qu’on approuvait là. Et cependant, en ces deux cas, c’est toujours le même principe : point de vertu sans sacrifice. »
« Pourquoi, dans ses libertés sur son maître, Figaro m’amuse-t-il, au lieu de m’indigner ? C’est que, l’opposé des valets, il n’est pas, et vous le savez, le malhonnête homme de la pièce : en le voyant forcé, par son état, de repousser l’insulte avec adresse, on lui pardonne tout, dès qu’on sait qu’il ne ruse avec son seigneur que pour garantir ce qu’il aime, et sauver sa propriété. »
« Est-ce mon page, enfin, qui vous scandalise ? et l’immoralité qu’on reproche au fond de l’ouvrage serait-elle dans l’accessoire ? […] Un enfant de treize ans, aux premiers battements du cœur, cherchant tout sans rien démêler, idolâtre, ainsi qu’on l’est à cet âge heureux, d’un objet céleste pour lui, dont le hasard fit sa marraine, est-il un sujet de scandale ? »
« Ce qu’il éprouve innocemment, il l’inspire partout de même. Direz-vous qu’on l’aime d’amour ? Censeurs, ce n’est pas là le mot : vous êtes trop éclairés pour ignorer que l’amour, même le plus pur, a un motif intéressé : on ne l’aime donc pas encore ; on sent qu’un jour on l’aimera. »
« Mais à treize ans, qu’inspire-t-il ? Quelque chose de sensible et doux, qui n’est ni amitié ni amour, et qui tient un peu de tous deux. »
« Ainsi, dans cet ouvrage, chaque rôle important a quelque but moral. Le seul qui semble y déroger est le rôle de Marceline. Coupable d’un ancien égarement dont son Figaro fut le fruit, elle devrait, dit-on, se voir au moins punie par la confusion de sa faute, lorsqu’elle reconnaît son fils. L’auteur eût pu en tirer une moralité plus profonde : dans les mœurs qu’il veut corriger, la faute d’une jeune fille séduite est celle des hommes, et non la sienne. Pourquoi donc ne l’a-t-il pas fait ? »
« Quant à moi, saisissant l’aveu naïf de Marceline au moment de la reconnaissance, je montrais cette femme humiliée, et Bartholo qui la refuse, et Figaro, leur fils commun, dirigeant l’attention publique sur les vrais fauteurs du désordre où l’on entraîne sans pitié toutes les jeunes filles du peuple douées d’une jolie figure. »
« La Folle journée explique donc comment, dans un temps prospère, sous un roi juste et des ministres modérés, l’écrivain peut tonner sur les oppresseurs, sans craindre de blesser personne. C’est pendant le règne d’un bon prince qu’on écrit sans danger l’histoire des méchants rois ; et plus le gouvernement est sage, est éclairé, moins la liberté de dire est en presse : chacun y faisant son devoir, on n’y craint pas les allusions : nul homme en place ne redoutant ce qu’il est forcé d’estimer, on n’affecte point alors d’opprimer chez nous cette même littérature qui fait notre gloire au-dehors, et nous y donne une sorte de primauté que nous ne pouvons tirer d’ailleurs. »
« Un monsieur de beaucoup d’esprit, mais qui l’économise un peu trop, me disait un soir au spectacle : Expliquez-moi donc, je vous prie, pourquoi dans votre pièce on trouve autant de phrases négligées qui ne sont pas de votre style ? — De mon style, monsieur ? Si par malheur j’en avais un, je m’efforcerais de l’oublier quand je fais une comédie ; ne connaissant rien d’insipide au théâtre comme ces fades camaïeux où tout est bleu, où tout est rose, où tout est l’auteur, quel qu’il soit. »
« chacun y parle son langage ; eh ! que le dieu du naturel les préserve d’en parler d’autre ! Ne nous attachons donc qu’à l’examen de leurs idées, et non à rechercher si j’ai dû leur prêter mon style. »
« À des moralités d’ensemble et de détail, répandues dans les flots d’une inaltérable gaieté ; à un dialogue assez vif, dont la facilité nous cache le travail, si l’auteur a joint une intrigue aisément filée, où l’art se dérobe sous l’art, qui se noue et se dénoue sans cesse à travers une foule de situations comiques, de tableaux piquants et variés qui soutiennent, sans la fatiguer, l’attention du public pendant les trois heures et demie que dure le même spectacle (essai que nul homme de lettres n’avait encore osé tenter) ; que reste-t-il à faire à de pauvres méchants que tout cela irrite ? attaquer, poursuivre l’auteur par des injures verbales, manuscrites, imprimées : c’est ce qu’on a fait sans relâche. Ils ont même épuisé jusqu’à la calomnie, pour tâcher de me perdre dans l’esprit de tout ce qui influe en France sur le repos d’un citoyen. »
« Je conviens qu’à la vérité la génération passée ressemblait beaucoup à ma pièce ; que la génération future lui ressemblera beaucoup aussi ; mais que, pour la génération présente, elle ne lui ressemble aucunement ; que je n’ai jamais rencontré ni mari suborneur, ni seigneur libertin, ni courtisan avide, ni juge ignorant ou passionné, ni avocat injuriant, ni gens médiocres avancés, ni traducteur bassement jaloux. Et que si des âmes pures, qui ne s’y reconnaissent point du tout, s’irritent contre ma pièce et la déchirent sans relâche, c’est uniquement par respect pour leurs grands-pères et sensibilité pour leurs petits-enfants. J’espère, après cette déclaration, qu’on me laissera bien tranquille ; ET J’AI FINI. »
Trois pages de « Caractères et habillements de la pièce » précisent les intentions de l’auteur. Je relèverai surtout le commentaire sur le personnage de Chérubin : « Ce rôle ne peut être joué, comme il l’a été, que par une jeune et très jolie femme ; nous n’avons point à nos théâtres de très jeune homme assez formé pour en bien sentir les finesses. Timide à l’excès devant la comtesse, ailleurs un charmant polisson ; un désir inquiet et vague est le fond de son caractère. Il s’élance à la puberté, mais sans projet, sans connaissances, et tout entier à chaque événement ; enfin il est ce que toute mère, au fond du cœur, voudrait peut-être que fût son fils, quoiqu’elle dût beaucoup en souffrir.
Son riche vêtement, au premier et au second acte, est celui d’un page de cour espagnol, blanc et brodé d’argent ; le léger manteau bleu sur l’épaule, et un chapeau chargé de plumes. Au quatrième acte, il a le corset, la jupe et la toque des jeunes paysannes qui l’amènent. Au cinquième acte, un habit uniforme d’officier, une cocarde et une épée. »
Extraits choisis pour la lecture expliquée
Les scènes célèbres sont nombreuses. La difficulté de sélectionner des extraits de 20 lignes corse l’affaire, parce que Beaumarchais est un auteur disert. Voyez le monologue censé être le plus long du théâtre classique…
Extrait n° 1 : le début de la scène d’exposition (I, 1).
Le théâtre représente une chambre à demi démeublée ; un grand fauteuil de malade est au milieu. Figaro, avec une toise, mesure le plancher. Suzanne attache à sa tête, devant une glace, le petit bouquet de fleurs d’orange, appelé chapeau de la mariée.
Scène I. FIGARO, SUZANNE.
Figaro. — Dix-neuf pieds sur vingt-six.
Suzanne. — Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau : le trouves-tu mieux ainsi ?
Figaro lui prend les mains. — Sans comparaison, ma charmante. Oh ! que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d’une belle fille, est doux, le matin des noces, à l’œil amoureux d’un époux !…
Suzanne se retire. — Que mesures-tu donc là, mon fils ?
Figaro. — Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que monseigneur nous donne aura bonne grâce ici.
Suzanne. — Dans cette chambre ?
Figaro. — Il nous la cède.
Suzanne. — Et moi je n’en veux point.
Figaro. — Pourquoi ?
Suzanne. — Je n’en veux point.
Figaro. — Mais encore ?
Suzanne. — Elle me déplaît.
Figaro. — On dit une raison.
Suzanne. — Si je n’en veux pas dire ?
Figaro. — Oh ! quand elles sont sûres de nous !
Suzanne. — Prouver que j’ai raison serait accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur, ou non ?
Figaro. — Tu prends de l’humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des deux appartements. La nuit, si madame est incommodée, elle sonnera de son côté : zeste, en deux pas tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose ? il n’a qu’à tinter du sien : crac, en trois sauts me voilà rendu.
Suzanne. — Fort bien ! Mais quand il aura tinté, le matin, pour te donner quelque bonne et longue commission : zeste, en deux pas il est à ma porte, et crac, en trois sauts…
Figaro. — Qu’entendez-vous par ces paroles ?
Suzanne. — Il faudrait m’écouter tranquillement.
Figaro. — Eh ! qu’est-ce qu’il y a, bon Dieu ?
Suzanne. — Il y a, mon ami, que, las de courtiser les beautés des environs, monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château, mais non pas chez sa femme : c’est sur la tienne, entends-tu ? qu’il a jeté ses vues, auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas. Et c’est ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon.
Extrait n° 2 : (I, 7).
Scène 7. SUZANNE, CHÉRUBIN.
Chérubin, accourant. — Ah ! Suzon, depuis deux heures j’épie le moment de te trouver seule. Hélas ! tu te maries, et moi je vais partir.
Suzanne. — Comment mon mariage éloigne-t-il du château le premier page de monseigneur ?
Chérubin, piteusement. — Suzanne, il me renvoie.
Suzanne le contrefait. — Chérubin, quelque sottise !
Chérubin. — Il m’a trouvé hier au soir chez ta cousine Fanchette, à qui je faisais répéter son petit rôle d’innocente, pour la fête de ce soir : il s’est mis dans une fureur en me voyant ! — Sortez ! m’a-t-il dit, petit… Je n’ose pas prononcer devant une femme le gros mot qu’il a dit : sortez, et demain vous ne coucherez pas au château. Si madame, si ma belle marraine ne parvient pas à l’apaiser, c’est fait, Suzon, je suis à jamais privé du bonheur de te voir.
Suzanne. — De me voir, moi ? c’est mon tour ? Ce n’est donc plus pour ma maîtresse que vous soupirez en secret ?
Chérubin. — Ah ! Suzon, qu’elle est noble et belle ! mais qu’elle est imposante !
Suzanne. — C’est-à-dire que je ne le suis pas, et qu’on peut oser avec moi…
Chérubin. — Tu sais trop bien, méchante, que je n’ose pas oser. Mais que tu es heureuse ! à tous moments la voir, lui parler, l’habiller le matin et la déshabiller le soir, épingle à épingle… Ah ! Suzon, je donnerais… Qu’est-ce que tu tiens donc là ?
Suzanne, raillant. — Hélas ! l’heureux bonnet et le fortuné ruban qui renferment la nuit les cheveux de cette belle marraine…
Chérubin, vivement. — Son ruban de nuit ! donne-le-moi, mon cœur.
Suzanne le retirant. — Eh que non pas ; son cœur ! Comme il est familier donc ! si ce n’était pas un morveux sans conséquence. (Chérubin arrache le ruban.) Ah ! le ruban !
Chérubin tourne autour du grand fauteuil. — Tu diras qu’il est égaré, gâté, qu’il est perdu. Tu diras tout ce que tu voudras.
Suzanne tourne après lui. — Oh ! dans trois ou quatre ans, je prédis que vous serez le plus grand petit vaurien !… Rendez-vous le ruban ? (Elle veut le reprendre.)
Chérubin tire une romance de sa poche. — Laisse, ah ! laisse-le-moi, Suzon ; je te donnerai ma romance ; et, pendant que le souvenir de ta belle maîtresse attristera tous mes moments, le tien y versera le seul rayon de joie qui puisse encore amuser mon cœur.
Suzanne arrache la romance. — Amuser votre cœur, petit scélérat ! vous croyez parler à votre Fanchette. On vous surprend chez elle, et vous soupirez pour madame ; et vous m’en contez à moi, par-dessus le marché !
Chérubin, exalté. — Cela est vrai, d’honneur ! je ne sais plus ce que je suis, mais depuis quelque temps je sens ma poitrine agitée ; mon cœur palpite au seul aspect d’une femme ; les mots amour et volupté le font tressaillir et le troublent. Enfin le besoin de dire à quelqu’un Je vous aime est devenu pour moi si pressant, que je le dis tout seul, en courant dans le parc, à ta maîtresse, à toi, aux arbres, aux nuages, au vent qui les emporte avec mes paroles perdues. — Hier je rencontrai Marceline…
Suzanne, riant. — Ah ! ah ! ah ! Ah !
Chérubin. — Pourquoi non ? elle est femme ! elle est fille ! Une fille, une femme ! ah ! que ces noms sont doux ! qu’ils sont intéressants !
Extrait n° 3 : (II, 2).
Scène 2. FIGARO, SUZANNE, LA COMTESSE, assise.
La Comtesse. — Un homme aussi jaloux !…
Figaro. — Tant mieux ! pour tirer parti des gens de ce caractère, il ne faut qu’un peu leur fouetter le sang : c’est ce que les femmes entendent si bien ! Puis, les tient-on fâchés tout rouge, avec un brin d’intrigue on les mène où l’on veut, par le nez, dans le Guadalquivir. Je vous ai fait rendre à Basile un billet inconnu, lequel avertit Monseigneur qu’un galant doit chercher à vous voir aujourd’hui pendant le bal.
La Comtesse. — Et vous vous jouez ainsi de la vérité sur le compte d’une femme d’honneur !…
Figaro. — Il y en a peu, madame, avec qui je l’eusse osé, crainte de rencontrer juste.
La Comtesse. — Il faudra que je l’en remercie !
Figaro. — Mais dites-moi s’il n’est pas charmant de lui avoir taillé ses morceaux de la journée, de façon qu’il passe à rôder, à jurer après sa dame, le temps qu’il destinait à se complaire avec la nôtre ! Il est déjà tout dérouté : galopera-t-il celle-ci ? surveillera-t-il celle-là ? Dans son trouble d’esprit, tenez, tenez, le voilà qui court la plaine, et force un lièvre qui n’en peut mais. L’heure du mariage arrive en poste ; il n’aura pas pris de parti contre, et jamais il n’osera s’y opposer devant madame.
Suzanne. — Non ; mais Marceline, le bel esprit, osera le faire, elle.
Figaro. — Brrrr. Cela m’inquiète bien, ma foi ! Tu feras dire à monseigneur que tu te rendras sur la brune au jardin.
Suzanne. — Tu comptes sur celui-là ?
Figaro. — Oh ! dame, écoutez donc ; les gens qui ne veulent rien faire de rien n’avancent rien, et ne sont bons à rien. Voilà mon mot.
Suzanne. — Il est joli !
La Comtesse. — Comme son idée : vous consentiriez qu’elle s’y rendît ?
Figaro. — Point du tout. Je fais endosser un habit de Suzanne à quelqu’un : surpris par nous au rendez-vous, le comte pourra-t-il s’en dédire ?
Suzanne. — À qui mes habits ?
Figaro. — Chérubin.
La Comtesse. — Il est parti.
Figaro. — Non pas pour moi ; veut-on me laisser faire ?
Suzanne. — On peut s’en fier à lui pour mener une intrigue.
Figaro. — Deux, trois, quatre à la fois ; bien embrouillées, qui se croisent. J’étais né pour être courtisan.
Suzanne. — On dit que c’est un métier si difficile !
Figaro. — Recevoir, prendre, et demander : voilà le secret en trois mots.
La Comtesse. — Il a tant d’assurance qu’il finit par m’en inspirer.
Figaro. — C’est mon dessein.
Suzanne. — Tu disais donc…
Figaro. — Que, pendant l’absence de monseigneur, je vais vous envoyer le Chérubin : coiffez-le, habillez-le ; je le renferme et l’endoctrine ; et puis dansez, monseigneur. (Il sort.)

Dans l’acte II, scène 4, la didascalie suivante cite un tableau de Charles André van Loo, dit Carle (1705-1765) : La Comtesse, assise, tient le papier pour suivre. Suzanne est derrière son fauteuil, et prélude en regardant la musique par-dessus sa maîtresse. Le petit page est devant elle, les yeux baissés. Ce tableau est juste la belle estampe d’après Vanloo, appelée LA CONVERSATION ESPAGNOLE.) Voir sur ce blog.
Extrait n° 4 : (II, 6, 7).
Scène 6. CHÉRUBIN, LA COMTESSE, SUZANNE.
[…] La Comtesse. — Est-ce là ma baigneuse ?
Suzanne s’assied près de la comtesse. — Et la plus belle de toutes. (Elle chante avec des épingles dans sa bouche.)
Tournez-vous donc envers ici,
Jean de Lyra, mon bel ami.
(Chérubin se met à genoux. Elle le coiffe.) Madame, il est charmant !
La Comtesse. — Arrange son collet d’un air un peu plus féminin.
Suzanne l’arrange. — Là… mais voyez donc ce morveux, comme il est joli en fille ! J’en suis jalouse, moi ! (Elle lui prend le menton.) Voulez-vous bien n’être pas joli comme ça ?
La Comtesse. — Qu’elle est folle ! Il faut relever la manche, afin que l’amadis prenne mieux… (Elle le retrousse.) Qu’est-ce qu’il a donc au bras ? Un ruban ?
Suzanne. — Et un ruban à vous. Je suis bien aise que madame l’ait vu. Je lui avais dit que je le dirais, déjà ! Oh ! si monseigneur n’était pas venu, j’aurais bien repris le ruban, car je suis presque aussi forte que lui.
La Comtesse. — Il y a du sang ! (Elle détache le ruban.)
Chérubin, honteux. — Ce matin, comptant partir, j’arrangeais la gourmette de mon cheval ; il a donné de la tête, et la bossette m’a effleuré le bras.
La Comtesse. — On n’a jamais mis un ruban…
Suzanne. — Et surtout un ruban volé. — Voyons donc ce que la bossette… la courbette… la cornette du cheval… Je n’entends rien à tous ces noms-là. — Ah ! qu’il a le bras blanc ! c’est comme une femme ! plus blanc que le mien ! Regardez donc, madame ! (Elle les compare.)
La Comtesse, d’un ton glacé. — Occupez-vous plutôt de m’avoir du taffetas gommé dans ma toilette. (Suzanne lui pousse la tête en riant ; il tombe sur les deux mains. Elle entre dans le cabinet au bord du théâtre.)
Scène 7. CHÉRUBIN, à genoux ; LA COMTESSE, assise.
La Comtesse reste un moment sans parler, les yeux sur son ruban. Chérubin la dévore de ses regards. — Pour mon ruban, monsieur… comme c’est celui dont la couleur m’agrée le plus… j’étais fort en colère de l’avoir perdu. »
Extrait n° 5 : (III, 16). La colère de Marceline contre Bartholo après avoir retrouvé leur fils en Figaro
Scène 16. LE COMTE, allant de côté et d’autre ; MARCELINE, BARTHOLO, FIGARO, BRID’OISON.
Marceline. — Est-ce que la nature ne te l’a pas dit mille fois ?
Figaro. — Jamais.
Le Comte, à part. — Sa mère !
Brid’oison. — C’est clair, i-il ne l’épousera pas.
Bartholo. — Ni moi non plus.
Marceline. — Ni vous ! Et votre fils ? Vous m’aviez juré…
Bartholo. — J’étais fou. Si pareils souvenirs engageaient, on serait tenu d’épouser tout le monde.
Brid’oison. — E-et si l’on y regardait de si près, pè-ersonne n’épouserait personne.
Bartholo. — Des fautes si connues ! une jeunesse déplorable !
Marceline, s’échauffant par degrés. — Oui, déplorable, et plus qu’on ne croit ! Je n’entends pas nier mes fautes, ce jour les a trop bien prouvées ! mais qu’il est dur de les expier après trente ans d’une vie modeste ! J’étais née, moi, pour être sage, et je le suis devenue sitôt qu’on m’a permis d’user de ma raison. Mais dans l’âge des illusions, de l’inexpérience et des besoins, où les séducteurs nous assiègent, pendant que la misère nous poignarde, que peut opposer une enfant à tant d’ennemis rassemblés ? Tel nous juge ici sévèrement, qui, peut-être, en sa vie a perdu dix infortunées !
Figaro. — Les plus coupables sont les moins généreux ; c’est la règle.
Marceline, vivement. — Hommes plus qu’ingrats, qui flétrissez par le mépris les jouets de vos passions, vos victimes ! c’est vous qu’il faut punir des erreurs de notre jeunesse ; vous et vos magistrats, si vains du droit de nous juger, et qui nous laissent enlever, par leur coupable négligence, tout honnête moyen de subsister. Est-il un seul état pour les malheureuses filles ? Elles avaient un droit naturel à toute la parure des femmes : on y laisse former mille ouvriers de l’autre sexe.
Figaro, en colère. — Ils font broder jusqu’aux soldats !
Marceline, exaltée. — Dans les rangs même plus élevés, les femmes n’obtiennent de vous qu’une considération dérisoire ; leurrées de respects apparents, dans une servitude réelle ; traitées en mineures pour nos biens, punies en majeures pour nos fautes ! Ah ! sous tous les aspects, votre conduite avec nous fait horreur ou pitié ! »
Dans l’acte IV, scène 5, Fanchette dit au comte : « Oui, Monseigneur. Au lieu de punir Chérubin, donnez-le-moi en mariage, et je vous aimerai à la folie. » Où l’on voit que nos ancêtres ne faisaient pas de différence entre nubilité et puberté.
Extrait n° 6 : (V, 3). Le monologue de Figaro
Vous en trouverez un commentaire ici, mais la lecture expliquée doit se cantonner à un extrait d’une vingtaine de lignes, et il est dur de saucissonner Figaro !
Scène 3. FIGARO, seul, se promenant dans l’obscurité, dit du ton le plus sombre.
« Ô femme ! femme ! femme ! créature faible et décevante !… nul animal créé ne peut manquer à son instinct : le tien est-il donc de tromper ?… Après m’avoir obstinément refusé quand je l’en pressais devant sa maîtresse ; à l’instant qu’elle me donne sa parole ; au milieu même de la cérémonie… Il riait en lisant, le perfide ! et moi, comme un benêt… Non, monsieur le comte, vous ne l’aurez pas… vous ne l’aurez pas. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie !… noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus : du reste, homme assez ordinaire ! tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m’a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement, qu’on n’en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes [1] ; et vous voulez jouter !… On vient… c’est elle… ce n’est personne. — La nuit est noire en diable, et me voilà faisant le sot métier de mari, quoique je ne le sois qu’à moitié ! (Il s’assied sur un banc.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée ! Fils de je ne sais pas qui ; volé par des bandits ; élevé dans leurs mœurs, je m’en dégoûte et veux courir une carrière honnête ; et partout je suis repoussé ! J’apprends la chimie, la pharmacie, la chirurgie ; et tout le crédit d’un grand seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d’attrister des bêtes malades, et pour faire un métier contraire, je me jette à corps perdu dans le théâtre : me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail : auteur espagnol, je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule : à l’instant un envoyé… de je ne sais où se plaint que j’offense dans mes vers la Sublime Porte, la Perse, une partie de la presqu’île de l’Inde, toute l’Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d’Alger et de Maroc ; et voilà ma comédie flambée, pour plaire aux princes mahométans, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrissent l’omoplate, en nous disant : Chiens de chrétiens ! — Ne pouvant avilir l’esprit, on se venge en le maltraitant. — Mes joues creusaient, mon terme était échu : je voyais de loin arriver l’affreux recors, la plume fichée dans sa perruque ; en frémissant je m’évertue. Il s’élève une question sur la nature des richesses ; et comme il n’est pas nécessaire de tenir les choses pour en raisonner, n’ayant pas un sou, j’écris sur la valeur de l’argent, et sur son produit net : aussitôt je vois, du fond d’un fiacre, baisser pour moi le pont d’un château-fort, à l’entrée duquel je laissai l’espérance et la liberté. (Il se lève.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours, si légers sur le mal qu’ils ordonnent, quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil ! Je lui dirais… que les sottises imprimées n’ont d’importance qu’aux lieux où l’on en gêne le cours ; que, sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur ; et qu’il n’y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. (Il se rassied.) Las de nourrir un obscur pensionnaire, on me met un jour dans la rue ; et comme il faut dîner, quoiqu’on ne soit plus en prison, je taille encore ma plume, et demande à chacun de quoi il est question : on me dit que, pendant ma retraite économique, il s’est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions, qui s’étend même à celles de la presse ; et que, pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l’autorité, ni du culte, ni de la politique, ni de la morale, ni des gens en place, ni des corps en crédit, ni de l’Opéra, ni des autres spectacles, ni de personne qui tienne à quelque chose, je puis tout imprimer librement, sous l’inspection de deux ou trois censeurs ».
Extrait n° 7 : (V, 7). Le quiproquo
Scène 16. FIGARO, LE COMTE, LA COMTESSE, SUZANNE.
Le Comte prend la main de sa femme. — Mais quelle peau fine et douce, et qu’il s’en faut que la comtesse ait la main aussi belle !
La Comtesse, à part. — Oh ! la prévention !
Le Comte. — A-t-elle ce bras ferme et rondelet ? ces jolis doigts pleins de grâce et d’espièglerie ?
La Comtesse, de la voix de Suzanne. — Ainsi l’amour…
Le Comte. — L’amour… n’est que le roman du cœur ; c’est le plaisir qui en est l’histoire : il m’amène à tes genoux.
La Comtesse. — Vous ne l’aimez plus ?
Le Comte. — Je l’aime beaucoup ; mais trois ans d’union rendent l’hymen si respectable !
La Comtesse. — Que vouliez-vous en elle ?
Le Comte, la caressant. — Ce que je trouve en toi, ma beauté…
La Comtesse. — Mais dites donc.
Le Comte. — Je ne sais : moins d’uniformité peut-être, plus de piquant dans les manières, un je ne sais quoi qui fait le charme ; quelquefois un refus, que sais-je ? Nos femmes croient tout accomplir en nous aimant : cela dit une fois, elles nous aiment, nous aiment (quand elles nous aiment !), et sont si complaisantes, et si constamment obligeantes, et toujours, et sans relâche, qu’on est tout surpris un beau soir de trouver la satiété où l’on recherchait le bonheur.
La Comtesse, à part. — Ah ! quelle leçon !
Le Comte. — En vérité, Suzon, j’ai pensé mille fois que si nous poursuivons ailleurs ce plaisir qui nous fuit chez elles, c’est qu’elles n’étudient pas assez l’art de soutenir notre goût, de se renouveler à l’amour, de ranimer, pour ainsi dire, le charme de leur possession par celui de la variété.
La Comtesse, piquée. — Donc elles doivent tout ?…
Le Comte, riant. — Et l’homme rien. Changerons-nous la marche de la nature ? Notre tâche, à nous, fut de les obtenir, la leur…
La Comtesse. — La leur ?…
Le Comte. — Est de nous retenir : on l’oublie trop.
La Comtesse. — Ce ne sera pas moi.
Le Comte. — Ni moi.
Figaro, à part. — Ni moi.
Suzanne, à part. — Ni moi.
Le Comte, prend la main de sa femme. — Il y a de l’écho ici, parlons plus bas. Tu n’as nul besoin d’y songer, toi que l’amour a faite et si vive et si jolie ! Avec un grain de caprice, tu seras la plus agaçante maîtresse ! (Il la baise au front.) Ma Suzanne, un Castillan n’a que sa parole. Voici tout l’or promis pour le rachat du droit que je n’ai plus sur le délicieux moment que tu m’accordes. Mais comme la grâce que tu daignes y mettre est sans prix, j’y joindrai ce brillant, que tu porteras pour l’amour de moi.
La Comtesse, fait une révérence. — Suzanne accepte tout.
Figaro, à part. — On n’est pas plus coquine que cela.
Suzanne, à part. — Voilà du bon bien qui nous arrive.
Le Comte, à part. — Elle est intéressée ; tant mieux !
La Comtesse, regarde au fond. — Je vois des flambeaux.
Le Comte. — Ce sont les apprêts de ta noce. Entrons-nous un moment dans l’un de ces pavillons, pour les laisser passer ?
La Comtesse. — Sans lumière ?
Le Comte, l’entraîne doucement. — À quoi bon ? Nous n’avons rien à lire.
Figaro, à part. — Elle y va, ma foi ! Je m’en doutais. (Il s’avance.)
Le Comte grossit sa voix en se retournant. — Qui passe ici ?
Figaro, en colère. — Passer ! on vient exprès.
Le Comte, bas à la Comtesse. — C’est Figaro !… (Il s’enfuit.)
La Comtesse. — Je vous suis. (Elle entre dans le pavillon à sa droite, pendant que le Comte se perd dans le bois, au fond.)
Le comte qui fuit, c’est tout un symbole de ce qui change avec Figaro dans la relation maître-valet. Ils jouent dans cette pièce quasiment d’égal à égal — autant Suzanne que Figaro avec le comte ou la comtesse — et cette scène du quiproquo en est la meilleure expression. Figaro maîtrise le langage, à l’opposé de Sganarelle, il n’est plus un Scapin, il n’est plus un valet de comédie, il existe pour lui. Michel Delon fait de Chérubin, « un morveux sans conséquence », la clé de la pièce. « Chérubin symbolise une liberté célibataire, polymorphe, innocente dont il réveille la nostalgie chez ses aînés. « Je ne sais plus ce que je suis », reconnaît Chérubin. Figaro dans le monologue de l’acte V se demande en écho : « Quel est ce moi dont je m’occupe ». » Le ruban est l’objet qui donne du sens à ce passage d’une enfance innocente et irresponsable à l’âge des responsabilités : « Imprégné de souvenirs et de désirs, taché de sang, le ruban trace à travers le Mariage la difficile frontière entre l’innocence et la culpabilité, le poids des conséquences et la grâce de l’instant de fête. » Chérubin ne fait pas de différence entre les âges, de Fanchette à Marceline : « Pourquoi non ? elle est femme ! elle est fille ! Une fille, une femme ! ah ! que ces noms sont doux ! qu’ils sont intéressants ! » (cf. extrait 2, I, 7).
Je propose en texte complémentaire, le début de l’article « De la puberté », dans l’Histoire naturelle de Buffon : « La puberté accompagne l’adolescence et précède la jeunesse. Jusqu’alors la Nature ne paraît avoir travaillé que pour la conservation et l’accroissement de son ouvrage, elle ne fournit à l’enfant que ce qui lui est nécessaire pour se nourrir et pour croître ; il vit, ou plutôt il végète d’une vie particulière, toujours faible, renfermée en lui-même, & qu’il ne peut communiquer ; mais bientôt les principes de vie se multiplient, il a non seulement tout ce qui lui faut pour être, mais encore de quoi donner l’existence à d’autres. Cette surabondance de vie, source de la force & de la santé, ne pouvant plus être contenue au-dedans, cherche à se répandre au-dehors ; elle s’annonce par plusieurs signes ; l’âge de la puberté est le printemps de la Nature, la saison des plaisirs ; pourrons-nous écrire l’histoire de cet âge avec assez de circonspection pour ne réveiller dans l’imagination que des idées philosophiques ? » (Georges-Louis Leclerc de Buffon, 1707-1788), « De la puberté », in Œuvres, La Pléiade, p. 212). À noter : comme beaucoup d’articles de Buffon, des parties de son texte ont été intégrées telles quelles dans certains articles de L’Encyclopédie, comme l’article « Puberté » du Chevalier de Jaucourt, sans que le nom de Buffon apparaisse ! Wikipédia n’a rien inventé ! Voir notre article sur les Œuvres de Buffon. À noter que cet article de l’Encyclopédie, qui fait 1100 mots, si on en ôte 2 ou 3 phrases trop complexes, constitue un excellent exercice de contraction de texte.
Compléments et idées pédagogiques
Sur le thème de la « comédie du valet », un film que l’on pourrait voir, est Guêpier pour trois abeilles (1967) de Joseph L. Mankiewicz, film bâti sur la mise en abyme de la pièce Volpone (Le Renard) (1606) de Ben Jonson, dans laquelle le protagoniste demande à son valet Mosca de le faire passer pour mort de façon à épier la réaction de ses amis, et le valet en profite pour spolier son maître ; situation que Mankiewicz, spécialiste des mondes en déliquescence, se plaît à détourner. Comme c’est un film à rebondissements, nul doute qu’il conviendra à nos élèves et fournira un bon parallèle à cette comédie à rebondissements.
Dans La fille d’un soldat ne pleure jamais (1998) de James Ivory, Anthony Roth Costanzo, contre-ténor de 16 ans qui joue un camarade de classe d’une des protagonistes, interprète devant sa classe de l’école américaine, l’air des Noces de Figaro « Voi que sapete » (air de Chérubin, acte II, scène 3), accompagné au piano par sa mère interprétée par Jane Birkin. Un moment de grâce dans le film, et la prof BCBG pense défaillir à l’instar de la comtesse devant ce Chérubin au bel organe. Voici le texte et la traduction :
« Voi che sapete che cosa è amor,
Donne, vedete s’io l’ho nel cor.
Quello ch’io provo vi ridirò.
E per me nuovo, capir nol so.
Sento un affetto pien di desir,
Ch’ora è diletto, ch’ora è martir.
Gelo, e poi sento l’alma avvampar
E in un momento torno a gelar.
Ricerco un bene fuori di me,
Non so chi’l tiene, non so cos’è
Sospiro e gemo senza voler,
Palpito e tremo senza saper.
Non trovo pace notte nè dì,
Ma pur mi piace languir così. »
Traduction :
« Vous Mesdames qui savez de quoi est fait l’amour,
Voyez s’il est dans mon cœur.
Je vous dirai ce que j’éprouve,
C’est si nouveau que je ne puis le comprendre.
Je ressens une langueur pleine de désir,
Parfois douleur, parfois plaisir,
Je gèle, quand soudain mon âme s’enflamme,
Et le moment d’après je redeviens glacé.
Je recherche un bien être au delà de moi,
Je ne puis le saisir, j’ignore ce qu’il est.
Je soupire et je gémis, sans le vouloir
Je tremble et je palpite, sans rien savoir.
Je ne trouve le repos, ni le jour ni la nuit.
Mais peu importe j’aime souffrir ainsi. »
(refrain)
– Voir dans Ma vie avec Mozart d’Éric-Emmanuel Schmitt, des réflexions sur cet air.
Voir en ligne : Le texte sur Wikisource
© altersexualite.com 2019
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] L’ensemble de la péninsule ibérique, regroupant plusieurs royaumes, y compris le Portugal. On retrouvera cette expression dans « Des cannibales » de Montaigne : « pour cet effet, traversèrent les Espagnes, la Gaule, l’Italie, jusques en la Grèce ».
 altersexualite.com
altersexualite.com