Accueil > Livres pour les jeunes et les « Isidor » HomoEdu > Fictions niveau 3e > Vipère au poing, d’Hervé Bazin
« Aspics du soir, je vous entends siffler », pour les 3e et le lycée
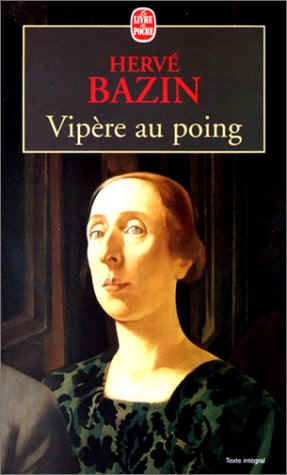 Vipère au poing, d’Hervé Bazin
Vipère au poing, d’Hervé Bazin
Bernard Grasset, 1948, 320 p., 4,6 €.
samedi 6 juin 2015
Cela fait longtemps que j’avais envie de relire ce grand classique du XXe siècle que j’avais lu ado, sans doute aux alentours de la troisième, et complètement oublié, à part le nom de Folcoche et la « pistolétade », ce qui est déjà pas mal. Quand on vous serine à longueur de journée les slogans orwelliens sur les « violences faites aux femmes », il est bon d’avoir sous la main un livre qui nous rappelle que non, les femmes ne sont pas par essence des victimes, et qu’il en est qui pour la saloperie ressentent un sacerdoce, à l’instar de Folcoche, l’héroïne de ce roman autobiographique. Oui, une femme peut terroriser son mari, ses enfants et ses employés de maison, en « bénéficiant, aux yeux du monde, du préjugé favorable accordé à toutes les mères » (p. 200). Oui, une femme peut ressembler à une vipère qu’on a envie d’étrangler. Bazin jetterait d’ailleurs bientôt le cadavre de son père de l’autre côté de la balance, avec La Tête contre les murs, joliment adapté par Georges Franju avec dans le rôle principal Jean-Pierre Mocky, également coauteur de l’adaptation. Mais l’essentiel n’est peut-être pas là, et si ce livre mérite sa place dans cette bibliographie altersexuelle, c’est sans doute parce que cette « vipère au poing » est aussi une métaphore brute de décoffrage de la découverte à l’adolescence de ce monstre en soi qu’est la sexualité.
Résumé
Le titre mystérieux est expliqué dès l’incipit, et le motif de la vipère sera repris à plusieurs reprises, avec une composante sexuelle. Alors qu’il n’était qu’un « bambin », le narrateur a saisi une vipère avec le poignet, et l’a étouffée : « Elle avait de jolis yeux, vous savez, cette vipère, non pas des yeux de saphir comme les vipères de bracelets, je le répète, mais des yeux de topaze brûlée, piqués noir au centre et tout pétillants d’une lumière que je saurais plus tard s’appeler la haine et que je retrouverais dans les prunelles de Folcoche, je veux dire de ma mère » (p. 7). À cette époque, le bambin a la chance, avec son frère aîné Frédie, d’être élevé en France par sa grand-mère, alors que leurs parents et le petit dernier Marcel sont en Chine. Le père, professeur à l’université catholique, qui « avait épousé la fort riche demoiselle Paule Pluvignec, petite fille du banquier de ce nom », est parti enseigner dans ce pays. La faiblesse du père est due à ce détail : c’est elle qui a le pognon, et de retour au pays, il cesse d’enseigner et compte vivre de ses rentes comme sous l’Ancien Régime, tout en se livrant en amateur à l’entomologie. Avant que nous ne fassions connaissance avec la mère, le narrateur ne mâche pas ses mots : « Suivirent, m’a-t-on dit, quelques fausses couches involontaires, auxquelles je ne pense pas sans une certaine jalousie, car leurs produits ont eu la chance, eux, de ne pas dépasser le stade de fœtus Rezeau ».
La première rencontre avec la mère à la gare est édifiante : comme les deux garçons s’approchent pour l’embrasser, elle leur demande de la laisser descendre du train, et : « pour couper court à toutes effusions, lança rapidement, à droite puis à gauche, ses mains gantées. Nous nous retrouvâmes par terre, giflés avec une force et une précision qui dénotaient beaucoup d’entraînement » (p. 36). Le régime dictatorial s’installe aussitôt, et tout est bon pour humilier les enfants. Par exemple, l’administration forcée d’huile de ricin, « cette bonne saleté » (p. 59) permet en outre de licencier la gouvernante, qui s’oppose à ce genre de pratique. Une lésine sordide guide la mère. Elle a tôt fait de remplacer les galoches par les sabots de bois les plus rustiques possibles, fourrés de paille pour économiser sur les chaussettes (p. 64). Tant de méchanceté atteint vite son effet, comme le subsume cet épiphonème : « Les enfants ne réfléchissent que comme des miroirs : il leur faut le tain du respect » (p. 67). La vieille peau invente la confession publique des enfants, et se sert des confessions des uns pour condamner les autres. Cela lui vaudra son surnom : « « La folle ! La cochonne ! » répétait-il en se déshabillant, si haut que ses injures traversaient la cloison. Et, tout à coup, contractant ces termes énergiques, il rebaptisa notre mère : « Folcoche ! Saleté de Folcoche ! » Nous ne la connaîtrons plus que sous ce nom » (p. 72). Lors d’une correction injuste, le narrateur, pour la première fois, se rebiffe : « Folcoche reçut dans les tibias quelques répliques du talon et j’enfonçai trois fois le coude dans le sein qui ne m’avait pas nourri » (p. 81). Elle le bat de plus belle, « mais je ne pleurais pas. Ah ! non. Une immense fierté me remboursait au centuple ». L’invention du surnom entraîne avec elle la formule « V. F… V. F… V. F… C’est-à-dire, vengeance à Folcoche ! Vengeance ! Vengeance à Folcoche, gravée dans toutes les écorces, et sur les potirons de fin d’année » (p. 89), ainsi que la fameuse « pistolétade », consistant à fixer Folcoche dans les yeux jusqu’à ce qu’elle les détourne la première. On trouvera une lecture analytique de cet épisode sur ce site.
Malade, Folcoche finit par se faire hospitaliser. Sa haine leur manque : « J’imagine assez le désarroi des adorateurs de Moloch ou de Kali, soudain privés de leurs vilains dieux. Nous n’avions rien à mettre à la place du nôtre. La haine, beaucoup plus encore que l’amour, ça occupe » (p. 115). Après avoir failli mourir, Folcoche reprend possession de son fief, tente de revenir sur les concessions accordées par le père en son absence à des enfants qui ont grandi entre-temps. Les deux aînés arrachent la faveur de partir quelques semaines avec le père pour voir des amis. Le narrateur se rend compte que Folcoche lui manque : « Folcoche m’était devenue indispensable comme la rente du mutilé qui vit de sa blessure » (p. 174). Au retour, coalisés par l’excès de sévérité, les trois enfants tentent d’empoissonner la mère par une surdose de la belladone qu’elle s’administre contre ses crises de foie ; hélas, elle est « mithridatisée » (p. 211). Le narrateur s’enfuit alors que sa chambre est littéralement assiégée ; il prend le train pour Paris, où il se réfugie chez ses grands-parents maternels, le fameux sénateur Pluvignec (Jean Guilloteaux en réalité), plein aux as. Ce sera au moins l’occasion de visiter Paris, avec son père qui vient le rechercher. Le portrait féroce de la famille maternelle et de son grand homme sera équilibré plus loin dans le roman par celui non moins féroce du grand homme de la famille paternelle, l’écrivain René Bazin dans la réalité, fêté par les Rezeau comme un patriarche d’Ancien régime auquel les gueux locaux font allégeance (cf. p. 269).
La sexualité
Pendant le voyage seul en train apparaît le thème de la sexualité, qui va prendre une place importante dans la fin du roman, et donner tout son sens au titre. C’est d’abord une fille frôlée à sa descente du train : « deux tout jeunes seins, qui, eux non plus, ne sont pas désagréables à regarder. […] Je toucherais bien, si c’était possible. Je ne sais pourquoi, mais j’ai envie de toucher ceux-ci par curiosité, vous savez, pour voir comment c’est fait, si ça résiste, comment c’est attaché. Attaché comme une joue sur un visage ou comme une pomme sur un pommier ? À la réflexion, je pense que cela tient des deux. Et, réflexion refaite, elle m’agace vraiment, cette petite que je ne peux pas m’empêcher de regarder, comme si elle avait quelque chose d’extraordinaire que je découvrirais aujourd’hui seulement. Elle m’agace, avec ses cils baissés, qu’elle relève par instants, laissant échapper un regard prompt, comme une ablette qui se faufile entre les roseaux. […] Laissons cela. L’amour, comme dit Frédie, si c’est la même chose que l’amour de Dieu dont on nous rabâche les oreilles (sic) depuis des années, ça ne doit être encore qu’une fichue blague » (p. 233). Quelque temps après, l’éducation sexuelle se fait comme elle peut à la campagne : « il y avait trois mois seulement qu’en tombant par hasard sur un couple de chiens en train de bien faire j’avais reconsidéré la question et mis au point certains détails férocement tus par la pudibonderie familiale. J’avais été privé de ces petits camarades de collège qui sont, généralement, les initiateurs (pas toujours désintéressés) de leurs cadets. Je n’osais interroger mes frères, aussi tardifs que moi sur ce chapitre et victimes de cette éducation qui considérait comme « répugnante » toute confidence sexuelle, toute phrase trop précise » ; « mon ignorance était telle que je me suis longtemps représenté le sexe féminin, non pas dans le sens vertical, mais dans le sens horizontal, comme la bouche. À quelque chose malheur est bon, et cette candeur me mit à l’abri du vice solitaire, ce fléau contre lequel nous n’avions jamais été mis en garde » (p. 278).
Aspics du soir, je vous entends siffler
Bazin a des phrases superbes sur la puberté : « Mais les réveils matinaux, dont Victor Hugo a si bien parlé en vers [1], le poitrail de Madeleine, ces fuseaux des jambes d’enfants de Marie endimanchées montant vers on ne sait quoi sous la robe, cette démangeaison du bout des doigts qui demandent à palper comme des antennes et semblent vouloir ajouter quelque chose au sens tactile, cette sorte de faim – et c’en est une – qui part aussi du ventre et qui ne s’appelle pas encore le désir, toute une éruption de sentiments et de boutons, les premiers fournissant le pus des seconds, tout cela finit par avoir raison de moi. Aspics du soir, je vous entends siffler. Au nom de quoi faut-il vous taire ? » ; « Cette nouvelle vipère qui me grouillait dans le corps, il me fallait aussi l’étrangler » (p. 279). Voilà qui éclaire le double sens du titre : ne dit-on pas « étrangler le borgne » ? Le narrateur jette son dévolu sur Madeleine, la vachère, et ses intentions sont tout sauf romantiques : « Ce besoin naturel, car tu le penses tel, est-il donc si gênant de le faire à deux ? Tu voulais rester pur, idiot. Est-ce qu’on retient ses glaires lorsqu’on a envie de cracher ? L’hygiène publique a inventé les crachoirs comme Dieu a inventé les femmes. La pureté n’exige pas la rétention, mais l’exutoire » (p. 282). Le lien est explicite entre l’assouvissement de la sexualité et la vengeance : « Mais c’est aussi contre toi. Ne dis pas que cela n’a aucun rapport. Tu n’es qu’une femme, et toutes les femmes paieront plus ou moins pour toi. J’exagère ? Écoute… L’homme qui souille une femme souille toujours un peu sa mère. On ne crache pas seulement avec la bouche » (p. 285).
On apprécie la sincérité de ce premier roman qui ne tourne pas autour du pot de lait et de miel : « Madeleine n’était pas vierge et n’a d’ailleurs aucunement cherché à me le faire croire. […] Entre nous, j’ai bien tardé à enfoncer une porte ouverte, et ma victime a dû, depuis trois mois, me trouver assez godiche. […] Quant à moi, je m’étonne de ne pas être plus satisfait. L’opération n’est pas désagréable, j’en conviens. Mais, quand cette fille s’est relevée et m’a dit, en défroissant soigneusement sa robe : « Vous v’là content, pas vrai ? », eh bien, je me souviens d’avoir eu envie de la gifler. J’aurais voulu la voir pleurer, cette essoufflée ! Je me suis retenu, car je tiens à me la conserver quelque temps, faute de mieux. Mais qu’elle se surveille ! Je ne veux plus l’entendre murmurer, comme elle l’a fait en me quittant, presque tendre et les nichons écrasés contre ma poitrine : « Faut croire que j’ai bien de l’amitié pour toi, tu sais ! » […] Telle est la source de mon assurance. Je ne suis pas le petit jeune homme qui se touche. J’ai une fille à ma disposition, moi » (p. 290). Cette sincérité va de pair avec la conscience que Folcoche a empreint sa personnalité : « Quels sont du reste les qualités et surtout les défauts que je ne tienne pas d’elle ? Nous partageons tout, hormis le privilège de la virilité, que le Ciel lui a refusé par inadvertance et qu’elle usurpe allègrement. Il n’est aucun sentiment, aucun trait de mon caractère ou de mon visage que je ne puisse retrouver en elle » (p. 292). Après une opération digne du contre-espionnage (le narrateur tend un piège à Folcoche, qu’il espionne en train de dissimuler son propre portefeuille dans la chambre du garçon pour l’accuser de vol), le narrateur gagne la partie, et obtient pour lui-même et ses frères le sacrifice d’une éducation au collège. Il termine sur une terrible profession de foi : « Toute foi me semble une duperie, toute autorité un fléau, toute tendresse un calcul. Les plus sincères amitiés, les bonnes volontés, les tendresses à venir, je les soupçonnerai, je les découragerai, je les renierai. L’homme doit vivre seul. Aimer, c’est s’abdiquer. Haïr, c’est s’affirmer. Je suis, je vis, j’attaque, je détruis. Je pense, donc je contredis. Toute autre vie menace un peu la mienne, ne serait-ce qu’en respirant une part de mon oxygène. Je ne suis solidaire que de moi-même. Donner la vie n’a aucun sens si l’on ne donne pas aussi la mort : Dieu l’a parfaitement compris, qui a fait toute créature périssable » (p. 315).
Mon avis
Sexe et politique, toujours, dans ce livre qui prouve une fois de plus qu’un bon roman peut contenir des idées, contrairement à l’axiome de Proust exprimé dans Le Temps retrouvé (« Une œuvre où il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse la marque du prix »). On relèvera des pages où, à propos de ses parents (puisque le roman est amplement autobiographique), Bazin montre que leur haine du peuple est à l’origine de son engagement communiste contre eux. Relevons par exemple la p. 127, où est démonté le mécanisme de la condescendance : « le peuple (à prononcer du bout des lèvres comme « peu » ou même comme « peuh ! »), le peuple, cela se considère comme l’entomologiste étudie la termitière, en faisant des tranchées et des coupes, qui écrabouillent quelques insectes pour le plus grand bien de la science et de l’humanité ». Plus loin, c’est une profession de foi politique : « Le monde s’agite, il ne lit plus guère La Croix, il se fout des index et imprimatur, il réclame la justice et non la pitié, son dû et non vos aumônes ; il peuple les trains de banlieue qui dépeuplent ces campagnes asservies, il ne connaît plus l’orthographe des noms historiques, il pense mal parce qu’il ne pense plus vôtre, et pourtant il pense, il vit, infiniment plus vaste que ce coin de terre isolé par ses haies, il vit, et nous n’en savons rien, nous qui n’avons même pas la T.S.F. pour l’écouter parler, il vit, et nous allons mourir » (p. 273). Mais cette caresse vers les pauvres sent trop le revers de la gifle infligée à son propre milieu pour qu’on la prenne au sérieux. Non, le narrateur n’est guère passionné par le peuple ; il ne tente jamais de rien tirer des huit ou neuf abbés précepteurs qui se succèdent auprès de la fratrie, ni de la bonne muette, la seule qui résiste aux mauvais traitements de Folcoche, ni des autres humains vivant à côté de la propriété des Rezeau. On ne peut pas, du reste, lui reprocher de manquer de lucidité, et c’est précisément cette lucidité qui ne se paie pas de mots qui nous retient dans ce chef d’œuvre de la littérature de l’adolescence.
Adaptation cinématographique de Philippe de Broca
Je n’ai pas vu l’adaptation pour la télévision de 1971 par Pierre Cardinal, avec Alice Sapritch (voir ici), mais j’ai vu celle de Philippe de Broca pour le cinéma, son dernier film, sorti en 2004. Je craignais le pire, et pourtant j’ai été séduit par un des meilleurs films de ce cinéaste. Acteurs parfaits (Catherine Frot, Jacques Villeret dans un de ses derniers rôles, etc., sans oublier une rare apparition de Macha Béranger dans le rôle de la mère de Folcoche). Certes l’adaptation altère énormément le sens du livre, mais n’est-ce pas la marque d’une bonne adaptation, encore plus quand elle n’est pas la première ? Le film était présenté par la veuve du réalisateur, lors de la rétrospective de la cinémathèque en mai 2015, et elle a expliqué qu’il s’agissait d’une commande. De Broca avait d’abord refusé, sous prétexte qu’ayant adoré sa mère, il se sentait incapable de filmer un tel personnage. Il s’en est sorti en trouvant dans d’autres écrits de Bazin des éléments d’une sorte de réhabilitation de la mère et même du père, en chargeant les grands-parents paternels de la responsabilité de la personnalité de Folcoche. Cela est d’autant plus compréhensible que la question du rapport avec les parents est sans doute la plus émouvante et personnelle qui soit. Que Bazin, le principal intéressé, ait réglé des comptes avec ses parents dans ce livre écrit jeune est une chose ; mais on comprend qu’un cinéaste âgé, qui n’a aucun compte à régler avec ses parents, souhaite mettre de la distance avec ce règlement de compte. Du coup, effectivement, le sens n’est plus le même, et c’est vraiment une œuvre originale de Philippe de Broca qui porte le même titre. Le rôle de la sexualité a également fait les frais de l’adaptation. D’une part on a ôté le personnage de Madeleine, d’autre part, c’est la bonne sourde qui fait office d’initiatrice, et encore, du bout des doigts. On sent que le créneau film pour enfants ou pré-ados a poussé les producteurs à éviter le sujet. C’est là aussi dommage, car du coup le titre n’a plus guère de sens sans la métaphore sexuelle. Mais encore une fois, c’est un beau film émouvant et superbement joué, sur le thème de la parentalité.
– On fera un rapprochement éclairant avec un livre paru en 1945, Black boy, de Richard Wright. Je pense à la scène du chapitre I dans laquelle le petit Richard tue un chat pour mettre en faute son père qui lui a dit de le tuer dans un moment d’énervement. Lire aussi Un Barrage contre le Pacifique, de Marguerite Duras, pour retrouver une mère tant soit peu dénaturée.
– Dans la même veine du « désamour maternel », voir sur le blog de l’ami Robert Vigneau cet article.
– Lire l’article de La petite Mu qui plume.
Voir en ligne : Fonds Hervé Bazin, bibliothèque universitaire d’Angers
© altersexualite.com 2015
Retrouvez l’ensemble des critiques littéraires jeunesse & des critiques littéraires et cinéma adultes d’altersexualite.com. Voir aussi Déontologie critique.
[1] Allusion au célèbre vers « Quand on est jeune, on a des matins triomphants » extrait de « Booz endormi ».
 altersexualite.com
altersexualite.com